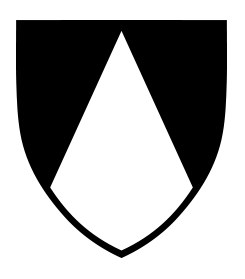Saint Thomas d’Aquin († 1274)
 Dans La Divine Comédie, Dante se décrit marchant à travers le paradis et rencontrant deux dominicains. L’un présente l’autre et se présente lui-même: « A droite, ici, mon plus proche voisin a été pour moi un maître fraternel, c’est Albert de Cologne. Et moi, je suis Thomas d’Aquino. »
Dans La Divine Comédie, Dante se décrit marchant à travers le paradis et rencontrant deux dominicains. L’un présente l’autre et se présente lui-même: « A droite, ici, mon plus proche voisin a été pour moi un maître fraternel, c’est Albert de Cologne. Et moi, je suis Thomas d’Aquino. »
Au Moyen Âge, c’est cette image qui se présentait à l’esprit quand on évoquait Albert et Thomas. La relation entre le maître et l’élève débuta en 1248, lorsque Thomas d’Aquin, âgé d’environ vingt-trois ans, fut transféré au couvent d’études de Cologne. Les dirigeants de l’ordre avaient jugé nécessaire ce transfert – inhabituel – pour faire échapper le jeune homme à la colère de son père, le comte d’Aquino. La famille de Thomas l’avait destiné à l’état de clerc, l’avait fait élever chez les bénédictins du Mont-Cassin et l’avait envoyé à Naples pour un complément d’études mais lorsqu’il entra au noviciat du couvent des prêcheurs qui s’y trouvait, il fut en butte à la résistance de ses parents qui avaient imaginé tout autrement pour lui une » carrière ecclésiastique « . Aussi fut-il, dès que l’occasion s’en présenta, » kidnappé » par ses frères aînés et retenu, sans autre cérémonie, dans le château familial où l’on espérait le détourner de son projet. On ne lui rendit la liberté qu’au bout d’un an. Les supérieurs l’envoyèrent aussitôt hors d’Italie, peut-être à Paris pour y étudier, mais probablement tout de suite à Cologne.
De bonne heure, Albert le Grand a reconnu publiquement les qualités scientifiques de son élève. En fait foi une de ces anecdotes qui furent si répandues sur les débuts de l’ordre: Thomas, silencieux et réservé, avait été surnommé par ses camarades d’étude le » boeuf muet » (c’était aussi une allusion à sa stature vigoureuse). Lorsque Albert arriva à Cologne, il visita les cellules des étudiants et dans l’une d’elles trouva un écrit qui dénotait une application savante. » Qui habite là – » demanda-t-il. On lui répondit que c’était le boeuf muet. Il déclara: » Un jour il mugira si fort que par lui la chrétienté s’enrichira en science et en doctrine. «
Albert trouva bientôt l’occasion de connaître Thomas de plus près et c’est lui qui recommanda le jeune bachelier à la faculté de Paris et l’imposa, malgré quelques résistances. Tout comme l’avait fait son maître quelques années plus tôt, Thomas, de 1252 à 1255, fit des cours sur les Sentences de Pierre Lombard et, une fois maître en théologie (en 1256), fut chargé de l’une des deux chaires de théologie. Tout comme pour Albert, de ces années d’activité date une série d’oeuvres : son Commentaire des sentences, De l’existence et de l’essence (ouvrage philosophique capital de sa jeunesse), des chapitres de la Somme contre les gentils. Et enfin, tout comme Albert après avoir enseigné à Paris s’en revint en Allemagne, Thomas quitta Paris pour l’Italie, non pas tout d’abord comme professeur dans un centre d’étude de l’ordre, mais comme conseiller théologique auprès du pape Urbain IV à Orvieto. Là il put continuer à écrire, achever la Somme contre les gentils, rédiger ses commentaires sur l’épître aux Romains et sur la première épître aux Corinthiens. Mais la plus populaire de ces oeuvres datant d’Orvieto fut le texte de l’Office du Saint Sacrement, qu’Urbain IV lui demanda de composer pour la Fête-Dieu qu’il venait d’étendre à toute l’Église: on y trouve les deux hymnes Pange lingua et Adoro te devote qui ne sont pas seulement une glorification du sacrement de l’autel, mais aussi l’expression de la vénération personnelle de Thomas pour l’eucharistie. Cette piété eucharistique, un de ses premiers biographes, Guillaume de Tocco, y insiste particulièrement: » Tous les jours, si la maladie ne l’en empêchait pas, il célébrait la messe; il en entendait une seconde, de l’un ou l’autre de ses frères et il la servait très souvent. Parfois il semblait saisi pendant la messe d’un abandon à Dieu si puissant qu’il fondait en larmes, tant il était consumé par les saints mystères d’un si grand sacrement et réconforté par ses dons. «
Pourtant, le style de Thomas dAquin est plutôt, dans ses écrits, impassible et distant; et c’est ainsi qu’il se montrait aussi lorsqu’il était personnellement en question, par exemple lors des attaques menées par l’université de Paris contre les ordres qu’on appelait » mendiants » (franciscains et dominicains) alors qu’il enseignait à Paris : car le maître de l’ordre l’avait, en 1269, appelé pour la seconde fois à occuper cette chaire (entretemps il était allé à la cour pontificale de Clément IV). Dans un premier écrit, déjà, il avait soutenu le droit des ordres mendiants à enseigner dans les facultés de théologie. Dans la deuxième partie de son oeuvre maîtresse, la Somme théologique, il aborda à nouveau la question et s’efforça d’y répondre en théologien, posant ainsi pour la spiritualité dominicaine des bases qui sont restées valables jusqu’à nos jours : » Si la contemplation de Dieu en soi et pour soi, dans la vie contemplative, est la plus haute forme de vie chrétienne puisqu’elle est celle qui approche de plus près la vision de Dieu dans l’éternité, d’autre part l’amour du prochain a une valeur particulière, selon l’exemple de l’amour de Jésus-Christ pour l’homme sur la terre. Car, tout comme Jésus-Christ vivait dans la contemplation constante de Dieu le Père et, en même temps, en tant qu’homme, était au service des hommes, de même le chrétien doit vivre à la fois dans l’amour de Dieu et du prochain, dans la contemplation de Dieu et dans les oeuvres de miséricorde. » Les oeuvres de miséricorde découlent de la contemplation aimante de Dieu et y ramènent; parmi elles, les théologiens médiévaux donnaient une grande place à l’enseignement religieux et à la prédication. C’est particulièrement valable pour les prêcheurs qui doivent transmettre à leurs contemporains le fruit de leur contemplation : contemplata aliis tradere, ces mots sont restés leur devise.
Saint Thomas lui-même a vécu de cette façon, selon son biographe Guillaume de Tocco : » Chaque fois qu’il avait dessein d’étudier, de commenter, de faire un cours, d’écrire ou de dicter, il commençait par prier dans le secret. En priant, il demandait de pouvoir découvrir sans erreur les secrets de Dieu. Et lorsque avant de prier il avait eu encore un doute dans sa recherche, il revenait à son travail instruit par la prière. » On a conservé une lettre du saint à un novice de l’ordre ; elle nous en dit plus sur lui-même que de longs traités: » Montre-toi vraiment affable envers tous. Ne te soucis pas de ce que les autres font ou ne font pas. Ne te fie pas trop à qui que ce soit: montrer trop de confiance nous fait dédaigner et détourne de l’étude […]. Ne t’inquiète pas de qui tu as entendu quelque chose: mais ce que tu as entendu de bon, grave-le dans ta mémoire. Donne-toi la peine de comprendre à fond tout ce que tu lis et entends. «
Lorsque, en 1272, Thomas retourna en Italie pour prendre la direction du studium de l’ordre à Naples, il se consacra surtout à achever sa Somme théologique, qui devait rester pendant des siècles le manuel des étudiants en théologie. Il en avait terminé la deuxième partie à Paris, où il avait aussi composé les volumineux commentaires sur l’Éthique et la Métaphysique d’Aristote.
Mais son oeuvre capitale devait rester inachevée. En se rendant au concile de Lyon, il tomba gravement malade et se fit conduire à l’abbaye cistercienne de Fossanova dans le Latium. Les moines le soignèrent de leur mieux, l’installèrent dans la cellule de l’abbé, firent venir du bois de la forêt pour le chauffer. Déjà près de sa fin, à la prière des moines qui entouraient son lit, il leur commenta le Cantique des Cantiques, car, remarque Guillaume de Tocco, » son âme n’abandonnait pas l’indispensable activité de l’enseignement […]. Et il était fort à propos que le maître, avant de sortir de la prison de son corps, achevât son étude de la sagesse par le cantique de l’amour entre l’Aimé et l’aimée, si bien qu’ayant fondé toutes ses connaissances sur Dieu, il parvint aussi dans la joie aux embrassements de l’Aimé « . Thomas mourut là, à Fossanova, le 7 mars 1274.
(Source : Hertz, Anselm. Nils Loose, Helmuth. Dominique et les dominicains. Cerf, 1987.)