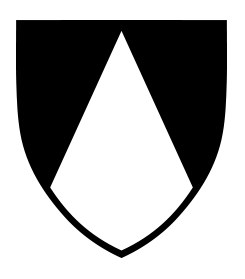Vie de saint Dominique de Guzman
1. Enfance et jeunesse en Castille
 Comme nombre de vies de saints médiévaux, l’histoire de Dominique commence par une légende. Jourdain de Saxe, le successeur du fondateur dans la charge de maître de l’Ordre, écrit dans son » petit livre » sur les débuts des prêcheurs que la mère de Dominique avait eu une vision: » Il lui semblait porter en son sein un petit chien, qui tenait en sa gueule une torche enflammée, puis, sortant du ventre maternel, paraissait embraser le monde entier « , et quelques pages plus loin, à propos d’une autre vision: » Sa mère le vit portant la lune [suivant un autre texte: « une étoile »] sur le front: ce qui signifiait évidemment qu’il serait un jour donné comme lumière des nations, pour illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l’ombre de la mort. «
Comme nombre de vies de saints médiévaux, l’histoire de Dominique commence par une légende. Jourdain de Saxe, le successeur du fondateur dans la charge de maître de l’Ordre, écrit dans son » petit livre » sur les débuts des prêcheurs que la mère de Dominique avait eu une vision: » Il lui semblait porter en son sein un petit chien, qui tenait en sa gueule une torche enflammée, puis, sortant du ventre maternel, paraissait embraser le monde entier « , et quelques pages plus loin, à propos d’une autre vision: » Sa mère le vit portant la lune [suivant un autre texte: « une étoile »] sur le front: ce qui signifiait évidemment qu’il serait un jour donné comme lumière des nations, pour illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l’ombre de la mort. «
Son père était Félix de Guzmân. Sa mère, Jeanne, appartenait à la lignée des Aza : les deux familles faisaient partie de la noblesse castillane et possédaient de grandes propriétés foncières dans les environs, proches et lointains, de Caleruega. Ce lieu, que Jourdain qualifie de » village « , a gardé jusqu’aujourd’hui son aspect rural, bien qu’un couvent de dominicaines contemplatives s’y trouve depuis le milieu du XIIIe siècle et qu’un couvent de dominicains, plus tard, y ait été érigé à côté du donjon seigneurial ou torreon. Caleruega est situé, en effet, à l’écart des grandes voies de circulation, sur ce plateau castillan où règnent, selon un dicton populaire, » neuf mois d’hiver et trois mois d’enfer « , tant l’été y est sec et brûlant.
Dominique est né dans cette tour fortifiée, le torreon, en 1170 ou 1171. De sa famille, de son enfance, nous savons bien peu de choses sinon qu’il eut plusieurs frères, dont l’un devait entrer dans l’ordre des prêcheurs. L’hagiographie du Moyen Age ne s’intéressait guère au développement historique; alors que nous cherchons à analyser un homme d’après ce qu’il a vécu dans son enfance, les écrivains de ce temps se contentaient de quelques légendes destinées à faire voir que le » héros » futur, enfant, se comportait déjà en héros.
Toujours est-il que nous savons, d’après des sources anciennes, que dès l’âge de cinq ans l’enfant fut confié à un oncle archiprêtre, chargé de faire son éducation. On peut donc penser que sa famille le destinait à l’état clérical. Cette orientation, à l’époque, allait autant de soi qu’aujourd’hui une préparation au métier d’avocat ou à celui de médecin. En outre, à la fin du XIIe siècle, la Castille avait grand besoin de vocations ecclésiastiques et monastiques : au cours des siècles passés, la région au nord du Douro était tombée à plusieurs reprises sous la domination de l’islam, et elle ne fut définitivement reconquise qu’au début du XIIe siècle par les comtes de Castille.
C’est dans ce climat que grandit Dominique, et ce climat marqua sans aucun doute certains traits de son caractère, certaines façons qu’il eut de se comporter: son absence de timidité devant les princes, les cardinaux, les papes (alors même qu’il se tenait devant eux en habit taché et en sandales), son autorité naturelle à l’égard de ses frères, sans jamais avoir besoin de se faire violence, enfin et surtout sa piété austère qui n’avait rien de sentimental.
Jourdain et les biographes qui sont venus après lui se sont surtout intéressés à un épisode de sa vie d’étudiant. Voici comment Jourdain le raconte: » Au temps où il poursuivait ses études à Palencia , une grande famine s’étendit sur presque toute l’Espagne. Ému par la détresse des pauvres et brûlant de compassion, il résolut par une seule action d’obéir à la fois aux conseils du Seigneur et de soulager de tout son pouvoir la misère […]. Il vendit donc les livres qu’il possédait, pourtant vraiment indispensables, et toutes ses affaires. Constituant alors une aumône [c’est-à-dire une fondation charitable], il dispersa ses biens et les donna aux pauvres. » Le frère Étienne qui déposa au procès de canonisation ajoute que Dominique avait dit: » Je ne veux pas étudier sur des peaux mortes tandis que des hommes meurent de faim. «
2. Chanoine à Osma
 En outre, le geste charitable de Palencia contribua à orienter la destinée de Dominique. Diego, prieur du chapitre cathédral de la ville d’Osma, entendit parler de lui et, au nom de l’évêque, l’invita à entrer dans ce chapitre comme chanoine régulier. Une grande partie des domaines des familles Guzman et Aza se trouvait dans les limites du diocèse, mais en l’occurrence, ni la naissance ni les biens n’entraient en ligne de compte l’évêque et son prieur ne voulaient, comme chanoines, que des clercs disposés à travailler à la réforme du chapitre. Cette réforme avait été inaugurée par les évêques précédents, qui avaient soumis les chanoines à la règle de saint Augustin: mais après quelques premiers succès ce début de réforme en était au point mort.
En outre, le geste charitable de Palencia contribua à orienter la destinée de Dominique. Diego, prieur du chapitre cathédral de la ville d’Osma, entendit parler de lui et, au nom de l’évêque, l’invita à entrer dans ce chapitre comme chanoine régulier. Une grande partie des domaines des familles Guzman et Aza se trouvait dans les limites du diocèse, mais en l’occurrence, ni la naissance ni les biens n’entraient en ligne de compte l’évêque et son prieur ne voulaient, comme chanoines, que des clercs disposés à travailler à la réforme du chapitre. Cette réforme avait été inaugurée par les évêques précédents, qui avaient soumis les chanoines à la règle de saint Augustin: mais après quelques premiers succès ce début de réforme en était au point mort.
Ce qui faisait surtout problème pour ces chanoines, c’était de s’astreindre à une vie commune et de renoncer à toute propriété personnelle. Ils étaient, en majorité, issus de la noblesse habituée à jouir de possessions foncières, ce renoncement leur était donc particulièrement pénible. D’ailleurs, dans d’autres chapitres de cathédrale, ces prescriptions n’avaient pas été promulguées et ils ne voyaient pas pourquoi il en serait autrement pour eux, à Osma. Des chanoines d’origine noble, appelés au chapitre à l’instigation de puissants barons, menaient un train de vie personnel et considéraient comme bien privé leur part des prébendes de l’Eglise : ils avaient même le droit d’en disposer par testament. Cette question avait une importance économique. De tels legs, parfois en faveur de la famille du testateur, morcelaient les biens d’Eglise qui non seulement faisaient vivre l’évêque et le chapitre, mais devaient permettre l’édification de lieux de culte, d’hôpitaux, d’hospices. Pour pouvoir subvenir à de telles dépenses, les évêques devaient s’opposer aux prétentions de leurs chanoines.
 C’est pourquoi le prieur Diego d’Acevedo (ou Diègue d’Acébès) cherchait des clercs prêts à suivre la règle augustinienne. Un étudiant en théologie vendant tout ce qu’il possédait pour nourrir des affamés serait assurément mieux disposé à la vie canoniale réformée, que quelque dignitaire ecclésiastique de haute naissance qui se faisait attribuer une part des biens d’Église sans vouloir nullement renoncer à ses possessions privées.
C’est pourquoi le prieur Diego d’Acevedo (ou Diègue d’Acébès) cherchait des clercs prêts à suivre la règle augustinienne. Un étudiant en théologie vendant tout ce qu’il possédait pour nourrir des affamés serait assurément mieux disposé à la vie canoniale réformée, que quelque dignitaire ecclésiastique de haute naissance qui se faisait attribuer une part des biens d’Église sans vouloir nullement renoncer à ses possessions privées.
Quant à la vie commune, elle cherchait son modèle dans la vie que Jésus avait menée en commun avec ses apôtres. Un tel esprit était loin de certains chanoines qui tenaient à conserver un mode de vie individuel. Dans sa biographie, très complète, de saint Dominique, le Père M. H. Vicaire, o.p., a bien montré que le chanoine, à cette époque, était appelé à une vie de prière, souvent plus contemplative que celle des moines qui, dans les abbayes, à côté des tâches multiples (travaux des champs, écoles) assuraient aussi des charges pastorales. L’office chanté quotidien, la prière commune des heures, la méditation et la lecture spirituelle en cellule traçaient pour le chanoine régulier un cadre où pouvait s’épanouir la contemplation. Le jeune Dominique en fut imprégné, en conserva l’esprit jusqu’à sa mort et, lorsqu’il fonda l’ordre des prêcheurs, en fit la base de la vie religieuse.
Il pouvait avoir vingt-trois ou vingt-quatre ans lorsqu’il reçut la robe blanche et le manteau noir des chanoines réguliers de Saint-Augustin: ce vêtement, un peu simplifié, serait plus tard celui des dominicains. Après un an de probation, il fit profession dans le chapitre, puis, peu de temps après, fut ordonné prêtre. Sur ses activités au chapitre d’Osma, nous sommes relativement bien informés. Nous savons qu’il lisait avec prédilection les Conférences des Pères du désert du moine italien Jean Cassien : ce livre consacré aux anachorètes africains servit à alimenter la vie spirituelle de générations de chanoines et de moines au Moyen Age. Tel fut le cas de Dominique, et Jourdain note que ce livre, » avec le concours de la grâce, le fit parvenir à un degré difficile à atteindre de pureté de conscience, à beaucoup de lumière sur la contemplation et à un grand sommet de perfection « .
Manifestement, il eut aussi à l’occasion un rôle de prédicateur dans la cathédrale d’Osma. Il y fut » sacristain « , c’est-à-dire chargé de tout ce qui concernait le culte, et, en 1201, âgé de vingt-huit ans environ, il était sous-prieur du chapitre. Pour cette charge, on choisissait volontiers de jeunes membres, afin que, d’une part, leur dynamisme donnât à la communauté une impulsion nouvelle et, d’autre part, afin de les » tester « , c’est-à-dire vérifier s’ils pouvaient faire leurs preuves dans un poste de direction. L’influence du prieur Diego a dû jouer aussi dans ce choix de Dominique qui était » sa découverte » ; en outre, une amitié unit très tôt ces deux hommes, le jeune et le plus âgé, amitié forgée dans leurs communs efforts pour réaliser la réforme du chapitre.
En décembre 1201, Diego fut nommé évêque d’Osma. Pour lui succéder dans la charge de prieur, Dominique était assurément encore trop jeune. Mais il est permis de penser que quelques années plus tard, cette charge lui aurait été confiée, préparant peut-être – comme il en avait été pour Diego – une élévation à l’épiscopat. En fin de compte, tout devait se passer autrement, mais ni Diego ni Dominique ne pouvaient le prévoir.
3. Prédicateur dans le Midi de la France
 L’occasion qui devait profondément modifier l’orientation de la vie de Dominique se trouva dans les deux voyages qu’il fit pour accompagner jusqu’au Danemark son évêque, Diego. Un mariage était projeté entre l’héritier du trône de Castille (un frère de Blanche de Castille qui venait d’épouser Louis de France) et une parente du roi de Danemark: l’évêque était chargé de négocier la conclusion de ce mariage. Ces voyages, en 1203 et 1205, représentèrent un tournant décisif dans la vie de ces deux hommes.
L’occasion qui devait profondément modifier l’orientation de la vie de Dominique se trouva dans les deux voyages qu’il fit pour accompagner jusqu’au Danemark son évêque, Diego. Un mariage était projeté entre l’héritier du trône de Castille (un frère de Blanche de Castille qui venait d’épouser Louis de France) et une parente du roi de Danemark: l’évêque était chargé de négocier la conclusion de ce mariage. Ces voyages, en 1203 et 1205, représentèrent un tournant décisif dans la vie de ces deux hommes.
S’étant rendu ensuite auprès du pape Innocent III, Diego lui demanda de l’autoriser à quitter l’évêché d’Osma, car il voulait s’en aller comme missionnaire auprès des Cumans, un peuple encore païen qui habitait l’est de la Hongrie. Dominique ne connaissait pas seulement l’intention de son ami, il la partageait. Plus tard, il évoquait encore le désir (en 1219, puis en 1221 peu avant sa mort) d’aller évangéliser les païens de Prusse et de Scandinavie. Cet élan missionnaire était à l’époque largement répandu. Il s’est traduit par les tentatives de reconquête de régions du bassin méditerranéen autrefois chrétiennes et tombées au pouvoir de l’islam, par les croisades vers la Terre sainte, par la Reconquista de l’Espagne. Mais plus que la croisade, l’intention missionnaire était liée à l’idée qu’on avait de la perfection chrétienne: il s’agissait d’imiter les apôtres et de se préparer à un martyre dont l’éventualité était très vraisemblable. Le consentement à donner jusqu’à sa vie se trouve aussi dans certains ordres fondés alors pour le rachat des captifs chrétiens: on s’y engageait à se faire prisonnier volontaire des Sarrasins en échange d’un chrétien réduit par eux en esclavage.
Mais le pape ne voulut pas libérer l’évêque d’Osma pour la mission. Il ne le pouvait pas: le diocèse avait besoin d’un évêque réformateur. Et Innocent III était trop sage politique pour abandonner un but proche, réalisable, en faveur d’un but lointain, aux contours vagues et au succès incertain: aussi renvoya-t-il Diego à Osma. Mais il ne pouvait empêcher Diego et Dominique d’être angoissés par un autre problème: la situation précaire de l’Église dans le midi de la France. Dès leur premier voyage au Danemark, ils s’étaient émus du mouvement religieux des cathares qui, depuis quelques dizaines d’années, s’était étendu sur de larges territoires de la France méridionale et de l’Italie du Nord, et se propageait même en Flandre et en Rhénanie. Jourdain relate une discussion, à Toulouse, entre Dominique et un cathare qui tenait l’auberge où s’étaient arrêtés l’évêque et son sous-prieur: » Au cours de la nuit […] le sous-prieur attaqua avec force et chaleur l’hôte hérétique de la maison, multipliant les discussions et les arguments […]. L’hérétique ne pouvait résister à la sagesse et à l’esprit qui s’exprimaient […] ; Dominique le réduisit à la foi. » Il ne soupçonnait pas encore que de tels affrontements deviendraient la tâche de sa vie.
Sur le chemin du retour, en juin 1206, Diego et Dominique rencontrèrent à Montpellier trois légats pontificaux chargés par Innocent III de combattre les hérésies des cathares et des vaudois. Cette rencontre devait avoir, pour tous ceux qui y participèrent, de grandes conséquences.
Malgré tout ce qu’on a écrit (et peut-être à cause de tout ce qu’on a écrit) sur les cathares, il est bien difficile de se faire une idée précise de leurs origines, qui sont diverses, et des nuances de leurs convictions. Nous n’en dirons que quelque mots, pour éclairer les motifs qu’il y eut d’y voir une hérésie, en face de la foi de l’Église. Les cathares se faisaient du monde une image dualiste. Pour eux, il y avait eu une création bonne et une mauvaise, ce qui produisait une opposition entre l’esprit et la chair, entre l’âme et le monde. Ils retrouvaient cette opposition dans la Bible: le Dieu bon est celui de l’Évangile, le Dieu mauvais, celui de l’Ancien Testament. Comme beaucoup de religions dualistes, celle-ci avait été influencée par la gnose: elle imaginait des degrés, nettement séparés entre eux, dans la connaissance et la perfection. Certains groupes croyaient aussi à la métempsycose, à la réincarnation des âmes. Pour être finalement libérés de la puissance du mal, du monde, les croyants devaient renoncer à presque toutes les nécessités terrestres,. pratiquer l’abstinence sexuelle, abandonner toute propriété privée. Cette ascèse qu’ils pratiquaient dans leur vie impressionnait les populations. Alors même que seul un petit nombre de » purs « , de » parfaits « , parvenait au plus haut degré de la connaissance, le nombre des adeptes et sympathisants augmentait constamment.
Dans la vie spirituelle, un rôle particulier était joué par le consolamentum : une imposition des mains qui dispensait au fidèle l’Esprit Saint, lui donnait l’assurance d’entrer dès sa mort dans la béatitude éternelle. A l’origine, ce consolamentum n’était accordé qu’aux » parfaits « , mais on était venu à l’accorder aux simples croyants à l’heure de la mort. Des nobles, de riches bourgeois entretenaient donc chez eux un parfait pour recevoir de lui cet ultime secours et pouvaient en attendant continuer leur vie sans se soucier de perfection: cela rappelle un peu l’époque constantinienne où beaucoup de catéchumènes attendaient d’être sur leur lit de mort pour recevoir le baptême.
Le mouvement vaudois, qui tient son nom du commerçant lyonnais Pierre Valdo (ou Valdès) ne cherchait aucune complication sur le plan du dogme. Au début, il était orienté vers la recherche de la pauvreté évangélique dans la conduite de la vie. Mais quand les vaudois commencèrent à prêcher cette pauvreté évangélique, ils entrèrent en conflit avec les autorités ecclésiastiques. En 1184, au synode de Vérone, Valdo fut excommunié. Des prédicateurs libres se répandirent alors, ayant rompu tout lien avec la hiérarchie de l’Église et ne faisant plus de différence entre clercs et laïcs. Ce qui qualifiait pour prêcher n’était plus l’ordination, mais la conscience apostolique et la pauvreté de vie: les prédicateurs renonçaient à posséder quoi que ce soit, ils devaient vivre d’aumônes. Mais par la force des choses une certaine organisation se créa: on distingua les prédicateurs tenus à la pauvreté évangélique et les simples croyants, qui se comportaient comme des élèves à l’égard de leurs maîtres.
Cette pauvreté dont faisaient preuve les vaudois et les cathares fit rapidement une très forte impression dans les populations, qui comparaient leur comportement avec le mode de vie du clergé et surtout des hauts dignitaires de l’Église. Dans le midi de la France, le clergé n’était sans doute ni pire ni meilleur que dans les autres régions du pays, mais cette comparaison l’exposait à la critique, et celle-ci alla croissant. En outre, la petite noblesse méridionale était moins fortunée que les riches abbayes, et les partages d’héritage l’appauvrissaient encore: chez ces possesseurs de terres, l’équilibre économique était menacé. Parmi ces nobles il y avait, en ce début du XIIIe siècle, des lignées de cathares de deux ou trois générations. Ils faisaient élever leurs filles dans des écoles dirigées par des cathares, leurs parentes célibataires vivaient dans des » couvents » cathares où la vie était plus ascétique, la règle plus sévère que dans maints monastères féminins de l’Église.
Devant les progrès des cathares et des vaudois, les réactions ecclésiastiques se bornèrent d’abord à des mesures juridiques; elles n’eurent le plus souvent quelque succès que dans les diocèses où les hérétiques étaient en minorité: ceux-ci furent alors refoulés dans la clandestinité. Mais dans les régions où les deux sectes avaient, relativement, de nombreux adhérents, comme dans le diocèse d’Albi, ces mesures restèrent sans effet. La ville d’Albi était une forteresse cathare, et l’évêque n’osait pas sévir ouvertement contre les hérétiques, car il y en avait plusieurs dans sa propre famille; il évita toute contestation avec eux, il n’en parlait pas dans les rapports qu’il envoyait au pape. D’autres évêques, qui avaient entrepris de lutter en face contre les doctrines cathares, durent affronter la noblesse, le comte Raimond de Toulouse par exemple, ou la bourgeoisie des villes qui se souleva contre eux: ils furent expulsés de leur siège ou même assassinés.
Innocent III, pape depuis 1198 (il avait alors trente-sept ans), s’était empressé d’envoyer des légats pour lutter contre l’hérésie. Il lui opposait l’antique loi de lèse-majesté, car les hérétiques s’attaquaient à la majesté de Dieu même: sévir contre eux devenait un acte politique. Mais ni les deux premiers légats ni les suivants n’obtinrent de résultats. Les deux légats nommés en 1203 étaient des moines cisterciens: Pierre de Castelnau et Raoul de Fontfroide, tous deux originaires du Midi et connaissant de visu la situation. Ils obtinrent de quelques féodaux la promesse de ne plus user de violence contre les établissements d’Église, et un capitoul (magistrat municipal) de Toulouse prêta à l’Église serment de fidélité mais lorsque les légats exigèrent qu’on expulsât de la ville les hérétiques, ils se heurtèrent à l’opposition des bourgeois. Ils eurent des rapports difficiles avec l’archevêque de Narbonne, qui résista à leur menace de censure et qui, loin de se décider à combattre l’hérésie, se plaignit à Rome de ces légats qui, disait-il, excédaient leurs pouvoirs. En 1204, le pape désigna comme troisième légat l’abbé de Cîteaux, Arnaud Amaury, et donna aux trois légats de pleins pouvoirs que ceux-ci s’empressèrent d’utiliser.
Cependant, des mesures de droit canon ne pouvaient résoudre la question essentielle: comment ramener à l’Église la population qui l’avait abandonnée – Innocent III, qui voyait parfaitement la situation, insistait dans ses instructions aux légats sur la nécessité de regagner le peuple. Il en revint au plan qu’avait eu auparavant saint Bernard: combattre l’hérésie par la prédication. Le pape enjoignit donc aux légats d’envoyer dans le Languedoc des prédicateurs cisterciens. Mais il semble que cette injonction ait dépassé les moyens des légats. Ils s’efforcèrent bien d’obtenir comme prédicateurs des frères de leur ordre; eux-mêmes, à diverses reprises, prêchèrent au peuple. Mais leur comportement de légats pontificaux, à cheval, suivis d’un train de serviteurs, les exposait aux critiques et aux railleries des masses populaires qui le comparaient au mode de vie des prédicateurs cathares et vaudois.
Innocent voyait bien le problème. Il leur écrivit: » Nous voulons et nous vous exhortons à procéder de telle sorte que la simplicité de votre attitude, manifeste aux yeux de chacun, ferme la bouche aux ignorants comme aux gens dépourvus de bon sens, et que rien dans votre action ni dans vos paroles n’apparaisse, que même un hérétique soit capable de cri tiquer. » Mais devant les seigneurs féodaux et les évêques, il fallait bien que des légats soient vus comme des ambassadeurs du pape ! Leur enjoindre de troquer ce rôle contre celui d’un simple prêtre annonçant la Parole de Dieu, c’était, probablement, trop leur demander.
Telle était la situation religieuse dans le midi de la France lorsque eut lieu à Montpellier la rencontre entre, d’une part, l’évêque d’Osma et Dominique, et, d’autre part, les légats qui tenaient conseil avec d’autres cisterciens. C’était en juin 1206 et, selon la tradition dominicaine, cette date représente la naissance précise de l’ordre des prêcheurs. Cette vue est assez exacte, bien qu’elle ne soit révélée telle que rétrospectivement. Le conciliabule entre les légats, l’évêque Diego et Dominique envisagea certainement de façon très complète les moyens de ramener le peuple à la foi de l’Église, et Diego en vint à cette déclaration essentielle: » Il me semble impossible de ramener à la foi par des paroles seules des hommes qui s’appuient avant tout sur des exemples. » C’était dire: la prédication ne sera efficace que si les prédicateurs vivent ce qu’ils proclament. Certes la doctrine des cathares, mélange de cosmogonies hétérogènes et de spéculation gnostique, pouvait être disqualifiée, mais, subjectivement, la façon dont vivaient les parfaits inspirait confiance. Il en était de même du comportement des vaudois.
Jourdain de Saxe fait bien ressortir ce lien entre la prédication et la vie personnelle. Renonçant à placer dans la bouche de Diego un beau dis cours sur la pauvreté des apôtres, il le montre faisant tout aussitôt un premier pas, après avoir répondu aux légats qui l’interrogeaient: » Faites ce que vous me verrez faire ! » Et » envahi par l’esprit du Seigneur, il appelle les siens, les renvoie à Osma avec son équipage, son bagage et divers objets d’apparat qu’il avait emportés avec lui […] « . Il ne garda que quelques clercs, dont évidemment Dominique. Les légats et les abbés cisterciens qui étaient présents suivirent son exemple. Sous sa conduite, le petit groupe se dirigea, à pied, vers les régions où les hérétiques étaient nombreux.
Estimant qu’un geste aussi spontané était surprenant, certains historiens supposent que Diego avait reçu, au moins indirectement et globalement, l’accord préalable du pape pour cette recherche de moyens d’action nouveaux. Il se peut aussi que le pape lui ait ensuite donné par écrit son approbation et ses encouragements. On peut supposer qu’au début tous les participants à cette mission de prédication pensaient que ce serait une entreprise unique et de courte durée. Les trois légats ne pouvaient guère cheminer à pied durant des mois à travers les villages, et Diego devait retourner dans son diocèse. L’abbé de Cîteaux, Arnaud – le troisième légat – repartit d’ailleurs pour présider le chapitre de son ordre et trouver à cette occasion quelques prédicateurs cisterciens.
Nous ne savons pas bien quelle idée se faisait le groupe de son activité de prédication, ni quels résultats concrets il en attendait. Le savait-il lui-même ? L’entreprise était inhabituelle, on ne pouvait s’appuyer sur des précédents. Les premières expériences des légats avaient été négatives. L’accueil fut très différent selon les endroits. En pleine terre cathare, il ne fut pas précisément amical. Des rencontres contradictoires avec les cathares influents attirèrent une grande affluence. Dans la petite ville de Servian, près de Béziers, la discussion dura plus d’une semaine. A Béziers même, plus de quinze jours. Quel fut l’effet de ces disputes et de ces prêches, les sources n’en disent rien de précis. Il n’y eut pas de conversions en masse: on ne pouvait guère en attendre. Mais on put penser qu’il y avait quelque chose de gagné, quand on vit les habitants de Servian, dont l’accueil avait été réservé ou franchement hostile, accompagner au départ les prédicateurs sur la route de Béziers, sans rien d’inamical.
En si peu de temps, toutefois, il était impossible de jeter un pont sur l’abîme qu’avait creusé une lutte de dix ans, menée des deux côtés avec amertume, haine et emploi de la force.
Dans les relations qui nous sont parvenues de cette mission de prédication sont souvent cités les noms de Diego et du légat Raoul, moine de l’abbaye cistercienne de Fontfroide près de Narbonne. Mais Dominique est à peine entrevu. Cela ne peut surprendre: il était le plus jeune, faisait partie du groupe comme accompagnateur de son évêque et restait dans l’ombre de celui-ci. On trouve cependant un écrit de lui mentionné dans la relation du » miracle de Fanjeaux « . Dans cette ville se tenait un tribunal d’arbitrage: des mémoires avaient été rédigés par des cathares, d’autres par les défenseurs de la foi de l’Église, et parmi ces derniers celui de Dominique avait été jugé le meilleur. Comme les arbitres ne se mettaient pas d’accord pour décider de la valeur de ces mémoires, on en vint à l’épreuve du feu, alors considérée comme jugement de Dieu pour affirmer soit l’innocence d’un accusé, soit le bien-fondé d’un droit revendiqué. Selon Jourdain de Saxe, le mémoire des hérétiques se consuma dès qu’il fut jeté dans les flammes. Celui de Dominique » non seulement demeure intact, mais saute au-dessus des flammes, en présence de tous « . Cet épisode – que d’autres récits placent à Montréal – fut l’un de ceux qui inspirèrent le plus les artistes, et dans les scènes de la vie de saint Dominique on voit souvent le livre jaillissant du brasier (voir planche 17).
Au printemps de 1207, un important colloque fut organisé à l’initiative des cathares dans la ville forte de Montréal. Ils n’en avaient jamais proposé jusqu’alors, soit par crainte d’être persécutés, soit parce qu’ils préféraient rester entre eux. S’ils se décidèrent à provoquer une rencontre, ce fut sans doute à cause du bruit qu’avait fait la prédication de Diego et des légats. Ces derniers accordèrent aux théologiens cathares un sauf conduit – ce qui n’était pas d’usage auparavant – et acceptèrent Montréal comme lieu de la rencontre, bien que ce fût le centre d’un fief cathare important. Quatre » arbitres » furent désignés. Ce n’était nullement des théologiens, mais deux chevaliers et deux bourgeois. Ils n’étaient donc guère qualifiés pour départager les avis dans une controverse théologique, mais ils jouaient, en fait, plutôt le rôle de présidents de séance: il s’agissait moins de leur jugement que de l’exposition, devant un public nombreux, des thèses en présence. Tout comme de nos jours les candidats paraissent à la télévision lors d’une campagne présidentielle ou électorale, les disputes théologiques d’alors trouvaient des auditeurs intéressés par la théologie comme nous le sommes par la politique, la sécurité ou l’économie. La discussion dura quinze jours, avec quelques interruptions. En fin de compte le jury refusa de rendre une sentence: ce que les uns considérèrent comme une défaite, les autres comme une victoire.
Plus importante que de telles disputes, plus riche de promesses pour l’avenir, fut la fondation dans le village de Prouille, près de Fanjeaux, d’une maison destinée à recevoir des femmes et des jeunes filles. Cette fondation devait devenir le couvent de dominicaines qui existe encore aujourd’hui. C’était là, comme toute l’activité de prédication, une réponse à l’action des cathares. Ceux-ci, nous l’avons vu, envoyaient leurs filles dans des écoles dirigées par des parfaites. En créant une communauté féminine catholique, on incitait les familles récemment converties à y envoyer leurs filles. L’évêque de Toulouse, Foulques, qui venait d’entrer en charge (son prédécesseur avait été déposé) donna son autorisation. Et ce fut surtout Dominique qui se préoccupa d’assurer aux moniales un logis et les ressources nécessaires à leur subsistance.
Vinrent à la même époque s’adjoindre au groupe de prédicateurs douze abbés cisterciens, entraînés par Arnaud, l’abbé de Cîteaux. Le groupe comptait à présent une quarantaine de religieux. Il put se démultiplier en petits groupes et intensifier ainsi la prédication. Le pape s’intéressait de près à cette oeuvre de conversion: on lui envoyait des rapports détaillés auxquels il répondait en parlant de la » Prédication en Narbonnaise « . Sur le sceau des missionnaires était inscrit: » Prédication de Jésus-Christ. « Mais dès la fin de 1207, Arnaud et les autres abbés cisterciens se retirèrent; ils avaient à se préoccuper des abbayes dont ils étaient les chefs responsables et n’avaient sans doute envisagé leur mission de prédication que comme une action limitée dans le temps. Peut-être aussi avaient-ils été déçus de leur peu de succès. Deux rapports expriment cette déception. Le premier note sobrement que les prédicateurs » convertissent un petit nombre. Aux fidèles chrétiens, qui sont peu nombreux, ils donnent un enseignement doctrinal et les affermissent dans la foi « . Dans un autre rapport qui évoque la multitude des adeptes de l’hérésie, le ton est plus amer: » Par Dieu ! je dois dire que ces gens se soucient des prédicateurs autant que d’une pomme pourrie. «
De plus, en juillet, le légat Raoul était mort. Seuls restaient Diego et Dominique, avec leur petit groupe. Dès lors, Diego fit ce à quoi l’on pouvait s’attendre: il repartit pour son diocèse, espérant trouver là-bas de nouveaux prédicateurs. Il n’y réussit pas, car en décembre il mourut à Osma. La Prédication de Jésus-Christ perdait en lui son inspirateur et son chef, et Dominique perdait son conseiller et son ami paternel. Quelle eût été la vie de Dominique sans sa rencontre avec Diego et l’action commune qu’il mena avec lui, il est vain de se le demander. Mais une chose est sûre: si Dominique put fonder l’ordre des prêcheurs, il le doit à l’évêque d’Osma et trouva dans la mission dont celui-ci fut l’instigateur le modèle de son ordre.
4. De la prédication à la fondation de l’Ordre des Prêcheurs
 La mort de l’évêque d’Osma représenta une coupure, non seulement dans la mission en Narbonnaise, mais dans la vie de Dominique. Personne sans doute, n’eût reproché à celui-ci de regagner à son tour son église d’Osma. La Prédication de Jésus-Christ était si affaiblie par le départ des cisterciens qu’il était douteux qu’on pût la poursuivre; sur ces entrefaites le légat Pierre de Castelnau fut assassiné par un familier du comte Raimond de Toulouse, et ce crime présageait une guerre, la longue » guerre des albigeois » au cours de laquelle la prédication, oeuvre de paix, aurait encore moins de chances de réussir. Il resta toutefois à Prouille et, malgré les hostilités, maintint fermement la Prédication de Jésus-Christ. Il résidait à Fanjeaux, à quelque vingt minutes à pied du couvent de Prouille, dont il était prieur. Sa mission de prédication le conduisit en tous sens à travers les diocèses de Toulouse et de Carcassonne, et parfois dans des régions purement albigeoises. Certes, il ne pouvait s’absenter trop longtemps de Prouille, car le couvent se trouvait assez souvent dans la zone des combats. Par les relations contemporaines et par le procès de béatification, nous connaissons les noms d’hérétiques qu’il ramena à la foi de l’Église. Sa tâche était déjà difficile auparavant, elle dut l’être d’autant plus du fait de la guerre.
La mort de l’évêque d’Osma représenta une coupure, non seulement dans la mission en Narbonnaise, mais dans la vie de Dominique. Personne sans doute, n’eût reproché à celui-ci de regagner à son tour son église d’Osma. La Prédication de Jésus-Christ était si affaiblie par le départ des cisterciens qu’il était douteux qu’on pût la poursuivre; sur ces entrefaites le légat Pierre de Castelnau fut assassiné par un familier du comte Raimond de Toulouse, et ce crime présageait une guerre, la longue » guerre des albigeois » au cours de laquelle la prédication, oeuvre de paix, aurait encore moins de chances de réussir. Il resta toutefois à Prouille et, malgré les hostilités, maintint fermement la Prédication de Jésus-Christ. Il résidait à Fanjeaux, à quelque vingt minutes à pied du couvent de Prouille, dont il était prieur. Sa mission de prédication le conduisit en tous sens à travers les diocèses de Toulouse et de Carcassonne, et parfois dans des régions purement albigeoises. Certes, il ne pouvait s’absenter trop longtemps de Prouille, car le couvent se trouvait assez souvent dans la zone des combats. Par les relations contemporaines et par le procès de béatification, nous connaissons les noms d’hérétiques qu’il ramena à la foi de l’Église. Sa tâche était déjà difficile auparavant, elle dut l’être d’autant plus du fait de la guerre.
Son plus grand souci était assurément la prédication et la recherche de nouveaux compagnons pour la mission. Il était bien intégré alors dans l’Église du midi de la France et nous savons qu’il parlait bien la langue d’oc. Il était donc normal qu’outre la Prédication de Jésus-Christ, d’autres charges lui fussent confiées. En 1213, l’évêque de Carcassonne fit de lui son vicaire pour le remplacer dans les questions spirituelles (mais sans pouvoirs judiciaires ni administratifs). Au cours de la même année on lui proposa deux fois un évêché; il refusa chaque fois, estimant que sa tâche de prédicateur était plus pressante. Dès le début de la mission, il ne se fit plus appeler sous-prieur, mais seulement » frère Dominique « . Il continua à habiter avec quatre ou cinq collaborateurs dans une maison située derrière l’église de Fanjeaux, et bien que la petite communauté ait reçu de Simon de Montfort de quoi subvenir à ses besoins, elle vivait volontairement dans la pauvreté: ils distribuaient des secours aux habitants dont beaucoup, du fait de la guerre et des impôts, avaient à peine le minimum vital. Dans leurs tournées de prédication ils ne prenaient pas d’argent avec eux, mais se contentaient de ce qu’on leur donnait sur la route ou dans le lieu de la prédication.
Nous savons, par le procès de béatification et par d’autres sources, que dès Palencia et Osma Dominique était ardent à la prière, passant souvent des nuits entières à veiller et à prier. Lorsqu’il s’adonna à la prédication, sa prière se fit surtout apostolique: il demandait à Dieu la conversion des cathares et des vaudois. Il progressa en même temps dans la prière apostolique et dans la prédication, qui formaient pour lui une unité. A coup sûr, il avait toutes dispositions humaines pour être un bon prédicateur une solide formation théologique et surtout une connaissance approfondie des Écritures, une élocution claire, une parole qui savait émouvoir, encourager. Ce n’était pas un prédicateur qui » remuait les masses « , comme l’avait été Bernard de Clairvaux prêchant la croisade vers la Terre sainte, ou comme le serait plus tard Bernardin de Sienne dans ses sermons appelant à la pénitence. Quand ses compagnons et lui arrivaient dans un village ou une ville, souvent peu de gens s’arrêtaient, sur une place ou devant l’église, pour écouter la première prédication. A la deuxième ou à la troisième prédication, il y avait un plus grand nombre d’auditeurs. Comme le thème choisi était destiné à contredire l’enseignement des cathares et des vaudois, les partisans de ceux-ci interrompaient les prêcheurs, discutaient avec eux. L’ambiance était sans doute davantage celle du » coin des orateurs » à Hyde Park que celle d’un sermon solennel prononcé en chaire par un Bossuet.
Des biographes postérieurs ont peut-être eu raison de parler de » milliers d’hérétiques » ramenés à l’Église par la parole de Dominique: mais ces » milliers » se répartissent sur plus de dix ans de prédication et en de nombreux endroits. La » conversion » dont il s’agissait alors était tout autre chose qu’un élan du coeur ou qu’une décision de la volonté amenant à changer de vie. La » réconciliation » qui permettait de faire à nouveau partie de l’Église était un fait juridique, noté par écrit et lié à des oeuvres de pénitence. Au sermon qui donnait l’impulsion première succédaient des entretiens particuliers qui amenaient à recevoir le sacrement de pénitence. Lorsque ses anciens biographes nous disent que dans sa prière il » combattait pour le salut des âmes « , n’y voyons pas une figure de rhétorique : l’expression révèle le sérieux, le don de soi qui animaient Dominique et ses compagnons lorsqu’ils s’efforçaient de reconquérir les hérétiques.
On s’est demandé pourquoi Dominique avait tenu à obtenir pour sa communauté de prédicateurs le statut d’un ordre reconnu par le pape. La plupart des historiens sont d’accord pour penser que, dès son installation à Toulouse, il songeait à la fondation d’un ordre de prêcheurs élargi aux dimensions de l’Église. Mais il y avait aussi des motivations plus pratiques et immédiates. Son évêque, Foulques, était certes un protecteur aux vues larges, mais dès qu’il aurait un successeur, celui-ci, se référant à la tradition, pouvait abolir les innovations du prédécesseur et retirer ainsi à la communauté de Toulouse les bases mêmes de son existence.
La convocation à Rome, pour 1215, du IVe concile de Latran offrit l’occasion d’obtenir l’approbation du pape. Lorsque Innocent III convoqua ce concile, il était politiquement au faîte de sa puissance. Ses interventions auprès des souverains en Allemagne, en Angleterre et (dans une moindre mesure) en France avaient consolidé la position de la papauté et obtenu satisfaction pour les prétentions de l’Église. En convoquant un concile oecuménique, il voulait travailler à la réforme intérieure de l’Église et préparer une nouvelle croisade. Sans vouloir mentionner tout ce qui fut débattu et décidé dans ce concile, nous retiendrons celles de ses conclusions qui concernent l’action de Dominique et qui ont influencé la fondation de l’ordre des prêcheurs.
Dominique revint à Toulouse, et la communauté se décida pour la règle de saint Augustin. Un tel choix était prévisible: Dominique lui-même était » chanoine régulier « , pratiquant cette règle depuis son entrée au chapitre d’Osma, cette règle était l’une des plus répandues à l’époque, et enfin (beaucoup moins précise dans ce qu’elle ordonnait que la règle bénédictine) elle se bornait à poser les principes de la vie religieuse communautaire: pauvreté personnelle, charité fraternelle, obéissance à l’égard des supérieurs ; la façon de mettre en oeuvre concrètement ces principes était laissée à la discrétion de chaque ordre.
Après cette décision, les frères s’attachèrent à rédiger les statuts qui compléteraient la règle et leur donnèrent le titre général de consuetudines : l’expression était empruntée au droit coutumier de l’époque et désignait donc des » coutumes » ayant une sorte de valeur juridique. Ces premières » coutumes » furent simplement des prescriptions concernant la vie quotidienne (heures fixées pour les offices, le repas, le sommeil) et ascétique (silence, recueillement, jeûne, exercices de pénitence…). Elles étaient inspirées plus ou moins des observances rigoureuses des prémontrés fondés par saint Norbert en 1120 – eux-mêmes chanoines réguliers de Saint-Augustin.
Ce règlement minutieux de la vie quotidienne peut apparaître aujourd’hui comme une limite à la liberté individuelle, mais l’homme du Moyen Age ne ressentait pas les choses ainsi. La vie des clercs était normalement réglée par des prescriptions ecclésiastiques, et celle des laïcs l’était aussi par des ordonnances concernant le vêtement, par les corporations pour les gens de métier, par les » coutumes » qu’observaient les ruraux aussi exactement que si elles avaient force de loi. Dans un tel ordre on se sentait à l’abri, protégé. La notion d’ordre n’était pas en contradiction avec l’idée de liberté, mais avec l’idée de chaos, avec les forces de la nature qui semblaient désordonnées, démoniaques: on les redoutait, on s’en protégeait en établissant des règlements. Il faut comprendre ainsi le mot souvent cité de saint Augustin: » Garde la règle pour que la règle te garde! «
A la fin de 1216, Dominique se rendit de nouveau à Rome, accompagné de quelques frères, pour recevoir la confirmation de son ordre, que le pape lui avait promise. Mais en juillet, Innocent III était mort. Son successeur Honorius n’éleva toutefois aucune objection et, le 22 décembre 1216, il fit rédiger la bulle de confirmation qui faisait de la communauté de Toulouse un ordre autonome. Le nom de cet ordre allait presque de soi. Les frères étaient connus comme frères de la Prédication de Toulouse. La mission de prédication en Languedoc était devenue » ordre des prêcheurs « .
5. L’envoi des frères par saint Dominique
 La Pentecôte 1217 fut une date déterminante pour la vie de saint Dominique et pour l’histoire de l’Ordre. Jourdain de Saxe raconte ainsi l’événement: » Il invoqua le Saint-Esprit, convoqua tous les frères et leur dit qu’il avait pris dans son coeur la décision de les envoyer tous à travers le monde, en dépit de leur petit nombre […]. Chacun s’étonna de l’entendre prononcer catégoriquement une décision si rapidement prise. Mais l’autorité manifeste que lui donnait la sainteté les animait si bien qu’ils acquiescèrent avec assez de facilité. »
La Pentecôte 1217 fut une date déterminante pour la vie de saint Dominique et pour l’histoire de l’Ordre. Jourdain de Saxe raconte ainsi l’événement: » Il invoqua le Saint-Esprit, convoqua tous les frères et leur dit qu’il avait pris dans son coeur la décision de les envoyer tous à travers le monde, en dépit de leur petit nombre […]. Chacun s’étonna de l’entendre prononcer catégoriquement une décision si rapidement prise. Mais l’autorité manifeste que lui donnait la sainteté les animait si bien qu’ils acquiescèrent avec assez de facilité. »
Il ne semble pourtant pas qu’ils se soient mis d’accord si aisément… Les objections les plus justifiées furent assurément celles qui vinrent de la communauté elle-même. C’était, et c’est toujours, contraire à toute expérience humaine que de disperser et semer à tout vent les membres d’une petite communauté récemment fondée. A quoi bon avoir prescrit des observances bien pesées, à quoi bon avoir rédigé des instructions pour le maître des novices, si ceux qui les avaient décidées n’avaient pas la possibilité de les mettre à l’épreuve, au moins pendant quelque temps ? Si l’on se bornait à considérer l’expérience, le plan de Dominique devait paraître inconsidéré, dangereux. Effectivement, quelques-unes des intentions fondamentales de Dominique échouèrent tout d’abord. Cela ne doit pas surprendre. Dans ce petit groupe, il n’y avait guère de personnalités dominantes. Le père Vicaire, dont le travail sur Dominique et l’origine de l’ordre est exhaustif, note, à ce propos, que les premiers frères étaient » simples en général et faiblement instruits pour la plupart. Il en est qui ont peur des sacrifices, d’autres qui perdent pied dans les difficultés matérielles « . Pour eux un temps de probation assez prolongé sous la direction de Dominique eût été précieux. Mais le fondateur ne fut pas ébranlé, et il répondit aux objections des frères: » Ne vous opposez pas à moi, je sais ce que je fais. «
C’était là un argument d’autorité. N’essayons pas de justifier cette attitude en remarquant que » l’histoire lui a donné raison « . On peut toujours commenter a posteriori les décisions historiques, bonnes ou mauvaises. Dans ce cas la décision prise ne peut s’expliquer que par ce qu’on appelle, en langage chrétien, » charisme » et » inspiration » ; nous pénétrons là dans les secrets d’une relation intime entre Dieu qui donne ce charisme, cette inspiration et celui qui les reçoit. Quand on est à l’extérieur on ne peut que pressentir – à la seule condition d’être ouvert à cette dimension de la foi – leur présence chez celui qui les a reçus. Les frères y étaient certainement ouverts, et c’est ainsi qu’il faut comprendre la conclusion de Jourdain de Saxe: les frères étaient » pleins d’espoir quant à l’heureuse issue de cette décision « .
A l’Assomption, le petite groupe se réunit une dernière fois pour célébrer la messe ensemble. Puis ils se séparèrent. Un certain nombre, parmi eux, ne se revirent plus. Deux groupes se dirigèrent séparément vers Paris pour s’y établir. Un autre groupe fit route vers Madrid. Un autre encore se dirigea vers l’Espagne, mais il abandonna bientôt. Dans le couvent de Toulouse restaient seulement quelques frères originaires de la ville ou de ses environs immédiats.
Alors commença pour Dominique une période de voyages qu’il fit à pied, en tant que prédicateur apostolique. Comme aux établissements d’Espagne et de France s’ajoutèrent bientôt des fondations en Italie, il était constamment sur les routes de ces pays. D’après les dépositions de ses frères, dans aucun de ces couvents il n’avait de cellule personnelle: il couchait dans la cellule d’un frère absent ou simplement sur une litière de paille dans un coin d’une pièce vide; et d’ailleurs il passait une partie de ses nuits en prière dans la chapelle ou l’église du couvent. Comme il allait à pied, il ne prenait que le strict nécessaire. Certes, il recevait dans les couvents ce qu’il lui fallait. Mais à longueur d’année ce renoncement au minimum de biens personnels dont chacun, à vrai dire, a besoin pour pouvoir à l’occasion s’en servir faisait partie de sa conception personnelle de la pauvreté apostolique, qu’il n’imposa sans doute jamais à ses frères à ce point.
Dans les quelques années qui lui restaient encore à vivre, il se consacra surtout aux couvents nouvellement fondés. Non seulement il visitait les établissements déjà existants, mais il préparait aussi le terrain pour de nouvelles fondations. Ainsi il est probable que la fondation du couvent de Bologne fut due à son initiative lorsque, au cours de l’hiver 1217, il alla de Toulouse à Rome, où il devait demander, et recevoir, de nouvelles lettres de recommandation du pape pour l’ordre des prêcheurs. Ces bulles étaient très importantes: d’abord, en dehors de la région de Toulouse et de Narbonne, le nouvel ordre était encore tout à fait inconnu; ensuite, cette forme de vie conventuelle et surtout cette activité de prédication, de la part de clercs qui n’étaient pas des prélats (auxquels auparavant le soin de prêcher était réservé), devaient, évidemment, rencontrer les réticences et la méfiance des évêques et du clergé local.
Durant l’été 1218, il en fut de même lors de son voyage en Espagne. Treize ans auparavant, à la suite de l’évêque d’Osma, il avait, en se dirigeant vers la France et le Danemark, traversé à cheval les Pyrénées: c’est ce que peut nous évoquer, sur le sarcophage du saint évêque Pedro dans la salle du chapitre d’Osma, la chevauchée d’un chanoine accompagné d’un serviteur (voir planche 14). Cette fois, avec un de ses frères, Dominique franchit à pied les montagnes, prêchant dans les villes et les villages et vivant des aumônes qu’on leur accordait.
A Madrid, il rendit visite aux deux frères qu’il y avait envoyés l’année précédente et fonda le premier couvent espagnol de moniales dominicaines. Ces religieuses reçurent une lettre de lui qui a été conservée: c’est le seul document que nous connaissions écrit de sa main. Rédigée en style très sobre, elle donne des avertissements d’ordre pratique et d’ordre spirituel, entre autres celui-ci qui pourrait provenir des instructions aux maîtres des novices que nous avons citées: » Ne bavardez pas entre vous et ne perdez pas votre temps à des rencontres. » Pas un mot de trop, pas une de ces fleurs de rhétorique pieuse dont les lettres d’édification sont si riches au Moyen Age.
A Ségovie on donna à Dominique une maison. Quelques frères s’y installèrent et en firent un couvent. (C’est ainsi que naquirent bien d’autres couvents en Espagne, en France, en Italie et en Allemagne.) Vers le mois de mai 1219, Dominique faisait route vers Toulouse pour visiter le couvent Saint-Romain. Là, le frère Bertrand l’attendait avec des nouvelles de Paris. Et tous deux repartirent pour cette ville.
Quelques semaines ne s’étaient pas écoulées que Dominique repartait pour Bologne. Là, sous la direction du frère Réginald d’Orléans, en peu de temps, d’un misérable hospice on avait fait un couvent, près de l’église S. Niccolô. Comme à Paris ce furent surtout de jeunes étudiants de l’université qui entrèrent dans l’ordre, mais des professeurs aussi demandèrent à s’y agréger et, à leur tour, lui amenèrent de nouvelles recrues. Évidemment, dans une communauté qui avait grandi aussi vite et dont les racines étaient aussi diverses, il y eut des crises. Plusieurs des jeunes gens qui étaient entrés avec enthousiasme capitulèrent devant les exigences sévères de la pauvreté apostolique. Et Réginald dut avoir plus d’une fois recours à toute son éloquence et à toute son autorité pour éviter des divisions à l’intérieur de la communauté.
Dominique décida de s’établir définitivement à Bologne. Selon Jourdain de Saxe, ce fut pour veiller sur les jeunes frères qui s’y trouvaient déjà nombreux, pour » façonner l’enfance encore tendre de la nouvelle pépinière « . D’autres motifs ont pu jouer, et notamment l’état de sa santé. Mous savons que depuis des années il souffrait de l’estomac et de l’intestin. Il n’en disait rien, continuait sa vie ascétique et consacrait de longues heures à la prière nocturne dans l’église. Mais l’épuisement dû à de longues marches, les voyages avec tout ce qu’ils entraînaient d’imprévu et d’incommodités altéraient sa santé à la longue. Comme la situation du couvent de Paris restait aussi difficile, il y envoya le frère Réginald. Il pensait que celui-ci, français, était le plus désigné pour triompher des résistances, d’autant plus qu’avant d’entrer dans l’ordre il avait été professeur à l’université de Paris et doyen à Orléans. Mais peu de temps après son arrivée à Paris, Réginald mourut.
Réginald était non seulement un éminent théologien, mais un remarquable prédicateur qui, à Bologne, enthousiasmait ses auditeurs. Jourdain en parle comme d’un » nouvel Élie » et dit qu’il » mettait tout Bologne en effervescence « . Des étudiants qu’il avait conquis pour l’ordre dans cette ville, il était aimé et honoré, et quand Dominique, à regret, l’envoya à Paris, chacun des jeunes frères » pleura de se voir si tôt arraché au sein aimant d’une mère à laquelle ils étaient accoutumés « . L’expression peut sembler un peu trop imagée, mais elle caractérise bien cette aptitude à aimer qui était chez lui un charisme particulier. Jourdain raconte aussi à son sujet qu’un certain frère, qui l’avait connu dans le monde » vaniteux et difficile dans sa délicatesse, l’interrogea avec étonnement : « N’éprouvez-vous pas quelque répugnance, Maître, à cet habit que vous avez pris ? » Mais lui, en baissant la tête: « Je crois n’avoir aucun mérite à vivre dans cet ordre, car j’y ai toujours trouvé trop de joie. » » Sur le tombeau de Dominique à Bologne, Nicola Pisano a immortalisé cette amitié en montrant Réginald faisant profession entre les mains du fondateur.
Réginald ne fut pas le seul à quitter Bologne: Dominique partit bientôt, lui aussi, pour se rendre à Viterbe où, à la suite d’une émeute à Rome, la cour pontificale s’était installée. Il voulait obtenir du pape de nouvelles lettres de recommandation pour l’ordre, en particulier pour le couvent de Paris. Honorius acquiesça à toutes ses demandes, fit envoyer aux évêques de nouvelles bulles de recommandation et obtint finalement pour les frères de Paris le droit de prêcher dans leur chapelle. Dominique demeura à Viterbe et à Rome plus longtemps que prévu, et ses contacts avec le pape, au cours de l’hiver 1219-1220, furent de plus en plus étroits et confiants. Honorius III n’avait sans doute pas les capacités politiques de son prédécesseur Innocent III et il ne conçut pas d’autre réforme de l’Église que celle qu’Innocent avait exposée au concile de Latran, mais il appuya cette réforme avec prudence et contribua à son exécution. Non seulement il se montra ouvert aux idées de Dominique, mais il les soutint partout où il le put. Il lui confia une nouvelle tâche qui entrait dans ce plan de réforme et correspondait, d’ailleurs, aux intentions du fondateur des prêcheurs; celle de réformer, à Rome, certains monastères de femmes.
Il s’agissait de couvents tombés en décadence temporellement et spirituellement. Dominique forma le projet de rassembler les moniales de plusieurs couvents dans le monastère de Saint-Sixte, que peu de mois auparavant le pape Honorius III lui avait cédé et qui à force de travail était devenu habitable pour quelques frères. Ce projet rencontra, comme on pouvait ‘s’y attendre, une forte résistance de la part des religieuses – pour la plupart issues de la noblesse romaine -, car il s’agissait d’abandonner des lieux honorés de longue date. En outre, Saint-Sixte était situé dans un quartier marécageux, et donc malsain. Enfin, on n’appréciait pas du tout le projet de Dominique: faire venir des religieuses de Prouille pour veiller à ce que la réforme soit observée. A force d’entretiens et d’exhortations, Dominique réussit enfin à persuader les moniales de la nécessité de ce changement, malgré leur répugnance à accepter la clôture stricte qu’il impliquait et à laquelle elles n’étaient pas habituées. Il y eut, certes, des réactions violentes de la part de leurs familles qui essayèrent de les retenir par la force. Mais en fin de compte, en avril 1220, Dominique put recevoir dans la clôture le dernier groupe de moniales.
A cette installation se rattache une légende. Dans le monastère Sainte-Marie-in-Tempulo se trouvait une image vénérée de la Madone, qu’on prétendait avoir été peinte par saint Luc. On affirmait que cette image ne se laisserait jamais emporter ailleurs. Les soeurs posèrent donc comme condition qu’elles pourraient revenir dans leur ancien couvent au cas où l’image miraculeuse » résisterait » à son transfert à Saint-Sixte. Dominique en fut d’accord. Comme on craignait un soulèvement de la population romaine, l’image fut transportée de nuit en procession solennelle. Elle ne manifesta nullement l’intention de retourner à l’emplacement primitif : les soeurs restèrent donc à Saint-Sixte, et l’image se trouve toujours dans le couvent qui a succédé à celui des soeurs de Saint-Sixte, au même endroit, sur le Monte Mario.
Pour les frères qui jusqu’alors étaient installés à Saint-Sixte, il fallait obtenir une nouvelle résidence: elle se trouva à Sainte-Sabine, sur l’Aventin. Près de la célèbre basilique du Ve siècle, les frères purent installer un modeste couvent. Aujourd’hui, ce couvent de Sainte-Sabine est le siège du maître de l’ordre des prêcheurs, et il n’est pour ainsi dire personne, parmi les nombreux dominicains qui se rendent à Rome au cours de leur vie religieuse, qui néglige d’aller prier dans la cellule étroite et basse que Dominique, quand il séjournait dans la ville, utilisait pour y passer la nuit.
6. La mort à Bologne
 Le pape Honorius confia à Dominique encore une autre tâche: organiser et diriger une mission de prédication en Lombardie. Des lettres pontificales furent envoyées à des religieux de divers couvents italiens, leur enjoignant de se mettre à la disposition de Dominique, nommé chef de la mission. Il s’agissait, tout comme dans les missions en Languedoc, de regagner des cathares et des vaudois. Ainsi, au cours des années 1220 et 1221, Dominique chemina presque sans arrêt sur les routes du nord de l’Italie pour y prêcher. Du succès de cette mission nous ne savons à peu près rien. Elle fut à coup sûr aussi difficile qu’en France et on ne pouvait s’attendre à des conversions en masse. Au fond, tout autre que Dominique aurait pu conduire cette mission. Mais il était considéré par la curie comme un expert pour tout ce qui touchait à la prédication. Cette nouvelle existence itinérante altéra gravement sa santé. Les accès de faiblesse devenaient plus fréquents. Parfois il ne pouvait avaler que des légumes et du bouillon d’herbes.
Le pape Honorius confia à Dominique encore une autre tâche: organiser et diriger une mission de prédication en Lombardie. Des lettres pontificales furent envoyées à des religieux de divers couvents italiens, leur enjoignant de se mettre à la disposition de Dominique, nommé chef de la mission. Il s’agissait, tout comme dans les missions en Languedoc, de regagner des cathares et des vaudois. Ainsi, au cours des années 1220 et 1221, Dominique chemina presque sans arrêt sur les routes du nord de l’Italie pour y prêcher. Du succès de cette mission nous ne savons à peu près rien. Elle fut à coup sûr aussi difficile qu’en France et on ne pouvait s’attendre à des conversions en masse. Au fond, tout autre que Dominique aurait pu conduire cette mission. Mais il était considéré par la curie comme un expert pour tout ce qui touchait à la prédication. Cette nouvelle existence itinérante altéra gravement sa santé. Les accès de faiblesse devenaient plus fréquents. Parfois il ne pouvait avaler que des légumes et du bouillon d’herbes.
Lorsque, en mai 1221, il revint à Bologne où devait se tenir le deuxième chapitre général de l’ordre, c’était un homme à bout de forces, qui n’avait plus que quelques mois à vivre. Pourtant, comme toujours, il le laissa à peine voir et ne se ménagea pas. Comme ses frères le relatèrent plus tard, il ne se relâcha d’aucune des sévérités de la règle, alors qu’il accordait généreusement des adoucissements aux frères malades ou épuisés, car ces observances étaient ordonnées au but de l’ordre, c’est-à-dire à la prédication, et n’étaient pas un but en soi. En 1220, la conclusion du premier chapitre de Bologne l’avait précisé: « Que le supérieur ait en son couvent pouvoir de dispenser les frères chaque fois qu’il l’estimera convenable, principalement en ce qui paraîtrait faire obstacle à l’étude, à la prédication ou au profit des âmes. » Dominique, certes, blâmait sans indulgence les manquements de certains frères et prescrivait les pénitences prévues mais il n’agissait jamais sous le coup de la colère et préférait reprendre en particulier le frère fautif.
Dans une seule occasion on le vit vraiment irrité. Revenant à Bologne après une tournée de prédication, il s’aperçut qu’en reconstruisant le couvent on avait agrandi les cellules. Il appela aussitôt le frère responsable et lui ordonna de faire démolir le nouveau bâtiment. Il ne s’agissait plus d’une faute individuelle mais du danger pour la communauté de s’écarter du fondement de la pauvreté apostolique.
Cette obligation de pauvreté pour la communauté avait déjà abouti, au premier chapitre général, à l’interdiction d’accepter soit des biens fonciers, soit des revenus de n’importe quelle nature. Cela n’impliquait pourtant pas qu’on dût refuser le don d’une maison, en toute propriété, pour y fonder un couvent, car Dominique reçut de telles donations à maintes reprises. Cette interdiction portait sur des rentes, des revenus fixes dont un couvent aurait pu vivre. La communauté devait subsister à l’aide d’aumônes, comme chaque frère en particulier. Il était donc interdit d’élever des constructions qui seraient source de dépenses et dont l’entretien, trop lourd pour la communauté, donnerait aussi motif à la population de se scandaliser.
A ce deuxième chapitre général, on peut dire que Dominique, déjà gravement malade, procéda à la » mise en ordre de ses affaires « . Il le fit d’abord en déléguant les pleins pouvoirs que jusqu’alors il exerçait seul comme prieur et maître de l’ordre. A ce chapitre, on décida que plusieurs couvents d’une région seraient groupés en une province ayant à sa tête un prieur provincial: celui-ci » jouit dans sa province des mêmes pouvoirs que le maître de l’ordre et ceux de la province lui rendent les mêmes honneurs qu’ils font au maître de l’Ordre « .
Après la clôture du chapitre de Bologne, Dominique reprit ses activités accoutumées: il travailla avec ardeur à la fondation d’un couvent de religieuses à Bologne même, il alla prêcher en Lombardie. Fin juillet, il revint à Bologne, épuisé, secoué à la fois par des accès de fièvre et de violentes douleurs intestinales. Il put encore une fois rassembler ses forces pour prendre part aux pourparlers concernant le couvent des religieuses. Mais au début d’août il fut vaincu par la maladie. Couché sur un matelas dans un coin du dortoir, il attendait la fin en priant et en méditant. Lorsque la fièvre se calmait, il priait avec le frère qui le gardait ou s’entretenait avec les novices qui venaient le voir. Les frères, qui n’avaient pas encore perdu l’espoir d’une amélioration, le transportèrent au prieuré bénédictin de Monte Mario, hors de la ville et de sa chaleur étouffante. Mais ce geste d’affection fut inutile. Au matin du 6 août, les frères de Saint-Nicolas gravirent la colline et Dominique fit devant les prêtres de la communauté une confession générale; il reconnut n’avoir jamais eu dans sa vie de relation sexuelle, mais quand les frères se furent retirés et qu’il resta seul avec l’un d’entre eux, il lui dit : » J’ai mal fait de parler devant les frères de ma virginité, je n’aurais pas dû le dire. » Lui qui ne parlait jamais de lui, qui jamais ne s’offrait en modèle, ne se pardonnait pas d’être sorti de cette réserve à l’heure de la mort.
Pendant qu’on lui administrait l’extrême-onction, un incident se produisit, que nous avons peine à comprendre aujourd’hui (mais il faut le situer dans le contexte juridique de l’Église de ce temps): le clerc desservant la chapelle déclara que si Dominique mourait au prieuré, c’est là qu’il devrait être enterré ! Les frères ne l’acceptèrent pas. Le mourant fut ramené sur une civière au couvent Saint-Nicolas et couché, puisqu’il n’avait pas de cellule à lui, dans la cellule d’un frère. C’est là qu’il mourut, entouré de tous ses frères, au soir du 6 août 1221. Une tradition rapporte qu’il leur dit: » Ne pleurez pas ! Je vous serai plus utile et porterai pour vous plus de fruit après ma mort que je ne le fis dans ma vie. «
Une légende accompagne son entrée dans la vie, une autre s’est répandue à propos de sa mort. Jourdain de Saxe la relate ainsi: » Le même jour, à l’heure où il trépassa, frère Guala, prieur de Brescia, puis évêque de la même ville, se reposait auprès du campanile des frères de Brescia. Il s’était endormi d’un sommeil assez léger lorsqu’il aperçut une sorte d’ouverture dans le ciel par laquelle descendaient deux échelles radieuses.
Le Christ tenait le haut de la première échelle, sa Mère le haut de l’autre; et les anges les parcouraient toutes deux, les descendant et remontant. Un siège était placé en bas, entre les deux échelles, et quelqu’un, sur le siège. Ce paraissait un frère de l’ordre; son visage était voilé par la capuche comme nous avons coutume d’ensevelir nos morts. Le Christ et sa Mère tiraient peu à peu vers le haut les échelles, jusqu’à ce que celui qu’on avait installé tout en bas parvînt jusqu’au sommet. Quand on l’eut reçu dans le ciel, au chant des anges, dans la splendeur d’une lumière immense, l’étincelante ouverture du ciel se ferma et plus rien désormais ne se présenta. Le frère qui avait eu la vision, quoiqu’il fût assez malade et faible, reprit bientôt ses forces et partit sur-le-champ pour Bologne. Il y apprit que le même jour, à la même heure, le Serviteur du Christ Dominique y était mort. «
(Source : Hertz, Anselm. Nils Loose, Helmuth. Dominique et les dominicains. Cerf, 1987.)