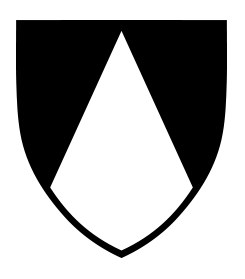Lettres des Maîtres de l’Ordre
Bruno Cadoré 2010-2019
La sainteté de Dominique, lumière pour l’Ordre des Prêcheurs (2018)
Du « Propositum » de l’Ordre au Projet conventuel de vie apostolique (2015)
Dominique : gouvernement, spiritualité et liberté. Commentaire du thème annuel du Jubilé (2015)
Commentaire du thème annuel du Jubilé (2015)
par Bruno Cadoré, o.p.
 « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 31-32) ; « C’est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés » (Ga 5,1)
« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 31-32) ; « C’est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés » (Ga 5,1)
La vérité vous rendra libres ! En écho à cette promesse de Jésus, l’image qui s’impose à moi est celle du groupe qui marchait avec Jésus, annonçant le Royaume de ville en village. Libérés, chacun et chacune, à sa manière, l’avait été. Libérés du poids de leurs fautes, des impasses de leurs mensonges, des lourdeurs de leur histoire, des divisions aliénantes… Portés par le désir de leur Maître et Seigneur d’aller encore vers d’autres villes, ils l’accompagnaient, assurés de se tenir, avec Lui, dans un Souffle qui les rendait jour après jour davantage libres d’être eux-mêmes, libres d’être donnés à cette amitié offerte par Dieu avec son Fils, libres pour être envoyés. Libres d’être disciples du Christ et, à leur tour, d’inviter d’autres à les rejoindre. C’est le Souffle de la prédication de Jésus qui les rend libres, alors même qu’ils n’avaient peut-être pas bien mesuré à quoi ils s’engageaient en répondant à son invitation à le suivre, ou en le rejoignant de leur propre initiative, comme en gratitude de la miséricorde dont Il leur avait fait la grâce. En se tenant avec Lui dans Sa proclamation du Royaume, ils découvrent qu’ils deviennent encore plus libres qu’ils n’auraient osé l’espérer. Libres, à cause de la parole de leur ami et Seigneur. « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres ». Libérés par la Parole de vérité !
C’est, je crois, à cette liberté du prêcheur que fait référence le thème de cette année de préparation à la célébration du Jubilé de l’Ordre. Dominique : gouvernement, spiritualité et liberté. Nous avons en mémoire des textes importants qui nous ont été proposés au cours des dernières décennies sur ces thèmes (le gouvernement dans l’Ordre, l’obéissance, la liberté et la responsabilité…), et que nous serons heureux de relire. Il me semble que le thème de cette année nous invite, dans la perspective ouverte par ces textes, à centrer notre attention sur ce qui constitue peut-être le cœur de la spiritualité de l’Ordre : recevoir l’audace de la liberté du prêcheur en apprenant à devenir ses disciples. Et tel est l’horizon du gouvernement dans l’Ordre.
On souligne toujours la place essentielle, unique, donnée à l’obéissance dans la profession d’être prêcheur : « je promets obéissance, à Dieu… ». Dominique, rappellent les historiens, demandait aux premiers frères de lui promettre « obéissance et vie commune ». Deux voies pour devenir disciples : écouter la Parole et se mettre à son école en vivant, avec d’autres, à sa suite, comme cette première communauté des ami(e)s qui allaient avec Jésus de ville en village pour apprendre de Lui comment être prêcheur. Ecouter et vivre ensemble, faisant de cette suite de la Parole la source de l’unanimité.
Consacrés dans la prédication : Envoyés pour prêcher l’Evangile
En cette année dédiée à la vie consacrée, il me semble que nous sommes invités à puiser à nouveau, sans cesse, à cette source de notre vie : être consacrés à l’évangélisation de la Parole de Dieu, être consacrés à la prédication de la Parole, « demeurer dans Sa Parole ». « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Le gouvernement pour Dominique consiste à soutenir ce désir – des individus et des communautés – d’être « vraiment ses disciples ». Cela signifie être gardien de cette « demeure de la Parole ». Là encore, c’est le critère de la mission qui s’impose. En effet, quelle est cette « Parole » ? Nous apprenons ce que cette Parole signifie pour nous à partir de la conversation du Fils avec le Père dans le souffle de l’Esprit : « ceux que tu m’as donnés… », « que là où je suis, eux aussi soient avec moi… ». Cette intimité filiale en laquelle s’enracine la mission « comme tu m’as envoyé, moi aussi je les envoie… ». La demeure dans la Parole n’évoque pas un quelconque « immobilisme contemplatif autocentré ». Elle n’évoque pas davantage une « observance morale » qui établirait (ou chercherait) un définitif « état de perfection ». Demeurer dans la Parole, à l’école de Dominique, c’est plutôt entrer dans le mouvement du Verbe qui vient à l’humanité pour y faire sa demeure, et nous rendre libres par la puissance de son Esprit. C’est se tenir dans le Souffle de la mission du Fils. C’est devenir soi-même disciples, et communauté de disciples, à la mesure de cette proximité amicale et fraternelle avec le Fils. Suivant l’expression de Thomas d’Aquin lorsqu’il parle du « verbum spirans amorem », on peut en effet penser que demeurer dans la Parole, est demeurer dans cette Parole qui « insuffle » l’amour, c’est-à-dire établit l’amitié, la fraternité et la communion, en nous et entre nous. Souffle de l’Esprit ; Parole de vérité et de liberté.
L’une des premières décisions de Dominique, retenue par l’histoire de l’Ordre comme l’une des plus importantes, fut celle de disperser les frères de saint Romain, afin que le grain ne s’entasse pas. Il a ainsi manifesté que le gouvernement dans l’Ordre devra être essentiellement ordonné à la prédication. A ce titre, le gouvernement engage à une certaine dynamique de vie spirituelle, en cherchant à promouvoir et servir la liberté de chacun qui trouve sa source dans la Parole de Dieu. Comme Jésus l’avait fait lui-même avec les disciples, Dominique envoie ses frères deux par deux sur les routes de la prédication. En réalité, il les envoie à la fois pour étudier et pour prêcher, et c’est grâce à cette détermination de la dispersion que l’Ordre va se développer, s’implanter, fonder et accueillir les nouvelles vocations. Cette dispersion instaure l’itinérance comme modalité du « devenir disciples », invitant les prêcheurs à laisser leur vie être marquée par les rencontres qu’ils feront en allant dans le monde comme « frères ». Elle va aussi les conduire à se mettre à l’école des premières universités et, ainsi, à enraciner leur recherche de la vérité de la Parole dans la conversation avec les savoirs de leur époque, enraciner leur respect pour la capacité humaine de connaître dans l’étude du mystère de la révélation du Dieu créateur et sauveur. Demeurer dans sa Parole, c’est se tenir au plus près de la conversation de Dieu avec l’humanité que Jésus, premier et seul maître de la prédication du Royaume, a rendue visible aux yeux de tous.
« Dieu a manifesté la tendresse et l’humanité de son Fils en son ami Dominique, qu’Il vous transfigure à l’image … ». Cette prière de bénédiction de la fête de saint Dominique fait écho au choix du Pape saint Jean-Paul II de placer sa réflexion sur la « Vita consacrata » sous la lumière du mystère de la Transfiguration (VC 14). Dans cette perspective, et parce qu’il a la charge d’appeler, de conduire et de soutenir sur le chemin du « devenir disciples » pour devenir prêcheurs, le gouvernement dominicain vise sans cesse à promouvoir les conditions de cette « économie de la transfiguration ». La prédication du Royaume est la modalité selon laquelle l’Ordre propose à ses frères et à ses sœurs pour se laisser conformer par l’Esprit au Christ. La contemplation de l’icône de la Transfiguration indique les dimensions essentielles de cette aventure. Au cœur du chemin de prédication, Jésus emmène avec Lui trois de ses disciples qui assisteront à sa transfiguration : la contemplation du mystère du Fils est au cœur de la mission du prêcheur. D’elle, le prêcheur reçoit ce qu’il a mission de transmettre : la réalité du Fils de Dieu en même temps que la révélation de l’économie du mystère du salut. Souvenons-nous, en effet, du récit même de la Transfiguration : « dressons trois tentes, l’une pour toi, l’une pour Moïse, l’une pour Elie… ». Et la réponse de Jésus ne tarde pas : une tente sera bel et bien dressée, mais ce sera au Golgotha de Jérusalem. Il y aura bien deux compagnons, mais ce seront des brigands mis avec Lui au ban de la société et punis de mort.
A la lumière resplendissante de la montagne de la transfiguration, répondra l’éclair qui déchirera les cieux, comme pour assurer par avance l’accomplissement de cette descente au séjour des morts d’où le Fils sera relevé, vivant, renversant une fois pour toutes les ténèbres de la mort, et portant avec lui en la pleine présence du Père ceux qui désormais sont avec Lui à jamais vivants. Sur la montagne de la Transfiguration, les disciples reçoivent, finalement, la mission qui sera leur joie : aller avec Jésus, jusqu’à Jérusalem, là où se révèle en plénitude la Parole de vérité. Là où la vie donnée du Christ est la source de notre liberté.
Se situer sous le signe de la Transfiguration, c’est prendre un chemin sur lequel peut mûrir notre désir de devenir disciples, en demeurant dans sa Parole, laissant cette dernière nous enseigner l’obéissance et l’amour du Fils révélés au Golgotha et au matin de Pâques, recevant de son Souffle la mission comme au jour de Pentecôte.
Demeurez dans ma Parole
Dans sa lettre apostolique aux consacrés, le Pape François invite ces derniers à « réveiller le monde », en sachant créer « d’autres lieux où se vive la logique évangélique du don, de la fraternité, de l’accueil de la diversité, de l’amour réciproque ». Ces lieux « doivent devenir toujours plus le levain d’une société inspirée de l’Évangile, la “ville sur la montagne” qui dit la vérité et la puissance des paroles de Jésus ». Ces lieux sont nos communautés, où nous avons promis d’apprendre à devenir ces « experts en communion » dont parle le Pape dans cette même lettre apostolique.
Il est significatif et essentiel que, dans l’Ordre, la fonction de supérieur(e) se situe précisément au croisement de ces deux horizons de la promesse : obéissance et vie commune. « Obéissance apostolique » dont Dominique a voulu qu’elle engage les prêcheurs à devenir frères de ceux à qui ils étaient envoyés dans l’itinérance mendiante, et à se laisser convertir et façonner dans la fraternité en menant la vie communautaire. Cette fraternité apostolique à laquelle nous engage le vœu d’obéissance est le chemin proposé par Dominique pour recevoir pleinement notre liberté. Obéissance et vie commune : deux manières pour orienter les regards vers la communion eschatologique à laquelle le monde est promis après en avoir été créé « capable », comme on dit que le monde est créé « capable de Dieu ». Deux manières d’engager, « usque ad mortem », notre liberté dans toute sa plénitude. Une fois encore, il s’agit pour le/la supérieur(e) d’appeler à prendre cette route pour se placer « sous l’autorité » de la Parole, pour se faire serviteur de cette conversation de Dieu avec l’humanité que le Verbe est venu accomplir en demeurant parmi les hommes. Obéissance et vie commune, pour que la prédication enracine à la fois dans la communauté des disciples qui écoutent la Parole de vie, et dans la communauté espérée comme cette communion eschatologique annoncée par le prophète et que le Fils vient sceller de sa propre vie.
Ce qui pourrait être un « arbre de la prédication », fruit de cette promesse de vie évangélique et apostolique, s’enracine dans trois modalités que nous offre la tradition de l’Ordre pour « demeurer dans sa Parole » : la communion fraternelle, la célébration de la Parole et la prière, l’étude. C’et une tâche précise du gouvernement dans l’Ordre – et c’est peut-être sa toute première responsabilité – que de promouvoir parmi les frères, parmi les sœurs et les laïcs, la qualité de ce triple enracinement qui garantit et promeut la liberté apostolique.
La communion fraternelle est le lieu où les frères et les sœurs peuvent faire l’épreuve de la capacité de la parole humaine à s’ordonner à la recherche de la vérité qui les rendra libres. C’est par la vie communautaire qu’il nous est offert d’advenir à notre liberté en contribuant à la communion. Pour cette raison, notre « religion capitulaire » est essentielle à notre spiritualité : chaque membre de la communauté a sa propre voix et, en s’engageant dans la recherche commune du bien de tous ajusté à la mission d’être serviteur de la Parole, il participe pleinement au gouvernement de l’Ordre. Ce dernier est démocratique, non qu’il consiste en la désignation du pouvoir de la majorité, mais parce qu’il consiste plutôt en la recherche démocratique de l’unanimité. Cet exercice de la vie communautaire est exigeant, nous le savons, car il appelle chacun à ne jamais se dérober à sa participation propre au dialogue de cette recherche. Il est exigeant, aussi, parce qu’il engage à exprimer le plus en vérité possible ses positions et arguments, quitte à objectiver des désaccords avec les frères, mais dans la confiance que nul ne sera jamais réduit à une opinion ou position exprimée, pour être toujours d’abord accueilli et aimé comme un frère. Il est exigeant, encore, parce qu’il engage tous les membres d’une communauté, après la patiente recherche du point le plus proche possible de l’unanimité, à prendre avec détermination sa part dans la réalisation de la décision prise par tous. C’est à ce prix que chacun est alors accueilli, reconnu et porté par tous dans l’élan de sa propre générosité et créativité apostolique. Peut-être est-ce à cause de la difficulté de cet exercice que nous désertons trop souvent cette dimension de notre enracinement dans la Parole par la vie communautaire.
La prière est une deuxième modalité d’enracinement de l’arbre de la prédication dans la Parole. La prière personnelle et communautaire ne saurait être considérée comme un exercice dont il faut s’acquitter pour être conforme à l’engagement à la vie consacrée régulière. Elle est la manière selon laquelle nous faisons le choix, personnellement et en communauté, de ponctuer le temps de notre histoire humaine par la méditation du mystère de l’histoire de Dieu avec le monde. Il s’agit par-là d’ « apprivoiser » l’histoire de la révélation, en réponse à ce Dieu qui vient en son Fils « apprivoiser » chacun de nous. Il s’agit de laisser, dans la prière, l’Esprit « souffler où Il veut ». Pour cela, la prière procède de l’écoute de la Parole et y conduit en retour, établissant le centre de gravité de nos vies personnelles et de la vie de nos communautés dans la contemplation du mystère de la révélation dont l’Ecriture est le récit. La célébration de la Parole dans la liturgie, sa contemplation dans la méditation des mystères du Rosaire, la patiente prière silencieuse, nous aident à situer la consécration de notre vie à la prédication entre contemplation et étude, deux modes de quête de la vérité de Sa Parole dont nous désirons donner le goût à celles et ceux à qui nous sommes envoyés. « Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Demeurer ainsi devient pour nous l’occasion, comme ce fut le cas pour les premiers amis de Jésus prêchant, de nous découvrir libres parce que relevés par son appel, consolidés par son amour et sa miséricorde, encouragés et envoyés par sa grâce à porter plus avant sa Parole de vérité. Demeurer dans la Parole conduit alors à porter avec nous, en ce silence de l’écoute et de l’attente, celles et ceux à qui nous sommes envoyés, qui s’en remettent à notre prière, qui nous sont donnés par Dieu pour que, mystérieusement, nous acceptions qu’Il lie leur destin au nôtre en une même grâce du salut. En ce domaine, le gouvernement dans l’Ordre est un veilleur : veiller à ce que la liberté des personnes et des communautés s’enracine vraiment dans la contemplation de ce mystère par lequel le Fils lui-même, en son humanité, a donné le salut au monde en ajustant sa liberté à celle du Père.
La prière nous met à l’école de Notre-Dame des Prêcheurs. Avec elle, les Prêcheurs peuvent découvrir et s’émerveiller sans cesse de la capacité de la vie humaine de pouvoir devenir une « vie pour Dieu ». Avec elle, chantant les Psaumes qui inscrivent leur contemplation dans l’histoire de la révélation, les paroles humaines des prêcheurs s’ancrent dans une intelligence cordiale de la conversation par laquelle Dieu propose son adoption à l’humanité. Avec elle, encore, l’Ordre établit au cœur de sa prédication le signe prophétique de la conversion à la communion fraternelle, annonce confiante de la pleine réalisation de la promesse de l’alliance en Celui qui est la Vérité. A l’école de Notre-Dame des Prêcheurs, cette spiritualité de l’obéissance dans la vie commune unit intimement l’Ordre au mystère de l’Eglise, par l’amour partagé du Christ, par l’adoption dans le souffle de Sa vie, par le don au monde.
L’étude est la troisième manière d’enraciner la prédication en « demeurant dans sa parole ». Elle est le lieu de la quête et de la contemplation de la vérité et c’est bien à ce titre qu’elle constitue une observance toute particulière dans notre tradition. Toujours solidement ancrée dans l’écoute de l’Ecriture, et en fidélité avec la doctrine et l’enseignement de l’Eglise, l’étude est dans l’Ordre la manière privilégiée d’entretenir notre conversation avec Dieu, en menant aussi un dialogue amical et fraternel avec les nombreux systèmes de pensée qui façonnent le monde et cherchent à leur manière la vérité. Par l’étude, l’Ordre nous propose de grandir sans cesse en liberté, non pas en valorisant de manière mondaine le niveau des connaissances acquises, mais plutôt en nous proposant d’avancer sur le chemin de l’ « humilité de la vérité ». Engager l’intelligence humaine dans cette aventure qui a l’audace de tenter par des mots et des concepts marqués humains de rendre intelligible le mystère, c’est à la fois rendre grâce au Dieu créateur qui a voulu que la raison humaine, aussi finie et limitée soit-elle, soit « capable de Dieu », mais aussi laisser advenir le dépassement de la raison par l’espérance d’une plénitude qu’aucun concept ne peut vraiment saisir. Advenue qui révèle la véritable ampleur de notre liberté. Le gouvernement, dans l’Ordre, a la responsabilité de ne pas nous laisser déserter ce champ de l’étude, et de stimuler notre créativité pour sans cesse chercher les moyens les plus adaptés pour proposer à d’autres cette aventure d’évangélisation de la raison.
Gouvernement et spiritualité ?
Cette perspective donnée à la spiritualité de l’Ordre – demeurer dans la Parole pour connaître la vérité qui rend libres – permet d’identifier certains principes essentiels du gouvernement dans l’Ordre. Nous avons déjà vu que le gouvernement est essentiellement ordonné à la mission de prédication et qu’il cherche à promouvoir ce mode de vie spécifique de la tradition dominicaine qui procure aux frères les conditions pour enraciner leur prédication dans la Parole.
Le premier principe est d’encourager sans cesse la célébration des chapitres pour établir les frères en une responsabilité apostolique commune. Dans sa récente Lettre apostolique, le Pape François exprime le vœu que les consacrés s’interrogent sur ce que Dieu et l’humanité demandent. Dans notre tradition, cela souligne l’importance renouvelée que nous avons à donner à la réalité de nos chapitres. Certes, les chapitres – conventuels, provinciaux et généraux – ont la charge de prendre des décisions précises d’organisation et de législation de notre vie et de notre mission. Et, nous l’avons souligné, ils sont à ce titre des moments privilégiés pour se mettre humblement à l’école de la vérité cherchée ensemble dans la fraternité. De précieuses réflexions de mes prédécesseurs nous ont aidés à saisir comment la démocratie dans l’Ordre était la modalité non pas de l’exercice du pouvoir par la majorité, mais plutôt celle de la recherche de la plus grande unanimité possible. Si le dialogue et le débat entre les frères est si important dans notre tradition, c’est bien pour que chacun puisse librement et en confiance participer à la formulation commune du bien de tous auquel chacun s’engagera à contribuer. Une telle conversation fraternelle est possible à la mesure du respect fraternel, de l’ouverture et de la liberté d’exprimer sa réflexion que nous manifestons entre nous.
L’un des objets essentiels de ces débats doit être l’attention aux signes de notre temps, et la compréhension des besoins et des appels qui sont ainsi lancés au charisme propre de l’Ordre : porter au cœur de l’Eglise la mémoire de la prédication évangélique. Dans une toute prochaine lettre, j’aborderai – en réponse à la demande du chapitre général de Trogir – le thème du projet communautaire dont l’élaboration me semble être le point d’appui du gouvernement dans l’Ordre. C’est à la mesure où tous auront participé à l’élaboration de ce projet que nous pourrons vraiment évaluer et orienter notre service de l’Eglise et du monde par la prédication. La communion fraternelle est construite à partir de ce souci commun de la mission, qui n’est pas seulement la détermination de ce que l’on veut « faire », mais aussi la mise en commun de nos « compassions pour le monde » à partir desquelles nous désirons partager ce bien précieux de la libération par la Parole de vérité.
Sur la base de cette responsabilité apostolique commune, et parce que la tâche du gouvernement dans l’Ordre est d’assurer cet enracinement dans la vérité de la Parole, le deuxième principe de gouvernement est d’envoyer prêcher. La réponse à cette « mission », Dominique l’a voulue itinérante et mendiante pour que la prédication de l’Ordre prolonge l’économie de la Parole qui en Jésus est venue au monde comme un ami et comme un frère, mendiant l’hospitalité de celles et ceux qu’il voulait inviter à prendre part à la conversation avec le Père. Les « assignations » auxquelles procèdent les supérieur(e)s devraient toujours être ordonnées à cet horizon de l’itinérance mendiante, pour la mission. C’est-à-dire, à proprement parler, l’horizon de l’itinérance apostolique, de cette « non installation » qui est la modalité du « devenir disciple ». « Je te suivrai partout où tu iras… », disait l’un des disciples, à quoi Jésus répondit : « Les renards ont des terriers, et les oiseaux des nids. Le Fils de l’homme, lui, n’a pas où reposer sa tête… ». C’est cette affirmation que Dominique a voulu prendre au sérieux, donnant ainsi à ses frères la chance de reprendre la question des disciples du Baptiste : Maître, où demeures-tu ? Viens et tu verras… Voilà ce que doit aider à comprendre l’exercice du gouvernement dans l’Ordre. A comprendre, et à entendre au cœur de la vie, des ministères et des responsabilités propres à chacun : au cœur des réalités les plus établies, parfois des réussites ou des « carrières » les plus brillantes, des fonctions les plus importantes, un appel peut retentir qui demande de quitter pour rejoindre, plus loin, et plus libres, une autre dimension de la mission commune de l’Ordre pour l’Eglise. Ces désinstallations – douloureuses parfois, mais si souvent fécondes – ont des critères qui sont sans cesse rappelés dans la vie de Dominique : compassion, frontière entre la vie et la mort, entre l’humain et l’inhumain, défi de la justice et de la paix, impératif du dialogue entre les religions et les cultures – autant de réalités qui font écho aux « périphéries existentielles » dont le Pape Francis parle à nouveau dans sa lettre. Miséricorde pour les pécheurs, plutôt qu’attachement à ses propres péchés qui nous centre sur nous-même(s). Service de la communion de l’Eglise et de son extension, plutôt qu’une importance trop grande accordée aux identités qui nous rassurent et nous retiennent à nous-mêmes. Demeurer dans la Parole, c’est se tenir dans le plein vent de ce Souffle de la mission de la Parole elle-même, du Verbe dont on désire devenir les disciples. L’itinérance de la prédication est ainsi le chemin de notre « libération pour être libres ».
C’est parce que l’exercice du gouvernement dans l’Ordre s’oriente vers cet envoi qu’une attention toute particulière doit être accordée à chacune des personnes, à ses propres dons, sa propre créativité, de sorte que soit au mieux promu le déploiement de la liberté de chacun au service du bien et de la mission de tous. Au cœur de cette attention, au nom de la commune recherche de la vérité de la Parole, les supérieurs doivent avoir à cœur la double exigence de la miséricorde et de la justice. La miséricorde, si chère à notre tradition, doit donner sa forme première au souci des personnes. C’est ainsi que les relations fraternelles interpersonnelles, comme les relations au sein d’une communauté, doivent toujours être le point d’appui qui permet de rappeler à chacun qu’il n’est pas réductible à ses failles et manquements. La fraternité se tisse vraiment lorsque chacun découvre, à travers elle et à travers l’appel qu’elle lui lance sans cesse de se laisser libérer pour être libre, sa pleine dignité d’être relevé et sauvé par la miséricorde du Christ. Mais, en même temps, cette dignité doit toujours être reconnue dans sa capacité de responsabilité. Dans la perspective de la Parole de vérité qui libère, il n’est pas de liberté individuelle qui puisse revendiquer d’être une île, ni le centre de gravité de la vie de tous les autres. La fraternité telle que la réalise le Christ, précisément, nous enseigne comment recevoir notre véritable liberté dans une disposition à la réciprocité où l’autre compte toujours davantage que moi-même. C’est pourquoi le gouvernement a la responsabilité exigeante de tenir ensemble le souci de la miséricorde et le devoir de la justice. La référence précise et objective à nos Constitutions, au bien commun, aux déterminations de nos chapitres, permet de garder le bien commun de tous à l’abri de l’arbitraire des revendications de liberté des individus. La tâche semble parfois aride et ingrate, mais c’est au prix de cet équilibre exigeant que l’on évitera une référence trop facile à une miséricorde qui confinerait à la lâcheté, l’irresponsabilité ou l’indifférence, et que chacun pourra recevoir la grâce qu’il est venu chercher dans l’Ordre : être appelé à se laisser libérer par la Parole de vérité.
En concluant ce commentaire du thème annuel du Jubilé, je voudrais évoquer un dernier principe spirituel du gouvernement dans l’Ordre, celui de l’unité et de la communion. Ici encore, c’est le critère de la mission sur lequel nous pouvons nous appuyer. C’est à la mesure où nous prenons, avec patience, les moyens de la délibération commune qui oriente le ministère de la prédication que les individus, les communautés, les provinces et toutes les entités de la famille dominicaine entrent dans la dynamique d’intégration en une seule unité. Chacune de ces instances est évidemment invitée, convoquée, à apporter au bien commun sa propre identité personnelle, culturelle, ecclésiale. Mais, à cause de la référence commune à l’enthousiasme fondateur qui nous a, tous ensemble, consacrés à la prédication, notre volonté est de répondre à l’envoi ensemble. Ou plutôt, ce qui est encore plus exigeant, nous demandons à l’Esprit de nous constituer en une communion de prédication. Nous formulons cette demande en même temps que la prière incessante que l’Esprit de communion ouvre en ce monde l’horizon du salut, établit en nos cœurs l’espérance de la nouvelle création. Au-dessus de la porte de la basilique de Sainte Sabine, donnée à saint Dominique par le Pape Honorius III, la mosaïque qui représente l’Eglise de la circoncision et l’Eglise des Gentils rappelle cet horizon premier de la prédication de l’Ordre : la Parole de vérité nous enjoint de servir, par la prédication et par le témoignage, la communion promise. C’est pour cela que nous sommes envoyés. Et sur la porte de cette même basilique, nous le savons, la représentation de la crucifixion rappelle que cette prédication nous conduira à devenir disciples de Celui qui, librement, donne sa vie pour que tous soient rassemblés dans l’unité.
La vérité vous rendra libres !
fr. Bruno Cadoré, op
Maître de l’Ordre
Prot. 50/14/84 Jubilee_2016
Mendiants et solidaires. Pour une culture de la solidarité au service de la prédication (2014)
Mendiants et solidaires
Pour une culture de la solidarité au service de la prédication
Lettre du Maître de l’Ordre – Mai 2014
fr. Bruno Cadoré, O.P.

Dans un monde où il n’y a jamais eu autant de richesse et d’argent en circulation mais où l’écart se creuse de plus en plus entre les riches et les pauvres, l’Ordre ne peut rester insensible à cette réalité, ni laisser les « logiques du monde » déterminer les relations entre nous. C’est pour cela, et pour ancrer notre prédication dans le souci d’un monde plus équitable, que nous devons développer entre nous une véritable et exigeante « culture de la solidarité ». Une telle culture participera au renforcement de notre unité, caractéristique fondamentale de notre Ordre.
Introduction : à partir de la mendicité, une culture de la solidarité
Mendicité
L’Ordre des Prêcheurs a été fondé comme un Ordre mendiant et, même s’il est évident que les époques sont différentes, il est important de tenir compte de cela lorsque nous parlons de notre identité dominicaine. On sait que Dominique avait une exigence très radicale concernant la pauvreté : à son époque, il a voulu choisir un statut le faisant solidaire de ceux qui étaient dans un état de déréliction ; il insistait aussi sur le fait de ne rien avoir en propriété, personnelle ou communautaire. Cela l’a naturellement conduit à adopter le statut de mendiant, suivant l’exemple même de Jésus (cf. Thomas d’Aquin, Summa Theologiae III 40 3). Cependant, outre le fait d’être la conséquence du choix d’un rapport assez radical à la pauvreté, la mendicité indique aussi le choix de vivre en dépendance de celles et ceux à qui les prêcheurs sont envoyés, à l’image de la dépendance de Jésus et ses premiers disciples lorsqu’ils vont à travers villes et villages pour proclamer le Royaume de Dieu (Lc 8, 1-3). Cette dépendance manifeste la volonté de prendre le risque d’une certaine précarité matérielle et à l’image de saint Dominique, l’abandon à la divine Providence, mais aussi le choix d’une prédication itinérante. Ainsi, parler de solidarité dans la mission universelle d’évangélisation évoque la nécessité du support mutuel dans cette mission d’itinérance évangélique, à la fois qualifiant notre vie (itinérance à cause de l’Evangile), et aussi déterminant notre objectif (itinérance pour donner l’Evangile).
Le choix d’une telle précarité mendiante est loin d’être évident aujourd’hui pour plusieurs raisons. Nous devons bien sûr, par exemple, assumer un certain nombre d’obligations, comme celles de la formation des plus jeunes frères ou du meilleur soin possible apporté aux plus anciens, mais aussi celles des assurances pour les soins de santé et les pensions de vieillesse, ou encore la maintenance raisonnable de nos lieux d’habitation et de célébration. Compte tenu de la réalité de la précarité sociale dont beaucoup sont victimes dans bien des pays, il ne serait pas sain, ni juste, de prétendre nous identifier à elle. Du fait des systèmes de solidarité établis entre les différentes composantes d’une société donnée, les religieux ne peuvent pas se mettre volontairement dans une position où les autres seraient dans l’obligation de subvenir à tels ou tels de leurs besoins qu’ils auraient les moyens d’assumer. Néanmoins, le choix d’une certaine « frugalité » et simplicité de vie doit être un choix déterminé, afin de ne pas nous tenir à distance des plus précaires, et ne pas nous trouver « solidaires » des nantis et des puissants sans l’avoir réellement décidé. Or il faut reconnaître que, progressivement, nous avons pris l’habitude de certains niveaux de vie qui obligent à assurer les ressources équivalentes nécessaires, et que nous ne sommes pas toujours prêts à abaisser le niveau de vie et de confort qui est le nôtre dans bien des pays. De même, dans de nombreux lieux, nous nous sommes habitués à être propriétaires de biens immobiliers importants (voire de chercher à le devenir) dont nous n’envisagerions que difficilement de nous départir pour assurer des besoins plus essentiels, alors même que nous avons besoin de solliciter la générosité d’autres pour nous aider à y subvenir. Il ne faut donc pas nous « payer de mots » et une réflexion sur la mendicité doit être pour nous un appel à évaluer objectivement et avec humilité ce à quoi nous engage un tel choix, et quels sont les besoins réels pour lesquels nous jugeons légitimes de demander l’aide d’autrui. Une question, en particulier, doit nous hanter : dans quelle mesure notre rapport à la mendicité nous met-il en dépendance des autres pour subvenir aux besoins de notre vie quotidienne, et dans quelle mesure pensons-nous la mendicité comme la manière moderne de demander aux autres de subvenir à des besoins que nous déterminons nous-mêmes ? Ou, au contraire, et de manière plus juste, souhaitons-nous apprendre à nous en remettre aux autres pour déterminer, à partir des « relations vivantes » (LCO, 99 II) entretenues avec eux, le niveau de vie qui serait le plus adéquat à notre mission de prédication ?
Solidarité et bien commun
Les deux derniers chapitres généraux (ACG Rome 2010 §§57, 72-73 ; ACG Trogir 2013 §§48, 57, 111, 209) nous invitent à poser ces questions sur notre manière de vivre la pauvreté et la mendicité dans le cadre plus global d’une véritable culture de la solidarité. Cette perspective pourrait nous aider à éviter le risque, souvent signalé au fil des visites dans les provinces, de faire des choix apostoliques qui, en réalité, en viennent à suivre des critères relevant davantage de la sécurité économique que de la mission, ce que bien des frères disent regretter. En visitant les provinces, on peut entendre, par exemple, des frères regretter que la nécessité de garder tel ou tel office assez rémunérateur empêche de répondre à un besoin plus urgent, ou que le choix de rester dans tel ou tel lieu soit moins lié au besoin réel de ce lieu qu’à sa rentabilité. Les questions économiques doivent, certainement, être prises en compte dans l’organisation de notre vie apostolique, mais comment faire pour qu’elles ne deviennent pas un critère contraignant qui ferait obstacle à la réponse aux besoins de l’évangélisation ou à la créativité ?
Depuis la fondation de l’Ordre de nombreuses formes de solidarité ont existé entre les différentes entités. Elles ont permis l’essor de notre mission et ont renforcé les liens fraternels de solidarité au cours des siècles. Toutefois une culture renforcée de la solidarité entre nous signifie, entre les autres exigences qui en découlent, entendre l’appel à ne pas d’abord être centrés sur nous-mêmes mais à nous laisser ‘exproprier de nous-mêmes’, selon la belle expression proposée par le Cardinal Ratzinger en 2000 pour désigner l’exigence spirituelle de la nouvelle évangélisation. Cette expropriation de nous-mêmes par le souci des besoins des autres pourrait constituer un milieu d’où émergerait et où s’enracinerait la conscience d’une responsabilité apostolique commune à laquelle serait, en un second temps, ordonnée l’organisation de notre vie matérielle concrète. La solidarité n’évoquerait ainsi pas seulement un fonds de ressources grâce auquel chacun pourrait réaliser, avec l’aide économique des autres, ses propres projets, mais plutôt une manière de vivre entre nous sur la base d’un souci commun de la Prédication qui nous rendrait davantage capables d’ajuster notre vie concrète aux besoins apostoliques réels assumés de manière solidaire par tous.
Prenons l’exemple de la formation initiale des frères, qui pourrait être l’un des éléments prioritaires de cette responsabilité commune, parce que la préparation des frères prêcheurs de demain doit réellement être le souci de tous. En ce domaine, on peut constater une réelle inégalité entre les frères de l’Ordre, qu’il s’agisse des ressources pour assurer la vie quotidienne des maisons de formation, des moyens d’études (bibliothèques, instruments de travail, inscriptions universitaires) ou de la possibilité de faire l’expérience de l’universalité de l’Ordre. Or, chaque frère en formation fera profession pour l’Ordre, et il nous faudrait trouver comment mieux assumer cette réalité d’un point de vue économique, de sorte que chacun puisse bénéficier des moyens nécessaires à sa formation et à ses études initiales. On pourrait souligner le même besoin de solidarité concernant les études académiques complémentaires et spécialisées par lesquelles les provinces ont le devoir de préparer des frères pour assumer cette dimension-là de la mission de l’Ordre. Déjà existent bien des réalisations de solidarité dans ce domaine de la formation entre certaines provinces, et la générosité de certaines entités est admirable. Nous pourrions sans doute améliorer encore l’efficacité de ce soutien en structurant davantage la solidarité au niveau de l’Ordre tout entier : ajustement et collaborations soutenues des nombreuses structures de formation existant dans les provinces déjà bien pourvues afin de libérer des forces, soutien des maisons de formation encore fragiles, bourses d’études, collaborations structurées pour l’enseignement, disponibilité pour renforcer les communautés de formation, etc…
Quand on parle de solidarité, la référence à l’Ecriture qui vient alors spontanément à l’esprit est celle de la première communauté décrite dans les Actes des Apôtres, où « Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun » (Ac 2, 44-45). L’enjeu, nous le savons bien, n’est pas seulement celui de partager avec d’autres, et encore moins de partager son superflu au gré de notre généreuse « bonne volonté ». Il est surtout celui d’avoir a priori de l’estime pour les besoins d’autrui, et de considérer que ces besoins sont aussi, en quelque sorte, les nôtres. Là où, parfois, nous sommes tentés de résoudre la question de la mise en commun du seul point de vue économique, il nous faut prendre plutôt le point de vue plus large qui sollicite aussi la solidarité pour aider à faire face à des besoins pour des tâches apostoliques ou des renforcement de communautés, à cause de notre responsabilité apostolique commune. Le péché de dissimulation, rapporté dans les Actes, n’est pas d’abord un mensonge, mais une désertion du souci de l’unité de tous qui suppose, de manière inconditionnelle, confiance et estime mutuelles. La mendicité est comme une école qui nous apprend comment adopter la position d’être mendiant de l’estime d’autrui pour nos besoins. La mise en commun des biens, de son côté, est une pédagogie de la vigilance du bien commun, fruit du souci des besoins d’autrui.
Renouveau dans l’Ordre
Cet appel à développer une culture de la solidarité est lancé par les derniers chapitres généraux en même temps qu’ils invitent à une restructuration de l’Ordre. Cette restructuration s’inscrit dans la perspective du renouvellement auquel nous invite la célébration prochaine du Jubilé de l’Ordre. Elle doit donc être définie non comme une rationalisation de nos structures mais comme la volonté d’ordonner au mieux nos modes d’organisation à la mission de prédication. L’enjeu est celui de la promotion et du soutien de la prédication de l’Ordre pour l’Eglise en de nouveaux lieux, ou en des lieux particulièrement difficiles. Dans ce cadre, il est essentiel de ne pas seulement prendre en considération les réalités fortes, organisées, bien établies et assurées. Le danger des restructurations, dans notre monde « globalisé », est en effet de donner la préférence aux plus forts, invitant les faibles à rejoindre les forts ou à se mettre sous leur protection, les exposant à l’arbitraire de la bonne volonté des forts. Dans notre effort de restructuration, nous devons au contraire prendre en considération la complémentarité entre toutes les formes de présence de la prédication de l’Ordre, plus ou moins fortes ou fragiles. Les commencements d’une nouvelle mission, par exemple, peuvent être fragiles et précaires, et demandent un soutien long et cohérent alors que, parfois, on voudrait porter très rapidement des jugements d’efficacité. On sait aussi que certains lieux de prédication particulièrement importants sont et resteront particulièrement vulnérables et peu souvent en mesure d’assurer la subsistance des prêcheurs, ce qui justifie de mettre en place une solidarité durable. Le seul point de vue possible est alors, une fois encore, celui de la responsabilité commune de la prédication, qui permet que, tous ensemble, nous nous donnions la possibilité de porter la Parole en des lieux plus difficiles où la fragilité et la précarité seront la condition même du témoignage évangélique.
Evidemment, une telle culture de la solidarité doit être placée dans le contexte global du monde. L’une des caractéristiques du « monde global » est l’écart qui s’élargit entre les riches et les pauvres. D’une certaine façon, cet écart s’élargit aussi entre nous – entre les provinces, et parfois même au sein d’une province entre les communautés. Cet écart s’élargit aussi entre nous et les couches les plus précaires de la population à laquelle nous sommes envoyés (moyens de déplacement et de communication, accès aux soins de santé, éducation…). Penser une culture de solidarité nous oblige ainsi à préciser le sens que nous voulons donner au fait d’être envoyés pour vivre en frères avec le monde et, par cette fraternité, témoigner de la Parole qui vient s’adresser à tous pour proposer l’amitié avec Dieu. En ce sens, la solidarité nous apprend à naître à la fraternité, tant au sein de nos communautés que dans notre relation avec celles et ceux à qui nous sommes envoyés.
La solidarité et les vœux
La solidarité n’est pas l’un des trois vœux classiques de la vie religieuse mais, dans cette perspective de la mendicité, nous pouvons comprendre comment une culture de la solidarité telle qu’évoquée plus haut concerne en fait les trois vœux classiques de la vie consacrée. Lorsque, dans l’Ordre, nous prononçons le voeu d’obéissance, nous demandons la grâce de consacrer notre vie à la Parole dans l’itinérance du prêcheur. D’une certaine façon, nous faisons vœu d’être mendiant, parce que prêcheur.
Aux premiers frères, Dominique demandait de lui promettre obéissance et vie commune. Il me semble qu’il insistait ainsi sur le lien entre la prédication et le travail de la fraternité, affirmant implicitement que le service de la prédication est intimement lié au mystère de la grâce par laquelle le Christ établit son Eglise comme Fraternité donnée au monde comme signe de l’espérance du salut. L’engagement à la vie commune n’est pas d’abord un engagement relevant d’une observance morale, mais bien plutôt cette attestation d’une espérance en ce mystérieux travail de naissance à la fraternité. Les premiers compagnons de prédication de Jésus l’ont vu se faire solidaire de l’humanité, solidaire de celles et ceux qui n’avaient pas leur place dans la société établie par les hommes – tels le lépreux, l’aveugle né et le paralytique, ou encore les publicains et les pécheurs dont il accepte de partager la table – solidaire de tous pour le salut de tous. Les disciples ont ainsi appris à vivre eux-mêmes cette solidarité (cf. Lc 8-10 ; Mt 10) comme un chemin privilégié pour la prédication. Les lettres apostoliques de Paul manifestent combien il pouvait être difficile pour les nouveaux croyants, au long du temps, d’établir entre eux de vrais liens de solidarité. Elles insistent sur le caractère essentiel de cet aspect économique dans la vie des disciples du Christ. Le témoignage de la vie fraternelle n’est pas celui d’un idéal moral déjà réalisé pleinement, mais bien plutôt celui de l’espérance que l’humain est capable de se convertir à la fraternité, en devenant progressivement solidaire des frères et sœurs qui lui sont donnés, inspiré par l’exemple même du Christ (2 Co 8-9, où St Paul propose un paradigme pour une réflexion théologique sur la solidarité entre les communautés chrétiennes). En ce sens, la fraternité solidaire est une modalité privilégiée pour « annoncer le Royaume ». La promesse d’obéir, d’écouter la Parole pour se laisser guider et mettre au service du bien de tous, scelle l’entrée dans la solidarité.
Toute conversion est, ultimement, œuvre de la grâce, mais il revient à qui la désire de se donner les moyens, et les conditions concrètes, pour se tenir prêt à être travaillé par cette grâce. De ce point de vue, nous pouvons dire que la manière de vivre le vœu de pauvreté est un des moyens de cette préparation. Nous ne pouvons nier un réel paradoxe dans nos vies religieuses : pauvres ou mendiants à l’origine, comme il a été facile, et rapide, de s’installer dans une vie plutôt « bourgeoise » et individualiste ! Ceci est vrai d’un point de vue collectif, et l’on comprend bien pourquoi Dominique voulait mettre en garde contre l’instinct de propriété, qui risque de nous attacher aux biens davantage que nous rendre disponible à la mobilité pour la prédication. Mais ceci est vrai aussi du point de vue personnel, ce qui se manifeste pour beaucoup d’entre nous qui, arrivés dans l’Ordre avec si peu de choses, devons à chaque nouvelle assignation organiser des déménagements de plus en plus importants tant nous avons accumulé livres et biens de tout genre, sans parler des positions sociales ou académiques. Le vœu de pauvreté est celui qui doit nous inviter, au jour le jour, à nous laisser désinstaller de cette tendance à « assurer » notre vie par nous-mêmes, pour préférer laisser les « relations vivantes » avec les gens (et avec les frères de notre communauté, de notre province) être, finalement, notre véritable assurance. C’est à partir de là qu’il sera donné à chacun « au centuple ».
Nous ne devons pas appartenir à des lieux précis qui se maintiendraient indifférents aux autres, mais nous devons plutôt accepter d’être faits solidaires dans les pays auxquels nous sommes envoyés. Il y a lieu de travailler ensemble pour gagner toujours davantage en simplicité et frugalité de vie, non par un malsain plaisir d’être un « héros » de la pauvreté qui conduirait à être imbu de soi-même, mais pour gagner en liberté intérieure, gagner aussi en confiance mutuelle qui nous permet de croire qu’il sera vraiment donné à chacun selon ses besoins. C’est souligner le lien essentiel entre le vœu de pauvreté et la détermination à mettre en commun nos biens. Or, il faut bien le reconnaître, la mise en commun des biens est l’une des plus grandes difficultés rencontrées dans les communautés, mais aussi dans les provinces entre les communautés. Chacun connaît les multiples stratégies qui tentent de détourner cet engagement et nous savons bien que c’est là un des points les plus difficiles de la vie commune. Faire l’expérience de cette difficulté est éprouver en notre propre expérience de la vie le défi que représente tout appel à la solidarité avec d’autres : la vie commune, dans le partage quotidien de la vie fraternelle, dans l’organisation capitulaire de la communauté, ainsi que dans la gestion concrète du bien commun, est en quelque sorte une « pédagogie » de la solidarité. De ce point de vue, porter en communauté le souci de vraies et fortes solidarités entre nous, c’est-à-dire entre les communautés et/ou les provinces, mais encore à établir de vraies solidarités avec les pauvres de notre monde est un appel à prendre au sérieux cet engagement à préférer organiser nos vies personnelles et communes sous le signe de la précarité plutôt que sous celui de la sécurité absolue. Encore et toujours, faire le choix de se laisser désinstaller et « exproprier de soi-même » …
Le vœu religieux de chasteté participe de ce même mouvement, invitant lui aussi à une certaine désinstallation affective. Après quelques mois dans une communauté vivant dans un milieu de grande précarité, en proximité avec de nombreuses personnes victimes de la pauvreté, un frère disait que, dans un tel apostolat, ce qui était en question pour les religieux était moins le vœu de pauvreté que celui de chasteté. En effet, la pauvreté subie n’est enviable par personne et ne saurait être considérée comme une « valeur » en soi. Mais l’engagement à la solidarité avec les pauvres appelle à approfondir, à cultiver davantage, l’engagement à la chasteté. C’est-à-dire la juste distance qui ouvre réellement un espace de liberté à chacun. La précarité à laquelle mène le vœu de chasteté dans le célibat continent est celle d’une certaine insécurité dans la solitude, faisant le pari que du manque naîtra une plus vive disponibilité à référer notre aptitude à la solidarité à la manière dont le Christ la réalise en son humanité. Ainsi, la chasteté conduit à la fois à une certaine attitude dans l’existence, mais aussi à l’apprentissage d’une certaine qualité de relation avec ceux qui sont dans le besoin, découvrant que la question n’est pas de combler les besoins, mais de lier les destinées en une relation de solidarité qui libère les uns et les autres.
Solidarité dans la mission et témoignage pour le monde
Au cours des visites dans l’Ordre, il est toujours très important de rappeler l’unité organique de notre Ordre, qui n’est pas une addition d’entités, chacune autonome, qui seraient contractualisées entre elles comme dans une « fédération », pas plus qu’une province n’est une addition juxtaposée de communautés, ni une communauté une juxtaposition de frères individuels. Cette visée d’une réalité « organique » (intégrative, en quelque sorte ; cf. LCO 1, VII) est, en elle-même, une forme d’annonce du Royaume : si nous aspirons à un monde dont le Dieu de l’Alliance pourrait accepter d’être le roi, et dans lequel l’humain ne chercherait plus d’autres « rois » fabriqué à sa propre image, il convient de chercher à en faire – avec les capacités humaines et les limites qui sont les nôtres – un monde habitable par tous. Un tel monde ne peut être réduit à une organisation contractuelle entre des entités ou individus autonomes ; il doit être un monde où les destins des uns et des autres sont liés en une même existence parce que liés en une même espérance en Dieu qui à la fois est source de la communion entre les humains, et sollicite leur participation active. Telle serait la prédication de la fraternité, à laquelle contribue très précisément l’engagement à la solidarité.
C’est dans cet horizon que l’on peut dire que, dans nos communautés, la question du rapport aux biens matériels, et à l’argent en particulier, est non seulement révélatrice de l’idée de la socialité que nous portons et souhaitons promouvoir, mais aussi de l’espérance réelle que l’on a en la puissance transformatrice du « travail de communion fraternelle » (cf E. Lévinas, « Socialité et argent, in C. Chalier et M. Abensour, Cahier de l’Herne. Emmanuel Lévinas, Editions de l’Herne, Paris, 1991, p. 134-138 – texte dans lequel la socialité désigne la dynamique des relations sociales qui organisent et déterminent une société et une culture). Les règles qui nous guident en ce domaine ne sont pas là pour « moraliser » la vie religieuse, mais bien plutôt pour l’inscrire d’abord dans son horizon théologique, et donner à nos pratiques concrètes des perspectives eschatologiques. C’est du point de vue de cet horizon (et avec la force de l’espérance qu’il peut donner) que l’on pourra oser affronter les failles éventuelles afin de les corriger (économie parallèle, résistance à la mise en commun des biens, consumérisme, sécurisation de la vie personnelle, priorité donnée aux liens familiaux ou aux soutiens privés sur la solidarité communautaire, alliances établies sur la base de dépendances affectives…). Ces corrections n’appellent pas d’abord des jugements moraux des personnes, mais bien plutôt une créativité dans la solidarité de la vie fraternelle. C’est aussi de ce point de vue théologique qu’on pourra oser définir des priorités en faveur des plus pauvres dans une communauté, des moins nantis, des moins productifs. C’est ce point de vue qui pourra guider les moyens mis en œuvre pour établir au sein de la communauté l’interdépendance de la solidarité (gestion en commun, donner à chacun selon ses propres besoins …).
Cet horizon sera aussi celui qui orientera les relations de solidarité au sein d’une province. Dans une province, certaines questions se posent souvent : la distinction entre des communautés riches et des communautés pauvres (parfois, les plus riches aident les plus pauvres, mais dans certains cas selon des critères qui relèvent de l’initiative des plus riches) ; il existe une inégalité entre les communautés qui rendent compte de leur gestion avec toute la transparence requise, et celles qui pratiquent une certaine dissimulation ; dans bien des lieux, des institutions apostoliques ont été créées qui promeuvent certainement la prédication, mais elles peuvent aussi progressivement être tentées de s’autonomiser par rapport à la province, quand elles ne sont pas exposées à ce que l’un ou l’autre frère responsable s’en fasse pratiquement le propriétaire. D’une manière plus générale, plusieurs provinces sont amenées à réfléchir sur les liens qui s’établissent progressivement entre les choix apostoliques et le souci de rentabilité économique : si cette dimension ne peut certes être ignorée, il s’agit d’éviter que, pour des raisons économiques non explicitées, les activités de prédication orientent nos solidarités du côté de ce qui assurerait notre propre sécurité. Il convient donc d’évoquer la relation qui peut s’établir au sein d’une province avec les communautés, les Instituts, voire les vicariats jugés peu participatifs. A propos de cela, trop souvent la réalité économique devient le premier, parfois le seul, mode de chercher à établir des relations avec d’autres.
A travers tous ces faits, comment l’Ordre révèle-t-il le monde ? Il est important d’en prendre conscience de sorte que l’on soit conscient de l’exigence radicale du travail de la communion fraternelle pour le monde. La question de l’option pour les pauvres est centrale parce qu’elle est un critère d’analyse, d’authentification, de décentrement (de qui nous faisons-nous les proches ?). Comment nos communautés se lient-elles par la solidarité, et partagent avec l’ensemble d’une province voire de l’Ordre leurs solidarités ?
Des questions se posent dans l’Ordre, en particulier concernant la santé et la formation initiale, qui sont deux domaines où se manifeste le plus d’inégalité entre nous. Mais on peut aussi interroger les liens de proximité avec tel ou tel milieu qui pourraient sembler assez incompatibles du point de vue de l’ensemble de l’Ordre. De même, on doit souligner une grande inégalité de la disposition de moyens de vie apostolique, ou d’insertion apostolique – c’est-à-dire aussi, parfois, de liberté apostolique. On peut, par exemple, accepter (voire demander) la responsabilité de paroisses pour vivre, au détriment d’une priorité donnée à l’approche éducative, ou à la promotion des pauvres, des femmes, ou à la protection des enfants.
Dans le fonctionnement de la solidarité entre nous, il est indispensable d’avoir des exigences de clarté, de transparence, de comptes rendus objectifs et précis. En même temps, il est important aussi de ne pas demander aux plus faibles, à ceux qui ont le plus de besoins essentiels, des comptes qu’on ne demande pas à ceux qui sont plus forts. Ainsi va le monde, certes, mais il est important de résister à cette tentation pour nous qui désirons annoncer une bonne nouvelle par la parole et par l’exemple.
Bâtir une culture de la solidarité
En réponse à la demande du Chapitre général de Rome, qui avait chargé le Maître de l’Ordre d’établir un « bureau de soutien à la mission » (ACG Rome 2010, 231), un Bureau de la solidarité – dont le nom est désormais Spem Miram Internationalis – a été mis en place depuis trois ans. Son objectif majeur est de promouvoir le développement de la culture de solidarité qui a été évoquée jusqu’ici et de gérer les fonds de solidarité dans cette perspective. Mais cette gestion doit trouver son sens dans les grandes lignes de cette culture de la solidarité, de même qu’elle trouvera sa pertinence pour promouvoir la solidarité à la mesure où une « culture commune de solidarité » sera soutenue par tous.
On peut identifier certains préalables à une telle culture. Elle doit s’appuyer sur une conscience apostolique commune et des priorités assumées ensemble. Il ne serait par exemple pas possible de développer une solidarité dans le domaine de la formation initiale si nous ne sommes pas tous convaincus qu’il est plus important de promouvoir la vocation de tous les frères pour l’Ordre, que de nous restreindre au seul souci de notre entité d’appartenance. Cela souligne à nouveau le fait que l’Ordre n’est pas une « fédération » de provinces, même s’il est très important que les entités aient de vrais enracinements locaux, culturels et ecclésiaux. Cet enracinement dans le « particulier » est essentiel pour que chaque entité contribue à promouvoir la mission de l’Ordre dans sa dimension de service de l’Eglise universelle. Une solidarité entre nous peut s’établir à la mesure où nous saurons développer une réelle connaissance et estime mutuelle des projets portés par les uns et les autres. Enfin, si nous voulons progresser dans la solidarité, cela suppose que chacun, chaque entité, soit animés par une vraie détermination à s’en tenir au « réellement nécessaire », mettant à disposition de tous tout le reste.
Dans cette perspective, je demande à toutes les entités, communautés et provinces, de réfléchir à une meilleure façon de vivre la solidarité au sein de l’Ordre. Il est possible d’identifier plusieurs formes de contribution à ce projet de solidarité : contributions régulières des communautés et des provinces aux fonds de solidarité de l’Ordre qui soutiennent les projets apostoliques et de formation des entités plus fragiles; collaborations pour la formation des jeunes frères ; alliance thématique (par exemple dans le champ de l’éducation ou de la protection de l’enfance) ; partage de nos « ressources humaines » (enseignants, pasteurs, experts) ; réponses partielles à des appels ; partage des « ressources relationnelles » (nous sommes parfois assez « jaloux » de nos bienfaiteurs !). Les communautés et provinces peuvent, chacune à leur niveau, décider de soutenir ces projets de solidarité de l’Ordre. Le Bureau Spem Miram Internationalis assure le suivi des projets à proposer au Maître de l’Ordre, et veille à ce que l’argent soit utilisé à bon escient de telle sorte que les communautés et provinces donatrices soient assurées de ce qu’il advient de leurs contributions généreuses (cf ; la page web de Spem Miram Internationalis, www.spemmiram.org, qui présente ces objectifs et les procédures de candidatures de projets, met à disposition les formulaires de soumission des projets, et montre les réalisations des projets soutenus par les différents fonds).
Il est évident aussi que la bonne dynamique de solidarité appelle un certain nombre de conditions : c’est, bien sûr, l’exigence de comptes clairs, de comptes rendus de ce qui est réalisé, de manifestation de gratitude ; mais c’est aussi une volonté de ne pas s’enfermer dans des attitudes de victimisation, de dépendance infantile. Un frère, il y a peu, me faisait prendre conscience que notre dynamique de solidarité entre nous serait probablement renforcée si nous trouvions comment déployer tous ensemble un projet de solidarité avec d’autres que nous. Il exprimait le rêve que cela soit une manière pour nous de célébrer le Jubilé de l’Ordre : donner au monde ce que nous avons reçu !
Ce pourrait être un point d’appui pour conclure cette lettre sur la culture de la solidarité. Bien sûr, nous avons besoin de développer davantage la solidarité entre nous, et cela sera un élément essentiel pour consolider l’unité de l’Ordre. Mais comme je le soulignais au début de cette lettre, une telle culture doit sans cesse se référer au fait que Dominique nous a transmis un Ordre qui a choisi d’être prêcheur en étant mendiant, imitant ainsi Celui dont nous voulons annoncer la venue dans le monde, Parole de vie se présentant comme mendiant l’hospitalité de l’humanité pour manifester qu’en le Fils, Dieu veut se faire solidaire du monde.
Votre frère,
- Bruno Cadoré, op
Maître de l’Ordre des Prêcheurs
Prot. 50/14/370 Letters_to_the Order
« Va dire à mes frères ! » : Les dominicaines et l‘évangélisation (2012)
Les dominicaines et l’évangélisation
Lettre du Maître de l’Ordre – Janvier 2012
fr. Bruno Cadoré, O.P.
 C’est cet appel du Christ à Marie, à l’aube de la résurrection, qui a été choisi comme thème de cette quatrième année de la neuvaine qui nous prépare à la célébration du Jubilé de l’Ordre. Intitulée « les dominicaines et la prédication », cette année nous invite donc à placer l’annonce de la résurrection à la source de notre mission de l’Ordre.
C’est cet appel du Christ à Marie, à l’aube de la résurrection, qui a été choisi comme thème de cette quatrième année de la neuvaine qui nous prépare à la célébration du Jubilé de l’Ordre. Intitulée « les dominicaines et la prédication », cette année nous invite donc à placer l’annonce de la résurrection à la source de notre mission de l’Ordre.
Cette phrase si simple du Christ a d’abord éveillé en moi le souvenir de l’émotion ressentie, il y a quelques années, dans l’église d’un village d’Irak. L’aube venait de se lever, et nous nous préparions à célébrer l’entrée au noviciat et la profession de jeunes frères. Dans l’attente de ce moment, se trouvaient là déjà dans l’église une foule de femmes, et parmi elles des mères et des sœurs, des amies, des sœurs apostoliques et des laïques dominicaines. Toutes ensemble, elles emplissaient l’église du dense silence de leur prière, alors que tout autour le pays souffrait du chaos, de la violence et des menaces. Dans le silence en la présence du Père, ces femmes priaient avec une telle intensité que, au cœur du chaos qui ravageait le pays et le déchirait par toutes sortes de divisions, elles portaient cette assurance que rien ne peut faire taire le message de la vie. Un jour, en ce monde, une aurore s’est levée par la naissance d’un enfant au pays de Judée, Prince de la Paix. Sa venue a repoussé pour toujours les ténèbres, en dépit des apparences et la nuit s’est définitivement déchirée lorsque, du creux de la mort infligée Il a donné la vie. Bien souvent, en ces lieux du monde où la violence prétend détruire et détruire tout lien social, les femmes, les mères, sont là comme des gardiennes de la vie qui attestent qu’en dépit des apparences, nul ne peut prétendre se faire maître d’une vie qui, d’abord, se reçoit pour être donnée. Va dire à mes frères ! Dis-leur la force de la vie, l’histoire inouïe de l’humanité qui, jour après jour, naît à nouveau dans l’Esprit de la vie offerte, jusque dans la Passion pour la Résurrection. Ces femmes d’Irak manifestaient l’horizon de la mission d’évangélisation : inscrire au cœur de l’histoire humaine la joie et l’espérance en la vie donnée du Christ pour que le monde vive, et apprendre à en être les témoins.
Dans la famille dominicaine, les femmes – moniales, sœurs apostoliques, laïques dominicaines, membres des Instituts séculiers – apportent une contribution essentielle à la mission d’évangélisation de l’Ordre. Plutôt que de parler de prédication, je choisis la définition de notre mission donnée au temps de la fondation de l’Ordre : totalement voués à l’évangélisation de la Parole de Dieu. Nous sommes de la famille des « prêcheurs », hommes et femmes, d’abord parce que nous engageons notre vie dans cette aventure de l’évangélisation qui, en quelque sorte, chacun selon son état de vie et son ministère, définit « la vie » que nous désirons mener avant de décrire des « actions ».
Va dire à mes frères ! Par cet envoi, le Christ charge Marie et les autres d’inviter l’Eglise à naître de la prédication. Cela évoque pour nous la première intuition de la prédication qui sera fondatrice de l’Ordre. Aux premiers temps de cette nouvelle aventure d’évangélisation menée par Dominique, ce sont en effet aussi des femmes qui viennent le rejoindre, puis des laïcs, comme pour donner d’emblée la figure que doit prendre l’évangélisation : une sorte de « petite Eglise », de communauté rassemblée par la puissance de la Parole entendue, rassemblée pour écouter ensemble cette Parole et la porter au monde. Comme dans la vie de Jésus – ainsi que l’écrit Luc (Lc 8, 1-4) – la communauté se rassemble en même temps qu’elle a l’intuition de devenir une « communauté pour l’évangélisation ». Dès l’origine déjà et aussi étrange que cela puisse paraître à cette époque, des femmes faisaient partie de la communauté qui s’était rassemblée autour de Jésus. Les catégories du monde n’ont pas leur place quand il s’agit d’être disciples. Imaginons cette communauté qui se constitue en suivant Jésus sur le premier chemin de l’évangélisation. Elle se rassemble au-delà des infirmités, failles, péchés, fragilités qui peuvent être guéries uniquement par Jésus. C’est à cause de sa miséricorde éprouvée de tant de manières diverses que la sainte prédication s’établit. Le voyant vivre et enseigner, les disciples ont probablement l’occasion de partager leurs expériences de rencontre personnelle avec Lui. Et les femmes de l’Evangile ont eu alors l’occasion de témoigner des paroles qu’Il leur avait adressées : Parole d’annonce de la résurrection, de reconnaissance de la foi et de promesse du salut, parole de vie et de pardon, de guérison et de confiance. Il leur parlait ainsi, les rejoignant au cœur même de leur être féminin, en cette familiarité avec la vie engendrée, en cette capacité de prendre soin et de protéger la vie fragile, en cette force aussi de confiance en la créativité et la résistance de la vie. Ces femmes seront avec Lui sur les chemins de l’enseignement, comme elles seront encore avec Lui sur le chemin qui le mène au Calvaire ; elles sont dans l’attente dans le jardin du tombeau, comme elles seront sur la route, courant annoncer aux apôtres qu’Il est ressuscité. La mission d’évangélisation a besoin de ce témoignage et de cette annonce pour savoir comment faire entendre au monde une Parole qui porte en elle la vie.
Depuis sa fondation, lorsque les premières « dominicaines » viennent rejoindre Dominique et que naît la « sainte prédication de Prouilhe », notre propre « communion pour l’évangélisation » qu’est la famille dominicaine a besoin d’être composée d’hommes et de femmes, de religieux et de laïcs, parce qu’elle a besoin d’être à l’image de la première communauté marchant sur les routes avec Jésus, apprenant de Lui comment aimer le monde et lui parler, comment chercher le Père et tout recevoir de Lui. C’est tous ensemble, dans la diversité et la complémentarité, comme dans le respect mutuel des différences et la volonté commune d’une égalité entre tous, que nous avons à mener ce « travail de la fraternité » dont nous devons être des signes dans le monde et dans l’Eglise. Une fraternité qui sait que l’égale reconnaissance de chacun souffre souvent de la mondanéité. En particulier, il y a encore beaucoup à faire pour que, ici et là, parole de femmes et parole d’hommes se valent, pour que soient refusées toutes les injustices et violences dont souffrent encore tant et tant de femmes dans le monde. Les dominicaines, dans l’aventure de la « sainte prédication » ont certes la charge de rappeler envers et contre tout que le monde ne peut se sentir « en paix » tant que ces iniquités ne sont pas résolues. Il faut apprendre à devenir sœurs et frères, à identifier les injustices, à les combattre, par ce long et beau travail d’écoute et de mutuelle estime. Mais elles ont aussi à signifier que l’évangélisation n’est pas d’abord une question de ministère mais une invitation à une certaine manière de vivre, entièrement vouée à ce que la Parole de Dieu soit une bonne nouvelle pour le monde. Au fond, nous passons souvent du temps à examiner d’abord ce qui nous distingue dans la famille dominicaine. Soyons d’abord attentifs à ce qui nous rassemble et nous unit : la grâce de la Parole de Dieu, sa vérité et sa force, sa vie et sa miséricorde. Les dominicaines et la prédication ? C’est d’abord le devoir que nous avons tous de partager avec elles ce qu’elles reçoivent et réalisent de la grâce de « l’évangélisation de la Parole de Dieu », afin que la communauté se construise et se consolide dans une mission commune.
Car, parler des dominicaines – moniales, sœurs, consacrées et laïques – c’est d’abord parler de la part immense qu’elles ont pris, et qu’elles prennent aujourd’hui dans ce travail de l’évangélisation, dans cet engendrement de l’espérance par « l’évangélisation de la Parole de Dieu » dans le monde. Les lieux de prière et de fraternité, de contemplation et d’hospitalité que sont les monastères de l’Ordre sont les premières pierres de la prédication. En ces lieux ce sont les appels et les besoins, les peines et les espoirs du monde entier qui sont repris dans la prière des sœurs et présentés au Père. La contemplation dominicaine est ainsi, de part en part, prédication. Il est bien impossible d’énumérer les innombrables engagements, amitiés et œuvres menés par les sœurs apostoliques de l’Ordre. Ce sont toujours des présences et des actes qui font de la Parole une bonne nouvelle pour leurs contemporains. Avec ce souci spécifique de trouver comment traduire le désir que « s’allume le feu » de la grâce de l’Esprit en ce monde. Souci manifesté au fil des siècles par leurs fondatrices ou fondateurs, dans des contextes où la place et la reconnaissance des femmes n’étaient pas évidentes. Pour les sœurs laïques, dans leurs familles, leurs groupes d’amitié, leurs lieux professionnels, c’est encore cette grande créativité et diversité qui se manifestent pour donner à voir, et à entendre, la Parole comme une bonne nouvelle d’où peut naître l’espérance de la résurrection.
Parlant des dominicaines et la prédication, je ne voudrais pas développer le thème de la complémentarité, si évidente, ni non plus celui du ministère ordonné de la prédication. Comme on l’aura compris, la question n’est pas d’abord ce que l’on fait, mais ce que l’on apporte au bien commun de la sainte prédication, et comment tous ensemble nous pouvons nous organiser pour recevoir ce qui est offert. Les dominicaines, je crois – mais c’est à elles qu’il revient de l’exprimer – apportent à la sainte prédication une expérience spécifique de la relation au Christ, une manière particulière d’étudier la Parole, un mode précis d’organisation de leur fraternité, une vulnérabilité à ce qui fait naître et mourir le monde qui leur est propre, une façon de dire Dieu. Elles apportent aussi la grande diversité des interprétations de l’intuition dominicaine telle que leurs fondatrices la leur ont transmise, et tout spécialement une compréhension fulgurante, à un moment donné de l’histoire humaine, de l’actualité de l’intuition de Dominique dans tel ou tel contexte, ou milieu, pour telle ou telle tâche du service de l’humanité. Va dire à mes frères ! Tel serait peut-être ce qu’il faudrait que nous enseignent nos sœurs, laïques et religieuses. Tel serait aussi, sans doute, ce que les frères pourraient avoir envie d’apprendre. Apprendre le monde ensemble, et en cette année tout particulièrement les frères par les sœurs et les sœurs entre elles au-delà des divergences, pour laisser s’ouvrir au cœur de la sainte prédication d’aujourd’hui une soif de la Parole de résurrection. Dans une famille, les liens les plus solides et les plus beaux sont souvent ceux qui se tissent par le partage des joies et des peines, par l’offrande mutuelle des amitiés partagées, par le soutien mutuel quand l’épreuve du monde nous fait douter de savoir comment y trouver notre avenir. Dans une famille, n’est-ce pas bien souvent les femmes qui font le lien, garantes du lien entre les êtres parce qu’elles engendrent à la vie, elles qui inspirent suffisamment confiance pour que l’ensemble des membres aient le désir de naître à nouveau dans la fraternité et dans la filiation ? Et pour nous, dans la famille de Dominique, le désir d’apprendre à écouter et à aimer le monde comme des filles et fils du Père et comme des sœurs et frères de l’humanité, le désir d’être, dans ce monde, comme des « sacrements de la fraternité ».
Va dire à mes frères ! Il me semble qu’il faut évoquer, parlant des dominicaines dans leur lien avec la prédication, l’expérience difficile que font, aujourd’hui, plusieurs congrégations de sœurs apostoliques et plusieurs monastères de l’Ordre. Après des années de déploiement, voilà que ne s’annonce pas la relève pour l’avenir. C’est rassemblés que nous devons traverser cette épreuve, à la fois en soutenant chacun dans sa spécificité et son autonomie, mais aussi en attestant que la mission de la prédication, portée ensemble, d’une part est redevable de tout ce qui a été semé et, d’autre part, est plus grande que la mission spécifique d’une institution donnée. Je ne peux ignorer comme cela peut être difficile d’affronter concrètement une telle épreuve, de manière réaliste et créative, sans résignation et sans obstination. Il nous faut « passer » du côté de la véritable espérance de la vie, quand quelque chose de la mort se donne à percevoir lorsque l’on doit fermer des maisons en grand nombre et porter trop de sœurs aimées en terre. Pour faire ce passage nous avons besoin, absolument, de nous tenir solidaires et unis afin de préparer l’avenir de la mission de la sainte prédication à partir des forces présentes. Sans rêver ce qu’elles ne sont pas, sans déterminer ce qu’elles devraient être. Mais en recevant, simplement, la grâce des vocations données et en les ordonnant à la mission commune portée par tous. La consécration et la vie religieuse doivent ouvrir notre espérance aux dimensions du monde, et pour le monde, et nous garder de vivre tétanisé dans le souvenir des gloires passées, ou la paralysie des difficultés présentes. On entend souvent dire que, dans bien des parties du monde, la vie religieuse apostolique – et donc dominicaine aussi – est très vieillissante et ne pourra pas se renouveler comme elle était jadis. Certes. Mais, il y a une grande aventure à vivre dans la vieillesse, qui peut rendre grâce d’avoir été si féconde pour la vie de l’Eglise et de tant et tant de communautés humaines : pouvons-nous, ensemble, apprendre à nous laisser porter par la légèreté de l’action de grâce plutôt que décourager par le poids de l’avenir perdu ? Surtout, nous en sommes tous convaincus, la sainte prédication a besoin, absolument besoin, de la contribution de femmes dominicaines y consacrant totalement leur vie : c’est donc réunis, et à partir de ce qui déjà est bien vivant, que nous devons en préparer les figures possibles. Cette nécessité, cette urgence, d’appeler des femmes à rejoindre la mission de l’Ordre sous ses différentes formes possibles, est l’affaire de tous les membres de la famille dominicaine, les hommes autant que les femmes.
Comme au temps de la prédication de Jésus, comme aux temps apostoliques, comme aussi au temps de la fondation de l’Ordre, en un temps où l’Eglise souligne l’urgence de l’évangélisation, la famille de saint Dominique, « famille pour l’évangélisation » a aujourd’hui plus que jamais le devoir de se laisser constituer par la fraternité qui « prêche la Parole ». Va dire à mes frères…
Belle et heureuse année à toutes et tous!
Rome le 13 janvier 2012.
Bruno Cadoré, o.p.
Maître de l’Ordre
____________________________
Laudare, Predicare, Benedicere. Lettre sur la célébration liturgique des Heures. (2012)
Les défis posés à l’Ordre des Prêcheurs par la nouvelle évangélisation dans la postmodernité (2012)
Rencontre de l’IEOP, Lisbonne, jeudi 12 avril 2012
par Bruno Cadoré, o.p.
Le défi de la nouvelle évangélisation au cœur de la mission de l’Ordre
 Depuis l’émergence de ce concept de « nouvelle évangélisation », bien des définitions ont été proposées et discutées. Dans une conférence donnée en 2000, par exemple, le Cardinal Ratzinger centrait sa réflexion sur le fait qu’il s’agissait d’entendre la question de l’homme : comment peut-on devenir un homme, apprendre et cultiver l’art de vivre la vie humaine, en une époque où beaucoup ne savent plus goûter la joie profonde de vivre. « Une grande partie de l’humanité d’aujourd’hui ne trouve plus, dans l’évangélisation permanente de l’Eglise, l’Evangile, c’est-à-dire une réponse convaincante à la question : comment vivre ? ». Le défi est alors de savoir comment donner accès à l’Evangile à celles et ceux qui ne rencontrent pas, ne sont pas rejoints, par l’évangélisation classique (la célébration de l’eucharistie, des sacrements, la prédication…). C’est pourquoi il convient de chercher de nouvelles structures et de nouvelles méthodes pour évangéliser.
Depuis l’émergence de ce concept de « nouvelle évangélisation », bien des définitions ont été proposées et discutées. Dans une conférence donnée en 2000, par exemple, le Cardinal Ratzinger centrait sa réflexion sur le fait qu’il s’agissait d’entendre la question de l’homme : comment peut-on devenir un homme, apprendre et cultiver l’art de vivre la vie humaine, en une époque où beaucoup ne savent plus goûter la joie profonde de vivre. « Une grande partie de l’humanité d’aujourd’hui ne trouve plus, dans l’évangélisation permanente de l’Eglise, l’Evangile, c’est-à-dire une réponse convaincante à la question : comment vivre ? ». Le défi est alors de savoir comment donner accès à l’Evangile à celles et ceux qui ne rencontrent pas, ne sont pas rejoints, par l’évangélisation classique (la célébration de l’eucharistie, des sacrements, la prédication…). C’est pourquoi il convient de chercher de nouvelles structures et de nouvelles méthodes pour évangéliser.
Dans Redemptoris Missio, le Pape Jean-Paul II écrivait : « L’Eglise doit affronter d’autres défis, en avançant vers de nouvelles frontières tant pour la première mission ad gentes que pour la nouvelle évangélisation de peuples qui ont déjà reçu l’annonce du Christ », soulignant la nécessité d’une force spirituelle pour un renouvellement de l’Eglise. Il écrivait encore, concernant spécifiquement l’Europe : « L’Europe ne doit pas purement et simplement en appeler aujourd’hui à son héritage chrétien antérieur : il lui faut trouver les capacités de décider à nouveau de son avenir dans la rencontre avec la personne et le message de Jésus-Christ » (Ecclesia in Europa, 2002, 2). Dans cette même perspective de renouvellement, le Pape Benoît XVI évoquait les « parvis des Gentils » (Audience à la Curie romaine, 21.12.2009, 40).
D’une certaine manière, toutes les définitions proposées mettent cet appel en évidence et c’est ce que je vous propose de retenir comme un appel pressant lancé à l’Ordre des Prêcheurs qui a été fondé pour l’évangélisation, tout particulièrement à un moment de l’histoire de l’Eglise où se posait cette question de la méthode et des structures. Diègue et Dominique, en effet, n’ont-ils pas proposé l’aventure de la prédication itinérante et mendiante en réponse à des méthodes qui paraissaient inadaptées pour répondre aux mouvements des « Purs » qui, contestant certaines pratiques et postures ecclésiales, prônaient un retour à l’évangélisme ? C’est donc un défi majeur pour l’Ordre que de prendre part, selon son charisme propre, à ce mouvement d’évangélisation, spécialement en ces temps où se prépare la célébration du Jubilé.
J’aime bien reprendre la formule utilisée dans la traduction française de nos Constitutions : l’Ordre est composé de frères totalement dédiés à l’évangélisation de la Parole de Dieu. Totalement dédiés à faire la Parole de Dieu être une bonne nouvelle pour le monde. Cette définition (à partir de laquelle, nous dit-on, Dominique enverra ses frères pour « étudier, prêcher et fonder des couvents ») nous permet en effet de souligner trois dimensions essentielles de la vocation des prêcheurs :
- Elle est centrée sur la Parole, l’économie du Verbe qui vient dans le monde et qui est « le chemin, la vérité et la vie ». Cela oriente notre vie tout en même temps vers la contemplation, l’étude et l’interprétation de l’Ecriture, promesse et révélation de l’accomplissement de l’Alliance dont nous sommes les serviteurs, et vers la joie d’une rencontre personnelle avec Celui qui est l’accomplissement et nous appelle ses amis.
- Ainsi pouvons-nous dire que cet « engagement pour la Parole » est ce qui constitue notre « consécration » religieuse, plaçant ainsi l’office de la prédication au cœur de la vie du prêcheur.
- Ceci souligne alors que c’est bien la vie globale du Prêcheur qui est concernée (cf. l’insistance de Dominique pour la manière dont serait nommé l’Ordre qu’il demande au Pape d’instituer), engagée dans le processus de la nouvelle évangélisation. Il ne suffira pas de parler de nos diverses « fonctions » de prédication, mais bien de la vie choisie à la suite de Dominique pour vivre dans le monde, comme par analogie, l’itinérance amicale et fraternelle de Jésus (« Dieu a manifesté la tendresse et l’humanité de son Fils en son ami Dominique, qu’Il vous transfigure à l’image du Christ »).
En relisant les Lineamenta préparatoires pour le prochain Synode qui sera consacré à la nouvelle évangélisation, on peut identifier comment ces propos se situent dans le contexte contemporain (qui, si je comprends bien, est celui que vous désignez ici comme « postmoderne »). Ces propos insistent sur trois points :
- C’est d’abord un contexte général : nous vivons « un moment historique, riche en changements et en tensions, en perte d’équilibre et de références ». Et, plus loin « Cette époque nous pousse à vivre en étant toujours plus immergés dans le présent et dans le provisoire, ce qui rend toujours plus difficiles l’écoute et la transmission de la mémoire historique, ainsi que le partage des valeurs sur lesquelles construire le futur des nouvelles générations ».
- Dans ce contexte, l’Eglise est affrontée à de grandes mutations, et se trouve être objet de critiques par rapport à elle-même comme institutions énonçant des discours, ou par rapport au visage de Dieu qu’elle annonce. L’on voit mettre en questions des pratiques jusqu’alors affermies, et s’affaiblir les parcours habituels de la vie croyante.
- Et pourtant c’est dans ce contexte, et avec ses propres fragilités et incertitudes, que l’Eglise doit déployer l’évangélisation comme dimension essentielle de sa nature, en particulier dans six « scénarios » caractéristiques :
- Culturel, marqué par la sécularisation, le relativisme et le culte stérile de la personne ;
- Les migrations, qui sont une des dynamique de la mondialisation ;
- Les moyens de communication : « culture médiatique et numérique qui se structure toujours plus comme le lieu de la vie publique et de l’expérience sociale ». La culture contemporaine serait marquée par l’éphémère et l’immédiat, renonçant ainsi à la mémoire et à l’orientation vers le futur ;
- Economie ;
- Recherche scientifique et technologique ;
- Politique et recherche de la paix et de la libération des peuples
Que seraient, dans ce contexte, les moyens de l’évangélisation ? Il s’agit de développer la capacité à une interprétation critique, de renforcer l’approche spirituelle, d’inventer de nouvelles manière d’être l’Eglise. Les grands enjeux sont alors : transmettre la foi en proposant la rencontre personnelle avec Jésus, à un moment où l’on semble privilégier pour les Eglises leur système de valeurs, ou leurs institutions, ou l’influence qu’ils pourraient avoir sur les jeux d’influence; transmettre la foi vécue par l’Eglise elle-même; mettre la Parole de Dieu au centre de tout; élaborer une pédagogie de la foi ; penser aux Eglises locales; rendre raison de la foi. On le voit, il est alors important d’initier à l’expérience chrétienne en ayant le souci de : processus, éducation à la vérité, écologie de la personne humaine, témoignages.
La postmodernité ? L’Ordre dans le monde de ce temps
Il ne s’agit évidemment pas ici d’engager une discussion sur le concept de « postmodernité » qui, comme la « nouvelle évangélisation » a reçu diverses définitions (de Lyotard à Agamben, de Maffesoli à Lipovetski, de Derrida à Nancy..). On peut, ici encore, retenir quelques éléments communs entre toutes ces définitions, comme le fait par exemple l’article consacré à ce concept dans Wikipedia :
- Un nouveau rapport au temps, où il n’est pas question seulement de tradition ni de progrès vers l’avenir (il n’y a plus de promesse d’avenir crédible), mais plutôt d’emphase mise sur l’immédiateté, le « tout est possible », l’ « éblouissement de la liberté », la place centrale donnée à l’imaginaire.
- Une fragmentation de l’individu et des sociétés, aboutissant à l’émergence de groupes d’identité, de tribus, de références communautaristes.
- De nouveaux modes de régulation des pratiques sociales selon lesquels l’efficacité l’emporte sur la légitimité, les comportements sont appréciés surtout par leur capacité adaptative, la science est d’abord perçue comme « instrumentale », le paradigme général d’organisation sociale est celui de la « résolution de problèmes » (ce qui d’ailleurs doit rendre prudent lorsqu’on cherche, dans l’Eglise par exemple, à trouver les moyens de résoudre les « problèmes » que pose la postmodernité à la manière usuelle d’évangéliser !)
M’inspirant de l’anthropologue Marc Augé (Non lieux, 1992), il me semble plus juste de parler de « surmodernité ». En effet, le « post » ferait penser qu’après la modernité on serait passé à autre chose, alors qu’on peut faire l’hypothèse que le contexte contemporain correspond à la poursuite de l’accomplissement de la raison moderne objective, laquelle se trouve, par ses propres productions, désorientée, désenchantée et en perte d’utopie. On peut, à titre d’exemple, citer l’efflorescence des attentes éthiques du monde contemporain, qui peuvent être interprétées comme les ultimes tentatives de la raison de maîtriser précisément ses propres productions dont les conséquences lui échappent, et imagine pouvoir en cadrer la maîtrise par le recours à la raison pragmatique ou aux identitarismes de divers systèmes de valeurs, où l’éthique est plus instrumentalisée que convoquée pour penser un monde en commun. Il y aurait là, d’ailleurs, à réfléchir au signe de contradiction que pourrait, que devrait, constituer les religions chrétiennes qui, même si elles sont souvent invitées à énoncer leur propre système de valeurs (et elles le font souvent d’elles-mêmes comme pour mieux prendre une place d’influence dans le débat), doivent d’abord affirmer qu’elles se définissent par l’amitié avec une Personne, et l’espérance en un avenir.
Pour Marc Augé, la surmodernité est marquée par trois réalités « excessives » :
- L’excès du temps : on assiste à une surabondance événementielle qui génère le besoin de donner sens au présent comme au passé. Ce trait renvoie les chrétiens à leur propre rapport à la mémoire et à l’avenir. Par exemple, là où l’on voit des identitarismes chrétiens se structurer autour d’un rapport au passé, cherchant légitimement à connaître et à ancrer leur témoignage et leur réflexion aujourd’hui dans une connaissance réelle, mais critique, de leur tradition propre (plurielle), il est important de se souvenir que le christianisme se définit comme une religion pour un avenir promis qui n’est pas fait de mains d’hommes, et doit bien affirmer que son « identité » d’un moment ne saurait être sa mission. On pourrait ici faire référence à ce mot de l’Akan du Ghana, désignant un oiseau mythique, Sankofa : san (retourne), ko (va), fa (ramène), désignant le fait que « la sagesse qui permet de tirer les leçons du passé construit l’avenir ».
- L’excès d’espace manifesté par : la surabondance spatiale et un changement d’échelle de la vision et de la connaissance du monde, la mondialisation de l’information, l’accélération des moyens de transport. Un signe de cet excès peut être celui de la prolifération des « non-lieux », ces lieux de passage et de circulation qui se ressemblent partout (cf. les aéroports, les gares, les centres des villes modernes, les banlieues les plus périphériques…), et forment une sorte d’universel abstrait. Ici, on pourrait lire une sorte d’effacement de la médiation du « particulier », laissant le singulier des individus s’affronter directement à l’universel. Cela touche une des difficultés, me semble-t-il, rencontrée dans la vie de l’Eglise lorsque la réalité des communautés ecclésiales s’efface ou se fragilise, laissant les individus singuliers en confrontation directe avec la réalité, si peu tangible, d’une institution ecclésiale universelle. Ainsi se construisent les conditions pour un relativisme subjectif.
- L’excès d’individu, où l’individu lui-même se veut un monde et où les références s’individualisent au point de rendre difficile une affirmation collective de sens. Ce dernier excès pourrait d’ailleurs nous aider à comprendre que, lorsque nous répétons si facilement que les individus de la jeune génération sont fragiles, il s’agit plutôt de désigner la fragilisation extrême des « espaces intermédiaires », de ces lieux d’hypostase inchoatives de l’universel que sont les communautés humaines particulières, lesquelles représentent des « espaces transitionnels » permettant habituellement aux individus de se mettre en jeu, c’est-à-dire de déployer leur propre créativité, en se projetant dans le particulier.
Après cet intermède un peu théorique, je vous propose maintenant d’énoncer quelques hypothèses de « défis pour l’Ordre », en écho à ces trois excès.
Des défis pour l’Ordre
Vie des frères et des communautés : une place pour le sujet dans le temps et l’espace
Dans l’Ordre, l’excès de l’individu de la surmodernité lance un défi particulier à la structure même de notre vie, à la place donnée à chacun dans nos communautés, et à la place de ces dernières dans la vie de chacun. Il me semble que cela souligne certains aspects importants pour aujourd’hui.
- La communauté représente l’espace transitionnel évoqué plus haut. Autrement dit, nous devons prendre soin de la qualité de la vie commune, en tant qu’elle est l’instance du particulier qui, en quelque sorte, nous « éduque » à l’universel. Nous pouvons ici parler des « communautés humanisantes », et de la manière de les organiser de sorte que chacun y trouve le chemin de sa propre humanisation. Mais c’est aussi la manière « capitulaire » de notre vie qui est ici mise au défi. Comment la « communion fraternelle » comme idéal évangélique peut-elle être réellement un horizon structurant pour les individus ? Ici, par exemple, se pose la question du fonctionnement concret des chapitres, non seulement conventuels mais encore provinciaux (selon que la majorité des capitulaires portent avec eux des « saintes prédications » enracinées en un lieu, ou sont des délégués de groupes de frères, l’enjeu de la démocratie n’étant alors pas exactement le même). Recevoir la communion comme une tâche personnelle, avant d’avoir à faire entendre sa voix pour orienter la construction de la communion.
- L’engagement dans le temps. Dans plusieurs lieux de l’Ordre, je constate que l’on cherche à s’adapter aux nouvelles conditions du discernement et de la décision d’engagement qui semblent marquer l’individu moderne. Cela aboutit, par exemple, à choisir des modes de « renouvellement des vœux » à brève échéance. Si la pertinence adaptative de ce choix peut être argumentée, il me semble qu’on pourrait tout autant argumenter la proposition de l’engagement sur un terme plus long : le fait de pouvoir s’engager pour trois ans, dans une certaine durée, ne serait-il pas un service rendu à la tentation, l’éblouissement de l’immédiateté ? Et ne serait-ce pas aussi un acte d’engagement important pour la constitution même de la communauté qui discerne et vote ? Comment donner une certaine place à la « durée de Dieu », face à l’éphémère de l’engagement humain ?
- Les tentations de l’identitarisme peuvent se repérer à plusieurs niveaux dans la vie concrète de l’Ordre. J’en soulignerais quelques-uns. C’est l’identitarisme « jeuniste » qui fonctionne parfois (l’inverse aussi, du reste). C’est l’identitarisme du formalisme religieux parfois. Ce peut être aussi la question liturgique qui fonctionne comme repère identitaire. Dans tous ces cas, comment pouvons-nous discerner ce qui, au fond, sera un renforcement du subjectivisme ? Un tel renforcement du subjectivisme présente comme écueil majeur celui du relativisme, pour lequel le sujet, dans son isolement ou, mieux, dans son « autoréférence », est la première et la seule mesure de la réalité. De ce point de vue, il me semble que c’est le risque encouru aujourd’hui à propos de la question des deux formes, ordinaire ou extraordinaire, du même rite romain. La question se pose peu dans nos communautés, mais je constate que lorsque c’est le cas l’évaluation du besoin, de la supériorité de sens et de valeur, de la qualité esthétique, du jugement des années et acteurs passés, est principalement élaboré par le sujet, à un moment, et selon un mode que lui seul détermine. Ce risque relativiste absolutise le passé, en même temps qu’il le tient à l’écart de tout regard ou étude critique (par exemple, pour l’ancien rite dominicain, aucune étude sur les évolutions de ce rites entre les années 1969 et 1965), de même que l’approche subjective s’affranchit elle-même de toute référence à des décisions capitulaires qui engageaient l’Ordre tout entier.
- On pourrait aussi appliquer la notion de « lieu transitionnel » à nos couvents : bien souvent, ils se présentent comme un lieu de médiation entre le monde extérieur (pourrait-on dire « sécularisé ») et le monde du « religieux », où l’horizon d’espérance chrétien (et, pour nous, catholique) est parfois clairement perçu, voire recherché, mais plus souvent sans doute découvert par surprise, avec intérêt ou dans l’indifférence. Nos lieux conventuels sont par exemple parfois situés près d’une église d’un centre ville, où passent non seulement des fidèles habitués, mais aussi des touristes et, surtout peut-être, des « errants » des villes modernes. Nous avons à faire un choix : ou bien être ainsi situés sans y adapter notre approche pastorale, ou bien saisir cette opportunité pour travailler la thématique transitionnelle : comment soutenir le processus de projection des « passants », de sorte qu’ils puissent puiser le plus authentiquement possible dans la tradition portée par ces lieux, l’énergie de leur quête de sens et de vérité ? Le lieu de « culte » deviendra alors bel et bien le lieu de la religion, donné au monde pour inviter à cette quête de vérité.
Une religion de la mémoire et de l’espérance : un temps pour le sujet et pour le monde
La recherche de la réponse la plus adaptée possible à ce que nous percevons des besoins d’évangélisation peut aboutir à un réel activisme, que je qualifierais plutôt de plongée dans le fonctionnalisme. Il y a des besoins de prêtres, d’enseignants, de divers services ecclésiaux ; ou encore il y a des innovations à expérimenter, ce qui peut justifier une sorte de fuite dans l’action (ce fut particulièrement net au moment des premières expériences sur Internet par exemple). Comme à cela s’ajoute une considération réaliste des besoins économiques, ceci justifiant cela, les fonctions se multiplient, et se juxtaposent souvent dans nos communautés. Il me semble que cela appelle certaines vigilances ;
- La vigilance sur la célébration centrale dans la vie des communautés, la célébration non d’abord comme exercice à accomplir car il nous faut « dire l’office », mais la célébration comme moment et espace où le temps présent est doublement saisi par la mémoire et l’espérance, et à ce titre devient temps et espace de prédication. On pourrait ici réfléchir à la célébration eucharistique communautaire, souvent effacée du fait des besoins de l’exercice de la fonction presbytérale de chacun.
- La vigilance à être enraciné en un lieu concret, à établir des liens vivants avec des gens, à faire que ces liens constituent la force même de la communauté et des liens fraternels entre ses membres. Ici encore, on peut faire référence à la pratique des chapitres.
- La vigilance à ce que la Parole soit au centre de l’édification de la communauté. On peut ici se rappeler quelle était la fonction, au moment de la fondation, d’un lecteur dans une communauté. Ne s’agissait-il pas de commenter théologiquement l’Ecriture ? Comment pourrions-nous mettre au centre de la communion fraternelle une telle étude en commun qui rapporterait notre risque de la fragmentation des personnes et des groupes, à ce qui en promet, au contraire, l’unité ?
Une mission universelle : élargir l’Eglise aux dimensions du monde
Evidemment, il faudrait ici évoquer diverses expériences nouvelles lancées ici et là précisément pour mieux relever le défi de l’évangélisation (rejoindre et rencontrer ceux que l’évangélisation classique de l’Eglise ne rejoint peut-être pas). Je me permets ici d’en citer quelques-unes, sans chercher à être exhaustif.
- le monde d’Internet, comme un monde, comme une culture avec laquelle il s’agit de dialoguer, dialogue à partir duquel pourrait s’élaborer un nouveau langage de la prédication, c’est-à-dire aussi de nouvelles « postures » de prédication ou d’enseignement.
- les églises conventuelles au centre des villes, centres qui ont changé au fil du temps et se trouvent aujourd’hui être des lieux de passage, en même temps d’ailleurs que des lieux d’errance paradoxale au cœur même de la foule
- les centres de conférences et de rencontres, que l’on pourrait désigner comme des lieux de « parvis », de « seuils », où l’enjeu pourrait ne pas être d’abord de délivrer un message ou un enseignement mais de rencontrer, d’écouter, de chercher à connaître et à comprendre
- la démarche dite de Salamanca, qui permettrait d’établir, au sein de l’Ordre universel, un lien entre des expériences pastorales difficiles en monde de grande précarité et insécurité, et la réflexion académique théologique en dialogue avec d’autres disciplines
- des lieux d’accueil et de célébration sur des routes de pèlerinages, si prisées aujourd’hui par nos contemporains qui, marchant avec eux-mêmes animés par une quête souvent indicible, peuvent rencontrer Quelqu’un qui s’adresse à eux
Mais je voudrais aussi, sur ce point, évoquer des vigilances qui me paraissent indispensables en écho aux excès évoqués plus haut.
- Le propos universel de la mission est un événement fondateur, ce qui doit souligner l’action au cœur de l’Eglise dans le souci de l’unité, de la dimension communautaire de l’engagement pour la Parole, de la dimension de la famille dominicaine (les femmes, les laïcs, les prêtres, …). Là où l’espace anonyme peut renforcer la solitude du sujet, la perspective universelle du déploiement de la vocation de la prédication, d’une part, celle aussi de l’élargissement de l’Eglise comme demeure pour le monde, sont de nature à renvoyer les sujets nos pas à leur solitude isolée mais plutôt à leur capacité d’alliance avec d’autres. En ce sens, le témoignage des communautés est essentiel, au moment où la tendance est plutôt de valoriser les témoignages personnels et les réalisations individuelles. C’est en ouvrant nos communautés aux dimensions interculturelle et internationale que nous pouvons apprendre, les uns des autres, cet inachèvement de l’universel. Mais c’est aussi en ouvrant nos communautés à l’extérieur d’elles-mêmes que nous pouvons proposer le témoignage de l’intérêt d’une telle ouverture, en laquelle Dieu vient se manifester. Dans les deux cas, il est question de rendre possible une rencontre personnelle de Jésus, à travers le lien communautaire, pour les frères ou pour les gens. Où il est question, une fois encore, d’espace transitionnel. (j’ajouterais ici le souci à avoir de donner place aux diversités ecclésiales dans une même communauté, en évitant les dérives subjectivistes que j’évoquais plus haut.)
- La tâche de la raison critique est probablement aujourd’hui une urgence. Dans l’Ordre, nous aimons dire que l’étude est l’une des premières observances, autrement dit l’un des premiers modes de l’ascèse, de cette recherche de la distance entre soi-même et soi-même qui permet de laisser ouvert et libre de trop de projections, le champ de la manifestation du Nom de Dieu. Le travail de la raison est donc bel et bien celui de la recherche de la vérité, d’une vérité qui ne peut se construire de mains d’homme à une période de l’histoire où, précisément, toute quête de sens fait l’objet d’une volonté de maîtrise rationnelle. C’est dire la pertinence et l’urgence aujourd’hui d’une étude philosophique et théologique qui prenne la peine d’identifier les théories et philosophies qui « interprètent » le monde (les philosophies contemporaines, dans la suite de l’histoire de la philosophie), ou cherchent à en acquérir une connaissance interprétative de la réalité susceptible de donner le pouvoir de la maîtriser et de la transformer. On dit de Dominique qu’il envoyait ses frères « étudier, prêcher et fonder des couvents ». Notons-le bien, on ne dit pas « enseigner, prêcher…), mais « étudier ». Etudier avec les autres, apprendre quelles sont les connaissances de l’homme contemporain et en quoi elles le stimulent à maîtriser le monde. Cette « étude en commun » est probablement l’un des pas indispensables pour avoir l’audace de proposer la tenue de « Parvis des Gentils », où les « Gentils » ne seront pas d’abord des gens à qui nous avons à parler mais qu’il convient d’écouter et de comprendre, où ils ne seront pas non plus d’abord des êtres qui seraient en déficit de « sens », voire d’« âme », mais d’abord des manifestation de la capacité créative de l’intelligence humaine, trace de sa création par Dieu pour les croyants. Il y a aujourd’hui une urgence à l’étude de la maîtrise technique et scientifique du monde, parce qu’elle constitue la ligne de fond de la culture contemporaine, mais aussi parce que, ce faisant, elle produit aussi les mythes modernes à travers lesquels le sujet contemporain s’identifie.
- Coopérateurs pour l’Eglise. Il me semble évident que l’Eglise doit se préparer à des mutations très importantes dans les années qui viennent. Evidemment, en Europe, cette question est dominée par celle de la réduction des assemblées de croyants et, par conséquence logique, de la diminution du nombre de vocations presbytérales. Mais ce sont aussi, et peut-être est-ce bien plus important, les changements dans les structures constituant la base de l’assemblée ecclésiale : les paroisses territoriales sont en réorganisation, et elles le sont à partir du nombre de prêtres plus souvent qu’à partir de la vie réelle des communautés. L’Eglise doit apprivoiser les changements de polarité entre le Nord et le Sud, et résister aux tentations du passé d’instrumentaliser au bénéfice de la vie du Nord les ressources de la vie du Sud. La tension entre une foi davantage argumentée et la religion populaire se fait partout percevoir et c’est probablement une opportunité à saisir pour l’évangélisation (je rêve, par exemple, d’une grande entreprise de réflexion dans l’Ordre, mettant en lien la priorité que nous voulons donner à l’étude et l’investissement très intense de beaucoup de frères, dans toutes les régions de l’Ordre, pour un accompagnement pastoral des piétés populaires, la Guadalupa…). Face à toutes ces mutations, comment l’Ordre peut-il servir l’Eglise et l’aider, à sa mesure, à traverser les passages qui s’imposeront ? Aider l’Eglise dans les mutations qui s’annoncent, en particulier en ce qui touche au type des communautés ecclésiales, au mode de l’étude de la théologie, aux répartitions territoriales des Eglises locales, aux religions populaires comme base possible pour une pédagogie de la foi pratique.
- Il me semble important de souligner encore deux pistes sur lesquelles le regard porté sur l’espace dans une perspective universelle sera de nature à aider l’Ordre à se situer comme « frère » de la postmodernité, plutôt que comme son « juge ». La première d’entre elles est celui de la Famille dominicaine. Notre chance est évidemment d’avoir été « fondés » comme une famille, d’emblée, comme si pour mener à bien notre mission, il nous fallait d’abord apprendre à aimer le monde, et apprendre cela en mettant en commun les différentes expériences des frères, des sœurs, des laïcs, des contemplatives, des jeunes…
- La seconde, et je terminerai par cela parce que c’est aussi par cela qu’il faudrait commencer tout discours et toute pratique de l’évangélisation : le tourment de l’envers du monde. Nous le savons bien, il est dans le monde un « envers », en lequel des gens, des peuples, des problématiques, sont oubliés, parfois même niés, ou encore instrumentalisés au bénéfice des plus puissants, de ceux qui ont « voix au chapitre » dans les orientations données au monde. Dans une perspective du « tout-monde » (cf. Edouard Glissant), l’envers du monde non seulement ne saurait être oublié, mais doit bien être considéré comme pleinement partie prenante du monde en commun. Même si, au fil des siècles, nous sommes passés de la posture de mendiants (voulant se faire d’abord les frères de ceux qui étaient dans la déréliction) à celle de bourgeois, il est de notre responsabilité, à cause des solidarités de destin de tant et tant de frères et sœurs de l’Ordre, de porter la présence de cet envers du monde, de ses acteurs, de ses souffrances, de ses espoirs, au cœur de la palabre par laquelle apprendre à bâtir et vivre un « monde en commun ». Apostolats « classiques » tels que la pastorale du Rosaire par exemple, ou les divers sanctuaires en charge des frères
Pour conclure, au lendemain de Pâques, Jésus qui se fait l’ami de l’envers du monde pour affirmer que lui seul, ainsi, peut dire en vérité le Nom de Dieu. Quitte à donner sa vie.
par Bruno Cadoré, o.p. Maître de l’Ordre des prêcheurs
Carlos Alfonso Azpiroz Costa 2001-2010
L'annonce de l'Évangile dans l'Ordre des Prêcheurs (2002)
Rome, le 7 novembre 2002. Fête de tous les saints et les saintes de l’Ordre
fr. Carlos Azpiroz Costa, o.p.
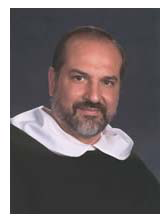 L’Ordre des Prêcheurs (Dominicains) « fut dès l’origine spécifiquement institué pour la prédication et le salut des âmes ». Aussi les fils et les filles de saint Dominique se vouent-ils à l’Église universelle d’une façon nouvelle en se consacrant totalement à l’évangélisation de la Parole de Dieu en son intégrité à tous les hommes et les femmes, à tous les groupes et à tous les peuples, croyants et non croyants, et surtout aux pauvres . Nous sommes conscients que l’histoire et le monde actuel sont le lieu où se joue le salut. C’est pourquoi, attentifs à la dynamique de la société moderne, nous insistons sur la nécessité de fonder notre prédication sur les nouveautés et les réalités que les hommes et les femmes présentent chaque jour à la foi chrétienne. En lisant les Actes des récents chapitres généraux nous pourrons esquisser ce que sont les nouveaux » aréopages » ou » frontières » auxquels nous sommes appelés ; quelles sont les priorités de l’Ordre et comment se caractérise notre annonce de l’Évangile.
L’Ordre des Prêcheurs (Dominicains) « fut dès l’origine spécifiquement institué pour la prédication et le salut des âmes ». Aussi les fils et les filles de saint Dominique se vouent-ils à l’Église universelle d’une façon nouvelle en se consacrant totalement à l’évangélisation de la Parole de Dieu en son intégrité à tous les hommes et les femmes, à tous les groupes et à tous les peuples, croyants et non croyants, et surtout aux pauvres . Nous sommes conscients que l’histoire et le monde actuel sont le lieu où se joue le salut. C’est pourquoi, attentifs à la dynamique de la société moderne, nous insistons sur la nécessité de fonder notre prédication sur les nouveautés et les réalités que les hommes et les femmes présentent chaque jour à la foi chrétienne. En lisant les Actes des récents chapitres généraux nous pourrons esquisser ce que sont les nouveaux » aréopages » ou » frontières » auxquels nous sommes appelés ; quelles sont les priorités de l’Ordre et comment se caractérise notre annonce de l’Évangile.
I. LA MISSION DE L’ORDRE DEPUIS SES ORIGINES : » MISSION SANS FRONTIÈRES «
La force du caractère missionnaire et évangélisateur de l’Église, affirmée dans Vatican II, dans Evangelii Nuntiandi -que le fr. Damian Byrne appelait » la charte du prêcheur » – confère une singulière actualité au projet constitutif de Dominique. C’est à toute la Famille dominicaine, » hommes et femmes ensemble dans la mission » , qu’incombe la responsabilité de rendre ce projet contemporain et de mettre en œuvre la mission spécifique de l’Ordre au sein du monde. Différents traits caractérisent la mission dominicaine depuis ses origines :
La mission de l’Ordre a été et doit continuer d’être une mission par-delà les frontières.
Cette mission se situe (selon le terme du frère Pierre Claverie OP, évêque d’Oran en Algérie, assassiné en 1996) sur les » lignes de fractures » de l’humanité, qui parcourent un monde marqué par la globalisation, et frappé si souvent par l’injustice et la violence des conflits raciaux, sociaux et religieux.
Elle exigeait et exige encore de la communauté dominicaine l’attitude et la pratique de l’itinérance, la mobilité, le déplacement permanent vers les nouvelles frontières que nous indiquent les priorités de notre mission.
II. LES FRONTIÈRES QUE NOUS SOMMES APPELÉS À ÉVANGÉLISER :
1. La frontière entre la vie et la mort :
Le grand défi de la justice et de la paix dans le monde
Les problèmes les plus dramatiques et les plus urgents du monde contemporain sont de type historique. Ils sont en lien avec les systèmes, les structures, les pratiques sociales, politiques et économiques qui placent un grand nombre de personnes entre la vie et la mort. C’est pourquoi l’engagement pour la justice et la paix -analyse, réflexion, action solidaire- est un critère de vérification de la mission dominicaine, et doit accompagner tout domaine ou toute modalité de notre prédication. Les exemples de Bartolomé de Las Casas, Antonio de Montesinos, Pedro de Córdoba en Amérique latine, tout comme celui de Domingo de Salazar en Orient et l’œuvre de Louis Joseph Lebret à notre époque sont éclairants.
2. La frontière entre l’humain et l’inhumain :
Le grand défi des marginaux
La structure marginalisante de la société actuelle génère un nombre de plus en plus élevé de marginaux, qui se trouvent à la frontière d’une vie inhumaine ou infrahumaine. Parmi les catégories de marginaux on trouve de nombreux peuples qui souffrent à la fois d’une pauvreté matérielle et d’une marginalisation culturelle, sociale, économique et politique. Il y a, aujourd’hui encore, sous des formes différentes, des victimes de » l’apartheid » : immigrés, dissidents, ouvriers, femmes, handicapés, jeunes, personnes âgées. Leurs situations sont des signes manifestes de l’absence du Royaume de Dieu et par là même un défi prioritaire pour notre réflexion, notre étude, notre évangélisation. La mission de la communauté dominicaine est d’inaugurer et de montrer un nouveau modèle de communion et de partage entre les peuples.
3. La frontière chrétienne:
Le défi des religions universelles
Les traditions religieuses universelles partagent avec nous une expérience de Dieu. L’hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, l’islam se situent cependant en-dehors de la frontière de l’expérience chrétienne de Dieu. Certaines de ces traditions religieuses exercent une forte influence sur l’homme contemporain. Le dialogue avec les autres religions remet en question les conceptions traditionnelles de la mission évangélisatrice de l’Église, de même que les attitudes et les modèles d’évangélisation dépourvus d’authenticité. Ce dialogue doit être à la fois analytique et autocritique ; il suppose une attitude d’écoute et une présence inculturée, exempte de toute trace de colonialisme, impérialisme, fanatisme. L’idéal de Dominique était de porter sa mission au-delà des frontières du christianisme établi, chez les Cumans (c’était son rêve). L’emplacement des couvents dans les villes et la présence des frères dans les universités, pour le dialogue interculturel et interreligieux, font de ce défi une priorité de l’évangélisation dominicaine.
4. La frontière de l’expérience religieuse:
Le défi des idéologies séculières
L’homme et la femme d’aujourd’hui souffrent intensément d’une situation paradoxale : carence de religion mais nostalgie du religieux. Les idéologies séculières expliquent en partie cette carence et mettent en question les vieux modèles de transmission du message du Christ. Nombre de questions posées par la pensée contemporaine restent encore sans réponse. Toutes contiennent une interrogation sur l’homme et son avenir et un questionnement critique sur la vérité. L’athéisme, l’incroyance, la sécularisation, l’indifférence, la laïcité sont des questions très proches de ces idéologies. Le dialogue avec ces dernières peut apporter un correctif critique aux diverses présentations du fait religieux et chrétien et, en même temps, il ouvre un champ prioritaire à l’évangélisation dominicaine. Les origines de l’histoire dominicaine nous ont enseigné une leçon importante dans cette capacité de l’Ordre à instaurer un dialogue entre le message du Christ et les diverses cultures, classiques ou naissantes. En sont des exemples : saint Dominique, qui incorpora l’étude à son projet constitutif ; Thomas d’Aquin au XIIIème siècle ; les professeurs et théologiens dominicains du XVIème siècle ; les théologiens dominicains du Concile Vatican II. La théologie a été créative et prophétique dans la Famille dominicaine dans la mesure où elle s’est laissée interpeller par ces courants culturels. Elle a été vivante dans la mesure où elle a pris pour point de départ les quæstiones disputatæ les plus récurrentes et pressantes de chaque époque .
5. La frontière de l’Église :
Le défi des confessions non catholiques et des autres mouvements religieux
La pluralité des confessions est un scandale pour les croyants et les non-croyants. Les richesses recelées dans les différentes traditions chrétiennes sont une invitation au dialogue œcuménique et à la réconciliation. La réflexion théologique de l’Ordre, fidèle à sa tradition, veut relever ce défi. Avec diverses nuances, la frontière de l’Église traverse aussi le phénomène des » nouvelles options religieuses « . Dans certains pays et régions du monde, la présence grandissante de ces » mouvements » constitue un défi à l’évangélisation. Rien ne sert de simplement dénoncer et d’user de l’anathème. L’idéal premier de Dominique fut de porter la mission par-delà les frontières de la » chrétienté « . Les besoins immédiats de l’Église l’en empêchèrent et il réalisa sa mission au milieu des hérétiques, à la frontière de l’Église. C’est d’eux qu’il apprit beaucoup de choses et c’est chez eux qu’il prit son modèle de vie évangélique et apostolique. Sans relâche il dialoguait avec eux. Et c’est par le témoignage de sa fidélité à l’Église et de sa communion avec elle qu’il les interpella.
III. PRIORITÉS DE L’ORDRE CORRESPONDANT À CES FRONTIÈRES:
Dans l’Église, l’Ordre des Prêcheurs participe à la vie apostolique : il doit toujours être en acte de mission, et se situer aux frontières. La priorité des priorités est pour nous la prédication, » en nous députant totalement à l’évangélisation de la parole de Dieu » en son intégrité. Pour réaliser cette finalité, l’Ordre a réaffirmé toutes ces dernières années quatre priorités.
Ces priorités ne peuvent être séparées les unes des autres ni aucune d’elles préférée au détriment des autres, elles s’appellent plutôt les unes les autres, car toutes répondent de manières diverses aux besoins les plus pressants des gens d’aujourd’hui, en ce qui concerne la prédication de la Parole de Dieu . Ces priorités ne constituent pas non plus une nouveauté : elles sont entièrement reliées au charisme et à la tradition vivante de l’Ordre, dans la vie de saint Dominique, dans la vie des frères du XIIIème siècle, chez les frères du XVIème siècle débarqués en Amérique et en Extrême Orient, à l’époque moderne. Les quatre priorités apostoliques sont toujours le fruit de notre grâce originelle . Ce sont :
1. La catéchèse dans un monde déchristianisé : c’est le monde de ceux qui ont grandi dans le contexte d’une tradition chrétienne mais, de fait, vivent en marge ou en-dehors, indifférents ou hostiles à la communauté visible des croyants. Cette catéchèse sera pascale, appel à la conversion personnelle, participation à la transformation du monde ; elle assurera aussi la promotion des ministères laïcs.
2. L’évangélisation dans la diversité des cultures : elle est orientée vers une recherche philosophique et théologique sur les cultures, les systèmes intellectuels, les mouvements sociaux, les traditions religieuses à l’œuvre » hors du christianisme historique « . L’Ordre est appelé à servir l’avènement d’une nouvelle manière d’être chrétien dans les différents continents ; les communautés locales doivent ressentir les choses avec les gens, dans une attitude positive de dialogue et d’appréciation de leurs valeurs culturelles.
3. La justice et la paix : analyse critique des origines, des formes et des structures de l’injustice dans les sociétés contemporaines ; praxis évangélique pour la libération et la promotion intégrale de l’homme et de la femme. Pour devenir des signes prophétique en ce monde, les actions pour la justice et la paix doivent être intégrées dans les projets des communautés locales, provinciales, régionales ; elles doivent se fonder sur l’analyse de la réalité, et sur les sources bibliques et théologiques ; elles doivent assurer leur appui aux frères et sœurs qui participent, parfois au risque de leur vie, aux associations et mouvements qui promeuvent la dignité humaine.
4. La communication humaine à travers les médias, dans la prédication de la Parole de Dieu. Les médias nous ont révélé avec une évidence absolue » le drame de notre époque » : la fracture entre la culture humaine et le message évangélique, entre parole humaine et parole de foi (Evangelii Nuntiandi 20) ; les médias constituent aujourd’hui l’outil privilégié pour doter la proclamation active de l’Évangile en son intégrité d’une parole intelligible et d’une efficacité culturelle. Nous voici aujourd’hui immergés dans un monde où toute personne humaine peut, par la communication, porter la vie ou la mort. Il s’agit là d’un phénomène où seuls des acteurs interviennent, sans spectateurs aucuns. La vocation de l’Ordre nous appelle à devenir prêcheurs, c’est-à-dire des communicateurs avec certaines caractéristiques : conviction, nouvelle vision, liberté.
IV. CARACTÉRISTIQUES DE LA PRÉDICATION ET ATTITUDES DU PRÊCHEUR
L’évangélisation à ces frontières et selon ces priorités prend certaines caractéristiques et requiert certaines attitudes personnelles et communautaires :
1. La prédication THÉOLOGIQUE
Elle implique une ouverture totale à la vérité intégrale, d’où qu’elle vienne . Cela exige une réflexion profonde et une disponibilité au dialogue (œcuménique, interreligieux, culturel) . Notre prédication s’est toujours appuyée sur une étude approfondie et scientifique de la théologie. » Notre étude doit viser principalement, ardemment et avec le plus grand soin à ce que nous puissions être utiles à l’âme du prochain » . Dès lors, l’étude est étroitement liée à la mission apostolique de l’Ordre et à la prédication de la Parole de Dieu. Se consacrer à l’étude c’est répondre à un appel » à cultiver l’inclination des hommes vers la vérité » . Saint Dominique encourageait ses frères à être utiles aux âmes par la compassion intellectuelle, en partageant avec eux la misericordia veritatis, la miséricorde de la vérité . Les crises du monde actuel, le scandale de la pauvreté de plus en plus grande et de l’injustice de plus en plus répandue, la confrontation des différentes cultures, le contact avec les populations déchristianisées, tout est défi pour nous. Notre pratique de la réflexion théologique doit nous préparer à pénétrer au plus profond la signification de ces faits dans le mystère de la Divine Providence. La contemplation et la réflexion théologique nous permettent de chercher les moyens les plus adaptés à la prédication actuelle de l’Évangile. C’est la voie authentique pour que notre prédication soit celle de la vérité doctrinale et non l’exposé abstrait et intellectuel d’un système.
2. La prédication COMPATISSANTE
Elle exige une attitude de compassion profonde envers les personnes, en particulier envers celles qui se trouvent » en marge « . Seule la compassion peut compenser notre aveuglement de sorte que nous puissions voir les signes des temps. La compassion nous rend humbles dans notre prédication -or c’est l’humilité qui nous dispose à écouter et à parler, à recevoir et à donner, à nous laisser influencer, à être évangélisés et à évangéliser. Cette compassion et cette humilité ne naissent que d’une union profonde avec Dieu dans le Christ. Nous sommes unis avec Dieu lorsque nous imitons la compassion et l’humble service du Christ. Compassion et humilité sont les sources d’où émane la connaissance des signes des temps, empreinte de prière et de contemplation : nous contemplons Dieu, qui s’est révélé à nous à travers les Saintes Écritures et qui manifeste sa volonté dans les signes des temps.
3. La prédication INCULTURÉE et INCARNÉE
Elle exige une profonde sensibilité aux différentes conceptions de la réalité données par les autres religions, les autres cultures, les autres philosophies (incarnation et inculturation). Il y faut une éducation, pour accepter d’attendre, d’être enseignés, de se convertir, d’être partie prenante, pour assumer en solidarité et contribuer à purifier et élever ce que nous découvrons dans ces religions, cultures, philosophies.
4. La prédication PROPHÉTIQUE
C’est la proclamation non pas de notre connaissance mais de la Parole du Dieu vivant et porteur de vie, l’annonce de l’Évangile révélé, en son intégrité, contenant les paroles de la vie éternelle. Sans oublier l’analyse soigneuse des » signes des temps « , qui procède de principes surnaturels et est éclairée par la prière. Pour discerner les signes des temps nous devons être attentivement à l’écoute du cri des pauvres, des opprimés, des marginaux, des torturés, et de tous ceux qui sont persécutés pour des motifs raciaux, religieux, parce qu’ils ont dénoncé l’injustice.
5. La prédication dans la PAUVRETÉ
La pauvreté n’est pas seulement une sorte d’abnégation de soi-même, elle est aussi le témoignage et le juste moyen d’où notre prédication tient sa force : la pauvreté est le signe de son authenticité et de sa sincérité. Nous vivons dans un monde où la division entre riches et pauvres se creuse sans cesse -entre pays riches et pauvres, comme entre individus, et entre groupes. En outre, les pauvres ont aujourd’hui une meilleure connaissance et conscience des structures nationales et internationales qui sont cause de cet état d’asservissement et de pauvreté. Si, dans un monde tel que celui-ci, nous nous présentions comme vivant davantage avec les riches qu’avec les pauvres, notre prédication ne serait pas digne de foi .
6. La prédication ITINÉRANTE
Nous sommes des hommes et des femmes en mouvement . L’itinérance est avant tout un concept spatial, qui implique d’être prêt à voyager, mais notre prédication requiert cette mobilité de bien d’autres façons : sociale, culturelle, idéologique et économique. Cet aspect de la spiritualité dominicaine doit façonner toute notre vie et se nourrit de diverses expériences bibliques de l’Ancien Testament et de Jésus même, » Chemin » que Dominique a voulu suivre, en véritable homme d’évangile.
7. La prédication COMMUNAUTAIRE
Notre prédication n’est pas le fait solitaire d’individus isolés : elle requiert une disposition à coopérer, travailler en équipe, soutenir l’effort des autres en montrant son intérêt, en encourageant et en aidant effectivement. Ces attitudes s’enracinent dans les éléments essentiels de notre vie dominicaine : vie commune, prière contemplative, étude assidue, communauté fraternelle, consécration par les vœux. La communion et la mission universelle de l’Ordre configurent aussi notre gouvernement où domine la collaboration organique et équilibrée de toutes les parties dans la visée de la fin de l’Ordre. Ce gouvernement communautaire à sa façon est particulièrement apte à promouvoir l’Ordre et le rénover régulièrement .
8. La prédication PARTAGÉE : la FAMILLE DOMINICAINE
L’Ordre est né comme Famille . Frères, moniales contemplatives, religieuses, membres des instituts séculiers et des fraternités laïques et sacerdotales, d’autres groupes associés d’une manière ou d’une autre à l’Ordre (entre autres : le Mouvement international des jeunes dominicains -MIJD – ; le Volontariat dominicain international -VDI -) : nous nous inspirons mutuellement dans le charisme de Dominique. Ce charisme est un et indivis : la grâce de la prédication . C’est une prédication partagée avec nos frères et sœurs de l’Ordre qui vivent le même sacerdoce commun de par leur baptême et qui sont consacrés de par leur profession religieuse et leur engagement au sein de la même mission . La manifestation la plus achevée de notre identité d’ensemble est notre collaboration mutuelle. Cette collaboration recouvre la prière commune, l’élaboration de projets et de décisions en commun, une mise en acte commune de ces projets, dans une complémentarité faite de réciprocité et d’égalité. Ces projets touchent des champs d’action comme les ministères liés à la prière, la prédication, l’enseignement, les responsabilités pastorales, la justice et la paix, les médias, la recherche, la rédaction de textes ou de livres, mais aussi bien la promotion des vocations et la formation .
Conclusion : Ces frontières, priorités et caractéristiques de notre annonce de l’Évangile ne sont pas de » nouveaux devoirs » qui viendraient s’ajouter à d’autres en une sorte d’ » impératif catégorique » ou comme une » nouvelle mode » chassant celle d’hier. Au contraire, elles tracent un chemin de joie et de liberté, elles expriment la vocation de tous ces hommes et ces femmes qui ont donné et donnent leur vie, reprenant à leur compte les paroles de l’apôtre :
» Oui, malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Corinthiens 9, 16).
Rome, le 7 novembre 2002
Fête de tous les saints et les saintes de l’Ordre.
« Marchons dans la joie et pensons à notre sauveur. » Regards sur l’itinérance dominicaine (2003)
Sainte-Sabine, le 24 mai 2003, Mémoire de la Translation de notre Père saint Dominique
fr. Carlos Azpiroz Costa, o.p.
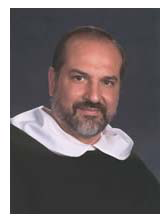 Mes chers frères et sœurs en saint Dominique,
Mes chers frères et sœurs en saint Dominique,
C’est un peu tremblant que je vous écris. Tout d’abord, pour prendre courage, une confidence. Récemment j’ai relu et médité les messages que les quatre derniers Maîtres ont adressés à l’Ordre. Quatre, pour ne citer que ceux que la Providence a mis au service de la Famille dominicaine depuis l’époque du Concile Vatican II jusqu’à 2001. Je ne peux que m’exclamer : quelle richesse ! quelle profondeur dans la parole de ceux qui nous ont prêché avec tant de générosité et de dévouement ! Face à pareils écrits – voici la confidence fraternelle –, qu’il est difficile d’écrire une lettre à l’Ordre ! Il semble que tout ait déjà été dit ! Que pourrais-je bien dire de neuf à mes frères et sœurs en saint Dominique ? En même temps, je constate avec tristesse que dans bien des communautés – je parle plus particulièrement des frères –, c’est à peine si l’on connaît les Actes des derniers Chapitres généraux, alors que ces textes sont de véritables programmes de vie dominicaine pour notre temps ! Enfin, comme cela arrive à beaucoup, et pas seulement dans l’Ordre, j’ai le sentiment de me trouver devant une « inflation » de documents, de textes, de messages, de lettres touchant aux thèmes les plus variés (mais qu’on n’a jamais le temps de lire avec profit avant l’arrivée du suivant).
DIFFERENTES EXPERIENCES DES SIX DERNIERES ANNEES
1. Voici quelque temps, un frère provincial s’entretenait avec moi de manière informelle sur la situation de sa Province. Pensant à haute voix, il se plaignait, non sans un certain découragement : « dans ma Province, je ne peux faire aucune assignation ». Ces mots m’ont beaucoup impressionné. J’y pense constamment, et à ce qu’ils impliquent.
Ces dernières années, ce n’est un secret pour personne, j’ai vécu deux expériences fort différentes. La tâche de Procurateur général, poste « sédentaire » comme il y en a peu, m’a pourtant mis au contact de maintes situations délicates pour la vie dominicaine et religieuse de nombreux frères et sœurs. À présent, dans l’exercice d’un ministère bien plus « nomade », en visitant les communautés des différents pays, je découvre sous un autre angle la « symphonie polychromatique » de l’Ordre dans l’Église et dans le monde. Les deux perspectives m’ont néanmoins conduit à une même intuition. Elles m’ont fait découvrir qu’il y a vraiment quelque chose qui « bloque », menaçant les racines de notre vocation et de notre mission dans l’Église et dans le monde : une certaine immobilité. L’inertie provoque une sorte de paralysie (« on s’installe »), qui finit par blesser à mort les énergies les plus généreuses de notre existence et de notre vie de fils et de filles de saint Dominique.
2. Une des caractéristiques que Dominique de Caleruega incarna à l’image des apôtres, et que nous avons héritée en tant que ses disciples, est l’itinérance évangélique. Pour le dire en image, par la grâce de Dieu, il a fait éclater les frontières d’un schéma « géographique » qui basait essentiellement le fonctionnement et la vie de l’Église sur l’organisation diocésaine d’une part, et – pour ce qui est de la vie religieuse – sur la structure de la vie monastique et des chanoines réguliers d’autre part. L’histoire de l’Église missionnaire ne commence certes pas avec l’Ordre des Prêcheurs : combien de moines missionnaires, par exemple, ont évangélisé combien de régions d’Europe ! Mais Dominique voulut fonder, in medio Ecclesiæ, un Ordre qui serait fait et appelé de prêcheurs.
« EN CE TEMPS-LA… » – SE METTRE EN CHEMIN CHANGE LA VIE !
3. Enfants, nous nous délections à l’écoute et la lecture d’histoires réelles ou imaginaires. Beaucoup commençaient par le traditionnel « Il était une fois ». Toutes proportions gardées, lorsqu’on proclame l’Évangile, suivant Jésus sur son Chemin, on commence généralement la lecture par « En ce temps-là »…
Avec la fraîcheur du disciple, comme pour nous ramener à l’amour des origines, le fr. Jourdain écrit dans son Libellus :
« Il arriva donc en ce temps que le roi Alphonse de Castille conçut le désir de marier son fils Ferdinand à une fille noble des Marches. Il vint trouver l’évêque d’Osma et lui demanda d’être son procureur en cette affaire. L’évêque acquiesça aux prières du roi. Et bientôt, (…) prenant également avec lui l’homme de Dieu Dominique, sous-prieur de son Église, il prit la route et parvint à Toulouse. »
4. Dans son « Histoire de saint Dominique », recoupant divers points historiques, Marie-Humbert Vicaire rapporte que cette invitation d’Alphonse VIII à l’évêque d’Osma fut lancée à la mi-mai 1203. Le célèbre biographe français conclut à la suite de Jourdain : « L’évêque ne tarda pas à se mettre en route, emmenant avec lui Dominique. C’était vers le milieu d’octobre 1203 » . Il y a de cela 800 ans !
Ce n’est ni l’heure ni l’endroit d’entrer dans les détails, ou de nous étendre en une analyse historique et chronologique exhaustive. Mais ce que nous savons avec certitude, c’est que ce voyage allait changer pour toujours la vie des deux amis. En effet, à peine eurent-ils passé les Pyrénées que les deux hommes de Dieu purent constater de leurs yeux un fait qu’ils ne connaissaient jusque là que par ouï-dire : le défi du dualisme d’origine manichéenne, profondément enraciné dans cette région parmi différents groupes et sectes. Comme exemple éloquent de l’impact qu’eut cette nouvelle réalité sur nos deux voyageurs, Jourdain raconte le célèbre épisode de l’hôte :
« Au cours de la nuit même où ils logèrent dans la cité, le sous-prieur attaqua avec force et chaleur l’hôte hérétique de la maison, multipliant les discussions et les arguments propres à le persuader. L’hérétique ne pouvait résister à la sagesse et à l’esprit qui s’exprimaient : par l’intervention de l’Esprit divin, Dominique le réduisit à la foi. »
La « mission matrimoniale », on le sait, allait exiger un autre voyage avant de finir tristement. Un échec ? Mais rempli d’une vie nouvelle ! Voici comment le raconte Jourdain de Saxe :
« Dieu disposait ainsi des causes du voyage dans ses vues salutaires, préludant à l’occasion de cette course à des noces autrement précieuses entre Dieu et les âmes, qu’il entendait ramener de par toute l’Église, et de beaucoup d’erreurs et de péchés, aux épousailles du salut éternel. L’événement le prouva dans la suite. »
5. Une mission diplomatique au nom du Roi – changement de programme imprévu dans la vie de Diego et de Dominique – est l’occasion qui apporte en fin de compte une teinte différente à leur histoire, illuminée par la lumière rénovatrice de la grâce. Un évêque et le sous-prieur d’un chapitre de cathédrale étaient appelés à croître et à donner des fruits entre les murs du petit jardin d’Osma, et les voici devant un panorama ecclésial et historique totalement différent. Certes, ils connaissaient les conséquences des hérésies au-delà des Pyrénées, mais seulement par ouï-dire. C’est une situation analogue à celle de Job le Juste qui, à la fin de sa difficile expérience de la vie, s’exclame dans un dialogue ouvert avec Dieu : « Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t’ont vu » .
En effet, Dieu appelait Diego et Dominique à commencer en terre étrangère une nouvelle évangélisation, qui s’étendrait avec le temps à des horizons universels. Marcher loin des repères connus leur ouvrit les yeux de l’âme. Ils ne furent plus jamais les mêmes. Les deux voyages diplomatiques (1203 et 1205) eurent des conséquences « vocationnelles » pour l’un comme pour l’autre – mais ce n’est pas la vocation diplomatique qu’ils découvrirent !
Diego d’Osma demanderait (en 1206 ?) au pape Innocent III de lui faire la grâce d’accepter sa démission de l’épiscopat : il chérissait le projet de consacrer toutes ses forces à la conversion des Cumans, peuple païen de l’Est de la Hongrie. Le pape, on le sait, refusa sa démission. Plus tard, l’évêque prit l’habit de Cîteaux ; il conseilla les légats du pape concernant la prédication de la foi contre les Albigeois ; il s’engagea sérieusement dans cette mission itinérante pendant deux ans ; puis il décida de rentrer au siège d’Osma ; quelques jours plus tard il tomba malade et mourut fin 1207.
Nous connaissons plus en détails la vie de Dominique. Depuis le voyage dans les Marches jusqu’à sa mort, il mènera la vie d’un apôtre itinérant. À partir de ce huitième centenaire du premier voyage missionnaire de Dominique, pourquoi ne pas commencer à célébrer joyeusement d’autres ‘octo-centenaires’ d’une beauté et d’une importance extraordinaires pour toute la Famille dominicaine, parmi laquelle on compte la fondation de Prouilhe, toujours considérée comme la première communauté de l’Ordre !
L’ITINERANCE DANS LE CŒUR ET L’ESPRIT DE TOUS LES DOMINICAINS
6. Le fr. Paul de Venise, un des témoins au procès de canonisation de saint Dominique, raconte que « Maître Dominique » lui disait, ainsi qu’aux autres qui le suivaient : « Marchez, pensons à notre Sauveur ». Il témoigne aussi : « Où qu’il se trouvât, Dominique parlait toujours de Dieu ou avec Dieu » ; et il reconnaît : « Jamais je ne le vis irrité, agité ou troublé, ni par la fatigue du voyage, ni par nulle autre cause. Il était au contraire toujours joyeux dans les tribulations et patient dans les adversités ».
7. Alors, une lettre à l’Ordre sur l’itinérance ? Ce que vous avez entre les mains, le texte que vous lirez et – je l’espère – méditerez en votre cœur, individuellement et en communauté, est le fruit d’une réflexion au sein du Conseil généralice. Lorsque j’ai commencé à penser au thème de l’itinérance dans la vie dominicaine, nous avons préparé une réunion du Conseil généralice au complet. J’y invitai aussi le fr. Manuel Merten, Promoteur général pour les moniales. Chaque frère avait préparé un bref exposé sur les divers aspects de l’itinérance dans notre « sequela Dominici » : itinérance et vie spirituelle ; itinérance, cheminement intellectuel et formation ; itinérance et chacun des vœux religieux ; itinérance et vie commune ; itinérance et vie contemplative ; itinérance et gouvernement dominicain ; itinérance et inculturation ; itinérance et phénomène de la mobilité humaine ; itinérance et mission ; etc. Lors d’une rencontre de trois jours hors de Rome, chacun a présenté son thème et nous avons tous discuté ces aspects et d’autres de notre itinérance dominicaine.
Je l’avoue, la qualité des réflexions fut telle que, à la fin, je ne me sentais plus capable d’écrire sur la question une lettre qui pût embrasser tant de richesses : l’éventail des thèmes à traiter était tellement large ! Mais d’un autre côté, il n’était pas possible non plus de publier tels quels les 15 textes préparés – loin de nous la prétention de publier une « encyclopédie » ou un « dictionnaire » sur le sujet !
Dans un second temps, nous avons tenté de méditer sur quelques thèmes centraux, autour desquels s’en articulent d’autres, également étudiés ensemble. Pour cela j’ai prié quatre frères de présenter une synthèse élaborée à partir de ce que nous avions échangé en communauté. Ce que je vous présente aujourd’hui est donc le résultat de notre travail. Le fr. Roger Houngbedji (du Vicariat d’Afrique de l’Ouest, Province de France, Socius pour l’Afrique) écrit sur l’itinérance dans la Bible. Le fr. Manuel Merten (Province de Teutonie, Promoteur général pour les moniales) nous offre sa réflexion sur l’itinérance et la vie contemplative. Le fr. Wojciech Giertych (Province de Pologne, Socius pour la vie intellectuelle) traite de l’itinérance dans le cheminement intellectuel et la formation. Enfin, le fr. Chrys McVey (Vice-province du Pakistan, Socius pour la vie apostolique et Promoteur général de la Famille dominicaine) nous prêche sur l’itinérance et la mission.
Le mot iter – itineris (du grec hodos) signifie « chemin, voyage, marche, trajet » : mettons-nous en route et parcourons ensemble ce paysage intérieur dominicain !
I – L’ITINERANCE DANS LA BIBLE
8. L’itinérance apparaît comme un thème dominant dans la Bible. Le peuple de la Bible se définit principalement en effet comme un peuple en pérégrination. Le mot « hébreu », par lequel il est désigné vient de « ibrî » (dérivé de « èber » qui veut dire « l’autre côté » d’une limite) et évoque l’idée d’émigration. Le peuple hébreu est donc un peuple foncièrement en migration, un peuple nomade. C’est dans cette optique que les grands croyants de l’Ancien Testament (notamment les Patriarches) vont se considérer comme des « étrangers » (xénoi), du fait qu’ils n’ont pu obtenir (mais ont vu seulement de loin) l’objet des promesses que Yahvé leur a faites (cf. Gn 23, 4 ; Ex 2, 22 ; 1 Ch 29, 15 ; Ps 39, 13 ; Lv 25, 23). Toute l’histoire du Peuple d’Israël sera donc comprise comme une longue marche vers l’accomplissement des promesses de Dieu en son Fils Jésus.
La communauté chrétienne (le nouveau Peuple de Dieu) sera elle aussi appelée « la Voie » (cf. Ac 9, 2 ; 18, 25 ; 19, 9.23, 22, 4 ; 24, 14.22), ce qui souligne bien l’idée de marche ou d’itinérance. Dans cette perspective, l’auteur de l’épître aux Hébreux présentera la communauté chrétienne comme une communauté de pèlerins sur la terre (He 11, 13), en marche vers la cité future solidement bâtie (He 13, 14). Les chrétiens vivent donc ici-bas comme des « déracinés » mais « enracinés » là-haut, la cité céleste : le but ultime de leur marche. Saint Pierre dans son épître (1 P 1, 17) montrera que du moment où les chrétiens n’appartiennent qu’à Dieu, ils doivent considérer leur passage sur terre comme un séjour transitoire, sans aucune attache avec ce bas-monde. Le terme technique utilisé par le Nouveau Testament pour exprimer cette situation passagère du chrétien dans ce monde est parepidêmos qui désigne l’étranger non établi, le voyageur, et s’oppose à l’étranger résidant en permanence.
Il apparaît donc que dans la mentalité biblique, toute la vie du croyant, son rapport à Dieu est polarisé par l’idée de la marche, du chemin, de l’itinérance. La question est de savoir en quoi consiste cette itinérance ou qu’est-ce qui la caractérise ? Une vue d’ensemble permet de dégager trois grands traits caractéristiques de l’itinérance biblique.
ITINERANCE COMME EXODE
Déplacement spatial
9. Le chemin de Dieu (hodos) se définit ici comme un départ, une sortie, un exode. Le croyant est appelé à s’arracher à un lieu déterminé, à rompre avec son attachement à un monde physique ou géographique pour se mettre en route et partir ailleurs. L’itinérance est prise ici dans son acception géographique, physique. C’est dans ce sens qu’on peut comprendre l’itinérance d’Abraham qui doit partir de sa terre pour s’aventurer dans un pays étranger (Gn 12, 1-9). La Parole de Dieu qui lui est adressée amène le patriarche à opérer une rupture totale avec sa patrie et toutes les attaches humaines pour se lancer sur une route où seule la foi est déterminante. La foi du patriarche consiste précisément en une réponse inconditionnelle qui l’amène à s’engager sur un chemin dont Dieu seul connaît l’issue. Il en est de même pour le prophète Élie qui se mettra en route jusqu’à l’Horeb où Dieu, à travers une brise légère, va se révéler à lui (1 R 19, 4-8). L’itinérance exige donc ici un saut dans l’inconnu qui est le lieu de la foi.
Par ailleurs, le peuple élu dans son ensemble est aussi marqué par l’expérience de l’Exode hors d’Égypte, une expérience qui va déterminer toute sa vie. Guidé par Dieu et par Moïse, le peuple est appelé à s’engager sur une voie longue et difficile où à travers mille épreuves il parviendra à connaître son Dieu et à faire son entrée dans la terre promise. À cause de ses nombreux péchés, le peuple sera de nouveau exilé en Babylone où il va douloureusement faire l’expérience de sa condition de « pérégrinant » en se considérant comme un groupe de réfugiés ou d’exilés en territoire étranger (cf. Ps 137). À sa libération, il sera de nouveau appelé à se lancer dans un nouvel exode, signe de la libération qu’accomplira le ‘Serviteur de Yahvé’ dont la mission consiste à faire sortir de l’esclavage plus profond constitué par le péché (Is 42, 1-9 ; 53, 5-12).
Dans le Nouveau Testament Jésus sera présenté aussi comme un grand itinérant. Dans les évangiles il apparaît en effet comme un grand voyageur, toujours en chemin (cf. Lc 9, 57 ; 13, 33 ; Mc 6, 6b), passant de la Samarie en Galilée ou faisant route vers Jérusalem (Lc 9, 51). Lui-même se présente comme le Fils de l’homme n’ayant pas d’endroit où reposer sa tête (Lc 9, 58). Il enverra aussi ses disciples sur la route (Lc 10, 1-9 ; Mt 10, 5-15) et indiquera la condition du disciple comme un engagement à sa suite (Lc 9, 59-62 ; Mc 2, 13-14 ; Jn 1, 43). Toute la mission des apôtres après la mort de Jésus s’effectuera dans la perspective d’une grande itinérance (cf. Ac 16, 1-10 ; 2 Co 11, 23-28).
Il en ressort que l’itinérance dans la Bible est d’abord et avant tout géographique/spatial dans le sens de passage d’un lieu à l’autre – le mot passage signifiant aussi la Pâques, l’Exode (Jésus accomplit sa Pâques en passant de ce monde à son Père : Jn 13, 1). Il est à remarquer que le déplacement spatial vise toujours une mission.
Déplacement spatial en vue d’une mission
10. Dans la perspective biblique, les déplacements qui sont faits dans le cadre d’un commandement ou d’une obéissance visent le plus souvent une mission : un message à donner, une action à faire. C’est le cas de Moïse par exemple dont la rencontre avec Yahvé (Ex 3, 1-6) sera le début de sa mission : alors qu’antérieurement, par peur de la police, Moïse a dû fuir l’Égypte (2, 15), à la demande de Dieu, il y retourne pour libérer le peuple. Au cours de cette mission il recevra fréquemment des demandes de la part de Yahvé pour rencontrer Pharaon et emmener le peuple au désert, pour recevoir la Loi et la donner au peuple. En fait, tout le livre de l’Exode se présente comme une itinérance vécue comme obéissance à Dieu.
Il en est de même dans les livres prophétiques. Le prophète est en effet pris par Dieu dans la situation qui est la sienne pour remplir une mission. Le plus souvent cette mission l’amène à se confronter au roi ou aux autorités religieuses, à risquer sa propre vie. C’est dire que l’obéissance demandée suppose non seulement un déplacement mais aussi un risque à prendre. La mission n’est pas sans danger, comme Élie, type du prophète, en fait l’expérience : il doit fuir son pays pour assurer le succès futur de sa mission (1 R 17, 3.9), revenir affronter Achab pour lui donner le message dicté par Dieu (1 R 18, 1 ; 21, 18-19) et abandonner le lieu de la rencontre avec Dieu pour continuer sa mission (1 R 19, 15-16). On a comme un résumé de ce schéma lorsque le prophète demande à un simple croyant d’être son intermédiaire : le commandement ordonne un déplacement en vue d’un message à donner, mais il y a un risque et donc raison d’avoir peur (1 R 18, 7-16).
Dans le Nouveau Testament, le commandement qui exige un déplacement est toujours associé à la prédication du Royaume, du temps de Jésus (cf. Lc 9, 2) ou à la mission après sa résurrection (Mt 28, 19-20). Les conditions en sont précisées : il s’agit de voyager sans bagages encombrants et sans moyens particuliers. Notons qu’il peut y avoir des échecs à l’appel, par refus de l’itinérance (Mt 19, 16-22 ; Lc 18, 18-23 ; Mc 10, 17-22).
ITINERANCE COMME CONVERSION
11. À l’itinérance géographique/spatiale est liée l’itinérance spirituelle qui apparaît comme le lieu d’une conversion, entendue comme metanoia (changement radical d’esprit, de mentalité). En effet, dans la Bible, l’itinérance géographique s’accompagne toujours de l’itinérance spirituelle : le détachement d’un lieu à un autre est en vue du détachement de soi-même pour n’appartenir qu’à Dieu. Le terme biblique utilisé pour manifester ce lien entre les deux types d’itinérance est « dérék » (chemin), dérivé de « darak » (marcher), qui désigne le chemin spirituel à entreprendre pour correspondre à la volonté et au plan de Dieu. Dans la mentalité d’Israël, l’homme, du fait de ses péchés et de son refus de réaliser les desseins de Dieu, doit en effet conformer son mode d’existence, ses faits et gestes, à la volonté divine (Mi 6, 8 ; Is 30, 21, Os 14, 10, Ps 119, 1). C’est la condition pour lui de parvenir à la vraie vie (Pr 2, 19 ; 5, 6 ; 6, 23 ; Dt 30, 15 ; Jr 21, 8). La conversion consiste en tout le processus spirituel (l’itinérance spirituelle) à entreprendre pour correspondre à la volonté de Dieu. C’est dans cette perspective qu’on peut comprendre tout le changement qui s’opère dans la vie du prophète qui reçoit une mission spécifique de Dieu. L’appel de Dieu le saisit et affecte profondément son statut social, son mode de vie en même temps qu’il lui demande de remplir une mission qui entraîne un déplacement, une itinérance (cf. Os 1, 2 ; Jon 1, 2 ; 3, 2). Le déplacement ici n’est pas seulement spatial mais aussi symbolique dans la mesure où il touche à la fois la vie du prophète et celle du peuple, dans son rapport à la Loi.
Cette même idée est reprise dans le Nouveau Testament à travers le terme « hodos » qui désigne la voie (Ac 18, 26) que les disciples doivent entreprendre pour parvenir à la vie (Mt 7, 13-14). C’est dans cette perspective que s’inscrivent les conditions posées par Jésus pour entrer dans le Royaume (Mc 1, 15) et celles qui sont exigées des disciples qui veulent s’engager à sa suite (Mc 8, 34-35). Suivre le Christ ici conduit le disciple à un renoncement radical à soi-même et à toutes ses tendances égoïstes afin de faire dépendre sa vie uniquement de lui seul. La suite du Christ (l’itinérance géographique) est ainsi conditionnée par le renoncement radical, comme lieu de conversion (itinérance spirituelle). L’itinérance spirituelle se présente ici comme le lieu d’une identification au Christ.
ITINERANCE COMME IDENTIFICATION AU CHRIST
Le Christ comme chemin
12. La grande innovation du Nouveau Testament est l’identification du chemin avec le Christ : le Christ lui-même se présente comme la voie vivante qui mène au ciel et donne accès au Père (Jn 14, 6). Cette identification du Christ au chemin montre que la route à entreprendre (qu’elle soit physique ou spirituelle) n’est pas un ensemble de lois ou d’attitudes mais la Personne du Christ, la seule voie à laquelle le disciple doit s’identifier pour avoir accès à Dieu le Père. Toute la démarche du chrétien (son itinérance) va donc consister à s’identifier au Christ par sa vie de foi. Croire au Christ consiste donc à aller et à s’unir à lui (s’engager existentiellement vis-à-vis de lui), de façon à s’approprier ses dons et richesses, condition pour atteindre Dieu.
L’identification au Christ (le chemin menant au Père) se présente ici comme ce qui donne au chrétien la consistance, la stabilité lui permettant de poursuivre la route malgré les difficultés et les épreuves du chemin. Autrement dit, s’identifier au Christ – lieu d’une vie de foi et d’enracinement en sa Personne – c’est ce qui donne au disciple l’élan pour une vraie itinérance. Il n’y a donc pas de vraie itinérance sans la recherche d’une certaine fixité ou stabilité en Christ.
Obéissance et itinérance dans l’Ordre
13. La question d’identification au Christ – lieu d’une conformité à sa volonté et de l’obéissance – a un lien très fort avec l’itinérance dans l’Ordre. En effet, dans la tradition dominicaine l’itinérance du fait de l’obéissance est l’origine même de l’Ordre ou plutôt de son développement spectaculaire hors de la région toulousaine. Saint Dominique disperse les frères deux par deux (Libellus 47), probablement en pensant à l’action identique de Jésus envoyant ses disciples deux par deux. Il s’agit d’une obéissance qui exclut la discussion (cf. Déposition du fr. Jean d’Espagne, Déposition de Bologne, 26) et qui est maintenue malgré l’opposition des frères et des autorités civiles et religieuses amies de saint Dominique. Les fruits seront le développement magnifique de l’Ordre. Là encore il s’agit d’une dispersion en vue d’une mission, celle de la prédication et de la propagation de la vie apostolique selon le modèle imaginé et voulu par saint Dominique. Les dépositions au procès de canonisation de Maître Dominique montrent que les frères voyageaient beaucoup d’un lieu à l’autre en fonction des besoins. Un exemple de cette mobilité est l’assignation du Bx Reginald à Paris alors qu’il faisait merveille à Bologne (Libellus 61-62).
L’obéissance religieuse n’est pas un but en soi. Elle est au service de la mission de l’Ordre, telle qu’elle est définie par les Chapitres généraux et provinciaux, et elle assure à l’Ordre la liberté nécessaire à son action (Bologne 33). Elle est un moyen pour que les frères, comme corps constitué, répondent aux exigences du bien commun à atteindre ensemble puisqu’il a été discerné ensemble. L’obéissance n’est donc pas l’expression du caprice du supérieur ou du Chapitre, mais l’expression personnalisée de l’effort qui est demandé à tous en vue de la mission ou du bien de l’Ordre dans des circonstances particulières. Comme celles-ci sont par nature changeantes, il convient que les frères acceptent de changer aussi afin de répondre au mieux à la mission. La mobilité intellectuelle, apostolique des charges, des lieux, est donc la conséquence de la mission évaluée et voulue en commun. Tant l’immobilisme que l’excessive mobilité sont des évasions par rapport à la mission. L’obéissance est un moyen pour réguler la mobilité en vue de la mission, de provoquer l’itinérance afin de répondre aux nécessités imposées par les circonstances ou voulues par un Chapitre. Évidemment, pour rejoindre ce que la Bible nous enseigne, l’itinérance voulue et acceptée dans le cadre de l’obéissance religieuse suppose la foi, d’une part en la capacité de l’institution à discerner le bien commun et, d’autre part, en Dieu, puisque c’est son Évangile qui est à l’origine de notre présence dans l’Ordre et la mission confiée par l’Église que nous servons du mieux possible. En ce sens, pour nous, l’obéissance religieuse et l’itinérance qui peut en résulter sont intimement liées à notre vie religieuse, puisque celle-ci est en vue de la prédication de l’Évangile. Ce n’est pas pour rien que le seul vœu que nous exprimons publiquement est celui de l’obéissance.
II – ITINERANCE – VIE CONTEMPLATIVE – MATURITE
ITINERANCE OU DEMEURE – Y A-T-IL UNE « MEILLEURE PART » ?
14. « Comme ils faisaient route, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit : ‘Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule ? Dis-lui donc de m’aider.’ Mais le Seigneur lui répondit : ‘Marthe, Marthe, tu te soucies et t’agites pour beaucoup de choses ; pourtant il en faut peu, une seule même. C’est Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée.’ »
Ce passage de l’Évangile selon saint Luc est probablement celui qui a contribué et contribue toujours le plus à une compréhension chrétienne de la contemplation : la contemplation est devenue synonyme du contraire de l’action, et valant mieux que l’action. Dans cette image, on chercherait en vain une allusion à la valeur particulière de l’itinérance pour un vrai disciple du Christ, hormis le fait que le Seigneur lui-même et ceux qui l’accompagnaient « faisaient route », avant d’entrer dans la maison de Béthanie.
Et pourtant, par un malentendu, on persiste parfois à interpréter ce texte comme une condamnation de l’action, donnant la préférence à « une vie cachée de silence » ou à un « lieu retiré pour la contemplation ». Et de fait, à première vue, « l’itinérance » semble exactement à l’opposé de l’attitude de Marie dans l’Évangile de Luc : elle ne bouge pas même d’un pouce pour aider sa sœur !
Enfant, je me sentais toujours quelque peu mal à l’aise devant la réaction de notre Seigneur à la requête de Marthe. D’un côté, d’après mon raisonnement naïf, Jésus profite de la diligence et du labeur de Marthe, mais d’un autre côté, en même temps, il reste avec Marie, qui est assise à ses pieds se contentant de l’écouter. À vrai dire, j’avais de la peine pour Marthe et j’en voulais à Marie, que je trouvais bien paresseuse, et il me semblait un peu injuste que Jésus la félicitât. Je m’imaginais devoir faire la vaisselle pendant que ma sœur lirait la Bible – j’aurais sûrement considéré qu’elle avait pris la meilleure part, et certainement pas qu’elle méritait des félicitations par dessus le marché ! Seulement, contredit-on Jésus ? J’aurais néanmoins aimé lui poser une question : mais alors, et tes paroles à la femme qui éleva la voix du milieu de la foule en te disant : « Heureuses les entrailles qui t’ont porté et les seins que tu as sucés ! » Ne lui as-tu pas répondu : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l’observent ! » ?
Quoique mon innocente pensée enfantine ait bien peu à voir avec l’érudition biblique actuelle, je demeure convaincu d’avoir eu raison de mettre en doute une conception de la « contemplation » qui ne consisterait qu’à « s’asseoir et écouter ». Selon l’enseignement de notre Seigneur lui-même, il faut « observer la parole », « faire la volonté du père » .
ITINERANCE ET CONTEMPLATION : L’ART D’INTERPRETER LE TEMPS PRESENT
15. Ce qui est clair, c’est qu’on utilise à tort « contemplation » si l’on se limite à un contraste avec « action », comme pour exhorter qu’il vaut mieux rester chez soi à ne rien faire que de s’asseoir et d’écouter. Non sans raison les Constitutions des Moniales de notre Ordre associent, dans un même souffle, la contemplation et le silence, avec l’empressement au travail, la ferveur dans l’étude de la vérité, l’assiduité à la prière et la concorde fraternelle.
Aussi, en tous cas selon une conception dominicaine, « la vie contemplative » c’est « la contemplation » allant de pair avec « l’action ». La « contemplation » est donc autre chose que la paresse. Et elle ne signifie pas immobilité ou rigidité. Même la clôture de nos moniales est liée à l’intelligence de la largeur, de la hauteur et de la profondeur de l’amour de Dieu, qui a envoyé son Fils pour que, par Lui, le monde entier soit sauvé.
« Le vide », si important pour toute « contemplation », n’est pas l’oisiveté. L’Évangile selon saint Jean nous raconte une autre visite de Jésus à la maison de Béthanie, qui nous aide à saisir plus pleinement les dimensions d’une « vie contemplative ».
« Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d’entre les morts. On lui fit là un repas, Marthe servait. Lazare était l’un des convives. Alors Marie, prenant une livre d’un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s’emplit de la senteur du parfum. »
Marthe sert à nouveau le Seigneur, Lazare est à table avec Jésus, mais Marie, qui dans l’Évangile de Luc avait choisi la meilleure part, n’est pas assise aux pieds de Jésus cette fois-ci, au contraire elle fait quelque chose de bien concret. Il semble pourtant qu’elle ait encore choisi « la meilleure part ». Jésus prend à nouveau son parti et la soutient contre l’intervention de Judas l’Iscariote et des disciples. Ce qui nous amène à la question : Quel est le mystère du « choix de la meilleure part », quelle est la véritable clé d’une « vie contemplative » ?
On trouve une réponse à cette question dans le livre de l’Ecclésiaste, un texte d’une grande sagesse – sûrement le résultat, le fruit d’une vie contemplative :
« Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour détruire, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour gémir, et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour en ramasser ; un temps pour embrasser, et un temps pour s’abstenir d’embrassements. »
« Interpréter le temps présent », voilà ce que Jésus attend des disciples. De toute évidence, Marie de Béthanie comble pleinement l’attente du Seigneur : lorsqu’elle s’assied à ses pieds pour écouter ses paroles, mais tout autant quand elle prend une livre de parfum et exprime généreusement son amour, sans se soucier de ce que les gens peuvent penser d’elle.
Comment y parvenir ? Quelles sont les conditions préalables nécessaires pour devenir un interprète du temps présent, un homme contemplatif, une femme contemplative ? Est-ce cette forme particulière d’attention que Marie de Béthanie manifeste au Seigneur : elle est totalement attentive à lui, à sa personne, elle est totalement attentive à sa mission, et en même temps elle demeure consciente d’elle-même et de ce qui est bon pour elle : elle vit réellement une relation permanente avec « celui que son cœur aime ».
Ce type d’attention implique qu’on centre sa vie entière sur un point unique : le lien avec Dieu et sa volonté. Pas à pas, cela nous forme à la façon dont Jésus a mené sa vie : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. »
Aucun doute sur l’itinérance de Jésus, et qu’il ait vécu une vie active ne fait pas de doute, mais il n’y a aucun doute non plus sur sa prière solitaire et silencieuse : la clé d’une vie contemplative est « l’interprétation du temps présent », l’attention à la volonté du père, la décision de ne régler votre vie que sur ce que Dieu demande ici et maintenant, « d’aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre toujours ses voies, d’observer ses commandements, de vous attacher à lui et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. »
ITINERANCE – CONTEMPLATION – MATURITE
16. « Notre cœur ne connaît aucun répit jusqu’à ce qu’il trouve son repos en Toi » – cette idée pénétrante de saint Augustin relie nos réflexions sur l’itinérance et la contemplation à la maturité dans la vie religieuse (et chrétienne). La maturité est inconcevable sans changement, sans avancée, sans prise de risque, sans itinérance spirituelle. Mais ce processus de croissance a besoin de haltes, de pauses, de temps d’adaptation aussi. Il nécessite à la fois notre travail personnel et des stimulations externes.
L’Évangile de Luc nous offre un excellent récit sur le processus de maturation religieuse et humaine.
« Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux faisaient route vers un village du nom d’Emmaüs, distant de Jérusalem de soixante stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. » L’itinérance – n’eût-elle pour but que d’échapper à la dépression – est décrite comme une condition suffisante, sinon nécessaire, à la guérison intérieure et au développement, tout comme l’amitié. Il n’existe pas de maturation que l’on suive seul. On a besoin de l’autre, besoin qu’il ou elle chemine à nos côtés, qu’il ou elle nous réconforte, qu’il ou elle partage nos soucis et nos préoccupations, qu’il ou elle nous remette en question.
« Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s’approcha, et il faisait route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : ‘Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?’ Et ils s’arrêtèrent le visage sombre. » Le récit nous fournit là une idée supplémentaire de comment l’on mûrit : en-dehors des personnes qui nous sont déjà familières, nous avons besoin d’être provoqués par l’extérieur. Pleurer ensemble et partager au sein d’un cercle d’amis n’est pas suffisant. Tant qu’on reste en terrain connu, il n’y a ni amélioration ni progrès : on s’arrête le visage sombre. Et même si l’on s’ouvre à la rencontre avec l’autre dans une expérience d’altérité, nos yeux pourraient bien être empêchés de reconnaître.
« Prenant la parole, l’un deux, nommé Cléophas, lui dit : ‘tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci !’ » Cela nous amène à une autre idée concernant les conditions préalables au processus de maturation. Cléophas considère l’inconnu à côté d’eux comme le seul à ne pas savoir. Alors qu’en fait, l’inconnu est justement le seul qui sait ! Mûrir exige une sorte d’abandon des sécurités. Tant que je serai convaincu d’être le seul à savoir, sûr que l’autre, l’inconnu, l’étranger est le seul à ignorer, mes yeux resteront clos et mon cœur ne sera pas tout brûlant au-dedans de moi – je ne pourrai atteindre à la maturité religieuse. « Alors il leur dit : ‘Ô cœurs sans intelligence, lents à croire à tout ce qu’ont annoncé les Prophètes !’ » Ce qui souligne l’obligation de compter avec cette possibilité : et si le cœur sans intelligence c’était moi, les convictions insensées les miennes, et non celles que je répute telles – comme les disciples d’Emmaüs qui considéraient insensées les femmes de leur groupe ?
« Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Nous observons maintenant la connexion entre la contemplation comme attention et le développement spirituel. Il faut écouter la Parole de Dieu et tenir compte de son étrangeté et de sa nouveauté. C’est ce que font les disciples d’Emmaüs en fait. Ils écoutent attentivement celui qui les a traités de « cœurs sans intelligence ». Ils vont même plus loin, ils le pressent : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » D’une certaine manière, c’est la curiosité, une aspiration profonde à plus de clairvoyance, un ardent désir de mieux comprendre, qui, au bout du compte, avec la révélation pleine d’amour du Seigneur, conduit à la reconnaissance et à la maturité du disciple. Maintenant leur itinérance va changer de direction : de la fuite à la rencontre, les yeux ouverts sur l’inattendu.
Le dernier Chapitre général formule cela en termes concrets pour la vie dominicaine contemporaine, en abordant le lien entre la contemplation et la formation (initiale) : « Considérant les différents aspects de ce monde qui ont formé nos frères jusqu’ici, trois éléments s’avèrent cruciaux pour qu’ils s’approprient un esprit contemplatif authentiquement dominicain : la constance, la profondeur et l’ouverture. La constance est un remède à notre expérience du caractère parfois éphémère que revêt notre vie, que ce soit sur un plan intellectuel, personnel ou religieux. Elle est manifeste dans notre longue vie d’étude et dans l’observance externe de la prière, du silence et d’une vie commune qui devrait nous réjouir. La profondeur s’érige en contraste face aux plaisirs, souvent superficiels, promis à bon nombre de gens dans une économie globale, mais dont peu sont récompensés ; elle engendre la guérison du désir qui est à la fois nécessaire et attendue. Elle est surtout visible dans le développement de la vie de prière, la vertu, l’amour de l’étude et dans une connaissance de soi plus compatissante. L’ouverture est à la fois un héritage de notre temps, mais aussi un antidote aux réactions contre celui-ci. Comme dominicains, nous ne pouvons prétendre être des prêcheurs vraiment contemplatifs qu’à la condition d’être ouverts aux personnes et à leurs expériences, à de nouveaux apprentissages et aux voies nouvelles à travers lesquelles Dieu nous invite à servir. Pourtant, afin que ces éléments soient présents et bien intégrés pour nos frères en formation initiale, nous devons nous engager nous-mêmes à renouveler notre vie dans chacune de ses dimensions (Mexico 27, 4) et à participer à la vie commune, même s’il nous en coûte personnellement (Ratio Formationis Generalis, 166). Ainsi faisant, nous donnons à nos frères en formation une manifestation visible de la Sainte Prédication à laquelle ils sont appelés et pour laquelle nous les invitons à engager leurs vies. »
Je ne saurais conclure cette approche spirituelle de l’aspect « Itinérance – Contemplation – Maturité » sans du moins citer un autre texte clé. On le trouve à la fin de l’Évangile de Jean : c’est le dialogue émouvant entre Jésus et Pierre. Après le témoignage de Pierre, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime », et la réponse de Jésus : « Pais mes brebis », le Seigneur continue : « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais ; quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. » Voilà peut-être la partie la plus importante de notre itinérance personnelle, la contemplation la plus profonde, le plus haut degré de maturité : quand nous sommes prêts à accepter que ce n’est plus nous qui définissons et décidons que faire, où aller, que quitter et que garder – mais nous étendons les mains pour qu’un autre puisse nous ceindre et nous emmener où nous ne voudrions pas – tout en gardant pleinement confiance que tout ce qui arrive est pour notre bien, et nous sommes encore capables d’avouer : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime ».
III – L’ITINERANCE DANS LE CHEMINEMENT INTELLECTUEL ET LE PARCOURS DE LA FORMATION
17. Itinérance signifie mouvement, capacité d’aller de l’avant avec passion, dans un esprit d’aventure. En réfléchissant à cet aspect de notre vie dominicaine, nous pouvons tenter de discerner les différentes manières dont ce mouvement est parfois bloqué, en nous-mêmes, dans nos communautés et dans nos provinces. Le blocage du mouvement intérieur est en fin de compte une forme de refoulement ou de répression. Il peut survenir au niveau des émotions, ce qui est une forme de névrose ; il peut apparaître au niveau mental, ce qui est un brusque arrêt idéologique des capacités intellectuelles ; et il peut se manifester au niveau de la vie spirituelle, lorsque la réponse à Dieu est paralysée par des freins intérieurs. Cette dernière forme de répression est la plus inhibitrice de l’itinérance propre à notre charisme dominicain.
LA LIBERATION DE L’ITINERANCE EMOTIONNELLE
18. Dans une répression de type névrotique, la dynamique des émotions est bloquée par d’autres émotions, par la peur, ou par un sentiment d’obligation affective. Cela mène à une concentration sur soi-même, une incapacité à l’autocritique, et une gravité qui ne laisse aucune place à l’humour. La répression émotionnelle est un problème de la jeunesse, quand la peur de soi-même, de ce qui est nouveau, de la sexualité, de ce que les gens vont faire ou dire, ou le sentiment émotionnel du devoir devient la règle primordiale. Elle empêche la conscience de raisonner par elle-même. Ce qui peut pousser de jeunes hommes et de jeunes femmes à rechercher la sécurité d’une vie religieuse protégée. Dans leur fragilité émotionnelle, ils sont parfois en quête de règles de vie claires et simples qui les dispensent du risque et de l’aventure. Au lieu d’être motivés par une fascinante mission de prédication, réussir à toucher les Cumans de notre époque, ils demeureront coincés par leurs peurs, par leur désapprobation instinctive de tout ce qui implique une nouveauté. Une vie communautaire saine les aidera à se libérer de ces peurs, à toucher les autres, à se laisser émouvoir par eux, à rire en toute liberté intérieure de leurs propres tâtonnements. Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, car ils s’amuseront beaucoup toute leur vie !
LA LIBERATION DE L’ITINERANCE INTELLECTUELLE
19. Dans le cas d’une répression intellectuelle, l’esprit est empêché d’avancer à la rencontre de la vérité dans toute sa richesse et sa diversité contextuelle. Un esprit qui s’abstient de l’effort de chercher la vérité, ou qui préfère des demi-vérités d’une simplicité séduisante, reste coincé dans une lamentable paralysie intellectuelle ou sera constamment ballotté au gré de forces extérieures telles que la mode.
20. L’itinérance ne devrait pas signifier une dispersion de l’esprit. Il y a là un danger intellectuel : adopter une attitude de type supermarché, essayer de tout savoir, s’intéresser à tout, accepter toutes les tendances à la mode sans même tenter de voir comment elles s’accordent entre elles. La première étape de la formation intellectuelle est un moment où l’esprit doit être nourri. Nous avons besoin de temps pour étudier, de temps pour une construction contemplative du monde. Nous devons nous poser des questions plus profondes, voir le nexus mysteriorum, l’enracinement métaphysique de la vérité.
Jésus a dit : « Ouvrez l’œil et gardez-vous du levain des Pharisiens et du levain d’Hérode » (Mc 8, 15). Les Pharisiens croyaient détenir toutes les réponses, leur esprit bloqué ne pouvait s’étendre au-delà de leurs convictions rigides. Hérode, lui, n’avait aucune réponse, aucune idée préconçue, aucune idéologie ; il voulait se divertir et s’amuser. À l’ère postmoderne, les grandes idéologies ont disparu, et le monde tourne autour du divertissement, faire de l’argent et le dépenser, créer et satisfaire des besoins superficiels. Il est donc tentant aujourd’hui d’en rester au niveau de la surface. Un/e jeune entrant dans l’Ordre peut être tenté/e de tout connaître, de s’intéresser à tout, d’accumuler sur maintes questions quantité d’informations issues de la télé, des journaux, des voyages ; mais il lui manquera une capacité de vision approfondie. « On est contraint de constater le caractère fragmentaire de propositions qui élèvent l’éphémère au rang de valeur, dans l’illusion qu’il sera possible d’atteindre le vrai sens de l’existence » (Jean Paul II, Fides et ratio, 6). La première étape de la formation intellectuelle doit aider le/la jeune à se forger des convictions, à s’affranchir de l’esclavage des modes. Notre tradition dominicaine est fondée sur la conviction que la raison possède un penchant inhérent pour la vérité, qu’elle peut percevoir le vrai bien, et s’y conformer, non sous la pression du groupe extérieur, mais parce que c’est vrai. Pour cela, cependant, la capacité de discerner la vérité doit être développée.
De quel type de philosophie dotons-nous nos jeunes ? Un savoir d’idées disparates et contradictoires, permettant de s’adapter aux divers courants de pensée contemporains ? Ou une philosophie qui intègre l’esprit, le conforte dans sa capacité de connaître le vrai, lui donne les moyens d’interpréter de manière critique ce qu’on observe dans la culture contemporaine ? Certaines personnes ont besoin d’aide pour formuler une synthèse intellectuelle, avant de pouvoir s’étendre vers de nouveaux domaines de pensée. D’autres y réussiront tout en acquérant un savoir disparate, car ils ont déjà des convictions intérieures bien formées.
Un excès d’itinérance intellectuelle durant la phase initiale de la formation peut avoir des effets désastreux. Certains, dans leur cheminement intellectuel, passent d’un extrême à l’autre. Ils commencent libéraux et finissent ultra-conservateurs. Ils cherchent des réponses à leurs questions dans le bouddhisme, la psychanalyse ou les sciences politiques, sans jamais prendre le temps de se plonger dans la Parole de Dieu et dans la tradition catholique. La formation intellectuelle initiale devrait déboucher sur le choix d’un Maître, auteur/e approuvé/e par l’Église, qui aidera l’étudiant à formuler une synthèse théologique. Il peut s’agir d’un Père ou d’un Docteur de l’Église, d’un théologien renommé, ce peut très bien être saint Thomas d’Aquin. Si les jeunes frères et les jeunes sœurs passent de nombreuses années à lire l’auteur/e élu/e, à étudier sa théologie, à construire leur ministère et leur prédication en se fondant sur l’œuvre du Maître, cela leur donnera un solide point de repère. Le prêcheur saura de quoi il parle. En revanche, l’absence de synthèse peut conduire à un état de perpétuelle itinérance, sans aucune conviction.
21. La nécessité d’une certaine hygiène intellectuelle ne doit cependant pas faire redouter les questions. La tradition thomiste formule le videtur quod. Notre synthèse intellectuelle est fondée sur la conviction que l’esprit peut s’accrocher au vrai bien. Convaincus que la vérité est accessible, nous pouvons aborder sans crainte toutes sortes de questions, sûrs que chaque vérité, quelque en soit la source, découle en fin de compte du Saint-Esprit. Un esprit formé, capable de discernement critique, n’a pas peur des idées nouvelles. Il continue de développer sa curiosité, il n’hésite pas à comparer son approche à celle des autres, il est capable d’acquérir de nouvelles informations, d’élargir son champ d’intérêt, parce qu’il possède une base. L’itinérance est possible quand on a un foyer où rentrer. Elle n’est pas une invitation au nihilisme intellectuel.
Un esprit formé à rechercher la vérité, et à s’y tenir, sera exempt de toute stagnation intellectuelle. La quête de la vérité devrait nous éviter de rester englués dans un état d’esprit, une vision de l’Église, de la société, où il n’y aurait pas de place pour une auto-analyse critique. Demandons-nous à l’Esprit où il nous conduit ? Le laissons-nous faire ? L’intelligence a soif de vérité ; mais on peut l’asservir : c’est le danger des idéologies. L’intelligence s’arrête brusquement à une demi-vérité, et ne se laisse pas conduire à la plénitude. Il n’y a pas que les grandes idéologies à avoir imposé diverses formes de totalitarisme. Il y a aussi de petites idéologies qui enferment des communautés et des provinces. Un style de vie particulier, un ensemble d’options concernant l’Église, les besoins d’une province ou d’une congrégation religieuse, se transforment aisément en une tradition inamovible. C’est un peu comme un moyen contraceptif qui empêcherait la naissance de nouveaux concepts ; il n’y a pas de vie insufflée. La forme dominicaine de gouvernement démocratique chérit la nouveauté pleine de vie des idées, à laquelle il faut réserver un champ d’expression dans nos Chapitres, nos rencontres communautaires, nos sessions de formation. Certes, toutes les solutions proposées ne conviennent pas, mais un milieu communautaire sain permettra qu’elles soient exprimées et discutées. Alors que si on relègue la discussion aux oubliettes, les petites idéologies maintiendront la communauté dans un état d’inertie.
La recherche de la vérité doit être entreprise dans la vie communautaire, les réflexions philosophiques, l’étude de la théologie, et dans le pèlerinage de la foi. Un des drames de la scène intellectuelle contemporaine est l’abandon de la quête de la vérité. « Il en va ainsi, par exemple, de la défiance radicale envers la raison que révèlent les plus récents développements de nombreuses études philosophiques. De plusieurs côtés, on a entendu parler, à ce propos, de « fin de la métaphysique ». (…) Je ne peux pas ne pas encourager les philosophes, chrétiens ou non, à avoir confiance dans les capacités de la raison humaine et à ne pas se fixer des buts trop modestes dans leur réflexion philosophique » (Fides et ratio, 55-58). « Le mystère de l’Incarnation restera toujours le centre par rapport auquel il faut se situer pour pouvoir comprendre l’énigme de l’existence humaine, du monde créé et de Dieu lui-même. Dans ce mystère, la philosophie doit relever des défis extrêmes, parce que la raison est appelée à faire sienne une logique qui dépasse les barrières à l’intérieur desquelles elle risque de s’enfermer elle-même » (Fides et ratio, 80).
22. L’expansion de l’esprit, itinérance intellectuelle, l’entraîne plus profond encore dans la vérité. C’est ce que signifient la foi et le dogme. Suivant la tradition théologique classique, la foi est un don de Dieu qui fait sortir l’esprit de sa coquille et l’attire à Dieu. Les énoncés dogmatiques sont un don du Saint-Esprit pour apporter plus de lumière, empêchant l’esprit de tomber dans l’erreur et le recentrant sur le mystère qui est salvifique. Dans la pensée moderne, la foi et le dogme sont interprétés comme une limitation de l’esprit, un blocage de la curiosité imposé par les autorités ecclésiastiques. Une itinérance spirituelle impliquera que l’esprit s’étende jusqu’à la vérité révélée. « En tant que vertu théologale, la foi libère la raison de la présomption, tentation typique à laquelle les philosophes sont facilement sujets » (Fides et ratio, 76).
L’adaptation de l’esprit au mystère divin est néanmoins douloureuse, car, par nature, l’esprit aspire à la clarté alors que la foi est une rencontre du mystère. Au sein même de la foi, il y a place pour chercher à comprendre (cogitatio fidei) , mais on trouve aussi parfois une coagitatio fidei. Le besoin de clarté inhérent à l’esprit fait qu’en s’adaptant à la foi, il se trouble. Dans l’essor de la foi l’esprit rencontre la croix. Le passage par cette croix est toujours douloureux, mais, paradoxalement, vivifiant. La grande pierre d’achoppement de la foi c’est l’orgueil intellectuel : l’incapacité ou le refus inconscient d’accepter le mystère. Nous ne devons pas scruter la Parole de Dieu à travers les instruments des sciences humaines en prenant ces sciences (histoire, archéologie, linguistique, psychologie, sociologie, philosophies) comme critère suprême, car cela détruit la foi. (Interprétant saint Paul, Thomas d’Aquin dit que même les bonnes philosophies peuvent détruire la foi, si ce sont elles qui ont le dernier mot !) . Nous sommes appelés à scruter notre vie en prenant la foi pour critère suprême. C’est douloureux pour l’orgueil intellectuel, mais c’est la seule manière d’avancer. Le courage de l’itinérance intellectuelle rend possible l’itinérance au niveau spirituel.
LA LIBERATION DE L’ITINERANCE SPIRITUELLE
23. Dans son pèlerinage de foi, l’esprit a besoin d’être libre de toute attache. Or, quand nous inventons des projets, de nouvelles missions, quand nous percevons des défis, quand nous concevons des idées, nous tendons à nous y attacher. L’attachement à nos propres concepts est bon pour un temps, mais nous nous en attribuons très facilement le mérite. Lorsque le Saint-Esprit conçoit la vie dans l’Église, c’est sans égoïsme, en un don total de soi. La conception du Saint-Esprit est immaculée. L’astuce consiste à être désintéressé dans ce que nous faisons avec passion. La motivation de notre travail a besoin d’être purifiée. Les mauvaises habitudes ne sont pas les seules qui ont besoin d’être purifiées, les bonnes intentions également, pour nous assurer qu’elles vont vers Dieu. Sans quoi l’attachement à nos propres idées empêche la croissance spirituelle et porte à se bâtir des empires personnels. L’essentiel est la transparence pour voir Dieu à l’œuvre en nous. Dans les inspirations intellectuelles comme dans les aspirations artistiques la tentation de l’égoïsme existe. À peine une idée nous vient-elle à l’esprit que déjà surgit la joie de l’utiliser dans un article, un projet artistique, une homélie à prêcher – pour notre gloire personnelle. Dépendre de Dieu, dans un esprit d’itinérance, exige une grande pauvreté spirituelle. Les bonnes choses qui nous passeront par la tête, les mains, la parole, viennent de Dieu et non de nous, même si nous leur avons consacré notre énergie et nos talents.
La profession religieuse par laquelle nous vouons notre avenir à Dieu confirme le prix de l’itinérance. Accepter l’inconnu, reçu dans la foi, comme règle de vie permanente, renforce notre attachement à Dieu et à Dieu seul. C’est là que naît la vraie fécondité de la vie et de la mission. Au fond, c’est la grâce de Dieu qui permet que le bien naisse de notre service.
Nous découvrirons au moment de la mort ce qu’était notre véritable vocation, quand, nous retournant sur notre vie, nous verrons à quel moment nous avons le mieux répondu aux appels qui nous étaient adressés. Une carrière authentique est faite par Dieu, tandis qu’à chaque étape de notre vie nous nous donnons à Lui totalement. Mais chaque étape est une surprise, elle n’arrive pas comme la réalisation d’un projet personnel pour lequel nous nous sommes battu. Dans les premières périodes de notre vie, nous faisons des plans et des rêves, mais, un à un, Dieu nous demande d’y renoncer, car ses desseins s’avèrent totalement différents. Que pouvons-nous dire de cette jeune postulante qui entra dans une congrégation dominicaine à Moscou, au début du XXème siècle ? Elle avait rêvé de parcourir la planète et de voir le monde, mais en même temps elle reconnaissait que Dieu lui demandait davantage. Elle mit ses rêves de côté et entra dans la vie religieuse, abandonnant à Dieu ses projets de voyage inaccomplis. La réponse de Dieu s’est révélée abondante. Avant la fin de son noviciat, la jeune femme fut arrêtée et envoyée au goulag en Sibérie. Elle vécut un long noviciat dans de nombreux camps de prisonniers, sur la côte Arctique puis au bord de la frontière chinoise. Son désir initial de voyage s’accomplissait d’une manière démoniaque mais divine à la fois. Sept ans passèrent avant qu’elle ne rencontre, dans un camp de prisonniers, une autre sœur entre les mains de qui elle put enfin faire sa profession. Une vie gâchée, peut-être, ou bien pas : au cœur de l’irréligion, au milieu du désespoir, cette sœur dominicaine a apporté le message de l’Évangile prêché par son témoignage et sa charité.
24. Comment se fait-il que certains d’entre nous ne veuillent pas se déplacer, refusent d’accepter que nous puissions être envoyés en mission ? Il y a les cas d’individualisme forcené, l’idée fixe de l’accomplissement personnel, l’ambition du succès. Au lieu de répondre à Dieu qui nous envoie, la poursuite d’une carrière privée l’emporte, comme si nous pouvions planifier notre vie. D’autres fois, c’est un attachement excessif à notre premier amour, la première assignation. Nous avons accepté la tâche qu’on nous confiait, nous l’avons accomplie avec la juste motivation, comme notre don à Dieu, mais au fil du temps nous nous sommes attachés à notre œuvre, nous traitons nos résultats comme s’ils ne tenaient qu’à nous. Nous n’arrivons pas à accepter que Dieu ait demandé nos services quelques années pour cette mission, avant que d’autres ne soient chargés de la poursuivre, tandis que nous devrons changer de tâche. C’est un moment difficile, comme pour les parents qui doivent laisser partir leurs enfants adultes. Les parents âgés qui ont focalisé leur vie sur leurs enfants peuvent redouter leur propre avenir : que vont-ils bien pouvoir faire plus tard dans la vie sans leurs enfants ? Mais c’est un passage normal, quand le temps est venu de trouver un nouveau défi dans l’existence.
Dans la vie religieuse, nous ne sommes pas propriétaires de nos apostolats, pas plus que nous ne possédons les gens que nous servons. Nous devons accepter qu’en les laissant à d’autres, c’est entre les mains de Dieu que nous les remettons, et Dieu aura soin d’eux. Pour cela il faut avoir l’espérance. Espérer, c’est accepter le mystère qui se déploie dans notre vie. Une espérance naturelle donne l’énergie, l’élan de relever des défis difficiles. (En polonais, le mot pour espérance, « nadzieja », signifie « force d’agir »). La vertu théologale de l’espérance, parce qu’elle est centrée sur Dieu, permet à notre volonté d’accepter la voie que Dieu nous a tracée. Saint Augustin et saint Jean de la Croix lient tous deux l’espérance à la mémoire, ils écrivent que pour croître en espérance, il faut purifier la mémoire. Non que se souvenir soit mauvais. Une bonne mémoire est bien sûr un atout de valeur, mais nous pouvons aussi nous attacher à nos souvenirs, aux bons comme aux mauvais, et cet attachement doit être purifié. L’attachement aux souvenirs agréables peut freiner l’enthousiasme d’aller de l’avant, d’accepter la nouveauté dans la vie. Il est normal qu’un frère travaillant dans une aumônerie universitaire ressente la joie de servir des jeunes au moment où ils s’épanouissent. Mais il les aidera de manière à les laisser partir, s’en aller vers d’autres villes, construire une famille, vivre leur vie. Quand il sera remplacé par quelqu’un de plus jeune, il devra mettre de côté le souvenir des joies et l’expérience pastorale acquise au fil des ans, pour pouvoir accepter une nouvelle tâche, un nouveau défi. De la même manière les mauvais souvenirs peuvent empêcher l’itinérance. Le rappel de situations difficiles, de souffrances, peut être paralysant. Quelqu’un qui a souffert dans une communauté où il ou elle n’était pas apprécié/e ne voudra certainement pas y retourner et ne sera pas prêt non plus à occuper un travail similaire, dans des conditions analogues. Alors que la communauté peut avoir changé entre-temps, ses membres peuvent avoir mûri, évolué, abandonné leurs comportements hostiles. Laisse-t-on à la communauté le droit de faire des erreurs et d’en sortir ? Les souvenirs douloureux ont aussi besoin d’être purifiés pour que l’espérance grandisse, et que soit acceptée la confiance dans le mystère divin qui se déploie dans la vie.
La purification de l’espérance aide à centrer l’attention sur Dieu. Et lorsque Dieu est vraiment notre passion première, alors nous sommes libres de partir. L’itinérance dominicaine a besoin de cette liberté. Le frère à qui l’on demande de changer de communauté tout comme le provincial à qui l’on demande de donner un frère peuvent le faire s’ils acceptent la conduite mystérieuse de Dieu. S’ils ne parviennent pas à s’ouvrir au mystère de Dieu ils refuseront les nouvelles missions qui leur seront proposées. Parfois les provinciaux sont perplexes lorsqu’on leur demande de donner un frère, parce qu’il a été formé et préparé pour la province ou qu’il gagne de l’argent pour la province… Où est alors l’ouverture au mystère dans l’espérance ?
25. Il n’est pas bon d’avoir trop de postes salariés. Évidemment les communautés préfèrent avoir des frères ou des sœurs qui ramènent un revenu régulier. Cependant, certaines tâches entreprises par l’ensemble de la communauté (par exemple, la responsabilité d’un sanctuaire) rapportent aussi de l’argent, sans pour autant lier un individu à un salaire. L’emploi salarié peut bloquer l’itinérance en ce qu’il conduit parfois une personne à passer des années dans le même travail, le même bâtiment, la même pièce. Les provinces qui ont trop de postes salariés finissent par stagner. Certains ministères doivent évoluer rapidement parce que la société traverse de profonds changements sociaux. Les jeunes changent souvent, sur des cycles de quelques années, ils écoutent un autre type de musique, vont voir un autre genre de films, mâchent un nouvelle marque de chewing-gum. Un jeune aumônier ou formateur/formatrice doit constamment s’adapter, préparer de nouveaux thèmes, de nouvelles conférences, pour ne pas perdre le langage commun avec les jeunes. À la longue, quand il y a peu de mouvement dans une province, une congrégation religieuse ou une fraternité laïque, l’inertie et la routine finissent par transmettre une image dépassée de l’Église.
26. Dans notre questionnement sur les réticences à l’itinérance, nous ne devons pas rejeter toute la responsabilité sur ceux qui ont du mal à quitter leurs attaches. Un blocage psychologique important contre l’itinérance vient parfois du manque de soutien de la part de qui envoie. Lorsqu’elle ouvre une mission, la province doit assumer la responsabilité des frères envoyés à l’étranger. Il y a habituellement une longue période durant laquelle une nouvelle mission appartient à la province, avec un statut de vicariat provincial ; à mesure qu’il croît en nombre, le vicariat devient d’abord régional, ensuite général, puis vice-province, et enfin province. Au long de toutes ces années, la province-mère peut envoyer ses frères dans la nouvelle entité, d’abord aux principaux postes de responsabilité, ensuite dans des engagements plus coopératifs, enfin dans une situation normale de dépendance vis-à-vis des frères locaux. Durant tout ce temps, la province-mère doit exercer sa responsabilité à l’égard des frères envoyés dans des missions lointaines. Ceux-ci ont besoin d’encouragements, d’intérêt, parfois d’aide financière. Si leur travail n’est pas considéré comme une mission mais comme un lieu commode pour mettre à l’écart les frères difficiles, dans la conviction que leurs problèmes se résoudront d’eux-mêmes, voilà qui par contrecoup découragera quiconque de relever le défi à l’avenir. Les personnes doivent savoir qu’elles sont envoyées en mission, pas reléguées dans un coin ou rejetées. L’itinérance exige la responsabilité de celui qui est envoyé comme de celui qui envoie.
27. Quand il allait de ville en ville, marchant le long des routes d’Europe, saint Dominique chantait Ave Maris Stella. Dans cette ancienne hymne mariale, on trouve la phrase Iter para tutum ! Saint Dominique priait Marie et lui demandait d’intercéder afin que son chemin soit sûr, qu’il le mène où il voulait aller, et que le dessein de Dieu soit présent dans ses initiatives.
IV – ITINERANCE ET MISSION
28. L’itinérance est le corollaire nécessaire de la mission. Ce lien ontologique s’enracine dans notre histoire et en particulier dans la vie de saint Dominique. Car il découvrit sa mission « en route » et envoya ses frères – même les novices – vivre « sur la route ». Les récents Chapitres de l’Ordre nous rappellent cette histoire et nous appellent à « nous remettre en route ». Quezon City, en 1977, a peut-être été le premier à montrer une conscience que les priorités s’étaient déplacées, mettant au premier rang « la catéchèse dans divers lieux et cultures ». Conscient que cette situation nouvelle et différente appelait une approche nouvelle, le Chapitre déclarait comme seconde priorité « la formation et la préparation nécessaire à la prédication dans ce nouveau monde ».
Les Chapitres suivants ont élaboré la signification précise de ces nouvelles priorités. Walberberg, en 1980, abordait « l’adaptation de nos activités apostoliques aux besoins d’aujourd’hui » et présentait quelques « jalons spécifiques » qui devraient caractériser la mission et la prédication dominicaines : prophétique, tirant crédibilité de notre pauvreté, fondée sur la compassion et s’appuyant sur l’étude scientifique de la théologie . Avila, en 1986, dans le pays même de Dominique, « homme de la frontière » exceptionnel, affirmait que la « mission spécifique » de l’Ordre est « l’évangélisation sur les frontières ». Et d’énumérer ces frontières où nous devons vivre notre mission. Oakland, en 1989, provoquait l’Ordre : « Entendons-nous ces appels qui montent du monde d’aujourd’hui ? » N’avons-nous pas plutôt besoin d’une conversion profonde, pour sortir des « commodité et sécurité [qui] produisent souvent des mentalités réfractaires à tout changement ». Nous devons retrouver « l’esprit d’itinérance et de mobilité de Dominique et (…) retrouver une pauvreté qui nous rende accueillants au souffle de l’Esprit et sensibles aux cris des âmes en détresse » .
Mexico (1992) signale les situations et les défis actuels de la vie apostolique dans l’Ordre et déclare avec vigueur : « Notre détermination [à relever ces défis] provient de l’exigence qui se trouve au cœur de chaque dominicain face à un appel si pressant. Les germes de notre tradition sont prêts à refleurir et porter fruit pour peu que nous sachions les accueillir avec un cœur généreux ». Le Chapitre cite aussi des « points forts de notre tradition », dont chacun exige et met en jeu un certain type d’itinérance physique ou mentale : la mobilité, être prêt à partir sans se laisser paralyser par un excès de bagage matériel, culturel, intellectuel ; le souci et le respect des gens, les rencontrer là où ils sont ; l’ouverture d’esprit, être prêt à apprendre et à écouter ; la communauté, car nous n’agissons jamais seul. Caleruega (1995) nous appelle à être « fidèles à l’itinérance » .
Les deux derniers Chapitres se centrent sur la nature de l’itinérance comme dépassement, « aller au-delà ». La mission, déclare Bologne (1998), « appelle l’Ordre à se porter courageusement par delà les frontières qui séparent les pauvres des riches, les femmes des hommes, les différentes confessions chrétiennes et les autres religions ». Le Chapitre situe cette mission sur « les lignes de fractures » de l’humanité et voit les membres de l’Ordre « consentir à servir ‘l’autre’ », (…) prêts à l’écouter et à nous laisser transformer par lui » .
Dans sa Relatio de Statu Ordinis au Chapitre de Providence, le Maître de l’Ordre parle d’un « avenir choisi, et dans la ligne d’une itinérance de cœur, d’esprit et de mission » et le Chapitre dit que chaque membre de la province doit garder la préoccupation de la mission d’un vicariat : « La province devrait promouvoir un esprit d’itinérance de sorte que les frères soient vraiment disponibles pour s’investir dans un tel service » .
La réflexion qui suit est une contribution pour encourager précisément cet esprit d’itinérance « de cœur, d’esprit et de mission ».
SE REMETTRE EN ROUTE
29. D’après les témoignages bibliques, c’est toujours au cours d’un voyage que les choses surprenantes se produisent. Abraham se précipite hors de sa tente pour saluer les étrangers et ceux-ci lui promettent un avenir différent de celui que Sarah et lui avaient imaginé (Gn 18, 1-15). Moïse, en fuite, fait l’expérience de Dieu à travers un buisson ardent et découvre en même temps un peuple et une mission. Dieu lui dit : « Maintenant va, je t’envoie (…) » et promet : « Je serai avec toi » – tant que tu poursuivras ton voyage… (Ex 3, 1-21). Jacob, « sur son chemin », lutte avec l’ange au gué de Yabboq, dans une histoire de conversion et de vulnérabilité. Comme beaucoup d’entre nous, Jacob a quelques traits de caractères fort désagréables. C’est un escroc et il a très peur de ceux à qui il a causé du tort. Derrière lui, son beau-père est à ses trousses ; devant lui, Ésaü l’attend. Et puis, il y a le combat, dont Jacob sort pardonné et converti, avec un nouveau nom, une nouvelle mission – et boiteux.
C’est « sur la route » que Jésus appelle ses disciples et c’est « en chemin » qu’il leur enseigne. (Il y a dans le film de Pasolini sur l’Évangile selon saint Matthieu une scène inoubliable du Sermon sur la Montagne : Jésus marche à toute vitesse à travers les collines, les disciples essaient de suivre le rythme et de le rattraper pour écouter ses paroles, et lui tourne la tête dans leur direction, tout en avançant, pour leur enseigner « en route ». Lorsque les quatre mille furent rassasiés, selon Marc (8, 1-10), c’est en chemin qu’ils mangèrent, en hâte comme dans un fast-food. Et c’est encore sur la route que Jésus apprenait des personnes qu’il rencontrait, comme la femme païenne (Mt 15, 21-28) dont il loue la foi, l’offrant même en modèle à ses disciples. Enfin, c’est sur le chemin d’Emmaüs qu’il se révèle aux disciples découragés (Lc 24, 13-35).
Voilà exactement la mission qu’il donne aux disciples : il les envoie, les fait « se remettre en route », sans bourse, sans besace ni sandales. Il leur dit : « Ne vous attardez pas en chemin pour saluer des gens » (Lc 10, 4). Il y a à ce sujet plusieurs choses intéressantes : Jésus les invite à une vie d’itinérance, une vie d’urgence (« repartez sans cesse ») et une vie de dépendance, fonction de la bonté d’autrui, d’étrangers qu’ils « ne connaissent pas ».
ACCUEILLIR EN SOI
30. Être itinérant, c’est se rendre vulnérable et dépendant. Mais pour un dominicain, l’itinérance est la seule réponse adaptée dans un monde qui produit des sans-abri, des souffrants, des étrangers. Se remettre en route – comme nos Chapitres généraux ne cessent de nous le rappeler –, c’est vivre sur ces « lignes de fractures » de l’humanité, partager le sort de ceux qu’on a contraints à l’itinérance. Cela signifie partager leur sort de sans-abri, pour les positions que nous prenons et qui vont à l’encontre de l’opinion dominante.
Le bibliste Walter Brueggemann parle du « monopole de l’imagination » : l’expression suggère que « certaine entité ou force de la société détient à la fois tout le pouvoir de décider comment ressentir les choses, et le droit légitime de fournir la lentille à travers laquelle la vie est correctement vue ou vécue. Nul n’est autorisé à avoir une image hors de ce catalogue d’idées ou d’images approuvées » . S’élever contre des monopoles aussi puissants c’est nous aligner sur la vision de l’Évangile que Dominique a faite sienne. (Selon un écrivain, ce n’est pas seulement pour les universités que Dominique a envoyé ses frères dans les villes, mais parce que là se trouvaient les victimes qu’une société mercantiliste émergeante venait de priver du droit de vote : les dominicains se devaient d’être leurs « frères »). Prendre une telle position, c’est nous rendre nous-mêmes marginaux et vulnérables. Mais c’est alors seulement que notre prédication est crédible.
Il est intéressant, dans notre contexte, de saisir que le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament pour « accueillir » (lambano : « prendre, recevoir, posséder ») ne veut pas dire qu’on mettra à l’écart ceux dont la conduite n’est pas en harmonie avec la nôtre. Ce verbe indique que nous devons « [les] prendre avec nous » et « [les] faire entrer chaleureusement dans notre compagnie » . Ce mot est souvent utilisé par saint Paul pour sa vision d’inconnus devenant une communauté, enracinée dans l’expérience de ce que Dieu fit en Jésus : « C’était Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde (…) mettant en nous la parole de la réconciliation » (2 Co 5, 19). C’est pourquoi il conjure les Romains de « donner l’hospitalité » (12, 13). Mais pour se réconcilier les autres, en faire ses amis, ou les accueillir, il faut les considérer « semblables à nous » par leurs besoins, leurs expériences et leurs attentes. « Il ne suffisait pas, écrit Christine D. Pohl, que les étrangers fussent vulnérables, les hôtes devaient s’identifier à leurs expériences de vulnérabilité et de souffrance avant de les accueillir » .
Le fait de « ne pas être à sa place », qui va de pair avec l’itinérance, signifie peut-être en fait pouvoir se mettre à la place de l’autre. Et il se pourrait bien que le texte le plus fondamental pour la mission ne soit pas celui du traditionnel « Va et baptise », mais plutôt un passage tel que 2 Co 1, 3-7, qui définit la mission comme paraklesis, consolante et réconfortante. Paul écrit : « Béni soit (…) le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit (…) ». Ce qui intéressant dans ce passage, c’est l’appel à une expérience mutuelle. Même ce que nous souffrons sert à la consolation des autres. La mission a-t-elle d’autre motif que de sortir, comme Jésus, qui « étendit la main et toucha » (Mc 1, 41), pour aller voir les personnes vulnérables, le long du chemin, dans une relation de guérison et de réconfort.
PRENDRE LE RISQUE
31. Claude Geffré a écrit que « le défi du pluralisme religieux nous invite à revenir au cœur du paradoxe chrétien comme religion de l’incarnation et comme religion de la kénose de Dieu » . C’est pour cette raison qu’il peut parler du christianisme comme d’une « religion de l’altérité ». Il y a quelque chose d’aventureux dans un voyage théologique aux frontières, qui nous provoque, nous incite à devenir d’authentiques dominicains, à « nous remettre en route » pour répondre aux nouvelles réalités, où qu’elles soient, sur la frontière, à être « utiles » à ces autres qui définissent notre mission et déterminent où nous devons aller.
Au début de la Bible, il est écrit que « quiconque avait à consulter le Seigneur sortait vers la Tente du Rendez-vous qui se trouvait hors du camp » (Ex 33, 7). « Hors du camp », parmi ces « autres » relégués quelque part à l’extérieur : c’est là que nous rencontrons Dieu. L’itinérance requiert que nous quittions l’institution, sortant des perceptions et des croyances conditionnées par la culture, car c’est « hors du camp » que nous rencontrons un Dieu qui échappe à tout contrôle. « Hors du camp » nous rencontrons l’Autre, différent, et nous découvrons qui nous sommes et ce que nous avons à faire.
En février 2001, des dominicains et dominicaines vivant presque tous en Asie se sont réunis à Bangkok, « hors du camp », pour partager leur expérience de l’écoute et de l’apprentissage. « Nous avons réalisé, ont-ils déclaré, que le dialogue avec les personnes d’autres traditions religieuses est le principal défi de ce début de millénaire pour notre prédication dominicaine. Ici, en Asie, lieu privilégié pour la rencontre avec des cultures différentes, des religions différentes, des peuples différents, nous sommes provoqués à la conversion : à une nouvelle manière d’écouter, de regarder, de toucher, d’apprendre et de comprendre. »
« Le dialogue ouvre une porte sur un monde inconnu, dont nous ignorons encore les contours exacts – mais ce voyage nous conduira chez nous car nous croyons que là est notre place. »
« Ce qui a suscité la naissance de l’Ordre, c’est l’attention que Dominique accordait aux besoins des gens dans le monde en mutation du XIIIème siècle. Comme Dominique – et comme les moines bouddhistes et les sannyasis hindous –, nous sommes appelés à nous remettre en route, à revendiquer notre héritage mendiant, à réaliser que nous sommes tous des mendiants devant la vérité qui n’attend que de nous surprendre. »
« Nous prions de savoir nous en remettre à cet Esprit qui trace pour nous la carte du voyage, car, en tant qu’Église et en tant qu’Ordre, nous faisons don de nous-mêmes à l’Esprit. C’est l’Esprit, présent dans chaque culture et dans chaque religion – longtemps avant l’arrivée du christianisme – qui rend le dialogue à la fois possible et nécessaire. »
« Nous prions d’avoir la confiance de notre Père Dominique qui, quoiqu’il ne pût prévoir les résultats, savait qu’il accomplissait la volonté de Dieu ».
Il est profondément significatif pour nous, dominicains, chargés d’une mission universelle de prédication, de nous souvenir que Jésus a commencé sa mission dans la « Galilée des Nations », district des étrangers, dont la population se composait pour moitié de Gentils, dont le culte était pour moitié païen, territoire peuplé de gens que les institutions de Jérusalem considéraient suspects : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » (Jn 1, 46). Et pourtant, après la Résurrection, Jésus dit à ses disciples : « Je vous précéderai en Galilée » (Mt 26, 32). Et son message aux femmes est encore plus étonnant : « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront » (Mt 28, 10).
C’est hors du camp, en tous les Galiléens qui nous entourent, que nous découvrons ce qu’est la mission : être en mission c’est vivre hors du camp. Et découvrir, avec les autres, ce qu’est vraiment Dieu. Mais cette connaissance a un prix. On retrouve à la fin de la Bible l’image de la sortie du camp, ou de la sortie de la tente à la rencontre de Dieu, dans l’Épître aux Hébreux : « Jésus lui aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Par conséquent, pour aller à lui sortons en dehors du camp, en portant son opprobre » (13, 12-13). Nous sommes bénis par l’exemple des martyrs dominicains en Algérie, au Pakistan et ailleurs, qui se sont placés sur « les lignes de fractures », « hors du camp ». Ils ont « porté son opprobre » ; ils nous « sanctifient » par leur sang. Comme eux, nous sommes appelés à « aller à lui hors du camp », et endurer ce que Jésus a enduré.
Même ses proches pensaient de Jésus qu’il avait « perdu le sens » (Mc 3, 21), tant son comportement était loin de la norme, excentrique. Pour adopter la vita apostolica au monde d’aujourd’hui, nous, dominicains, devons sans doute être un peu plus loin des normes, un peu plus excentriques, un peu moins équilibrés et conventionnels. Que faisons-nous aujourd’hui qui pourrait faire croire aux autres que nous avons « perdu le sens » ? Le rapport de la commission de Missione Ordinis au Chapitre général de Bologne demandait : « Si nous vivons ce que nous prêchons, si notre vie est en vérité un service de l’Évangile qui nous pousse sur les routes au delà des frontières, alors quelque brin de folie évangélique, joyeusement, nous habitera » .
V – LA PROFESSION DOMINICAINE, PROFESSIO IN MANIBUS
32. Un bref rappel historique, les sources bibliques pour reconnaître notre vocation, des échos de nos racines contemplatives, l’étude et la formation comme chemin à parcourir, l’appel à la mission à la rencontre de ceux qui ont faim et soif de l’Évangile, même quand ils l’ignorent… Il ne pouvait manquer une référence canonique dans cette réflexion, poursuivie en commun et devenue « lettre à l’Ordre » !
Dans l’insécurité qui nous entoure, tout le monde semble gagné par le désir de connaître « ce qui va arriver », « ce qui nous attend », « dans quelle direction et combien de temps nous devrons avancer pour atteindre un objectif », « quelles étapes il faut prévoir pour obtenir un résultat », « combien de marches il reste à gravir avant la pleine réalisation ». Rien de tout cela n’est étranger à notre vie dominicaine : nous souhaitons et nous exigeons que les autres soient clairs, fiables, stables (surtout les supérieurs !).
33. Cependant nous sommes appelés à être prêcheurs, à être prophètes. Être prophète ne signifie pas connaître ou deviner l’avenir, le voir clairement, offrir des garanties. Dieu appelle les prophètes à lire l’histoire à la lumière de sa Parole ; à lire la Parole en prenant le pouls des événements. Les prophètes ne sont pas appelés à lire l’avenir dans les lignes de la main comme des experts chiromanciens.
Les mains, c’est vrai, projettent ce qu’on a dans le cœur. Chaque geste de nos mains manifeste ce qui se trouve en nous. (Nul besoin d’être italien ou argentin pour s’en rendre compte !) La douceur d’une caresse, la dureté d’un geste agressif, la vie dans les mains du semeur, la mort dans celles de l’assassin…
34. Au début de notre vie dominicaine, après le temps de noviciat, nous avons tous fait un geste – un geste très éloquent : nous avons mis nos mains dans les mains de la personne qui recevait notre profession.
Un article d’Antoninus M. Thomas OP, lu à l’époque de mes études de droit canon, m’inspire encore aujourd’hui à ce sujet. Le grand historien du droit de l’Ordre nous enseigne que les dominicains ont tiré ce geste, essentiel dans le rituel de la profession, de celui qu’utilisaient alors les « convers » cisterciens.
Les frères convers de Cîteaux faisaient leur profession dans la salle capitulaire entre les mains de l’abbé, alors que les autres moines faisait profession dans l’église abbatiale par un document écrit, déposé sur l’autel, en signe d’offrande et de stabilité monastique (du temps de saint Dominique, tel était aussi le rituel des chanoines réguliers, dont les Prémontrés) : les moines et les chanoines réguliers, en effet, étaient spécialement liés à leur monastère et à l’église du monastère.
Les frères dominicains faisaient leur profession – comme les convers cisterciens – dans la salle capitulaire, par l’offrande de leurs mains. Si l’oblatio super altare symbolise pour les moines et les chanoines leur lien à l’abbaye et à l’église canoniale, la professio in manibus comme élément central de la profession dominicaine ouvre pour les prêcheurs les chemins de l’apostolat.
35. Nous avons tous fait profession par l’offrande de nos mains et, en même temps, par l’offrande des mains de qui, soutenant les nôtres, recevait notre profession. C’est un échange mutuel de volontés. Les mains ouvertes à la grâce de Dieu, ouvertes à la miséricorde des frères et des sœurs avec qui nous engageons notre avenir sans même les connaître !
C’est un véritable signe de confiance mutuelle. Notre avenir aux mains de nos frères, de nos sœurs. L’avenir de nos frères, de nos sœurs, dans nos mains. Voilà toute la stabilité dominicaine : elle ne tient qu’à la stabilité de notre profession d’obéissance !
Dans notre profession, nous n’avons pas lié l’engagement de notre vie et de notre avenir à une abbaye ou une église canoniale donnée. Et pourtant, on croirait bien parfois que nous avons fait profession de demeurer dans tel couvent ou telle maison ; de nous tenir à certains postes ou fonctions, ou au contraire de n’assumer aucune responsabilité ; de ne pas quitter la ville ou le pays d’où nous venons, où nous sommes né ; de rester là où nous nous « sentons » bien, en bonne compagnie, entouré d’amis…
36. Je n’oublie pas que l’itinérance dominicaine prend des contenus et des caractéristiques différentes selon les branches de l’Ordre (je pense surtout aux moniales contemplatives et aux laïcs). C’est pourquoi nous n’avons pas voulu limiter le sens de l’itinérance à des valises qu’on prépare pour un départ. Encore que, tout bien considéré, on se réjouit de constater que les moniales contemplatives et les laïcs nous enseignent eux aussi l’itinérance dominicaine.
Beaucoup de moniales, avec grande générosité, ont souhaité « partir » créer de nouvelles fondations ; d’autres l’ont fait pour aider des monastères dans le besoin. Certaines communautés contemplatives, reconnaissant la pauvreté de leurs moyens, le petit nombre de sœurs, le manque de vocations, ont décidé de s’unir à un autre monastère pour vivre la vocation à laquelle le Seigneur les a appelées « pour habiter ensemble dans l’unanimité, ne faisant qu’un cœur et qu’une âme », loin du monastère précis où elles étaient d’abord entrées.
Et nombreux sont les laïcs qui s’offrent comme volontaires pour aller annoncer l’évangile dans des pays lointains, collaborant à la mission apostolique de communautés dominicaines.
37. Malheureusement, confrontés à une assignation ou à un changement de fonction ou de responsabilité communautaire, nous réfutons les motifs de ceux qui nous invitent à « partir », car nous en limitons la compréhension à deux catégories réductrices : soit la promotion, en quête d’un cursus honorum imaginé ou mérité, soit la punition. Cela correspond peut-être à d’autres mondes, auxquels justement nous avons renoncé, comme celui de l’entreprise, de la compétitivité, de la carrière politique ou académique. Mais dans la vie dominicaine, cette attitude détruit la confiance, rompt la docilité, blesse l’itinérance, ruine d’infinies possibilités.
En maintes occasions, devant un changement, une assignation, un poste ou une responsabilité à assumer ou à quitter, etc., des phrases du type : « en conscience, je ne peux pas accepter » nous viennent immédiatement à l’esprit, comme par réflexe. Nous oublions bien aisément la fameuse distinction entre « conscience psychologique » et « conscience morale » ! Nous confondons nos émotions, nos sentiments, la conscience de nous-mêmes avec le jugement de la raison pratique, que notre profession dans les mains a élevé de manière surnaturelle au niveau d’un acte de foi en Dieu et en nos frères et sœurs.
38. C’est à partir de ce geste si ancien et si éloquent de notre profession dominicaine que nous avons commencé à expérimenter dans notre vie le mystère de la Pâque de Jésus, l’ars moriendi et nascendi, mourir pour vivre. C’est pour cela que nous avons remis notre vie et notre avenir entre les mains des autres.
Dans la basilique de Sainte-Sabine, notre église conventuelle à Rome, un monument funéraire porte une inscription évocatrice, qui veut synthétiser la vie du personnage :
UT MORIENS VIVERET – VIXIT UT MORITURUS
(pour vivre après la mort – il vécut en homme destiné à mourir)
Jésus a dit : Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit (Jn 12,24).
Après la Résurrection, quand Thomas voulut « voir pour croire », usant de ses mains et de ses doigts pour « mesurer ou vérifier » ce que ses frères lui avaient annoncé, Jésus en personne l’invita : « voici mes mains »… Après la Résurrection, les mains blessées de Jésus continuent d’être le signe d’un avenir plein d’espérance et de vie.
VI – EN MANIERE DE CONCLUSION
39. Le matin du 21 mai 1992, le fr. Damian Byrne me demanda de l’accompagner au Palazzo San Calisto dans le quartier du Trastevere à Rome. Quelques jours avant de quitter Sainte-Sabine pour le Chapitre général de Mexico, ce grand missionnaire dominicain, pauvre et itinérant, souhaitait saluer le Cardinal Eduardo Pironio. Comme nous marchions vers le lieu du rendez-vous, le fr. Damian me fit ce commentaire : « je n’ai jamais rien entendu de plus beau sur saint Dominique et sur l’Ordre que ce qu’a dit le Cardinal au Chapitre général de 1983 ».
J’ai toujours été curieux de connaître ces paroles si dominicaines adressées au Chapitre de Rome. Dans les archives générales, il n’y avait pas de document écrit, mais la cassette de l’enregistrement. J’avoue avoir éprouvé une grande émotion à réentendre leurs voix à tous deux, le fr. Damian Byrne et le Cardinal Pironio !
Mendiants, nous empruntons aussi les idées, comme le messager qui reçoit le témoin des mains d’un autre et court immédiatement le remettre au suivant. Timidement, je paraphrase ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi, pour l’annoncer aux autres.
40. Lorsque le Seigneur confie une mission, invariablement, il répète ces trois phrases :
« Voici, je t’envoie… ». L’envoi, la mission vient assurément de Dieu. Cette volonté s’exprime à travers la volonté des frères ou des sœurs, mais la mission vient de Dieu : « Voici, je t’envoie… ». Cela nous donne beaucoup de courage en même temps qu’une grande sérénité.
« Ne crains point… ». C’est très important chez un prêcheur. À la condition qu’il soit vraiment pauvre ; car ainsi nous nous sentons peu sûrs de nous, mais confiants en Dieu et dans nos frères et sœurs. C’est de la pauvreté que le prêcheur tire une force spéciale qui le rend justement un prophète d’espérance. Le prêcheur est quelqu’un qui, parce qu’il est pauvre et s’appuie exclusivement sur Dieu, ne craint pas et ne permet pas que les autres craignent : car nous sommes témoins de la Résurrection !
« Je suis avec toi… ». Toujours, le Seigneur nous accompagne, « je suis avec toi, je ferai route avec toi ». Il nous encourage et nous incite à nous engager profondément dans la mission qu’il nous a confiée comme prêcheurs de l’évangile en ce moment providentiel de l’Église et de l’histoire.
Le monde attend particulièrement une communication du Verbe de Dieu, de la Parole de Dieu. Parlant de saint Dominique, sainte Catherine disait que « Son office fut celui du Verbe » . Chaque dominicain, chaque dominicaine est appelé/e par profession à cette mission. Aussi devra-t-il/elle se laisser posséder entièrement par la parole de Dieu afin de communiquer cette parole faite chair, faite histoire, faite geste. Nous sommes appelés à communiquer la Bonne Nouvelle à toutes les nations en unissant la vérité à l’amour, en étant fidèles à la vérité et à l’amour. À la vérité, parce qu’elle est spécifique des dominicains ; à l’amour, parce que nous aimons cette vérité comme on aime une personne. Sur cet amour se fonde notre vie dominicaine qui boit aux sources de la Règle de saint Augustin. Saint Dominique de Guzmán s’en inspira car il souhaitait envoyer, au-delà des frontières connues, des apôtres contemplatifs, comme Jésus envoya les Apôtres, suivant par conséquent une ligne fortement évangélique.
41. Jésus envoya Pierre naviguer en eau profonde et jeter ses filets. En bon connaisseur des mers, des barques, des filets et de la pêche, Simon lui répondit qu’il avait peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais, soutenu par la parole de Jésus, il jeta les filets et la pêche fut bonne ! (cf. Lc 5, 4-6).
Je fais simplement écho à l’Évangile de Jésus Christ et à l’invitation que le pape Jean Paul II nous lançait en concluant le Jubilé de l’an 2000 :
« DUC IN ALTUM ! Allons de l’avant dans l’espérance ! (…) Au début de ce nouveau siècle, notre marche doit être plus alerte en parcourant à nouveau les routes du monde. »
Le 15 août 1217, « Pentecôte dominicaine », invoquant l’Esprit-Saint devant les frères réunis, Dominique annonça qu’il avait pris dans son cœur la décision de les envoyer tous à travers le monde, en dépit de leur petit nombre. Quelques uns objectèrent, mais il répondit sans hésiter : « Ne vous opposez pas, je sais bien ce que je fais ». Il dissipa ainsi toutes leurs craintes. Réconfortés par sa parole, les frères « acquiescèrent avec assez de facilité, pleins d’espoir quant à l’heureuse issue de cette décision » .
Je vous disais que ces pages – trop longues, peut-être ? – sont le fruit d’une réflexion communautaire. Je vous invite tous à les méditer, individuellement et en communauté (!), et à prier avec moi :
« Dieu d’amour et de fidélité, qui nous as envoyé ta Parole pour qu’elle soit notre chemin, donne-nous qu’en suivant ce chemin sur les pas de saint Dominique, ‘nous marchions dans la joie et pensions à notre Sauveur’. Amen » . ![]()
Sainte-Sabine, le 24 mai 2003, Mémoire de la Translation de notre Père saint Dominique,
fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP
Maître de l’Ordre
1. La publication des messages les plus significatifs que le fr. Aniceto Fernández, le fr. Vincent de Couesnongle, le fr. Damian Byrne et le fr. Timothy Radcliffe ont adressés à l’Ordre est actuellement en préparation. Nous espérons vivement qu’elle paraîtra très prochainement dans plusieurs langues, sous le titre « Laudare-Benedicere-Prædicare – Messages à l’Ordre (1961-2001) ».
2. Libellus Iordani de Saxonia n° 14 – Éd. A. Waltz OP in MOPH XVI (Romæ 1935), 33-34.
3. M.-H. Vicaire, Histoire de saint Dominique, Vol. I (Paris 1982), 126.
4. Cf. Libellus n° 15.
5. Libellus n° 16.
6. Job 42,5.
7. Cf. Acta Canonizationis S. Dominici – Éd. A. Waltz OP in MOPH XVI (Romæ 1935), 161.
8. Luc 10, 38-42.
9. Cf. Humbert de Romans se plaignant de ceux dont l’unique passion était la contemplation et qui refusaient de répondre à l’appel à se rendre utile aux autres en prêchant. Source : Conférence du fr. Paul Murray, « Retrouver la Dimension contemplative », au Chapitre général de Providence, 2001.
10. Cf. Luc 11, 27-28.
11. Cf. par ex. : Mt 12, 50 ; 21, 31 ; Mc 3, 35 ; Lc 12, 47 ; Jn 7, 17 ; 9, 31 ; Ep 6, 6 ; He 10, 36 ; 13, 21 ; 1 Jn 2, 17.
12. Cf. Constitution Fondamentale ; LCM V.
13. Cf. LCM 36.
14. Jn 12, 1-3.
15. Qo 3, 1-5.
16. Cf. Lc 12, 54-56.
17. Cf. Ct 3, 1-3.
18. Jn 4, 34.
19. Cf. Jos 22, 5.
20. Lc 24, 13 et versets suivants.
21. Providence n° 355.
22. Jn 21, 18.
23. Fides et ratio, 48 : « Il est illusoire de penser que la foi, face à une raison faible, puisse avoir une force plus grande ; au contraire, elle tombe dans le grand danger d’être réduite à un mythe ou à une superstition ».
24. Super Epist. ad Col., 91-92. Cf. Fides et ratio, 37-8 : « “Prenez garde qu’il ne se trouve quelqu’un pour vous réduire en esclavage par le vain leurre de la ‘philosophie’, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde, et non selon le Christ” (2, 8). (…) Sur les traces de saint Paul, d’autres écrivains des premiers siècles, notamment saint Irénée et Tertullien, émirent à leur tour des réserves à l’égard d’une attitude culturelle qui prétendait soumettre la vérité de la Révélation à l’interprétation des philosophes. (…) Cela ne signifie pas pour autant qu’ils aient ignoré le devoir d’approfondir l’intelligence de la foi et de ses motivations, bien au contraire ».
25. Actes 17, A.
26. Actes I, 22, 1-5.
27. Actes 43, I.
28. Actes 51.
29. Actes 20.9.
30. Actes 33.
31. Actes, Appendice I, 4.3.2.
32. Actes 461.
33. ‘Welcoming the Stranger, ’ Interpretation and Obedience, Minneapolis MN: Fortress Press, 1991, p. 290-310.
34. Ceslas Spicq, trans and ed by James D Ernest, Theological Lexicon of the New Testament, Vol 3, Peabody MA: Hendrikson Publishers, 1996, p. 195-200.
35. Making Room, Recovering Hospitality as a Christian Tradition, Grand Rapids MI & Cambridge UK: William B Eerdmans Publishing Company, 1999, p. 97.
36. ‘The Theological Foundations of Dialogue, ’ Focus, Vol 22, No 1, 2002, p. 15-16.
37. Déclaration Sound the Gong, Conference on Interfaith Dialogue: 2001, ed Vicente G Cajilig OP, Manille, University of Santo Tomas, 2002, p. 6.
38. 4.3.3., Un dernier mot : la folie.
39. A. Thomas, La profession religieuse des dominicains, in Archivum Fratrum Prædicatorum 39 (1969), 5-52, en particulier 5-22.
40. Ce geste remonte aussi à l’homagium féodal du vassal à son seigneur, à certains contrats romains antiques, et même à des gestes bibliques.
41. Je fais allusion au monument funéraire du Cardinal d’Auxia († 1484) ; la traduction est libre.
42. Eduardo Francisco Pironio avait fait profession à Buenos Aires (1947) comme membre de la branche sacerdotale de ce qu’on appelait encore Tiers Ordre, dans les mains du fr. Manuel Suárez, alors Maître de l’Ordre. Quelques années plus tard, il acheva ses études de théologie à l’Angelicum, à Rome (1953-1954). Il fut Préfet de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers (1975-1983) et Président du Conseil Pontifical pour les Laïcs (1983-1996). Il est mort le 5 février 1998.
43. Alors Préfet de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, le Cardinal avait rendu visite au Chapitre, réuni à l’Angelicum, le 21 septembre 1983.
44. Il ne s’agit pas d’un texte écrit, préparé pour l’occasion ; sur la demande du Maître de l’Ordre, le Cardinal adressa quelques mots à l’assemblée. On conserve aux archives générales de l’Ordre une cassette avec l’enregistrement de la rencontre [cf. AGOP III 1983/17 Roma – Cassette degli interventi].
45. Dialogue n° 158.
46. Novo Millenio Ineunte (06/01/2001) n° 58.
47. Testimonium fratris Iohannis Hispani in Acta Canonizationis S. Dominici – Éd. A. Waltz OP in MOPH XVI (Romæ 1935) 144.
48. Cf. Libellus n° 47.
49. Liturgia de las Horas O. P. – édition typique en langue espagnole (Rome 1988) 1811 n° 6.
Timothy Radcliffe 1993-2001
Donner sa vie pour la mission (1994)
Lettre à l’Ordre des Prêcheurs. Sainte Sabine, Rome, 1994
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 Au temps de saint Dominique, les jeunes accouraient vers l’Ordre en grand nombre parce qu’avec sa passion pour la prédication, il les invitait à prendre part à une aventure. Qu’est-ce qui nous passionne et quelles sont les aventures de notre époque? Qui sont nos Cumans? Nous affrontons le défi d’établir l’Ordre dans une grande partie de l’Asie, où vit la moitié de l’humanité, et de nous préparer à enseigner en Chine. Y a-t-il de jeunes Dominicains prêts à apprendre le chinois et à se donner eux-mêmes, sans savoir ce qu’il leur en coûtera? Partout dans le monde, nous sommes renvoyés au dialogue avec l’Islam. Sommes-nous prêts à y donner notre vie?
Au temps de saint Dominique, les jeunes accouraient vers l’Ordre en grand nombre parce qu’avec sa passion pour la prédication, il les invitait à prendre part à une aventure. Qu’est-ce qui nous passionne et quelles sont les aventures de notre époque? Qui sont nos Cumans? Nous affrontons le défi d’établir l’Ordre dans une grande partie de l’Asie, où vit la moitié de l’humanité, et de nous préparer à enseigner en Chine. Y a-t-il de jeunes Dominicains prêts à apprendre le chinois et à se donner eux-mêmes, sans savoir ce qu’il leur en coûtera? Partout dans le monde, nous sommes renvoyés au dialogue avec l’Islam. Sommes-nous prêts à y donner notre vie?
Comme Dominique, nous aussi, nous avons à prêcher l’évangile dans les nouvelles villes, mais maintenant, ce sont des mégapoles tentaculaires où habite un pourcentage toujours grandissant de l’humanité, les jungles urbaines de Los Angeles, São Paolo, Mexico, Lagos, Tokyo, Londres, etc. Ce sont souvent des déserts urbains, marqués par la criminalité et la violence, et par l’immense solitude de ceux qui sont entourés de millions de gens et pourtant seuls. Comment parviendrons-nous à entrer dans le nouveau monde de la jeunesse, un monde de plus en plus mono-culturel, avec sa quête religieuse et son scepticisme, son respect des individus et sa suspicion envers les institutions, sa méfiance des mots et sa fascination pour la technologie de l’information, sa musique et ses chansons? Comment allons-nous être en contact avec tout ce qui est force de vie et de création dans cette nouvelle culture, en tirer profit et l’accueillir pour l’évangile?
Par-dessus tout, comment serons-nous des prêcheurs de l’espérance dans un monde souvent tenté par le désespoir et le fatalisme, affligé par un système économique minant les structures socio-économiques de la plupart des pays du monde? Quel évangile pouvons-nous prêcher en Amérique latine, ou bien quand l’Ordre s’implante en Afrique et renaît en Europe de l’Est? Et puis, il y a l’aventure intellectuelle sans fin de l’étude, de l’affrontement à la Parole de Dieu, l’exigence de la vérité, d’un questionnement à produire et à entendre, et la passion de comprendre. Une autre lettre en traitera.
Ainsi, frères et soeurs, il y a une chose indubitable: notre vocation de prêcheurs de l’évangile est aussi crucialement nécessaire aujourd’hui qu’hier (1). Nous pouvons répondre à ces défis si nous sommes des gens de courage, qui osent lâcher des engagements anciens pour être libres de prendre de nouvelles initiatives, qui ont l’audace de faire des expériences nouvelles et de risquer l’échec. Nous ne serons jamais capables d’y répondre sans nous offrir les uns aux autres confiance et courage. Une structure aussi complexe qu’un Ordre religieux peut tout aussi bien transmettre pessimisme et sentiment de la défaite qu’être un réseau d’espérance où chacun aide l’autre à imaginer et à créer du neuf. Si l’Ordre doit choisir la deuxième voie, alors nous devons affronter plusieurs questions.
Osons-nous accepter dans l’Ordre des jeunes qui ont l’audace d’affronter ces nouveaux défis avec courage et initiative, sachant qu’ils pourraient bien remettre en question beaucoup de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait? Serions-nous heureux d’accueillir dans notre Province un homme comme Thomas d’Aquin, qui a épousé une philosophie nouvelle et suspecte et qui a posé des questions difficiles et fondamentales? Accueillerions-nous un frère comme Bartolomé de Las Casas, avec sa passion pour la justice sociale? Nous réjouirions-nous d’avoir un Fra Angelico, qui a expérimenté de nouvelles façons de prêcher l’évangile? Recevrions-nous Catherine de Sienne à la profession, avec tout son franc-parler? Accueillerions-nous Martin de Porrès, qui pourrait troubler la paix de la communauté en invitant toutes sortes de pauvres? Accepterions-nous Dominique? Ou est-ce que nous préférons des candidats qui nous laissent en paix? Et à quoi notre formation initiale conduit-elle? Produit-elle des frères et soeurs qui ont grandi dans la foi et le courage, qui osent tenter et risquer davantage qu’en arrivant à nous? Ou les rendons-nous fades et inoffensifs?
Si nous voulons affronter les défis immenses et passionnants d’aujourd’hui, renouveler ce sens de l’aventure de la vie religieuse, alors nous devrons considérer plusieurs aspects de notre vie comme Ordre dans les lettres à venir. Aujourd’hui, dans cette lettre, je voudrais n’explorer qu’une seule question, que j’ai vue surgir dans toutes les régions de l’Ordre durant mes voyages. Comment les voeux que nous avons prononcés peuvent-ils être source de vie et de dynamisme et nous soutenir dans notre prédication? Les voeux ne constituent pas le tout de notre vie religieuse, mais c’est souvent à propos d’eux que les frères et les soeurs posent des questions de fond qu’ensemble nous devons aborder. On dit souvent que les voeux ne sont qu’un moyen. C’est vrai, car l’Ordre a été fondé non pour que nous puissions vivre les voeux mais pour que nous prêchions l’évangile. Mais les voeux ne sont pas un moyen dans un sens strictement utilitaire, comme une voiture peut l’être pour aller d’un endroit à l’autre. Les voeux sont des moyens en vue de faire de nous des gens vraiment missionnaires. Saint Thomas dit que tous les voeux ont pour fin la caritas (2), l’amour qui est la vie même de Dieu. Ils servent leur propos à la seule condition de nous aider à grandir dans l’amour, de sorte que nous puissions parler avec autorité du Dieu d’amour.
Les voeux sont en contradiction fondamentale avec les valeurs principales de la société, en particulier avec celles de la culture de consommation qui devient rapidement la culture dominante de notre planète. Le voeu d’obéissance va à l’encontre d’une compréhension de l’être humain comme un être enraciné dans une autonomie et un individualisme radicaux; dans notre culture, être pauvre est un signe d’échec et de manque de valeur, et la chasteté apparaît comme un rejet inconcevable du droit universel de la personne à l’accomplissement sexuel. Si nous embrassons les voeux, il est probable qu’à un certain moment nous les trouverons difficiles à tenir. Ils peuvent paraître nous condamner à la frustration et à la stérilité. Si nous les acceptons seulement comme un moyen utile pour une fin, un inconvénient inévitable dans la vie du prêcheur, ils peuvent paraître un prix à payer qui n’en vaut pas la peine. Mais si nous les vivons dans leur ordination à la caritas, comme une voie parmi d’autres où partager la vie du Dieu d’amour, alors nous pouvons croire que la souffrance peut être féconde, que la mort que nous expérimentons peut ouvrir un chemin de résurrection. Nous pouvons alors dire, comme notre frère Réginald d’Orléans: « Je ne crois pas avoir gagné aucun mérite à vivre dans cet Ordre, parce que j’y ai toujours trouvé tant de joie. » (3)
Dans cette lettre, je veux présenter quelques observations simples sur les voeux. Elles seront largement marquées de mes propres limites, et par la culture qui m’a formé. Mon souhait est qu’elles contribuent à un dialogue à travers lequel nous arriverons à une vision commune qui nous rendra capables de nous encourager les uns les autres et nous donnera la force d’être un Ordre qui ose faire face aux défis du siècle à venir.
Oser vouer sa vie
Dans plusieurs régions du monde, en particulier celles qui sont marquées par la culture occidentale, il y a eu une profonde perte de confiance dans l’acte de s’engager par promesse. On peut le constater dans la chute du mariage, le taux élevé de divorces ou, dans notre Ordre, dans les demandes régulières de dispense des voeux, cette lente et régulière hémorragie de la sève vitale de l’Ordre. Quel sens cela peut-il avoir de donner sa parole usque ad mortem?
Une raison pour laquelle donner sa parole peut ne pas sembler sérieux, c’est peut-être un affaiblissement du sens de l’importance de nos paroles. Est-ce que les paroles sont tellement importantes dans notre société? Peuvent-elles faire la différence? Peut-on donner sa propre vie à un autre, à Dieu ou dans le mariage, en disant quelques mots? Nous, les prêcheurs de la Parole de Dieu, nous sommes des témoins de l’importance des paroles. Nous sommes faits à l’image de Dieu qui dit une parole et les cieux et la terre vinrent à l’existence. Il dit une Parole qui est devenue chair pour notre rédemption. Les mots que les êtres humains se disent les uns aux autres donnent la vie ou la mort, construisent la communauté ou la détruisent. La solitude terrible de nos vastes cités est sans aucun doute signe d’une culture qui a parfois cessé de croire à l’importance du langage, de croire qu’elle peut construire la communauté par le langage partagé. Quand nous donnons notre parole dans les voeux, nous témoignons d’une vocation humaine fondamentale: dire des paroles qui ont du poids et de l’autorité.
Cependant, nous ne pouvons savoir ce que nos voeux signifieront et où ils nous mèneront. Pourquoi s’enhardir à les professer? Seulement parce que notre Dieu en a fait autant et que nous sommes ses enfants. Nous osons faire ce que notre Père a fait le premier. Depuis le commencement, l’histoire du salut a été celle d’un Dieu qui a fait des promesses, qui a promis à Noé que jamais plus la terre ne serait submergée par un déluge, qui a promis à Abraham une descendance plus nombreuse que le sable, et qui a promis à Moïse de conduire son peuple hors d’esclavage. Le sommet et l’accomplissement étonnant de toutes ces promesses, ce fut Jésus Christ, le « Oui » éternel de Dieu. Comme enfants de Dieu, nous osons donner notre parole, sans savoir ce qu’elle signifiera. Cet acte est un signe d’espérance puisque pour beaucoup de gens, il n’y a que la promesse qui existe. Si quelqu’un est enfermé dans le désespoir, détruit par la pauvreté ou le chômage, emprisonné dans un échec personnel, alors peut-être n’y a-t-il rien en quoi placer son espérance et sa confiance sinon en Dieu qui a prononcé des voeux pour nous, qui, toujours et toujours, a offert une alliance à l’humanité et, par les prophètes, nous a appelés à l’espérance du salut (4).
Dans ce monde tellement tenté par la désespérance, il ne peut y avoir d’autre source d’espérance que la confiance en ce Dieu qui nous a donné sa Parole. Et quel signe de cet engagement pris par Dieu, sinon des hommes et des femmes qui osent prononcer des voeux, dans le mariage ou dans la vie religieuse? Je n’ai jamais compris aussi clairement le sens de nos voeux que lorsque je suis allé visiter un barrio aux limites de Lisbonne, où habitent les plus pauvres des pauvres, les oubliés et les invisibles de la ville, et j’y ai trouvé un quartier vivant dans la liesse parce qu’une soeur qui partageait leurs vies allait faire profession solennelle. C’était leur fête.
On a appelé notre culture « la génération du maintenant », une culture où n’existe que l’instant présent. Ce peut être la source d’une spontanéité merveilleuse, d’une fraîcheur et d’une immédiateté dans lesquelles nous pouvons nous réjouir. Mais si le temps présent en est un de pauvreté et d’échec, de défaite ou de dépression, alors quelle espérance reste-t-il? Les voeux, par nature, conduisent vers un avenir inconnu. Pour saint Thomas, prononcer un voeu était un acte d’une générosité radicale, parce qu’on y donne en un instant une vie qui devra être vécue progressivement à travers le temps (5). Pour beaucoup de gens, dans notre culture, offrir ainsi un futur qui ne peut être prévu, n’a pas de sens. Comment puis-je me lier moi-même jusqu’à la mort quand je ne sais pas qui et ce que je peux devenir? Qui serai-je dans dix ou vingt ans? Qui aurai-je rencontré et qu’est-ce qui me touchera le coeur? Pour nous, c’est un signe de notre dignité d’enfants de Dieu et de confiance dans le Dieu de providence, qui présente, de façon inattendue, le bélier pris dans les buissons. Prononcer des voeux reste un acte de la plus profonde signification, un signe d’espérance dans le Dieu qui nous promet un avenir, même s’il dépasse notre imagination, et qui tiendra sa parole.
Il est vrai que parfois un frère ou une soeur peut s’estimer incapable de continuer selon les voeux prononcés. Ce peut être dû à un manque de discernement dans la période de la formation initiale, ou simplement parce que c’est une vie que, en toute honnêteté, ils ne peuvent plus assumer. Existe alors le sage recours à la possibilité d’une dispense des voeux. Rendons grâce au moins pour ce qu’ils nous ont donné, réjouissons-nous de ce que nous avons partagé! Demandons-nous aussi si, dans nos communautés, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour les soutenir dans leurs voeux.
L’OBÉISSANCE: LA LIBERTÉ DES ENFANTS DE DIEU
Le commencement de la prédication de Jésus, ce fut sa proclamation de l’accomplissement de la promesse d’Isaïe, la délivrance pour les captifs et la liberté pour les opprimés (Lc 4). L’évangile que nous sommes appelés à prêcher est celui de la liberté irrépressible des enfants de Dieu. « C’est pour la liberté que le Christ nous a rendus libres. » (Ga 5,1) Il est donc paradoxal de donner nos vies à l’Ordre, de prêcher cet évangile, à travers un voeu d’obéissance, le seul voeu que nous prononcons. Comment pouvons-nous parler de liberté alors que nous avons donné nos vies?
Le voeu d’obéissance est un scandale dans un monde qui aspire à la liberté comme à sa plus haute valeur. Mais de quelle liberté avons-nous faim? C’est une question qui se pose avec une intensité toute particulière dans les pays libérés du communisme. Ils sont entrés dans le « monde libre », mais était-ce pour cette liberté qu’ils ont combattu? Ils ont sûrement gagné une certaine liberté, importante, dans le processus politique, mais la liberté de marché est souvent décevante. Elle n’apporte pas la libération promise, elle déchire le tissu de la société humaine encore davantage. Par-dessus tout, notre monde supposé libre est souvent caractérisé par un profond sentiment de fatalisme, une incapacité à prendre nos destinées en main, à décider vraiment de nos vies, qui doivent nous interroger sur la liberté dans la culture de consommation. Le voeu d’obéissance, pour nous, n’est pas qu’une commodité administrative, un moyen utile. Il doit nous confronter à la question suivante: À quelle liberté aspirons-nous en Christ? Comment ce voeu peut-il le signifier, et nous aider comme prêcheurs du Royaume à vivre la liberté joyeuse des enfants de Dieu?
Quand les disciples trouvent Jésus parlant avec la Samaritaine auprès du puits, il leur dit: « Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé » (Jn 4,34). L’obéissance de Jésus au Père n’est pas une limitation de sa liberté, une restriction de son autonomie. C’est la nourriture qui lui donne la force et le rend solide. Sa relation au Père, le don de tout ce qu’il est, voilà son être même.
La profonde liberté de Jésus, son appartenance au Père, est certainement le contexte dans lequel réfléchir à ce que cela signifie pour nous d’être libres et de donner nos vies à l’Ordre. Ce n’est pas la liberté du consommateur, avec un choix sans restriction entre différents achats ou modes d’action; c’est la liberté d’être, la liberté de celui qui aime. Dans notre propre tradition dominicaine, cette appartenance réciproque dans l’obéissance mutuelle est marquée par une tension entre deux caractéristiques: un don total de nos vies à l’Ordre et une recherche de consensus fondée sur le débat, sur l’attention et le respect mutuels. Les deux sont nécessaires pour être prêcheurs de la liberté du Christ, cette liberté dont le monde a soif. Si nous échouons à nous donner réellement nous-mêmes à l’Ordre, sans condition, alors nous devenons simplement un groupe d’individus indépendants qui, à l’occasion, coopèrent; si l’obéissance est vécue comme l’imposition de la volonté du supérieur, sans la recherche d’un esprit commun, alors notre voeu devient aliénant et inhumain.
1. Obéissance et écoute
Dans notre tradition, l’obéissance n’est pas fondamentalement la soumission de la volonté d’un frère ou d’une soeur à un supérieur. Parce qu’elle est expression de notre fraternité les uns avec les autres, de notre vie partagée dans l’Ordre, elle est fondée sur le dialogue et la discussion. Comme on l’a souvent souligné, le mot obedire vient de ob-audire, écouter. Le commencement de l’obéissance vraie, c’est quand nous osons laisser parler nos frères et soeurs et que nous les écoutons. C’est le « principe d’unité » (6). C’est également quand nous sommes enjoints à grandir en humanité par l’attention aux autres. Les gens mariés n’ont pas d’autre choix que d’être entraînés au-delà d’eux-mêmes par les exigences de leurs enfants ou de leurs conjoints. Notre mode de vie, avec son silence et sa solitude, peut nous aider à grandir en attention et en générosité, mais nous risquons aussi de nous enfermer en nous-mêmes et dans nos propres préoccupations. La vie religieuse peut produire des gens profondément désintéressés ou fortement égoïstes, selon que nous écoutions ou non. Cela réclame toute notre attention, une réceptivité totale. Le moment fécond de notre rédemption, ce fut l’obéissance de Marie qui a osé écouter un ange.
Cette écoute demande que nous usions de notre intelligence. Dans notre tradition, nous utilisons notre raison non pas pour dominer l’autre mais pour nous en approcher. Comme le disait le P. Rousselot, l’intelligence, c’est « la faculté de l’autre ». Elle ouvre nos oreilles pour entendre. Comme l’écrivait Herbert McCabe:
- « C’est d’abord une ouverture d’esprit comme on en trouve dans tout apprentissage. L’obéissance ne devient parfaite que lorsque celui qui commande et celui qui obéit partagent un même esprit. La notion d’obéissance aveugle n’a pas plus de sens dans notre tradition que n’en aurait celle d’apprentissage aveugle. Une communauté totalement obéissante serait une communauté où personne n’a jamais été forcé à faire quelque chose. » (7)
Il en découle que le premier lieu où nous pratiquons l’obéissance dans la tradition dominicaine, c’est le chapitre de la communauté, où nous discutons les uns avec les autres. La fonction de la discussion dans le chapitre est de rechercher l’unité de coeur et d’esprit en même temps que nous recherchons le bien commun. Nous discutons ensemble, en bons Dominicains, non pour vaincre mais dans l’espoir d’apprendre les uns des autres. Ce que nous recherchons n’est pas la victoire de la majorité mais, dans toute la mesure du possible, l’unanimité. Cette recherche de l’unanimité, même si elle est parfois inaccessible, n’exprime pas simplement un désir de vivre en paix les uns avec les autres. Plus radicalement, c’est une forme de gouvernement issue du fait que nous croyons que ceux avec lesquels nous sommes en désaccord ont quelque chose à dire et donc que nous ne pouvons atteindre seuls la vérité. Vérité et communauté sont inséparables. Comme l’écrivait Malachy O’Dwyer:
- « Pourquoi Dominique mettait-il tant de confiance et de foi dans ses compagnons? La réponse est toute simple. C’était profondément un homme de Dieu, convaincu que la main de Dieu repose sur toute chose et sur toute personne … Puisqu’il était convaincu que Dieu lui parlait réellement par d’autres voix que la sienne, il avait donc à organiser sa famille de sorte que chacun dans la famille puisse être entendu. » (8)
Il en découle que dans notre tradition le gouvernement prend du temps. La plupart d’entre nous sommes très occupés et ce temps peut sembler perdu. Pourquoi consacrerions-nous du temps à débattre les uns avec les autres quand nous pourrions être dehors à prêcher et à enseigner? Nous le faisons parce que c’est cette vie partagée, cette solidarité vécue, qui fait de nous des prêcheurs. Nous ne pouvons parler du Christ qu’à partir de ce que nous vivons et la peine prise à chercher à être un seul coeur et un seul esprit nous prépare à parler avec autorité du Christ dans lequel se trouve toute réconciliation.
L’obéissance pour nous n’est pas une fuite de responsabilité. Elle structure les différentes façons dont nous la partageons. Souvent, le rôle d’un prieur est difficile parce que quelques frères pensent qu’en l’ayant élu à sa charge, il doit porter seul le fardeau. Ceci traduit un rapport puéril à l’autorité. L’obéissance demande que nous nous saisissions de la responsabilité qui est la nôtre, sinon nous ne répondrons jamais aux défis qui se posent à l’Ordre. Comme je l’ai dit à la rencontre des Provinciaux européens à Prague en 1993:
- « La responsabilité, c’est la capacité de répondre? Le voulons-nous? Dans mon expérience personnelle comme Provincial, j’ai vu « le mystère de la responsabilité disparue ». C’est aussi mystérieux qu’une nouvelle de Sherlock Holmes! Un chapitre provincial constate un problème et charge le Provincial de le traiter et de le résoudre. Une décision courageuse doit être prise. Il demande l’avis du conseil provincial. Le conseil charge une commission de considérer ce qui doit être fait. Ils prennent deux ou trois ans pour clarifier plus avant les données du problème. Puis ils renvoient l’affaire au prochain chapitre provincial, et ainsi le cycle de l’irresponsabilité continue. »
Parfois, ce qui paralyse l’Ordre et nous empêche d’oser faire du neuf, c’est la peur d’accepter la responsabilité et de risquer l’échec. Nous devons chacun nous saisir de la responsabilité qui est la nôtre, même si c’est douloureux de le faire et si nous risquons de prendre une mauvaise décision. Sinon, nous allons mourir par perte de pertinence.
On pourrait objecter que notre système de gouvernement n’est pas le plus efficace. Un gouvernement plus centralisé et plus autoritaire nous rendrait capables de répondre plus rapidement aux crises, de prendre de sages décisions basées sur une connaissance plus large de l’Ordre. Il y a souvent des poussées vers une centralisation de l’autorité. Mais, comme l’écrivait Bede Jarrett, o.p., il y a soixante-dix ans:
- « Pour ceux qui vivent à son ombre, la liberté dans le gouvernement électif est une réalité trop sacrée pour être écartée, même au risque de l’inefficacité. Avec toute sa faiblesse inhérente, selon eux, elle convient mieux que l’autocratie, si bienfaisante qu’elle soit, à l’indépendance de la raison humaine et à la consolidation de la volonté humaine. La démocratie peut gâcher le résultat, mais elle fait des hommes. » (9)
Elle peut parfois se révéler inefficace, mais elle fait des prêcheurs. Notre forme de gouvernement est profondément liée à notre vocation de prêcheurs, parce que nous ne pouvons parler avec autorité de notre liberté en Christ que si nous la vivons les uns avec les autres. Mais notre tradition de démocratie et de décentralisation ne peut jamais servir d’excuse à l’immobilisme et à l’irresponsabilité. Elle ne doit pas être une façon de nous soustraire aux défis de notre mission.
2. Obéissance et don de soi
La tradition démocratique de l’Ordre, notre accent sur la responsabilité partagée, sur le débat et le dialogue, peut laisser croire que les exigences que nous pose l’obéissance sont moins grandes que dans un système plus autocratique et centralisé. L’obéissance, alors, n’est-elle pas toujours un compromis entre ce que je veux et ce que l’Ordre demande? Est-ce qu’on ne peut pas négocier une certaine autonomie limitée? Je ne crois pas qu’il en soit ainsi. La fraternité réclame de nous tout ce que nous sommes. Puisque, comme tous les voeux, l’obéissance est ordonnée à la caritas, une expression de l’amour, elle doit être sans réserve. Il y aura inévitablement une tension entre le processus du dialogue, la recherche de consensus, et le moment où il faut se remettre entre les mains des frères, mais c’est une tension féconde plutôt qu’un compromis négocié. Bien que je parle plus spécialement à partir de mon expérience de gouvernement parmi les frères, j’espère que plusieurs éléments de ce qui va suivre pourront être utiles à nos soeurs.
Je commençais en soulignant l’immensité des défis auxquels nous sommes affrontés en tant qu’Ordre. Nous pouvons y faire face à la seule condition d’être capables de constituer de nouveaux projets communs et d’abandonner des apostolats qui peuvent nous être chers comme individus ou comme Provinces. Nous devons oser tenter de nouvelles expériences et risquer l’échec. Nous devons avoir le courage parfois de laisser des institutions qui ont été importantes dans le passé et peut-être même restent significatives aujourd’hui. Si nous ne le faisons pas, nous serons prisonniers de notre passé. Nous devons avoir le courage de mourir si nous voulons vivre. Ceci exigera, des Provinces et des individus, une mobilité d’esprit, de coeur et de corps. Si nous voulons construire des centres de formation et d’études propres à l’Ordre en Afrique et en Amérique latine, rebâtir l’Ordre en Europe de l’Est, faire face aux défis de la Chine, de la prédication dans le monde de la jeunesse, du dialogue avec l’Islam et les autres religions, il y aura inévitablement des apostolats qu’il nous faudra abandonner. Sinon nous ne ferons jamais rien de nouveau.
Pour moi, ce don sans réserve aux frères de sa propre vie représente davantage que la simple souplesse que réclame une organisation complexe pour répondre à de nouveaux chantiers. Il relève de la liberté en Christ que nous prêchons. Il relève de la lex libertatis (10), la loi de liberté de la Nouvelle Alliance. La nuit où il fut livré, alors que sa vie était vouée à l’échec, Jésus prit du pain, le rompit, le donna à ses disciples et dit: « C’est mon corps, et je vous le donne. » Placé devant son destin, parce qu’« il était nécessaire que le Fils de l’homme soit livré », il posa cet acte suprême de liberté en donnant sa vie. Notre profession, quand nous mettons nos vies dans les mains du provincial, est un acte eucharistique d’une folle liberté. C’est ma vie et je vous la donne. C’est ainsi que nous nous donnons nous-mêmes à la mission de l’Ordre « entièrement députés à l’évangélisation totale de la Parole de Dieu. » (11)
Quand un frère remet sa vie entre nos mains, cela implique que nous sommes liés par une obligation correspondante. Nous devons oser lui demander beaucoup. Un Provincial doit avoir le courage de croire que les frères de sa Province sont capables de choses formidables, davantage qu’ils ne peuvent jamais l’imaginer. Notre système de gouvernement doit exprimer une confiance surprenante envers chacun, de la même façon que Dominique qui scandalisait ses contemporains en envoyant ses novices prêcher, disant: « Allez en confiance, parce que le Seigneur sera avec vous, et il mettra en vos lèvres les paroles à prêcher. » (12) Si un membre de l’Ordre a librement donné sa vie, alors nous honorons ce don en demandant beaucoup les uns des autres, dans la liberté, même si cela conduit un frère à abandonner un projet qu’il aime chèrement et où il s’est épanoui. Sinon l’Ordre sera paralysé. Nous devons nous inviter les uns les autres à donner nos vies pour de nouveaux projets, à oser nous saisir des questions du jour, plutôt que nous contenter de maintenir des institutions ou des communautés qui ne sont plus vitales pour notre prédication.
Il y a aujourd’hui des défis qui se présentent à nous et qui nécessitent une réponse de l’Ordre tout entier. L’évangélisation de la Chine peut en être un. Dans de tels cas, le Maître aura à faire appel à la générosité des Provinces pour donner des frères à de nouvelles zones de missions, même si cela aura des conséquences difficiles à porter. J’ai rencontré un Provincial pour discuter du don d’un frère pour notre nouveau Vicariat général en Russie et Ukraine. Je l’ai fait avec une grande hésitation parce que je savais que c’était un frère que la Province aurait du mal à perdre. Le Provincial me dit: « Si la providence de Dieu a préparé ce frère pour ce travail, nous devons croire nous aussi à la providence de Dieu pour nos besoins. »
Rien de neuf ne pourra jamais naître si nous n’osons abandonner ce qui s’est montré valable, pour quelque chose qui pourrait tourner à l’échec. Personne ne peut savoir à l’avance. La pression de la société veut qu’on se construise une carrière, une vie qui aille quelque part. Donner sa vie à la prédication de l’évangile, c’est renoncer à cette assurance. Nous sommes des gens sans carrière, sans projets définis. C’est là notre liberté. Je pense au courage de nos frères qui établissent l’Ordre en Corée, se débattant avec un nouveau langage et une nouvelle culture, sans garantie à l’avance que ce don de leurs vies portera du fruit. C’est seulement un don du Seigneur, comme fut sa résurrection après l’échec de la croix. Par nature, un vrai don, c’est une surprise.
Une façon de vivre cette générosité, c’est d’accepter une élection comme prieur, comme provincial ou comme membre du conseil conventuel ou provincial. Dans plusieurs Provinces, il est devenu difficile de trouver des frères capables qui soient prêts à accepter des charges. La recherche d’un supérieur devient le problème de trouver quelqu’un qui soit d’accord pour que son nom soit proposé au chapitre. Nous cherchons des « candidats ». Or il me semble que la seule raison d’accepter un tel poste, c’est qu’on est obéissant aux désirs des frères et non parce qu’on souhaite être « candidat ». Il peut y avoir de bonnes raisons objectives de refuser une charge, qui doivent être prises au sérieux et éventuellement acceptées après confirmation par l’autorité supérieure. Il doit s’agir de raisons graves, et non simplement du fait qu’on n’est pas attiré par l’idée d’avoir cette charge.
Sur la montagne de la Transfiguration, Pierre est fasciné par la vision de gloire qu’il a eue. Il souhaite dresser des tentes et s’installer. Il résiste à l’appel de Jésus à marcher sur la route de Jérusalem, où il doit souffrir et mourir. Il n’arrive pas à voir que c’est dans cette mort sur la croix que la gloire sera révélée. Parfois, nous restons fascinés par la gloire de notre passé, la gloire des institutions que nos frères ont construites avant nous. Notre reconnaissance envers eux doit se traduire par la recherche de chemins pour rencontrer les questions actuelles. Comme Pierre, nous pouvons être hypnotisés et paralysés et résister à l’invitation à nous lever et à marcher pour avoir part à la mort et à la résurrection. À chaque génération, chaque Province doit faire face à la mort. Mais il y a la mort stérile, de ceux qui restent accrochés à la montagne de la Transfiguration alors que le Seigneur l’a quittée, et il y a la mort féconde de ceux qui osent prendre la route et voyager avec lui vers la montagne du calvaire, qui conduit à la résurrection.
LA PAUVRETÉ: LA GÉNÉROSITÉ DU DIEU DE GRÂCE
La pauvreté est le voeu pour lequel il est le plus difficile de trouver des mots qui sonnent juste, et ceci pour deux raisons. Les frères et les soeurs qui ont connu de plus près la pauvreté réelle sont souvent les plus réticents à en parler. Ils savent combien est purement rhétorique une bonne part de ce que nous disons sur la pauvreté et sur l’« option pour les pauvres ». Ils savent à quel point la vie des pauvres est terrible, souvent sans espérance, avec la violence journalière et oppressante, l’ennui, l’insécurité, la dépendance. Ceux d’entre nous qui ont vu, même de loin, à quoi ressemble la pauvreté, se méfient souvent des mots faciles. Pouvons-nous vraiment connaître nous-mêmes ce que veut dire cette dégradation, cette insécurité et cette désespérance?
Une deuxième raison pour laquelle il est si difficile d’écrire sur la pauvreté c’est que ce que signifie « être pauvre », varie tellement d’une société à l’autre, dépend beaucoup de la nature des liens familiaux, du modèle économique, des dispositions sociales de l’État, etc. La pauvreté signifie quelque chose en Inde, avec sa longue tradition de la sainte mendicité, autre chose en Afrique où dans la plupart des cultures la richesse est considérée comme une bénédiction de Dieu, autre chose encore dans la société de consommation occidentale. Ce que signifie pour nous prononcer le voeu de pauvreté est encore plus déterminé culturellement que quand il s’agit de l’obéissance ou de la chasteté. La taille et la localisation de la communauté, les apostolats des frères, imposent différentes contraintes qui doivent nous éviter des jugements trop faciles quant à savoir à quel point les autres vivent bien ce voeu.
Comme tous les voeux, c’est d’abord un moyen. La pauvreté nous offre la liberté d’aller partout prêcher. Vous ne pourrez pas être un prêcheur itinérant si vous devez transporter toutes vos affaires chaque fois que vous bougez. Dans la bulle Cum spiritus fervore de 1217, Honorius III écrivait que Dominique et ses frères,
« dans la ferveur de l’esprit qui les animait, se dépouillaient des fardeaux des riches de ce monde et, courant avec zèle pour propager l’évangile, avaient résolu d’exercer la charge de la prédication dans l’humble état de la pauvreté volontaire, s’exposant eux-mêmes à des souffrances et à des dangers innombrables pour le salut des autres. » (13)
Nous ne sommes pas invités à abandonner seulement les richesses pour suivre le Christ, mais « frères et soeurs et mères et pères pour l’amour de moi ». Le renoncement qui nous donne la liberté implique une coupure radicale avec nos liens familiaux, c’est-à-dire une perte d’héritage. Les conséquences doivent en être envisagées avec grande délicatesse parce que la nature de ces liens familiaux a changé dans plusieurs sociétés. Aujourd’hui, nos familles connaissent souvent divorce et remariage et, dans certaines sociétés, nos frères et nos soeurs seront de plus en plus des enfants uniques. Nous avons de véritables obligations envers nos parents, mais comment les concilier avec le don radical de nous-mêmes que nous avons fait en donnant nos vies à la prédication de l’évangile par nos voeux dans l’Ordre? Paradoxalement, c’est souvent les membres d’une famille qui sont engagés par des voeux religieux qu’on estime « libres » pour aider au soin des parents âgés ou malades. Nous devrons y réfléchir avec beaucoup d’attention.
Le voeu de pauvreté nous offre la liberté de nous donner sans réserve à la prédication de l’évangile, mais ce n’est pas seulement un moyen au sens étroit et utilitaire du terme. Comme les autres voeux, il est ordonné, comme l’écrivait Thomas, à la caritas, l’amour qui est la vie même de Dieu. Comment le vivre de sorte que nous puissions parler de Dieu avec autorité?
Une façon de répondre serait d’examiner comment la pauvreté touche aux aspects fondamentaux de ce sacrement de l’amour qu’est l’Eucharistie. L’Eucharistie est le sacrement de l’unité que la pauvreté détruit; c’est le sacrement de la vulnérabilité, que le pauvre endure; c’est le temps du don, que notre société de consommation refuse. Nous demander comment nous pouvons et devons être pauvres, c’est nous demander comment nous devons vivre de façon eucharistique.
1. Invisibilité
La nuit avant sa mort, Jésus réunit ses disciples autour de la table pour célébrer la nouvelle alliance. C’était la naissance d’une demeure à laquelle tous pourraient appartenir, puisqu’il assumait tout ce qui peut détruire la communauté humaine: la trahison, le rejet, la mort même. Le scandale de la pauvreté, c’est qu’elle déchire ce que le Christ avait uni. La pauvreté n’est pas seulement une condition économique, le manque de nourriture, de vêtement ou d’emploi. Elle brise la famille humaine. Elle nous rend étrangers de nos frères et de nos soeurs. Lazare, à la porte de la maison du riche, n’est pas seulement exclu du partage de sa nourriture, mais aussi de s’asseoir à sa table. L’abîme irréconciliable qui les sépare après la mort ne fait que révéler ce que la situation était durant leurs vies. Dans notre monde, aujourd’hui, le fossé entre les pays riches et les pays pauvres, et à l’intérieur de ces pays eux-mêmes, devient toujours plus grand. Même dans les pays riches de la Communauté européenne, il y a presque vingt millions de chômeurs. Le corps du Christ est désarticulé.
La pauvreté volontaire dont nous faisons le voeu est valable non parce que, dans un certain sens, il serait bon d’être pauvre. La pauvreté est terrible. Elle n’a de sens que si elle permet de dépasser les frontières qui séparent les êtres humains les uns des autres, si elle est présence auprès de nos frères et soeurs séparés. Quelle autorité pourraient avoir nos paroles sur l’unité en Christ si nous n’osons prendre ce chemin? L’an dernier, j’ai vu combien nos soeurs peuvent en apprendre aux frères, par leur présence discrète auprès des pauvres dans de nombreuses régions du monde. Elles savent l’importance d’être simplement là, comme un signe du Royaume.
L’Eucharistie est le fondement de la demeure humaine universelle. Une personne pauvre se sentirait-elle chez elle et bienvenue dans nos communautés? Y sentirait-elle sa dignité respectée? Ou bien se sentirait-elle intimidée et insignifiante? Nos bâtiments sont-ils attirants ou repoussent-ils? Une des façons pour les pauvres d’être exclus de la communauté humaine, c’est de devenir invisibles et inaudibles. Ils disparaissent, des desaparecidos, comme Lazare à la porte de l’homme riche. Quand on arrive à la gare centrale de Calcutta, les mendiants se ruent sur vous et vous imposent leurs difformités. Ils veulent être vus, être visibles. Sommes-nous prêts à affronter la peur de ce que nous pourrions voir, un frère ou une soeur?
2. Vulnérabilité
À la dernière Cène, le Christ assume sa souffrance et sa mort. Il accepte l’ultime vulnérabilité de l’être humain, sa possibilité d’être blessé et mis à mort. Notre voeu de pauvreté nous invite certainement à assumer notre vulnérabilité humaine. Dans la bulle d’Honorius III, que j’ai citée plus haut, Dominique et les frères sont loués non seulement parce qu’ils sont pauvres mais parce qu’« ils s’exposent eux-mêmes à des souffrances et à des dangers innombrables pour le salut des autres ». En quel sens partageons-nous ne serait-ce que l’ombre de la vulnérabilité des pauvres?
Aussi peu que nous mangions, il nous reste toujours une issue si nous ne pouvons plus le supporter. L’Ordre ne nous laissera pas mourir de faim. Cependant, j’ai rencontré des frères et des soeurs qui ont osé aller aussi loin qu’ils le pouvaient, par exemple dans un des plus violents barrios de Caracas. Ils supportent le danger et l’épuisement à vivre chaque jour dans un monde où la violence atteint tout. C’est une réelle vulnérabilité qui pourrait leur coûter la vie. Je pense à nos frères et soeurs en Haïti, dont l’appel courageux à la justice met les vies en danger. En Algérie et au Caire, nos frères ont choisi de rester, malgré tous les dangers, comme un signe de leur espérance dans la réconciliation entre chrétiens et musulmans. Au Guatemala, nos soeurs indigènes portent les vêtements de leur propre peuple, dont elles partagent ainsi quotidiennement l’humiliation. Si elles portaient l’habit habituel des soeurs, elles en seraient protégées. Nous ne sommes pas tous appelés à ce niveau d’exposition. Il y a des tâches différentes dans l’Ordre. Mais nous pouvons les soutenir, les écouter et apprendre d’eux. Le terreau de notre théologie, c’est leur expérience.
Cet appel du Christ à la vulnérabilité doit nous interroger sur notre façon de vivre ensemble le voeu de pauvreté. Osons-nous au moins vivre la vulnérabilité que suppose la vie commune? Vivons-nous vraiment d’une bourse commune? Vivons-nous l’insécurité de donner à la communauté tout ce que nous recevons, en nous exposant au risque qu’ils pourraient ne pas nous donner tout ce dont nous pensons avoir besoin? Comment parler du Christ qui s’est remis entre nos mains, si nous ne le faisons pas? Nos communautés sont-elles divisées en classes financières? Y en a-t-il parmi nous qui ont accès à plus d’argent que les autres? Y a-t-il un réel partage des ressources entre les communautés d’une Province, ou entre Provinces?
3. Don
Au coeur de nos vies, il y a la célébration de ce moment de totale vulnérabilité et de totale générosité, où Jésus prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous ». Au centre de l’évangile, il y a un moment de pur don. C’est là que la caritas, qui est la vie de Dieu, devient la plus tangible. C’est une générosité que notre société a du mal à saisir parce qu’elle est un marché où tout est à acheter et à vendre. Quel sens peut-elle trouver à un Dieu qui s’est écrié: « Venez à moi vous tous qui avez soif et je vous donnerai de la nourriture gratuitement »? Toutes les sociétés humaines ont des marchés, achètent, vendent et échangent des biens. La société occidentale est différente parce qu’elle est un marché. C’est le modèle fondamental qui domine et informe notre conception de la société, de la politique et même des personnes. Tout est à vendre. L’infinie fécondité de la nature, la terre, l’eau, sont devenues des marchandises. Même nous, les êtres humains, nous sommes sur « le marché de l’emploi ». Cette culture de la consommation menace d’envahir le monde entier, et elle prétend le faire au nom de la liberté tandis qu’elle nous enferme dans un monde où rien n’est libre. Même quand nous devenons conscients de la détresse du pauvre et cherchons à y répondre, très souvent la caritas est monétarisée en « charité », où le don d’argent se substitut au partage de la vie.
Comment pouvons-nous être prêcheurs d’un Dieu de grâce et de générosité, qui nous donne sa vie, si nous demeurons prisonniers de cette culture qui envahit tout? Une des exigences les plus radicales du voeu de pauvreté est certainement que nous vivions dans une simplicité telle que nous voyions le monde différemment et que nous saisissions quelques traits du Dieu absolument gracieux. Les vies de nos communautés devraient être marquées par une simplicité qui nous aide à nous libérer des promesses illusoires de notre culture de consommation, et de « la domination des richesses » (14). Le monde change de figure depuis le siège arrière d’une Mercedes ou de la selle d’une bicyclette. Jourdain de Saxe disait que Dominique était un « véritable amant de la pauvreté », non pas peut-être parce que la pauvreté est aimable en elle-même mais parce qu’elle peut nous révéler nos désirs les plus profonds. J’ai souvent été impressionné par la joie et la spontanéité de nos frères et soeurs qui vivent dans la simplicité et la pauvreté.
Dans quelques régions de l’Ordre, le langage même que nous utilisons pour parler de notre vie commune nous invite à être attentifs aux dangers d’absorber les valeurs du monde des affaires. Les frères et soeurs deviennent du « personnel », nous avons un « bureau de direction », le supérieur reçoit un rôle de « gestion » ou d’administration », et nous étudions les « techniques de gestion ». Quelqu’un pourrait-il imaginer Dominique comme le premier Président de la Société anonyme de l’Ordre des Prêcheurs? Combien de fois un Provincial décourage-t-il un frère de chercher de nouvelles façons créatives de prêcher et d’enseigner parce que la Province en pâtirait financièrement?
Les bâtiments dans lesquels nous vivons sont des dons. Y vivons-nous et les traitons-nous avec gratitude? Avons-nous une attitude responsable face à ce qui nous est donné, à l’entretien de nos bâtiments, à ce que nous recevons? Avons-nous besoin des bâtiments que nous avons? Nos bâtiments pourraient-ils être mieux utilisés? Les économes ont souvent une tâche ingrate, bien qu’ils aient un rôle vital pour nous aider à porter la responsabilité que nous avons envers ceux qui ont été généreux à notre endroit.
LA CHASTETÉ: L’AMITIÉ DE DIEU
Nous avons un besoin urgent dans l’Ordre de réfléchir ensemble au sens du voeu de chasteté. Il touche à des données centrales de notre humanité: notre sexualité, notre corporéité, notre besoin d’exprimer et de recevoir de l’affection, et pourtant, fréquemment, nous avons peur d’en parler. C’est si souvent un lieu de lutte solitaire, dans la peur du jugement ou de l’incompréhension. Il pourrait être utile de préparer une autre lettre sur ce point dans l’avenir.
Bien sûr, ce voeu, comme les autres, est un moyen. Il nous donne la liberté pour prêcher, la mobilité pour répondre aux besoins de l’Ordre. Mais, à propos de ce voeu, il est peut-être particulièrement important qu’il ne soit pas seulement ressenti comme une nécessité pénible. Si nous ne parvenons pas à apprendre, après peut-être beaucoup de temps et de souffrances, à l’assumer positivement, il peut empoisonner nos vies. Il nous est possible de l’assumer parce que, comme tous les voeux, la chasteté est ordonnée à la caritas, à cet amour qui est la vie même de Dieu. C’est une façon particulière d’aimer. Si elle ne l’est pas, alors elle nous conduira à la frustration et à la stérilité.
Le premier péché contre la chasteté, c’est le manque d’amour. On disait de Dominique que « comme il aimait tout le monde, tout le monde l’aimait » (15). Ce qui est en jeu ici, encore une fois, c’est l’autorité de notre prédication. Comment pouvons-nous parler du Dieu d’amour si ce n’est pas un mystère que nous vivons? Si oui, alors il réclamera de nous mort et résurrection. La tentation est de prendre la fuite. Une voie habituelle d’évitement, c’est l’activisme, se perdre dans un travail trépidant, un bon travail, important même, pour fuir la solitude. Nous pouvons être tentés de fuir la réalité même de notre sexualité, de notre corporéité. Or l’Ordre est né justement dans le combat contre un tel dualisme. Dominique était celui qui prêchait contre la division du corps et de l’âme, de l’esprit et de la matière. Cela demeure une tentation actuelle. Pour une grande part, notre culture moderne est profondément dualiste. La pornographie, qui semble se délecter de la sexualité, en est en réalité une fuite, un refus de cette vulnérabilité que demande la relation humaine. Le voyeur garde ses distances, invulnérable et sous contrôle, par peur.
C’est notre corporéité qui est bénie et sanctifiée dans l’Incarnation. Si nous devons être prêcheurs d’une Parole faite chair, alors nous ne pouvons renier ou oublier ce que nous sommes. Nous soucions-nous des corps de nos frères, en nous assurant qu’ils ont assez de nourriture, les soignons-nous quand ils sont malades, leur donnons-nous de la tendresse quand ils sont vieux? Quand Bede Jarrett encourageait un jeune Bénédictin qui endurait les premières souffrances de l’amitié, il écrivait:
« Je suis heureux parce que je pense que votre tentation a été celle du puritanisme, d’une étroitesse, d’une certaine inhumanité. Vous tendiez presque à un refus de la sanctification de la matière. Vous étiez amoureux du Seigneur, mais pas vraiment de l’Incarnation. En fait, vous aviez peur. » (16)
Le fondement de notre chasteté ne peut jamais être la peur, la peur de notre sexualité, la peur de notre corporéité, la peur des personnes de l’autre sexe. La peur n’est jamais un bon fondement pour la vie religieuse. Car le Dieu qui s’est approché de nous a osé devenir chair et sang, même si cela le conduisait à la crucifixion. Finalement, ce voeu réclame de nous que nous passions par là où Dieu est passé d’abord. Notre Dieu s’est fait homme, il nous invite à en faire autant.
Saint Thomas d’Aquin affirme, ce qui peut surprendre, que notre relation à Dieu est une relation d’amitié, amicitia. La bonne nouvelle que nous prêchons, c’est que nous avons part au mystère infini de l’amitié du Père et du Fils qui est l’Esprit. De fait, Thomas explique que les « conseils évangéliques » sont les conseils offerts par le Christ dans l’amitié (17). Une façon de vivre cette amitié c’est notre voeu de chasteté. Pour mieux voir ce qu’il réclame de nous, réfléchissons un instant à deux aspects de cet amour trinitaire: c’est un amour absolument généreux et non possessif et c’est un amour entre égaux.
1. Un amour non possessif
C’est cet amour absolument généreux et non possessif par lequel le Père donne à son Fils tout ce qu’il est, y compris sa divinité. Ce n’est pas un sentiment ou une émotion, mais c’est l’amour qui fonde l’être du Fils. Tout amour humain, des gens mariés ou des religieux, doit chercher à vivre ce mystère et à participer de sa générosité non possessive.
Nous devons être complètement sans ambiguïté sur ce que cet amour exige de nous qui avons fait voeu de chasteté. Cela ne signifie pas seulement que nous ne nous marions pas, mais aussi que nous nous abstenons de toute activité sexuelle. Cela réclame de nous une renonciation claire et réelle, un ascétisme. Si nous prétendons faire autrement et acceptons volontairement des compromis, nous entrons alors dans une voie qui peut devenir finalement impossible à tenir et nous rendre, nous comme d’autres, terriblement malheureux.
La première chose à laquelle nous sommes appelés, c’est de croire que le voeu de chasteté peut vraiment être une façon d’aimer; quand bien même nous aurions à passer par des moments de frustration et de désolation, c’est un chemin qui peut faire de nous des êtres riches en affection et pleinement humains. Les aînés de notre communauté sont souvent signes d’espérance pour nous. Nous côtoyons des hommes et des femmes qui sont passés par les épreuves de la chasteté et ont atteint la liberté de ceux qui peuvent aimer en liberté. Ils peuvent être pour nous des signes que rien n’est impossible avec Dieu.
Entrer dans cet amour libre et non possessif prendra du temps. Nous pourrons rencontrer des échecs et des découragements en chemin. Maintenant que plusieurs personnes entrent dans l’Ordre à un âge plus avancé, ayant déjà eu des expériences sexuelles, nous ne devons pas imaginer la chasteté comme une innocence qu’on peut perdre mais comme une intégrité du coeur dans laquelle on peut grandir. Même les moments d’échec peuvent, avec la grâce de Dieu, dessiner la route sur laquelle nous devenons plus mûrs, car « nous savons qu’en toute chose Dieu oeuvre pour le bien de ceux qui l’aiment » (Rm 8,28).
Nos communautés doivent être des lieux où nous devons nous donner les uns aux autres le courage quand le coeur hésite, le pardon quand l’un tombe et la vérité quand l’autre est tenté de se mentir à lui-même. Nous devons croire dans la bonté de nos frères ou de nos soeurs quand ils cessent eux-mêmes d’y croire. Rien n’est plus venimeux que le mépris de soi-même. Comme l’écrivait Damian Byrne dans sa lettre sur La vie commune:
« Alors que le sanctuaire le plus profond de nos coeurs est voué à Dieu, nous avons d’autres besoins. Il nous a faits tels qu’un large domaine de notre vie est accessible aux autres et est requis par les autres. Chacun de nous a besoin d’expérimenter l’attention véritable des autres membres de la communauté, leur affection, leur estime et leur amitié… Vivre ensemble, cela signifie rompre le pain de nos esprits et de nos coeurs les uns avec les autres. Si des religieux ne trouvent pas cela dans leurs communautés, alors ils iront le chercher ailleurs. »
Parfois, le passage à une véritable liberté et intégrité du coeur réclamera de nous que nous passions par la vallée de la mort, qu’apparemment nous ne nous trouvions affrontés qu’à la stérilité et à la frustration. Ce passage est-il vraiment possible sans la prière? Il y a d’abord la prière que nous partageons avec la communauté, la prière quotidienne, fondamentale pour nos vies. Mais il y a aussi la prière silencieuse et privée, qui nous place face à face avec Dieu, dans des instants d’une vérité inévitable et d’un pardon bouleversant. C’est là qu’on peut apprendre l’espérance. Dominique lui-même, quand il marchait, invitait parfois les frères à aller de l’avant pour qu’il puisse être seul pour prier et, dans une version primitive des Constitutions, Dominique disait que le maître des novices devait apprendre à ses novices à prier en silence (18). Nos moniales ont beaucoup à apprendre aux frères sur la valeur de la prière en silence.
2. L’amour qui fait des égaux
Enfin, l’amour qui est au coeur de Dieu est absolument fécond. Il engendre, il crée tout ce qui existe. Ce pour quoi nous luttons dans l’exercice de la chasteté, ce n’est pas seulement le besoin d’affection mais le désir d’engendrer, d’enfanter. Notre attention les uns pour les autres doit certainement comporter un souci pour la créativité que chacun de nous possède, et que nos vies de Dominicains doivent libérer pour l’évangile. Ce peut être la créativité d’un frère ou d’une soeur conduisant une communauté à devenir paroisse, le travail intellectuel d’un théologien, ou bien les pré-novices au Salvador faisant spontanément du théâtre. Notre chasteté ne doit jamais être stérile.
L’amour qui est Dieu est assez fécond pour créer une égalité. La Trinité est sans domination ni manipulation. Elle n’est ni paternaliste ni condescendante. C’est l’amour que notre voeu de chasteté nous invite à vivre et à prêcher. Comme l’écrivait Thomas, l’amitié trouve ou crée l’égalité (19). La fraternité de notre tradition dominicaine, la forme démocratique de notre gouvernement que nous apprécions, n’expriment pas seulement une façon d’organiser nos vies et de prendre des décisions, mais elles expriment quelque chose du mystère de la vie de Dieu. Que les frères soient connus en tant qu’Ordo fratrum praedicatorum donne corps à ce que nous prêchons, au mystère de cet amour de parfaite égalité qu’est la Trinité.
Ceci doit caractériser toutes nos relations. La Famille dominicaine, dans sa reconnaissance réciproque de la dignité de chacun et l’égalité de tous les membres de la Famille, appartient à notre façon de bien vivre ce voeu. Les relations entre les soeurs et les frères, les religieux et les laïcs, doivent aussi être une « sainte prédication ». Même notre recherche d’un monde plus juste, où la dignité de chaque être humain sera respectée, n’est pas un simple impératif moral mais exprime le mystère de l’amour qui est la vie de la Trinité que nous sommes appelés à incarner.
CONCLUSION
Quand Dominique passait par les villages où sa vie était menacée par les Albigeois, il avait l’habitude de chanter à voix haute pour que chacun sache qu’il était là. Les voeux n’ont de valeur que s’ils nous libèrent pour la mission de l’Ordre avec quelque chose du courage et de la joie de Dominique. Ils ne doivent pas constituer un lourd fardeau qui nous écrase, mais nous donner une liberté pour marcher légèrement tandis que nous allons vers des lieux nouveaux, pour faire du nouveau. Ce que j’ai écrit dans cette lettre ne donne qu’une expression très inadéquate de ce que cela pourrait être. J’espère qu’ensemble nous pourrons construire une vision partagée de notre vie de Dominicains, donnant leur vie pour la mission, qui puisse nous rendre forts sur la route et libres pour chanter.
Votre frère en saint Dominique,
Frère Timothy Radcliffe, o.p.
Maître de l’Ordre
Pâques 1994
Notes
1. Avila, 22.
2. Par exemple: Somme théologique IIa IIae, q. 184, a. 3.
3. Jourdain de Saxe, Libellus, 64.
4. Voir la Quatrième Prière eucharistique.
5. Somme théologique IIa IIae, q. 186, a. 6, ad 2 um.
6. L.C.O. 17, §I.
7. Herbert, McCabe, o.p., God Matters, Londres, 1987.
8. « Pursuing Communion in Government: Role of the Community Chapter », Dominican Monastic Search,vol. II, Automne-hiver 1992, p. 41.
9. The Life of St. Dominic, Londres, 1924, p. 128.
10. Somme théologique Ia IIae, q. 108, a. 4.
11. L.C.O. 1, §III
12. Acta canon. 24.
13. Cité par Marie-Humbert Vicaire, o.p., « The Order of St. Dominic in 1215 », dans Peter B. Lobo, o.p. (éd.), The Genius of St. Dominic, p. 75.
14. L.C.O. 31, §I.
15. Jourdain de Saxe, Libellus, 107. Voir L.C.O. 25.
16. Bede Bailey, Aidan Bellenger, Simon Tugwell (éd.), Letters of Bede Jarrett, Downside and Blackfriars (Dominicain Sources in English, vol. 5), p. 180.
17. Somme théologique Ia IIae, q. 108, a. 4.
18. Constitutions primitives, Dist. I. c. xiii.
19. I Ethicorum, 1.8, s.7
Jurassic Park et la dernière Cène (1994)
Conférence donnée au « The Tablet Open Day », Londres, Juin, 1994
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 L’an dernier, j’ai eu à m’adresser à l’Union des supérieurs majeurs (les responsables d’ordres religieux) pour une causerie de dix minutes sur les difficultés particulières que rencontrent dans leur mission les religieux en Occident. Tâche quasi impossible! Que peut-on dire en dix minutes? J’ai alors été voir le film Jurassic Park et il m’est apparu clairement que cette histoire nous donne une excellente image du monde dans lequel nous avons aujourd’hui à vivre notre foi. Ce film est un des plus grands succès de l’histoire du cinéma.
L’an dernier, j’ai eu à m’adresser à l’Union des supérieurs majeurs (les responsables d’ordres religieux) pour une causerie de dix minutes sur les difficultés particulières que rencontrent dans leur mission les religieux en Occident. Tâche quasi impossible! Que peut-on dire en dix minutes? J’ai alors été voir le film Jurassic Park et il m’est apparu clairement que cette histoire nous donne une excellente image du monde dans lequel nous avons aujourd’hui à vivre notre foi. Ce film est un des plus grands succès de l’histoire du cinéma.
À un certain moment, en Italie, il était donné dans un cinéma sur trois et, en France, le ministre de la Culture a déclaré qu’il était un danger national. Dans les stations service on peut acheter des biscuits pour les enfants en forme de dinosaure. Pourquoi un tel succès ? Certainement parce que chaque culture se nourrit d’histoires, de récits qui façonnent notre perception du monde et de nous-mêmes – qui nous disent ce que c’est que d’être un homme; et voici une histoire dans laquelle des millions de gens se retrouvent – peut-être sans bien s’en rendre compte. Mais nous, les chrétiens, prétendons vivre d’une autre histoire, que nous nous remémorons et revivons en nous réunissant tous les dimanches : l’histoire de la dernière Cène, l’histoire d’un homme qui a réuni ses amis pour partager un repas avec eux, et qui leur a donné son corps et son sang – sa propre personne. C’est cette histoire, plus que toute autre, qui devrait façonner nos vies et la conscience que nous avons de nous-mêmes. Ainsi, vouloir être un chrétien, ce n’est pas juste vouloir être bon. D’ailleurs, rien ne permet d’affirmer que les chrétiens soient, dans l’ensemble, meilleurs que les autres et Jésus n’a pas appelé les saints mais les pécheurs. Vouloir être chrétien, c’est plutôt accepter de fonder son existence sur une histoire que certains de nos contemporains trouvent très bizarre et qui propose une autre vision du monde, une autre façon d’être homme. Je voudrais ce soir évoquer quelques différences entre ces deux histoires.
Je suppose que la plupart d’entre vous ont vu Jurassic Park. Vous y avez probablement emmené vos enfants, en prétendant que c’était juste pour leur faire plaisir, mais vous y avez trouvé vous-mêmes beaucoup de plaisir. Pourtant, juste au cas où vous ne l’auriez pas vu, je vous le raconte. Un millionnaire (Richard Attenborough) utilise une expérimentation sur l’ADN pour ramener des dinosaures à la vie. Il crée une réserve mésozoïque où les dinosaures sont en liberté. Malheureusement, certains s’échappent et se mettent à tuer des visiteurs. Alors les humains se sauvent et désertent l’île et sa jungle. Cela vous semble peut-être n’avoir que peu de rapports avec la vie dans les banlieues londoniennes – ou alors les choses ont vraiment beaucoup changé depuis que je suis parti pour Rome! – mais à mon avis, cela rejoint des éléments importants de notre culture contemporaine.
Violence
Le premier élément que je voudrais souligner est tout à fait banal. Jurassic Park nous parle d’un monde de violence, de troupeaux de dinosaures sillonnant la campagne et dévorant tout ce qu’ils rencontrent. C’est une violence à laquelle l’homme ne peut répondre que par une nouvelle violence.
Notre autre histoire, celle de la dernière Cène, est aussi une histoire de violence : la violence infligée à Jésus, et qu’il assume » comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir. II n’ouvrait pas la bouche » (Is 53, 7).
J’ai récemment demandé à un groupe de dominicaines et de dominicains américains ce qu’ils considéraient comme la question numéro 1 posée à notre prédication, ils ont répondu sans hésiter que c’était la violence.
Dans les derniers mois, j’ai été au Rwanda, au Burundi, en Haïti, en Angola, en Croatie et à New York. Partout, j’ai été confronté à la violence d’une grande partie du monde dans lequel nous vivons. Je suppose que l’histoire humaine a presque tout le temps été violente et, à part les horreurs des deux dernières guerres, la nôtre n’a pas été sensiblement pire. Bien des société du passé ont exalté la violence. Je crois que la nôtre en fait autant, quoique de manière moins explicite et plus subtile.
Jurassic Park nous offre la réanimation d’une jungle darwinienne, où les animaux luttent pour survivre. Les plus faibles n’y réussissent pas et meurent; leur race s’éteint, comme celle des dinosaures. La compétition violente pour un territoire et de la nourriture appartient au processus vital qui est à l’origine de notre existence. La lutte brutale pour la vie est le berceau de notre naissance. En fin de compte, nous laisse penser le film, la violence porte du fruit. Mais la théorie darwinienne de l’évolution (que je ne puis prétendre avoir étudiée) m’intéresse à titre de symptôme : elle témoigne d’un profond changement, depuis environ deux cents ans, dans notre façon de comprendre ce que c’est qu’être homme. Elle représente le surgissement d’une conviction : à savoir que toute société humaine ne fonctionne et ne se développe que par une lutte sans merci entre des individus, chacun à la poursuite de son propre intérêt. On trouve dans notre langage bien des traces de la métaphore de la survie du plus apte, de la vie conçue comme une jungle darwinienne.
Ainsi Sumner, économiste de Yale, a-t-il écrit que » les millionnaires sont un produit de la sélection naturelle… On peut, à juste titre, les considérer comme des agents de la société, naturellement sélectionnés pour certaines tâches « .
C’est Mandeville, au XVIIIe siècle, avec sa petite parodie intitulée la Parabole des abeilles, qui nous fournit l’un des premiers témoignages du sérieux glissement qui s’est opéré dans notre façon de comprendre la société humaine. Selon lui, la convoitise, l’envie, l’orgueil, tous les vices traditionnels pourraient bien, en réalité, être très utiles. Ce serait grâce à eux que le monde tourne rond et que la société humaine est florissante : vices privés, peut-être, mais vertus publiques. La concurrence effrénée est un comportement qui a déjà un long passé derrière lui. C’est cette façon-là de comprendre ce qu’est un homme qui fait de nos cités des » Jurassic Parks » urbains, des jungles citadines pleines de violence, où les faibles sont écrasés.
Notre histoire, celle de la dernière Cène, en représente une radicale mise en question, et pas seulement parce qu’on y voit un homme qui subit la violence et refuse de l’exercer à son tour. Elle propose une image entièrement différente de ce que c’est qu’être un homme. Il nous offre son corps. C’est la Nouvelle Alliance, notre refuge et notre demeure. Le sens de notre vie n’est pas donné dans la quête de notre intérêt propre, mais dans l’acceptation d’un don de communion.
On a souvent dit – et la plupart d’entre nous en conviendraient sans doute – que ce qui est difficile ici, c’est de briser la fascination qu’exerce une image finalement nuisible et destructrice de l’être humain : un être humain qui est à jamais une monade solitaire en quête de son intérêt personnel. Nous sommes la chair les uns des autres; cette communion trouve sa parfaite réalisation dans cette chair que le Christ nous donne – son propre corps. Notre quête est fondamentalement celle du bien commun. Le problème qui se pose à l’humanité est de savoir comment échapper à l’emprise de ce mythe trompeur. Comment faire – Comme l’a écrit David Marquand dans son The Unprincipled Society (La Société sans principes) : » Comment une société en miettes peut-elle retrouver son unité ? Comment une culture imprégnée d’un individualisme égoïste peut-elle recréer les liens de la communauté ? Si l’on admet que l’obstacle majeur au nécessaire réajustement économique et politique est le type de bon sens qui a prévalu depuis près de 200 ans, comment redéfinir le bon sens ? » (The Unprincipled Society : New Demands on Old Politics, Glasgow, 1988, p. 288.)
Le récit de la dernière Cène peut rompre les entraves de notre imagination. C’est l’histoire d’une communauté brisée, en miettes. L’homme qui en est le coeur va être trahi et renié. Tous ses amis vont se disperser. C’est l’histoire de la naissance d’une communauté où l’aliénation sous toutes ses formes, la trahison et même la mort sont abolies. Une histoire qui nous apporte l’espoir.
Paroles
Au coeur de l’action de Jésus, il y a une parole puissante – des mots qui ont le pouvoir de transformer; ceci est mon corps, je vous le donne. Il dit une parole. Dans Jurassic Park, les mots ne sont pas très importants. On y entend beaucoup de grondements, de grognements, et le bruit des os broyés, mais a-t-on envie de bavarder avec un Tyrannosaurus Rex ? Un Russe ou un Chinois pourrait, sans perdre grand-chose, voir le film en version originale. Cette différence n’est pas négligeable. Il me semble que l’une des manières d’édifier une société humaine et d’échapper au piège de l’individualisme égoïste est de retrouver la révérence due aux mots, de redécouvrir que la parole a le pouvoir de construire et de soutenir une communauté. Nous sommes des êtres humains, et c’est parce que nous pouvons nous parler que nous sommes solidaires les uns des autres. Une société où l’on méprise la parole est une société en désintégration. Lorsque je me trouvais à San Salvador, j’ai été voir, à l’Université, la pièce où les Jésuites ont été abattus; les meurtriers ont également tiré sur leurs livres. On voit un exemplaire du Dictionnaire théologique du Nouveau Testament de Kittel, ouvert à l’article sur l’Esprit saint, source de toute sagesse, et dont la page est entièrement déchiquetée par les balles. Je repense à la bibliothèque d’un prêtre de Haïti dont tous les livres avaient été déchirés et saccagés. Je repense à un petit village à la frontière entre Croatie et Serbie, rasé jusqu’au sol. Les tombes du cimetière avaient été ouvertes, les corps, jetés tout autour et, dans l’Église, le missel avait été déchiré et souillé d’obscénités. Tout cela exprime la même haine des mots et la même crainte devant leur pouvoir.
Lorsque je fais escale en Angleterre au milieu de mes voyages, pour me remettre du décalage horaire et laver mes affaires, je ne trouve pas mention dans la presse de membres du Parlement faisant irruption les uns chez les autres et saccageant la bibliothèque de leurs adversaires – mais j’ai le sentiment que nous nous lançons facilement des mots à la tête, sans bien penser aux conséquences, comme des enfants qui joueraient aux cow-boys et aux Indiens sans se rendre compte qu’ils tiennent de vrais fusils. C’est comme si nous avions oublié que parler est un acte moral, qui exige un sens extrême de la responsabilité. Je ne puis m’empêcher d’être abasourdi quand je vois la différence entre ce qu’on disait de John Smith’ avant et après sa mort. Est-ce que tout cela n’était que des » paroles verbales » ? L’une des causes de la profonde crise sociale que nous vivons est que nous avons perdu confiance dans l’idée que les mots disent vraiment la réalité des choses. Nous avons perdu cette profonde vénération qu’exprimait saint Augustin pour » les mots, ces précieux réceptacles du sens « .
Le livre de la Genèse nous dit que la vocation d’Adam fut d’appeler les choses par leur nom. Dieu a fait Adam pour qu’il l’aide dans son oeuvre de création; Il lui montrait un lion, ou un lapin, et Adam lui donnait son nom; il savait de quoi il s’agissait et pouvait donc aider Dieu à faire surgir du chaos un monde de sens. Les noms qu’il donnait n’étaient pas des étiquettes collées arbitrairement sur les choses, comme s’il avait pu aussi bien nommer le lapin lièvre. Ils participaient au pouvoir qu’a la Parole divine d’amener à l’être, d’amener à la lumière. Parler, utiliser des mots, est presque une vocation divine. Cela nous donne pouvoir de vie et de mort, comme Dieu. C’est quelque chose de religieux.
La violence de notre société imprègne notre langage. Vaclav Havel, président de la République tchèque, a opposé les paroles de Salman Rushdie aux paroles de l’Ayatollah Khomeini : » des mots qui ont un effet magnétique sur la société par leur vérité et leur liberté, sont mis en face de mots qui hypnotisent, qui trompent, qui excitent, qui rendent fou, qui ensorcèlent, des mots nocifs, mortels même. La parole changée en flèche’. » (Cité par The Independent, 9 décembre 1989, p. 29.)
George Steiner écrit : » Il en va des mots comme des particules en physique : il y a la matière et l’antimatière. La construction et l’annihilation. Lorsqu’ils se trouvent face à face, en train de se parler, parents et enfants, hommes et femmes sont en situation d’extrême danger : un mot peut endommager une relation humaine, peut noyer l’espoir dans la boue. Les lames de la parole sont plus tranchantes que celles des couteaux. Et pourtant, ce même outil, lexical, syntaxique, sémantique, est aussi instrument de révélation, d’extase, il permet la merveille d’une compréhension qui est communion’. » (Real Presences : Is There Anything in What We Say?, Londres, 1989, p. 58.)
Une soeur dominicaine de Taiwan m’a parlé d’une petite fille qui portait un enfant sur le dos. Quelqu’un lui dit : » Mon enfant, tu portes une charge bien lourde! » Et elle de répondre : » Ce n’est pas une charge, c’est mon petit frère que je porte. » Un mot qui transforme.
Les tenants du politiquement correct sont dans le vrai, mais à tort : ils ont bien compris que les mots que nous utilisons sont très importants, car nos mots peuvent être des épées meurtrières. Mais la communauté humaine ne peut retrouver la santé simplement parce qu’on lui interdit l’usage de certains mots. Comme l’écrit Robert Hughes dans The Culture of Complaint (Une culture de la protestation) : » Nous souhaiterions créer une sorte de Lourdes linguistique, où le mal et le malheur seraient supprimés par un plongeon dans les eaux de l’euphémisme. » Et il rappelle qu’on n’efface pas l’horreur de la mort simplement en décidant que désormais on ne parlera plus de » cadavre » mais d’une » personne sans vie » , comme le propose le New England Journal of Medecine (un cadavre obèse, précise-t-il, devient une personne sans vie aux mensurations inhabituelles). Les administrateurs de l’université de San Francisco à Santa Cruz avaient tort de croire que l’on peut vaincre le racisme en bannissant certaines expressions comme » rire jaune » ou » manger la grenouille » (Il faut se rappeler qu’en anglais, les Français sont parfois appelés frogs par dérision. Les expressions du texte original, sans équivalent littéral en français, peuvent être entendues comme une allusion voilée aux Japonais (there is a nip in the air) ou aux Chinois (a chink in one’s armour)) sous prétexte que dans certains contextes, elles pourraient sembler avoir des relents racistes.
Ce n’est pas en interdisant les mots déplaisants que nous réussirons à établir une communion et à panser les plaies, mais en utilisant les mots qui créent la communion, qui accueillent l’étranger, qui comblent les distances. Au coeur de notre histoire de la dernière Cène, il y a un homme qui prononce les mots capables de donner vie à une communauté : » Ceci est mon Corps, je vous le donne « . Et si la doctrine de la Présence réelle – que ces mots soient réellement capables d’opérer une transformation en profondeur – semble stupide et absurde à nombre de nos contemporains, c’est sûrement parce que nous avons oublié quelle peut être la force des mots. Il faut relire ce qu’écrivait Emily Dickinson :
» Quelle lèvre mortelle pourrait pressentir
Ce que contient en puissance Une syllabe proférée,
sans défaillir sous le poids ? «
Les mots de la consécration, prononcés par le Christ, dévoilent ce à quoi tout langage humain aspire : la grâce parachevant la nature. Lorsqu’aux temps anciens, les moines d’Irlande s’enfuirent vers la côte, ils emportèrent avec eux les textes des Évangiles, qu’ils copiaient et recopiaient, ornaient et traitaient avec révérence. Ils fondèrent des communautés qui gardèrent vivante cette révérence pour les mots sacrés. Peut-être sommes-nous appelés à former des communautés capables de traiter avec révérence le langage, les mots porteurs de vérité, les mots constructeurs de communion. Si l’Église doit être un lieu où l’on peut retrouver en profondeur le sens de ce que c’est qu’être homme – des gens dont l’identité la plus profonde est d’être-avec-les-autres -, alors nous devons, avant tout, former une communauté où les mots sont utilisés avec révérence et de manière responsable.
Cela signifie que nous devons être une communauté où l’on ose débattre, discuter, chercher dans le dialogue une vérité dont nous ne pourrons jamais être les maîtres. Bien souvent, dans cette Église que nous aimons, on a peur du débat. Je ne veux pas dire des désaccords : il y a toutes sortes de clameurs exprimant bruyamment des désaccords. Je veux parler de cette lutte ardue de deux personnes qui cherchent à s’éclairer mutuellement, de ces discussions dans lesquelles on s’oppose à l’autre avec d’autant plus de passion qu’on est animé du désir de s’enrichir de son point de vue.
Dans la Somme, saint Thomas part toujours des objections de ses opposants. Non pas pour leur prouver qu’ils ont tort, mais pour découvrir en quel sens ils peuvent avoir raison. Nous combattons avec nos opposants comme Jacob avec l’ange, de manière à pouvoir demander une bénédiction. La révérence pour les mots implique l’humilité devant la vérité et devant l’autre. Nos mots dans l’Église comme dans la vie sociale, sont souvent lourds d’arrogance.
Je voudrais citer une dernière fois Havel : » Tous ensemble, nous devrions lutter contre les mots arrogants et garder un oeil vigilant pour l’arrogance insidieuse dont les germes se glissent dans des mots apparemment pleins d’humilité. A l’évidence, il ne s’agit pas juste d’une tâche linguistique. La responsabilité envers les mots est fondamentalement une tâche éthique. Comme telle, elle échappe d’ailleurs à l’horizon du monde visible pour rejoindre le monde où réside la Parole qui était au commencement, et qui n’est pas de l’Homme. «
Pardon
Quand nous nous réunissons, le dimanche, pour écouter à nouveau notre récit de fondation, les mots puissants que nous entendons sont des paroles de pardon, qui parlent du sang répandu pour le pardon de nos péchés. Une parole qui guérit et absout. Il y a pourtant, au coeur de notre culture, une résistance profonde à la notion de pardon. Elle vient en partie, me semble-t-il, de l’idée selon laquelle les gens qui s’intéressent beaucoup au pardon – notamment les catholiques – souffriraient d’une obsession malsaine concernant le péché. Cela n’est absolument pas le catholicisme dans lequel j’ai été élevé, marqué par l’influence bienveillante des Bénédictins. Plus radicalement, je me demande si, en réalité, notre culture ne se méfie pas du pardon parce que nous ne sommes pas convaincus que ce soit une bonne chose. N’y aurait-il pas, dans la culture contemporaine, l’idée qu’en dehors de la sphère strictement personnelle et privée, le pardon est nuisible, voire même dangereux ? S’il y avait trop de pardon, notre société se déliterait. Comme le beurre, ou le chocolat, ou d’autres bonnes choses, il faut le consommer avec une stricte modération.
Et pourtant c’est un élément central de notre foi. Il est vrai qu’après Dresde et Hiroshima, après Dachau et Auschwitz, on peut être réticent devant une notion trop facile du pardon. Comme si on pouvait tout simplement oublier de telles horreurs. Mais notre réticence est peut-être plus profonde encore et nous en trouvons des indices dans Jurassic Park. Dans la jungle darwinienne, il ne peut y avoir de pardon. La conséquence nécessaire de la faiblesse et de l’échec est l’extinction. Et il est heureux qu’il en aille ainsi, sinon il n’y aurait pas d’évolution. Nous autres, êtres humains, sommes le résultat d’un processus inflexible d’annihilation d’espèces innombrables qui n’ont pu s’adapter; et cela a mené à nous. C’est une histoire sans pardon qui est à l’origine de notre humanité. Dans Jurassic Park, les dinosaures sont sauvés de l’annihilation, et l’on constate bien vite que c’est une lourde erreur. Il aurait mieux valu laisser leur ADN emprisonné dans les gouttes d’ambre.
Je ne peux vraiment pas prétendre m’y connaitre en économie. Prieur, je me suis bien vite trouvé perdu dans les explications qui m’étaient données en anglais sur les comptes. Maintenant que je vis à Sainte-Sabine, à Rome, et que les explications me sont données en italien, je suis dans le noir complet. Mais j’ai dans l’idée que l’image de la survie du plus apte opère ainsi, hors de toute notion de pardon, dans une bonne part de notre économie et de notre politique; l’une des fonctions d’un gouvernement est justement de supprimer tout ce qui masque et protège les industries mal adaptées. Il ne faut pas de pardon. Les faibles doivent périr et la pitié est chose dangereuse. Je me rends bien compte que je simplifie à outrance et qu’en réalité, nous ne travaillons pas sans filet; nous rêvons d’une économie de marché sociale, d’un capitalisme bienveillant, et pourtant cela rejoint, dans la sensibilité contemporaine, quelque instinct fondamental.
Notre culture contemporaine est volontiers sans merci. Un des plaisirs de mon existence errante – soixante pays en deux ans! – est de trouver un journal anglais. Il est parfois vieux de plusieurs semaines, pourtant je me jette dessus comme un homme affamé. Mais je m’afflige d’y lire si souvent dénonciations et accusations. La méthode habituelle pour parvenir à la vérité semble être le scandale, le dévoilement des péchés de quelqu’un. Certes, tout cela est fait au nom de la moralité, pour un retour aux valeurs fondamentales. Mais on peut se poser la question : finalement, qu’est-ce qui est dévoilé ? Qu’est ce qui est mis à nu et révélé ?
Seule une attention patiente permet de pénétrer la vérité d’autres êtres humains, avec leurs vices et leurs vertus, leur méchanceté et leur bonté. Il faut les écouter attentivement et les laisser se dévoiler. La vérité n’est pas donnée dans la mise à nu brutale, mais dans un moment de révélation. Elle a besoin de tendresse, pas de dénonciation. Pour y voir clairement, il faut de la compassion, et même de l’amour. Thomas d’Aquin nous a appris que la vérité et la beauté se rejoignent.
Le journaliste qui a un scoop me fait penser à Pompée, prenant d’assaut le temple de Jérusalem et exigeant de voir ce que cachait le voile du Saint des Saints. Il l’arrache et s’écrie : » Mais il n’y a rien, rien du tout! » Il n’y avait rien qu’il puisse voir. Le pardon, dans la dernière Cène, n’est pas d’abord une question d’oubli. Il ne vient pas nous rassurer avec l’idée que notre Dieu veut bien ignorer nos fautes, regarder de l’autre côté. C’est un acte radicalement créateur, une guérison. Dans notre tradition, le pardon est ce moment de création pure, dans lequel Jésus est ressuscité des morts. Ce n’est pas ce qui nous permet d’oublier. Cela rend la mémoire possible. C’est le mystère d’un Dieu qui, selon l’image médiévale, fait que le bois mort de la croix bourgeonne et se couvre de fleurs; un Dieu de fertilité qui fait refleurir nos vies mortes. Nos deux histoires, Jurassic Park et la dernière Cène, diffèrent profondément dans leur façon de percevoir la création. Dans la première, les hommes sont créés selon un processus inflexible qui détruit les faibles. Dans la seconde, il y a une parole créatrice, qui guérit et rachète, qui nous restaure dans notre intégrité.
Les héros, dans Jurassic Park, sont les dinosaures. Ils sont, bien sûr, des victimes; ceux qui avaient été condamnés par l’évolution. Ce sont des héros qui conviennent à notre culture, où la victime a souvent statut de héros. La colère et l’amertume des victimes d’abus, d’injustices ou de mauvais traitements s’enracine dans le sentiment que rien ne peut jamais être fait pour guérir leurs blessures. Les victimes se sentent condamnées à jamais à en subir les effets. Évoquer seulement la possibilité d’un pardon reviendrait à banaliser leur souffrance et à augmenter leur colère. Tout ce qu’on peut faire, c’est chasser le coupable. Il n’y a que la croyance en un Dieu d’absolue fécondité, un Dieu qui a fait tout à partir de rien et a relevé Jésus d’entre les morts, qui puisse nous donner le courage de penser à ceux que nous avons blessés, ou à ceux qui nous ont fait du mal, et d’espérer le pardon.
Dans la dernière Cène, le pardon n’est pas juste une absolution privée, c’est la naissance d’une communauté. Ce n’est pas juste le don de la paix intérieure, personnelle, c’est la paix vécue ensemble. C’est comme cela que ça se passait en Europe où le sacrement de la réconciliation était le sacrement de la guérison de la communauté – un événement public jusqu’à ce que le concile de Trente invente le confessionnal.
C’est au Burundi l’année dernière, durant les massacres, que j’ai été témoin d’un des exemples les plus émouvants de ce pardon partagé. Le conflit entre Hutus et Tutsis qui a ensuite décimé le Rwanda avait déjà commencé au Burundi. Nos frères, qui appartenaient aux deux groupes ethniques, avaient tous perdu des membres de leur famille. C’était, pour eux, un temps de profonde souffrance. Comment faire pour construire et maintenir une communauté religieuse dans laquelle vivaient ensemble des ennemis ancestraux ? Cette question était notre toute première priorité. Je parcourais le pays en compagnie du responsable de notre conseil général pour l’Afrique, qui est Hutu, et du supérieur local, qui est Tutsi. Nous ne vîmes presque personne, sinon les habituelles bandes armées traquant leurs ennemis. Visitant les camps de réfugiés, nous y avons rencontré des parents de nos frères et de nos soeurs. Il était d’une importance capitale qu’ils acceptent de rencontrer ces deux frères, le Hutu et le Tutsi ensemble. Ce fut le premier geste de réconciliation et de pardon mutuel. Puis avant que je quitte la capitale, Bujumbura, nous nous sommes réunis et avons essayé de nous parler. Chacun dut écouter, dut entendre, non pas des dénonciations et des accusations, mais le récit de ce que les autres avaient eu à endurer; de telle sorte qu’ils ne deviennent pas des étrangers mais puissent demeurer des frères. C’est peut-être là le plus extraordinaire moment d’attention, d’écoute d’un autre qui semblait appartenir à un autre univers, qu’il m’ait été donné de vivre. Ce fut un moment de profond silence -le genre de silence qui accompagne des mots difficiles à prononcer, difficiles à entendre. Le pardon, ici, n’est pas une amnésie, mais l’impossible don de communion.
Fatalisme
Je voudrais encore faire ressortir un dernier contraste entre Jurassic Park et la dernière Cène – contraste qui est profondément lié à la possibilité même de pardon. Il s’agit des différentes façons de comprendre la liberté qu’impliquent nos deux histoires. Jurassic Park est une sorte de parabole, comme l’était l’histoire de Frankenstein, sur l’échec de notre culture scientifique à réaliser son rêve de tout maîtriser. C’est l’histoire d’une perte de contrôle, d’un échec de la liberté. C’est tout à fait explicite dans le livre, lorsque la cabine de contrôle du parc tombe en panne et que tous les dinosaures peuvent sortir. Le héros prend un instant de réflexion, alors qu’on est sur le point de sombrer dans le chaos, et s’écrie : » Depuis Newton et Descartes, la science nous a explicitement donné l’image d’une maîtrise totale. Elle a prétendu avoir le pouvoir d’arriver à tout maîtriser, grâce au fait qu’elle comprenait les lois de la nature. Mais, au XXe siècle, cette prétention a été anéantie, définitivement’. > Finalement, la seule liberté laissée à nos héros est la liberté de s’enfuir, d’échapper au gâchis qu’ils ont créé. Cela nous incite à attendre Jurassic Park 2 avec impatience. Cette liberté, la liberté de rester indépendant, de n’être pas solidaire, est bien celle de notre homme moderne, cet être isolé et solitaire, pour qui être solidaire, c’est se laisser piéger.
Bien des choses extraordinaires sont arrivées ces derniers temps; on a obtenu des libertés inespérées. Nous avons vu s’écrouler le mur de Berlin; Nelson Mandela devenir président d’Afrique du Sud. Peut-être même va-t-on vers la paix au Proche-Orient. Pourtant, en dépit de tout cela, nous sommes tentés par un certain fatalisme désabusé. Nous avons parfois le sentiment que nous ne pouvons absolument rien faire pour surmonter la pauvreté croissante, la cruauté et la mort. C’est ce dont parle Havel comme de l’ » incapacité générale de l’homme moderne à maîtriser sa propre situation « . Peut-être ce fatalisme n’est-il pas dû uniquement au fait que la science n’a pas réussi à fournir toutes les réponses. Dans The Culture of Contentment (La Culture de la satisfaction), l’économiste américain John Kenneth Galbraith affirme que notre système économique implique ce genre de fatalisme, que, depuis deux siècles environ, notre politique a été profondément influencée par une philosophie du laissez faire. Cela signifie qu’interférer avec le marché ne peut qu’être nuisible. Nous devons laisser le marché se développer selon ses propres lois et tout ira bien. » La vie économique peut trouver en elle-même la solution à ses problèmes et faire en sorte que finalement tout s’arrange pour le mieux. » C’est une philosophie qui nous encourage tous à vivre dans le court terme; car, comme l’a dit Keynes, » à long terme, nous serons tous morts « . (The Culture of Contentment, Londres, 1992, p. 79.)
La dernière Cène nous offre justement la liberté face à la mort, cette perspective à court ou à long terme. Elle nous offre le souvenir d’un homme destiné à la mort. Il est nécessaire – c’est là un des maîtres mots de l’Évangile de Marc – que le Fils de l’homme soit livré, pour souffrir et mourir. C’est son destin. Et pourtant, face à l’anéantissement, la nuit avant qu’il soit livré, il accomplit un acte de folle liberté. Il prend sa souffrance et sa mort, il s’empare de son destin et en fait une offrande : » Ceci est mon corps, je vous le donne. » Le destin est transfiguré en liberté. Et la forme que cela prend est exactement l’inverse de ce qui se passe dans Jurassic Park : il refuse d’échapper aux disciples qui vont le renier et le trahir. Il se remet entre leurs mains. Il les laisse faire de lui ce qu’ils veulent. C’est une liberté tout à fait différente de celle des héros de Jurassic Park, qui échappent à la furie des dinosaures en fuyant dans leur avion. C’est la liberté de se montrer solidaire. Et c’est la plus profonde liberté qui soit car, en dépit de ce que nous pensons souvent, nous sommes la chair les uns des autres, nous ne pouvons nous en sortir tout seuls.
Être libres de nous échapper c’est fuir notre nature profonde. Si vous me demandiez ce que j’ai appris de plus important, durant ces années comme Maître de l’Ordre, toujours entre deux aéroports, je dirais que j’ai appris un tout petit peu ce qu’implique cette liberté d’être solidaire. Ce que j’ai vu c’est tant d’hommes et de femmes, très souvent des religieux mais aussi, souvent, des laïcs, qui ont osé s’emparer de cette liberté-là, qui ont osé faire don de leur vie, en faire une offrande. J’ai appris une petit peu mieux ce que signifie célébrer l’Eucharistie.
Je viens de rentrer d’Algérie, où les frères ont décidé de rester, comme un signe d’espoir et d’une communion à venir, en dépit des menaces de mort proférées par les fondamentalistes islamistes. Pour eux, chaque Eucharistie est célébrée face à la mort.
Je repense à un jour, au nord du Rwanda, dans la zone des combats; c’était avant les événements présents. J’avais visité un camp abritant trente mille réfugiés. J’y avais vu des femmes essayant en vain de nourrir des enfants qui avaient renoncé à faire l’effort de vivre. J’avais visité l’hôpital tenu par les soeurs; service après service, j’y avais vu des enfants et des adolescents aux membres arrachés. Je me rappelle particulièrement un enfant, huit ou neuf ans, avec les deux jambes arrachées, et un bras, et un oeil, et son père, assis près de lui, qui pleurait. Nous sommes rentrés chez les soeurs; il n’y avait rien à dire. Pas un mot qu’on puisse ajouter. Mais nous avons pu célébrer l’Eucharistie, nous avons pu nous rappeler la dernière Cène. C’était la seule chose à faire, et qui pouvait donner aux soeurs le courage de rester, le courage d’être solidaires.
Pour conclure, comment briser le pouvoir, la fascination qu’exerce cette image de l’homme, qui tient notre humanité captive ? Comment allons-nous nous libérer de ce nouveau mythe, qui fait de nous des êtres solitaires, chacun à la poursuite de son propre intérêt, en une compétition effrénée ? Comment arriverons-nous, pour reprendre les mots de Marquand, à redéfinir ce qui a été le bon sens durant ces deux cents dernières années ? À comprendre que nous sommes frères et soeurs, enfants d’un même Dieu et frères dans le Christ, faits de la même chair et incapables de nous épanouir seuls ?
En vérité, le tréfonds de notre nature humaine n’est pas la convoitise et l’égoïsme, c’est la faim et la soif de Dieu, un Dieu en qui nous nous trouverons les uns, les autres. Si l’on en croit Alasdair McIntyre, nous devrions suivre l’exemple de nos ancêtres lointains, et former des petites communautés locales » où la vie morale pourrait se maintenir, de sorte que le sens moral aussi bien que le sens civique pourraient survivre à l’époque prochaine de ténèbres et de barbarie’ « . (After Virtue, Londres, 1981, p. 244.) Il n’est pas douteux que l’une des façons de témoigner de ce que c’est qu’être un homme est de se réunir en petites communautés locales pour revivre l’histoire de la dernière Cène, avec son mystère de liberté et de pardon. En Angleterre, certaines de ces petites communautés sont nommées paroisses. Elles prennent bien des formes diverses à travers le monde. Dans ces communautés, nous devrions être nourris de la certitude que le bien que nous recherchons n’est pas notre satisfaction personnelle mais le bien commun. Mais ces communautés ne devraient pas être des petits groupes repliés sur eux-mêmes, des bandes de copains. Cela, je ne pourrais pas m’y faire. Non! Il nous faut entretenir le sens d’une appartenance plus vaste, goûter notre communion avec tous les hommes, les saints et les pécheurs, les vivants et les morts.
La source vive de l'espérance. L'étude et l'annonce de la Bonne Nouvelle (1996)
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 Quand saint Dominique cheminait à travers le sud de la France, alors que sa vie était menacée, il chantait gaiement. « Il semblait toujours gai et heureux, sauf lorsqu’il était bouleversé de compassion pour une peine qui affligeait son prochain » (1). Et cette joie de Dominique est inséparable de notre vocation à être des prêcheurs de la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à « rendre raison de l’espérance qui est en nous » (1 Pierre 3,15). Aujourd’hui, dans un monde crucifié par la souffrance, la violence et la pauvreté, notre vocation est à la fois plus difficile et plus nécessaire que jamais. La crise de l’espérance traverse toutes les parties du monde. Comment vivre la joie de Dominique, alors que nous sommes des gens de notre temps, partageant les crises de nos peuples et les forces et les faiblesses de notre culture? Comment nourrir un espoir profond, enraciné dans l’inébranlable promesse de vie et de bonheur que Dieu fait à ses enfants? La conviction que j’explore dans cette lettre à l’Ordre est la suivante: une vie d’étude est l’une des voies que nous avons pour grandir dans cet amour qui « excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout » (1 Co 13,7).
Quand saint Dominique cheminait à travers le sud de la France, alors que sa vie était menacée, il chantait gaiement. « Il semblait toujours gai et heureux, sauf lorsqu’il était bouleversé de compassion pour une peine qui affligeait son prochain » (1). Et cette joie de Dominique est inséparable de notre vocation à être des prêcheurs de la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à « rendre raison de l’espérance qui est en nous » (1 Pierre 3,15). Aujourd’hui, dans un monde crucifié par la souffrance, la violence et la pauvreté, notre vocation est à la fois plus difficile et plus nécessaire que jamais. La crise de l’espérance traverse toutes les parties du monde. Comment vivre la joie de Dominique, alors que nous sommes des gens de notre temps, partageant les crises de nos peuples et les forces et les faiblesses de notre culture? Comment nourrir un espoir profond, enraciné dans l’inébranlable promesse de vie et de bonheur que Dieu fait à ses enfants? La conviction que j’explore dans cette lettre à l’Ordre est la suivante: une vie d’étude est l’une des voies que nous avons pour grandir dans cet amour qui « excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout » (1 Co 13,7).
Le temps est venu de renouveler l’histoire d’amour entre l’Ordre et l’étude. C’est en train de commencer. Partout dans le monde, je vois s’ouvrir de nouveaux centres d’études et de réflexion théologique, à Kiev, Ibadan, Sao Paulo, Saint-Domingue, Varsovie, pour n’en citer que quelques-uns. Ces centres ne doivent pas offrir seulement une formation intellectuelle. L’étude est un chemin vers la sainteté, qui ouvre nos coeurs et nos esprits les uns aux autres, qui construit des communautés et nous forme à être ceux qui proclament en toute confiance l’avènement du Royaume.
L’ANNONCIATION
Étudier est en soi un acte d’espérance, puisque cela exprime notre confiance qu’il y a un sens à nos vies et aux souffrances de nos peuples. Et ce sens vient comme un don, une Parole d’espérance, promesse de vie. Il y a un moment de l’histoire de notre Rédemption qui résume avec force ce que signifie recevoir ce don de la bonne nouvelle: l’Annonciation à Marie. Cette rencontre, cette conversation, est un symbole puissant de ce que cela signifie, pour une grande part, d’être étudiant. Je me servirai de ce symbole pour guider notre réflexion sur la manière dont l’étude fonde notre espérance.
1. Tout d’abord, c’est un moment d’attention. Marie écoute la bonne nouvelle qui lui est annoncée. C’est là le début de toute notre étude, l’attention à la Parole d’espérance proclamée dans les Écritures. « Oralement et par lettre, frère Dominique exhortait les frères à l’étude constante du Nouveau et de l’Ancien Testaments » (2). Nous apprenons à écouter Celui qui dit « Crie de joie, stérile, toi qui n’as pas enfanté; pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n’as pas mis au monde » (Is 54,1). Nos études nous offrent-elles la dure discipline d’apprendre à entendre la bonne nouvelle?
2. Ensuite, c’est un moment de fertilité. La voilà, telle que la peignit Fra Angelico, le livre sur ses genoux, attentive, attendant, écoutant. Et le fruit de son attention est qu’elle porte un enfant, le Verbe fait chair. Son écoute libère toute sa force de création, sa fertilité de femme. Et notre étude, l’attention à la Parole de Dieu, doit libérer les sources de notre fertilité, nous faire enfanter le Christ dans notre monde. Au coeur d’un monde qui semble souvent condamné et stérile, nous donnons le jour au Christ en un miracle de création. Chaque fois que la Parole de Dieu est entendue, elle ne parle pas seulement d’espérance, mais elle est une espérance qui prend chair et sang dans nos vies et nos paroles. Congar aimait à citer le mot fameux de Péguy: « Non pas le vrai, mais le réel… c’est à dire le vrai avec l’historicité, avec son état concret dans le devenir, dans le temps ». Voilà l’épreuve où mesurer nos études: donnent-elles à nouveau le jour au Christ? Nos études sont-elles des moments de véritable création, d’Incarnation? Les maisons d’études devraient être comme des salles de maternités!
3. Enfin, à une époque où le peuple de Dieu semble abandonné et sans espoir, Dieu donne à son peuple un avenir, un chemin vers le Royaume. L’Annonciation transforme la manière dont le peuple de Dieu peut comprendre son histoire. Au lieu de conduire à la servitude et au désespoir, elle ouvre un chemin vers le Royaume. Nos études préparent-elles la voie à l’avènement du Christ?Transforment-elles notre perception de l’histoire de l’humanité, de façon à nous la faire comprendre non du point de vue du vainqueur, mais de celui du petit, de l’opprimé que Dieu n’a pas oublié et qu’il vengera?
APPRENDRE À ÉCOUTER
- Il entra et lui dit: « Réjouis-toi, Ô comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. (Luc 1,29-30)
Marie écoute les paroles de l’ange, la bonne nouvelle de notre salut. C’est là que commence toute l’étude. Étudier n’est pas apprendre comment être intelligent mais comment écouter. Simone Weil écrivait d’un dominicain français, le frère Perrin, que « la formation de la faculté d’attention est le but véritable et presque l’unique intérêt des études ». (3) Cette réceptivité, cette ouverture de l’oreille qui marque toute l’étude, est en fin de compte profondément liée à la prière. Toutes deux exigent que nous soyons silencieux et attendions que la Parole de Dieu vienne à nous. Toutes deux nous demandent un vide, afin d’attendre du Seigneur ce qu’Il nous donnera. Pensez au tableau de Fra Angelico: Dominique, assis au pied de la croix, lisant. Est-il en train d’étudier ou de prier? Est-il seulement pertinent de se poser la question? La véritable étude fait de nous des mendiants. Nous sommes amenés à la découverte saisissante que nous ne savons pas ce que ce texte signifie, que nous sommes devenus ignorants et dépendants, et alors nous attendons, dans un état de réceptivité intelligente, ce qui nous sera donné.
Pour Lagrange, l’École Biblique était un centre d’études scripturaires justement parce qu’elle était une maison de prière. Le rythme de la vie de la communauté était « un va-et-vient entre l’oratoire et le laboratoire ». Il écrivait: « J’aime entendre l’Évangile chanté par le diacre à l’ambon, au milieu des nuages de l’encens: les paroles pénètrent alors mon âme plus profondément que lorsque je les retrouve dans une discussion de revue. » (4) Nos monastères doivent jouer un rôle important dans la vie d’étude de l’Ordre, comme des oasis de paix et des lieux d’attentive réflexion. L’étude dans nos monastères appartient à l’ascèse de la vie monastique dominicaine. Elle ne peut être laissée aux seuls frères. Chaque moniale a droit à une bonne formation intellectuelle comme faisant partie de sa vie religieuse. Comme le disent les Constitutions des Moniales: « Élément caractéristique de l’observance de l’Ordre, que le Bienheureux Père recommanda de quelque manière aux premières soeurs, l’étude nourrit la contemplation; en outre, (elle écarte) les obstacles provenant de l’ignorance et (forme) le jugement pratique. » (LMO 100 II)
Marie écouta la promesse faite par l’ange, et elle enfanta le Verbe de Vie. Cela paraît si simple. Qu’avons-nous besoin de faire de plus que nous ouvrir à la Parole de Dieu dite dans les Écritures? Pourquoi faut-il tant d’années d’études pour former des prêcheurs de la bonne nouvelle? Pourquoi devons-nous étudier la philosophie, lire des livres de théologie gros et ardus alors que nous avons la Parole même de Dieu? N’est-ce donc pas simple de « rendre raison de 1’espérance qui est en nous »? Dieu est amour et l’amour a vaincu la mort. Que faut-il dire d’autre? Ne trahissons-nous pas cette simplicité par nos discussions complexes? Or cela n’était pas si simple pour Marie. Cette histoire commence par sa perplexité. « À cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation » Écouter, cela commence quand nous osons nous laisser surprendre, déranger. Puis, l’histoire se poursuit par sa question au messager: « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme? »
a) La confiance dans l’étude
On raconte que saint Albert le Grand était un jour assis dans sa cellule, en train d’étudier. Alors le Démon lui apparut déguisé en l’un des frères, et essaya de le persuader qu’il perdait son temps et son énergie à étudier les sciences profanes. Cela était mauvais pour sa santé. Albert fit juste le signe de croix et l’apparition disparut (5). Hélas! Les frères ne sont pas toujours aussi faciles à convaincre. Toutes les disciplines — littérature, poésie, histoire, philosophie, psychologie, sociologie, physique, etc… — qui tentent de donner un sens à notre monde sont nos alliées dans notre recherche de Dieu. « Il doit être possible de trouver Dieu dans la complexité de 1’expérience humaine » (6). Notre monde, par toutes ses souffrances et ses douleurs, est en fin de compte le fruit de « cet amour divin qui a d’abord donné vie et toutes les belles choses » (7). L’espérance qui fait de nous des prêcheurs de la bonne nouvelle n’est pas un vague optimisme, une bonne humeur cordiale, comme un sifflotement dans les ténèbres. C’est la croyance qu’à la fin, nous pouvons découvrir une signification à nos vies, une signification qui n’est pas imposée, qui est là, qui attend d’être découverte.
Il s’ensuit que l’étude devrait avant tout être un plaisir, le pur délice de découvrir que oui, malgré toutes les démonstrations du contraire, les choses ont vraiment un sens, qu’il s’agisse de nos vies, de l’histoire de l’humanité ou de ce passage particulier des Écritures contre lequel nous nous sommes débattus toute la matinée. Nos centres d’étude sont des écoles de joie parce qu’elles sont fondées sur la croyance qu’il est possible de parvenir à une certaine compréhension de notre monde et de nos vies. L’histoire de l’humanité n’est pas l’éternel conflit insensé de Jurassic Park, la survie des plus adaptés. La création dans laquelle nous vivons et dont nous faisons partie n’est pas le résultat d’un hasard, mais le travail du Christ: « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » (Col 1,16s) La Sagesse danse au pied du trône de Dieu quand elle fait le monde, et la fin de toute l’étude est de partager son plaisir. Simone Weil remettait en avril 1942 le texte suivant au frère Perrin: « L’intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu’il y ait désir, il faut qu’il y ait plaisir et joie … La joie d’apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs. » (8). Les Constitutions parlent de notre propensio (LCO 77) à la vérité, une inclination naturelle du coeur humain. Étudier devrait être une simple partie de notre joie d’être pleinement vivants. La vérité est l’air que nous sommes faits pour respirer.
C’est une idée splendide, mais admettons tout de suite que c’est bien loin de l’expérience de beaucoup d’entre nous! Pour certains dominicains, frères et soeurs, les années d’étude n’ont pas été un temps d’apprentissage de l’espérance, mais de désespoir. Bien souvent, j’ai vu des étudiants se battre avec des livres qui semblent arides et éloignés de leur expérience, attendant impatiemment que tout cela soit fini pour pouvoir se lancer dans la prédication, jurant de ne plus jamais ouvrir un livre de théologie quand ils seront « rescapés » du studium. Et pire encore que l’aridité, pour certains il y a l’humiliation de s’acharner en vain sur les verbes hébreux, de ne jamais parvenir à comprendre la différence entre les Ariens et les Apollinariens, pour être finalement vaincus par la philosophie allemande!
Pourquoi l’étude est-elle si difficile pour tant d’entre nous? En partie parce que nous sommes marqués par une culture qui ne croit plus que l’étude est une activité qui vaut la peine, une culture qui doute que le débat peut nous conduire à la vérité à laquelle nous aspirons. Si notre siècle est si marqué par la violence, c’est sûrement en partie parce qu’il a perdu sa confiance dans notre capacité à atteindre la vérité ensemble. La violence est l’unique ressource dans une culture qui n’a aucune confiance dans la recherche commune de la vérité. Dachau, Hiroshima, le Rwanda, la Bosnie: ce sont tous des symboles de l’effondrement d’une foi dans la possibilité de construire un foyer commun d’humanité par le dialogue. Ce manque de confiance peut prendre deux formes, un relativisme qui désespère d’atteindre jamais à la vérité, et un fondamentalisme qui affirme que la vérité est déjà entièrement en notre possession.
Devant ce désespoir qu’est le relativisme, nous célébrons que la vérité est connaissable et nous est de fait proposée comme un don. Comme saint Paul, nous pouvons dire: « J’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis. » (1 Co 11,23) Étudier est un acte eucharistique. Nous ouvrons nos mains pour recevoir les dons de la tradition, riche de connaissance. La culture occidentale est marquée par une profonde suspicion à l’égard de tout enseignement, associé à un endoctrinement et un fanatisme. La seule vérité valable est celle qu’on découvre pour soi même ou qui se fonde dans ses propres sentiments. « Si je sens que c’est juste pour moi, alors ça va. » Mais l’enseignement doit nous libérer des frontières étroites de notre expérience et de nos préjugés pour ouvrir les vastes étendues d’une vérité que nul ne peut maîtriser. Je me souviens, lorsque j’étais étudiant, de l’éblouissement de découvrir que le Concile de Chalcédoine n’était pas la fin de notre recherche de compréhension du mystère du Christ, mais un autre début, faisant exploser toutes les jolies petites solutions cohérentes dans lesquelles nous avions tentés de l’enfermer. La doctrine ne doit pas endoctriner mais nous rendre libres pour poursuivre notre route.
Mais il y a aussi le raz de marée du fondamentalisme, qui provient d’une peur profonde de penser, et qui offre « la fausse sécurité d’une foi exempte d’ambiguïtés » (Oakland n° 109). Au sein de l’Église, ce fondamentalisme prend parfois la forme d’une répétition non réfléchie de paroles reçues, d’un refus de prendre part à la recherche interminable de compréhension, d’une intolérance à tous ceux pour qui la tradition ne se limite pas à une révélation, mais est aussi une invitation a se rapprocher davantage du mystère. Ce fondamentalisme peut sembler d’une fidélité solide comme le roc à l’orthodoxie, mais il contredit en fait un principe fondamental de notre foi, à savoir qu’en débattant et raisonnant, nous rendons honneur à notre Créateur et Sauveur qui nous a donné des esprits pour penser et nous rapprocher de Lui. Nous ne pouvons faire de théologie sans l’humilité et le courage d’écouter les arguments de ceux avec qui nous sommes en désaccord, et sans les prendre au sérieux. Saint Thomas écrivait: « De même que nul ne saurait juger d’un cas sans écouter les raisons des deux parties, de même celui qui doit écouter la philosophie se trouvera en meilleure position pour émettre un jugement s’il écoute tous les arguments des deux parties. » (9) Il nous faut perdre ces certitudes qui écartent les vérités inconfortables, voir les deux faces de l’argument, poser les questions qui peuvent nous effrayer. Saint Thomas était l’homme des questions, celui qui apprit à considérer sérieusement toute question, quelque stupide qu’elle puisse paraître.
Nos centres d’études sont des écoles d’espérance. Quand nous nous rassemblons pour étudier, notre communauté est une « sainte prédication ». Dans un monde qui a perdu confiance dans la valeur de la raison, cela témoigne de la possibilité d’une recherche commune de la vérité. Ce peut être un séminaire universitaire débattant un cas d’éthique biomédicale, ou un groupe d’agents pastoraux étudiant ensemble la Bible en Amérique latine. Là, nous devons apprendre la confiance les uns dans les autres comme partenaires de dialogue, compagnons d’aventure. L’humiliation n’a pas sa place dans l’étude si nous pouvons nous donner les uns aux autres le courage pour la route. Personne ne saurait enseigner sans comprendre de l’intérieur la panique d’un autre devant un nouveau livre à ouvrir ou une nouvelle idée à affronter. Aussi l’enseignant n’est-il pas là pour remplir la tête des élèves avec des faits, mais pour les renforcer dans leur inclination profondément humaine pour la vérité, et les accompagner dans cette recherche. Nous devons apprendre à voir avec nos propres yeux et à voler de nos propres ailes. Quand Lagrange enseignait à l’École Biblique, il disait à ses é1èves: « Regardez donc. Vous ne direz pas: le Père Lagrange a dit, vous aurez vu par vous-mêmes! » (10) Ce que l’enseignant doit donner par-dessus tout à l’étudiant, c’est le courage de faire des erreurs, de prendre le risque de se tromper. Maître Eckhart disait que « vous verrez rarement qu’on arrive à quelque chose de bon sans s’être d’abord égaré, un peu ». Aucun enfant n’apprend jamais à marcher sans être bien des fois tombé à plat ventre. Un enfant effrayé reste à jamais assis sur son derrière!
b) La destruction des idoles
Dans les premiers temps, l’étude des frères était essentiellement biblique, préparatoire au travail pastoral, principalement au sacrement de pénitence. Les premiers travaux théologiques de l’Ordre furent des manuels de confession. Mais alors que saint Thomas enseignait aux débutants en théologie de Sainte Sabine, il réalisa que notre prédication ne serait utile au salut des âmes que si les frères recevaient une solide formation théologique et philosophique. Cela pour deux raisons. Tout d’abord, ce sont souvent les questions les plus simples qui requièrent la pensée la plus profonde: Sommes-nous libres? Comment pouvons-nous demander des choses à Dieu? Ensuite parce que, selon la tradition biblique, l’obstacle entre nous et le véritable culte de Dieu n’est pas tant l’athéisme que l’idolâtrie. L’humanité a tendance à se construire de faux dieux et à les adorer. L’arrachement à cette idolâtrie nous demande un dur cheminement, dans notre façon de vivre et de penser. II ne suffit pas de s’asseoir et d’écouter la Parole de Dieu. Nous devons briser l’emprise de ces fausses images de Dieu qui nous tiennent captifs et ferment nos oreilles.
Toute sa vie, saint Thomas fut fasciné par la question: Qu’est-ce que Dieu? Comme le dit Herbert McCabe, o.p., sa sainteté consiste en ce qu’il se laissa vaincre par cette question. Au coeur de l’enseignement de Thomas d’Aquin, il y a cette ignorance radicale, car nous sommes liés à Dieu « comme à quelqu’un qui nous serait inconnu » (11). Nous devons nous dégager de cette image de Dieu, invisible et immensément puissant, qui manipule les événements de nos vies. Un tel Dieu serait en fin de compte un tyran et un rival de l’humanité contre lequel nous serions contraints de nous rebeller. Au contraire, nous devons découvrir en Dieu la source ineffable de notre être, le coeur même de notre liberté. Nous devons perdre Dieu si nous voulons Le découvrir, comme le disait saint Augustin, « plus près de moi que je ne le suis moi-même » (12). Enseigner la théologie, par conséquent, n’est pas une simple question de transmission d’informations, mais il s’agit d’accompagner les étudiants face à la perte de Dieu, la disparition d’une personne bien connue et aimée, afin de découvrir Dieu à la source de toute chose, Celui qui s’est donné à nous en son Fils. Alors nous pouvons vraiment dire: « Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. » McCabe écrit: « C’est l’un des grands plaisirs de l’enseignement dans notre studium que d’observer le moment, qui arrive tôt ou tard pour chaque étudiant, ce moment de conversion si l’on peut dire, où il réalise que … Dieu n’est rien moins que la source de tous mes actes libres, et la raison pour laquelle ils sont miens. » (13)
La discipline de notre étude a pour ultime finalité de nous amener à ce moment de conversion où sont détruites nos fausses images de Dieu, pour que nous puissions approcher du mystère. Mais penser ne suffit pas. La théologie dominicaine a commencé avec Dominique abandonnant son cheval pour devenir un pauvre prêcheur. La pauvreté intellectuelle de Thomas devant le mystère de Dieu est inséparable de son choix d’un ordre de pauvres prêcheurs. Le théologien doit être un mendiant qui sait comment accueillir les dons gratuits du Seigneur.
Quant à nous, écouter la Parole requiert que nous nous libérions des fausses idéologies de notre époque. Qui sont nos faux dieux? L’idolâtrie de l’État, dont les autels ont vu sacrifier des milliers de vies innocentes, en fait sûrement partie; le culte du marché, et la poursuite de la richesse. J’ai assez écrit sur les dangers du mythe du consumérisme. Notre monde tout entier a été séduit par une mythologie: que tout s’achète et se vend. Tout a été transformé en marchandises, tout a un prix. Le monde de la nature, la fertilité de la terre, la fragile écologie des forêts, tout cela est à vendre. Et même nous-mêmes, les fils et les filles du Très-Haut, nous sommes à acheter et à vendre sur la marché du travail. La Révolution Industrielle a vu déraciner des communautés entières, arrachées à leur terre et réduites en esclavage dans les villes nouvelles. Cette migration de masse continue aujourd’hui. L’exemple le plus poignant et le plus scandaleux est celui de l’esclavage de millions de nos frères et soeurs d’Afrique, transformés en articles à marchander pour le profit et l’exportation. Comme on l’a écrit au Chapitre de Caleruega: « Les hommes et les femmes ne peuvent être traités comme des marchandises, pas plus que leur vie et leur travail, leur culture et leurs ressources pour s’épanouir dans la société ne sauraient servir de monnaies d’échange au jeu des pertes et profits. » (20,5)
Nos centres d’études doivent être les lieux où nous sommes libérés de cette vision réductrice du monde, et où nous réapprenons à nous émerveiller de gratitude devant les généreux dons de Dieu. C’est par l’étude, en cherchant à comprendre les choses et nous comprendre les uns les autres, que nous recouvrons un sens d’émerveillement face au miracle de la création. Simon Tugwell, o.p., écrit: « Quand nous allons au fond des choses, atteignons leur véritable essence par nos esprits, ce que nous trouvons est l’impénétrable mystère de la création divine… En fait, connaître, c’est nous voir basculer tête la première dans une merveille qui dépasse de bien loin la simple curiosité. » (14) C’est bien la vérité qui nous libère. La libération intellectuelle va de pair avec la véritable liberté de la pauvreté. Comme Dominique et Thomas, nous devons devenir des mendiants qui reçoivent les dons généreux de Dieu. Le voeu de pauvreté et la proximité des pauvres sont le juste contexte dominicain pour étudier.
Dans notre lutte pour nous libérer de cette perception du monde, nous trouvons une aide dans le fait d’être un Ordre véritablement universel. Nombreuses sont les cultures dont la vision de la réalité ne se basent pas sur la domination et la maîtrise. Nos frères et soeurs d’Afrique peuvent nous aider vers une théologie qui se base davantage sur la réciprocité et l’harmonie. Les traditions religieuses asiatiques peuvent aussi nous aider vers une théologie plus contemplative. Nous devons être présents dans ces autres cultures, pas seulement pour pouvoir y inculturer l’Évangile, mais pour qu’elles puissent nous aider à comprendre le mystère de la création et de Dieu, donateur de toutes bonnes choses.
NAISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ
- Et l’ange lui dit: « Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. » (Luc 1,30)
Le propos de nos études n’est pas simplement de transmettre de l’information, mais de faire naître le Christ dans notre monde. Pour évaluer nos études, il ne s’agit pas tant de savoir si elles font de nous des gens bien informés, mais si elles nous rendent féconds. Chaque nouveau-né est une surprise, même pour ses parents. II ne peuvent connaître d’avance la personne qu’ils font venir au monde. Il en est de même pour notre étude, qui doit nous préparer à être surpris. Le Christ vient parmi nous à chaque génération par des voies que nous n’aurions jamais pu anticiper, mais pouvons seulement, petit à petit, reconnaître comme authentiques, tout comme cela prit du temps à l’Église d’accepter la nouvelle et choquante théologie de saint Thomas. Dans les montagnes du Guatemala, les frères et les soeurs de notre centre de réflexion sur l’inculturation AK’ KUTAN de Coban, tentent d’aider l’Ordre à naître avec la richesse de la culture indigène. À Takamori, derrière le Mont Fuji, notre frère Oshida cherche à donner naissance au Christ dans le monde du Japon, ou bien il y a notre frère Michael Shirres, en Nouvelle Wande, qui se bat depuis vingt ans pour unir les fertiles semences de la spiritualité Maori à la foi chrétienne. Cela peut se passer de toutes sortes de façons non académiques. En Croatie, un de nos frères dirige un groupe de rock appe1é « Les Messagers de l’espoir ». Au Japon, j’ai vu les tableaux magnifiques de nos frères Petit et Carpentier. Ou encore ce peut être la naissance miraculeuse d’une communauté dans un village d’Haïti. Comment notre prédication peut-elle faire naître le Christ chez les drogués de New York ou dans les taudis de Londres? Comment le Verbe peut-il se faire chair dans les mots d’aujourd’hui, prendre corps dans le langage de la philosophie et de la psychologie, à travers notre prière et notre étude? C’est pour cette incarnation du Verbe de Dieu dans chaque culture que l’établissement de maisons d’études, d’excellence théologique, doit être une priorité de l’Ordre dans tous les continents.
Je voudrais montrer qu’une vie d’étude construit la communauté et prépare de la sorte un foyer pour que le Christ puisse habiter parmi nous. II n’y a pas d’expérience de désespoir plus cruelle que celle de la solitude absolue de la personne renfermée sur elle-même. Si notre société est si souvent tentée par le désespoir, c’est peut-être parce que telle est l’image dominante de l’être humain dans notre monde, l’individu solitaire à la poursuite de ses propres désirs et de possessions privées. L’individualisme radical de notre époque prend l’apparence d’une libération mais peut nous plonger dans un désespoir total et solitaire. La communauté nous offre une « écologie de l’espoir » (15). Il n’y a qu’ensemble que nous pourrons oser espérer en un monde renouvelé.
Le chercheur paraît être le parfait exemple de la figure du solitaire, seul avec ses livres ou son écran d’ordinateur, avec sur la porte un panneau demandant de « ne pas déranger ». Et c’est vrai que l’étude nous impose souvent d’être seul et de nous mesurer à des questions abstraites. Mais c’est là un service que nous offrons à nos frères et soeurs. Le fruit de ce travail solitaire est la construction de la communauté grâce à l’ouverture des mystères de la Parole de Dieu. Nous apprenons par l’étude à appartenir les uns aux autres et ainsi, à espérer.
a) La transformation de l’esprit et du coeur
Même l’image extrême de l’être totalement seul, de l’individu isolé, est récusée. Car la doctrine de la création nous montre que notre Créateur nous est plus intimement proche qu’aucun être ne le pourrait, puisqu’il est la source toujours présente de notre existence. Nous ne pouvons pas être seul, parce que, seul, nous ne pourrions même pas exister!
Il y a dans la culture occidentale une obsession de la connaissance de soi. Mais comment puis-je me connaître séparément de celui qui me porte dans mon être même? Sainte Catherine était profondément moderne lorsqu’elle invitait les frères à entrer dans la « cellule de la connaissance de soi », mais cette connaissance de soi était inséparable d’une connaissance de Dieu. « Nous ne pouvons voir ni notre dignité, ni les défauts qui souillent la beauté de notre âme, à moins de nous considérer dans l’océan paisible de l’être divin à l’image duquel nous sommes conçus. » (16) Même ces moments de désolation la plus totale, de nuit ténébreuse de l’âme, lorsqu’il nous semble être complètement abandonnés, peuvent être transfigurés en moments de rencontre: « La nuit qui réunit le bien-aimé et sa bien-aimée, la nuit transfigurant le bien-aimé, en la vie même de sa bien-aimée. » (17)
L’étude ne peut jamais se réduire à un exercice de l’esprit ; c’est la transformation du coeur humain. « Et je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. » (Ez 36,26) Le premier Chapitre Général de l’Ordre, à Bologne, disait que l’on doit enseigner aux novices « comment ils doivent être absorbés par l’étude, de sorte que jour ou nuit, chez soi ou en voyage, ils doivent toujours être en train de lire ou réfléchir à quelque chose; de toute la force de leurs moyens, ils doivent essayer d’en imprégner leur mémoire » (18). Nous laissons sans cesse nos coeurs être formés, par la lecture de journaux et de romans, par la vision de films et de la télévision. Tout ce que nous lisons et voyons forme notre coeur. Lui donnons-nous de bonnes choses pour le nourrir? Ou le façonnons-nous de violence et de banalité, nous dotant d’un coeur de pierre?
Sainte Catherine de Sienne dit de Thomas que « Avec l’oeil de son esprit, il a contemp1é, ma Vérité avec une infinie tendresse et là il a accédé, à la lumière surnaturelle » (19). L’étude nous enseigne donc la tendresse et même Thomas était un grand théologien parce qu’il avait le coeur tendre. Le frère Yves Congar a écrit un jour que sa maladie et sa paralysie croissante l’avaient conduit à devenir de plus en plus dépendant de ses frères. Il ne pouvait plus rien faire du tout sans leur aide. Il a dit: « J’ai surtout compris depuis ma maladie, et ayant toujours besoin du service de mes frères, … que ce que nous pouvons raconter et dire, aussi sublime soit-il, ne vaut pas cher si cela n’est pas accompagné d’une praxis, d’une action réelle, concrète, de service, d’amour. Je pense que j’ai un peu manqué à cela dans ma vie, j’ai été un peu trop intellectuel. » (20)
Quand Savonarole parle de la compréhension des Écritures par saint Dominique, il dit qu’elle se fondait sur la « carità », la charité. Puisque c’était l’amour de Dieu qui avait inspiré les Écritures, seule une personne aimante pouvait les comprendre: « Et vous, frères, qui voulez apprendre les Écritures, qui voulez prêcher: apprenez la charité, et elle vous instruira. En vivant la charité, vous la comprendrez. » (21)
L’étude transforme le coeur humain par sa discipline. C’est « une forme d’ascèse dans sa persévérance même et sa difficulté » (LCO 83) qui fait partie de notre croissance dans la sainteté. Elle nous offre la rude discipline de rester dans nos chambres en silence, luttant pour comprendre, alors que nous n’aspirons qu’à nous échapper. L’une des innovations de l’Ordre a justement consisté à offrir à ceux qui étaient particulièrement doués pour l’étude, la solitude d’une cellule individuelle, mais une solitude qui peut être ascèse. Lorsque nous sommes seuls, nous débattant avec un texte, nous pensons alors à cent raisons valables de nous arrêter pour aller voir quelqu’un, lui parler. Nous nous convaincrons bien vite que nous devons absolument le faire et que continuer à étudier serait trahir notre vocation et un devoir chrétien! Et pourtant, à moins de supporter cette solitude et ce silence, nous n’aurons rien de bon à offrir. Dans la « Lettre au Frère Jean », on nous dit: « Aime ta cellule, sers t’en sans cesse, si tu veux être admis dans la cave à vin » (22), c’est-à-dire, de toute évidence, l’idée du paradis pour les novices du XIIIe siècle! Une longue étude est en effet inévitablement fastidieuse. Apprendre à lire l’Hébreu ou le Grec est une chose difficile et un travail pénible. Souvent nous nous demanderons même s’il en vaut la peine. C’est justement un acte d’espérance, l’espérance que ce travail portera des fruits tels que nous ne pouvons encore les imaginer.
b) L’étude et la construction de la communauté dans l’Ordre
Étudier ne doit pas seulement ouvrir nos coeurs aux autres, mais nous introduire à une communauté. Étudier, c’est entrer dans une conversation, avec ses frères et ses soeurs et avec les autres êtres humains, dans notre recherche de la vérité qui nous libérera tous. Albert le Grand décrit le plaisir de rechercher ensemble la vérité: « in dulcedine societatis quaerens veritatem » (23).
Les universitaires reflètent souvent les valeurs de notre société. Une grande part de la vie académique est basée sur la production et la compétition, comme si nous fabriquions des voitures au lieu de chercher à atteindre la sagesse. Les universités peuvent être comme des usines. Des articles doivent sortir en masse de la ligne de production, et les rivaux et les ennemis doivent être exterminés. Cependant, nous ne pourrons jamais dire de parole lumineuse sur Dieu si nous ne faisons pas une théologie différente, sans compétition et avec respect. On ne peut faire de théologie seul. Pas seulement parce que personne aujourd’hui ne serait capable de maîtriser toutes les disciplines, mais parce que la compréhension de la Parole de Dieu est inséparable de la construction d’une communauté. Une large partie de la préparation du Concile Vatican II fut menée par une communauté de frères au Saulchoir, en particulier Congar, Chenu et Feret, qui travaillèrent ensemble et partagèrent leurs découvertes.
On raconte que Thomas, un jour qu’il mangeait avec le Roi de France, frappa du poing sur la table en s’écriant: « Voilà qui fait taire les Manichéens! » Cela peut suggérer qu’il n’accordait guére d’attention aux autres invités, mais montre aussi que la théologie peut être un combat. Nous ne pouvons construire de communauté si nous n’osons débattre les uns avec les autres. Je dois souligner, comme bien souvent, l’importance du débat, de la discussion, de l’effort pour comprendre. Mais on se bat avec son contradicteur, comme Jacob lutte avec l’ange, pour réclamer une bénédiction. On discute avec son contradicteur parce qu’on espère en recevoir ce qu’il ou elle peut apporter. On lutte afin que la vérité puisse triompher. C’est par une sorte d’humilité que nous devons discuter. L’autre a toujours quelque chose à nous apprendre et nous l’affrontons pour recevoir ce don.
L’un des souvenirs les plus forts de mon année à Paris est celui du frère Marie-Dominique Chenu, le maître toujours avide d’apprendre de tous ceux qu’il rencontrait, même d’un ignorant jeune dominicain anglais! Souvent, tard dans la soirée, il rentrait d’une réunion avec des évêques, des étudiants, des syndicalistes, des artistes, heureux de vous raconter ce qu’il avait appris et de vous demander ce que vous aviez appris ce jour là. Le véritable enseignant est toujours humble. Jourdain de Saxe disait que Dominique comprenait tout, « humili cordis intelligentia » (24), grâce à l’humble intelligence de son coeur. Le coeur de chair est humble, mais le coeur de pierre est impénétrable.
La théologie n’est pas uniquement ce qui se fait dans les centres d’études. C’est le moment de l’illumination, de la nouvelle vision, où la Parole de Dieu rencontre notre expérience ordinaire, quotidienne, de tentative d’être humain, de péché et d’échec, d’essai de construire une communauté humaine et de faire un monde juste. Tout le monde de l’étude, les experts de la Bible, les érudits en patristique, les philosophes et les psychologues viennent aider à rendre cette conversation fertile et vraie. La bonne théologie existe quand, par exemple, le spécialiste des Écritures aide le frère engagé dans un travail pastoral à comprendre son experience, et quand le frère qui a une expérience pastorale aide le spécialiste à comprendre la Parole de Dieu. La reprise de notre tradition théologique exige non seulement que nous formions davantage de frères dans les diverses disciplines, mais que nous faisions la théologie ensemble. À moins de bâtir nos Provinces comme des communautés théologiques, notre étude risque de devenir stérile et notre travail pastoral superficiel. Une grande part du travail de Thomas consistait à répondre aux questions des frères, même aux questions un peu folles du Maître de l’Ordre!
Où faisons-nous de la théologie? Nous avons besoin des grandes facultés de théologie et des bibliothèques. Mais nous avons aussi besoin de centres où la théologie est faite dans d’autres contextes, avec ceux qui se battent pour la justice, dans le dialogue avec les autres religions, dans les quartiers déshérités et les hôpitaux. Tout particulièrement à ce moment de la vie de l’Église, une véritable étude implique la construction d’une communauté entre les hommes et les femmes. Une théologie naissant uniquement de l’expérience masculine claudiquerait sur une jambe, ne respirerait qu’avec un poumon. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui nous devons faire une théologie avec la Famille dominicaine, en écoutant nos idées les uns les autres, en bâtissant une théologie véritablement humaine. Comme Dieu le dit à sainte Catherine de Sienne: « J’aurais bien pu créer les êtres humains de façon que chacun ait tout, mais j’ai préféré accorder des dons différents à des personnes différentes, afin que tous aient besoin les uns des autres. » (25)
Toutes les communautés humaines sont vulnérables, susceptibles de se dissoudre et demandent constamment à être consolidées et entretenues. L’une des voies que nous utilisons pour faire et refaire la communauté ensemble passe par les mots que nous nous disons les uns aux autres. Comme serviteurs de Dieu, nous devrions être profondément conscients du pouvoir de nos mots, pouvoir de guérir ou de blesser, de construire ou de détruire. Dieu a dit une parole, et le monde a existé, et maintenant Dieu dit la Parole qui est Son Fils, et nous sommes rachetés. Nos propres paroles partagent ce pouvoir. Au coeur de toute notre éducation et notre étude doit se trouver un profond respect pour le langage, une sensibilité aux mots que nous offrons à nos frères et soeurs. Par nos paroles, nous pouvons apporter la résurrection ou la crucifixion, et les mots que nous prononçons sont souvent gardés dans la mémoire, dans le coeur de nos frères, y sont réfléchis, retournés, pour le bien ou pour le mal, pendant des années. Un mot peut tuer.
Notre étude doit nous éduquer dans la responsabilité, la responsabilité des mots que nous utilisons. Responsabilité dans le sens où ce que nous disons répond à la vérité, correspond à la réalité. Mais aussi, nous avons la responsabilité de dire les mots qui construisent une communauté, qui nourrissent les autres, qui guérissent les blessures et offrent la vie. Saint Paul, en prison, écrivit aux Philippiens: « Enfin, frères, tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d’aimable, d’honorable, tout ce qu’il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper. » (4,8)
c) L’étude et la construction d’un monde juste
Notre monde a vu triompher un système économique unique. Il est devenu difficile de lui imaginer une alternative. La tentation de notre génération pourrait consister à nous résigner aux souffrances et aux injustices de notre temps et à cesser d’aspirer à un monde reconstruit sur du neuf. Mais nous, prêcheurs, devons être les gardiens de l’espérance. On nous a promis la liberté des enfants de Dieu, et Dieu sera fidèle à sa Parole. À San Sisto, il y a un portrait de saint Dominique à l’étude, un chien à ses pieds tenant une bougie. À l’arrière plan, un autre dominicain chasse un chien avec un bâton. L’inscription nous dit que Dominique ne s’opposait pas au diable par la violence mais par l’étude! Notre étude nous prépare à prononcer une parole libératrice. Et elle le fait en nous enseignant la miséricorde, en nous montrant que Dieu est présent même au milieu des souffrances et c’est là que nous devons forger notre théologie. Elle nous propose une discipline intellectuelle qui prépare nos oreilles à l’écoute de Dieu qui nous appelle à la liberté.
Felicissimo Martinez a décrit un jour la spiritualité dominicaine comme ayant « les yeux ouverts ». Et lors du Chapitre Général de Caleruega, Chrys McVey a commenté: « Dominique était ému aux larmes — et poussé à agir — par la famine à Palencia, par 1’aubergiste à Toulouse, par l’état de certaines femmes à Fanjeaux. Mais cela ne suffit pas pour expliquer ses larmes. Elles coulaient de la discipline d’une spiritualité aux yeux ouverts qui ne laissait rien passer. Vérité est la devise de l’Ordre — non pas sa défense (ainsi qu’on le comprend souvent), mais plutôt sa perception. Et garder les yeux ouverts pour ne rien laisser passer, cela peut rendre les yeux très vifs. » Notre étude doit être une discipline d’authenticité qui ouvre les yeux. Comme le dit saint Paul: « Rendez-vous à l’évidence ». » (2 Co 10,7)
C’est douloureux de regarder ce qui se passe sous nos yeux. Il est plus facile d’avoir un coeur de pierre. Assez souvent, je suis allé en des endroits que j’aurais aimé oublier, des salles d’hôpital remplies de jeunes Rwandais aux membres amputés, les rues de Calcutta pleines de mendiants. Comment peut-on supporter de voir tant de misère? Et pourtant nous devons obéir au commandement de Paul de nous rendre à l’évidence et de voir un monde torturé.
Les livres que nous lisons doivent forcer nos coeurs à s’ouvrir. Franz Kafka écrivait: « Je pense que nous ne devrions lire que le type de livres qui nous blessent et nous déchirent… nous avons besoin des livres qui nous atteignent comme une catastrophe, qui nous affligent profondément, comme la mort de quelqu’un que nous aimons plus que nous-mêmes, comme d’être exilés dans les forêts loin de tous, comme un suicide. Un livre doit être la hache brisant la mer de glace au fond de nous. » (26)
Mais il ne suffit pas encore de regarder ces lieux de la souffrance humaine, et de nous contenter d’être les touristes de la crucifixion du monde. Car ce sont là les lieux où doit être faite la théologie. C’est en ces lieux de calvaire que l’on peut rencontrer Dieu et découvrir un nouveau monde d’espérance. Que l’on songe, de la plus grande théologie, combien fut écrite en prison, depuis l’épitre de saint Paul aux Philippiens, les poèmes de saint Jean de la Croix, jusqu’aux lettres de Dietrich Bonhoeffer dans un camp de concentration nazi. Nous sommes, dit saint Jean de la Croix, comme des dauphins qui plongent au sein des sombres ténébres de la mer avant d’émerger à l’éclat de la lumière. Un camp de réfugiés à Goma ou un lit dans un pavillon de cancéreux: voici où l’on peut découvrir la théologie qui fait naître l’espérance.
Ce n’est pas seulement dans les situations d’inquiétude extrême que l’on peut rencontrer Dieu. Vincent de Couesnongle a écrit: « Il ne peut y avoir aucune espérance sans air frais, sans oxygène ou sans un regard nouveau. Il ne peut y avoir aucune espérance dans une atmosphère confinée. » (27) Notre théologie est depuis ses débuts une théologie de la cité et des places de marché. Saint Dominique envoya ses frères dans les villes, lieux des idées nouvelles, des nouvelles expériences sur l’organisation de l’économie et la démocratie, mais aussi lieux où s’entassaient les nouveaux pauvres. Osons-nous nous laisser déranger par les questions de la ville moderne? Quelle parole d’espoir peut-on partager avec les jeunes confrontés au chômage pour le reste de leur vie? Comment découvrir Dieu dans la souffrance d’une mère célibataire ou d’un immigrant terrorisé? Ils sont eux aussi des lieux de réflexion théologique. Qu’avons-nous à dire à un monde en passe de se stériliser dans sa pollution? Nous laisserons-nous interpeller par les questions des jeunes et pénétrer dans les terrains minés des problèmes moraux comme par exemple l’éthique sexuelle, ou préférons-nous rester en sécurité?
Dès lors, nous devons oser voir ce qui est sous nos yeux; nous devons croire que c’est lorsque Dieu semble le plus loin et quand les êtres humains sont tentés par le désespoir que la théologie doit intervenir. Mais, bien sûr, en tant que dominicains, nous devons poser une troisième exigence. Nos paroles d’espérance n’auront d’autorité que si elles se fondent dans une étude sérieuse de la Parole de Dieu et dans une analyse de notre société actuelle. En 1511, Montesinos prêcha son fameux sermon contre l’oppression des Indiens et posa la question: « Ne sont-ils pas des êtres humains? N’ont-ils pas une âme raisonnable? N’êtes-vous pas obligés de les aimer comme vous vous aimez vous-mêmes? Ne comprenez-vous pas cela? Ne saisissez-vous pas cela? » Montesino invitait ainsi ses contemporains à ouvrir les yeux, et à voir alors le monde différemment. Pour faire la clarté, la compassion ne suffit pas. Il a fallu une étude rigoureuse pour voir à travers les fausses mythologies des conquistadors, et c’est elle qui fut la source de la position prophétique de Las Casas.
Chenu commentait: « II est extrêmement suggestif de constater la rencontre de la doctrine spéculative de ce premier grand maître du droit international (à l’heure où naissent les nations hors du mythe du Saint Empire) avec l’évangélisme de Las Casas. Le théologien en Vittoria couvre le prophète. » (28). Il ne suffit pas de s’indigner des injustices de ce monde. Nos paroles n’auront d’autorité que si elles se fondent dans une sérieuse analyse économique et politique des causes de l’injustice. Saint Antoine s’est colleté aux problèmes d’un nouvel ordre économique dans la Florence de la Renaissance, et dans notre siècle, Lebret a analysé les problèmes de la nouvelle économie. Si nous voulons résister à la tentation des clichés faciles, alors nous avons besoin de frères et de soeurs formés à l’analyse scientifique, sociale, politique et économique.
La construction d’une société juste ne requiert pas seulement une distribution équitable des richesses. Il nous faut bâtir une société dans laquelle nous puissions tous nous épanouir comme êtres humains. Notre monde se voit réduit à un désert culturel par le triomphe du consumérisme. La pauvreté culturelle de cette perception dominante de la personne humaine ravage le monde entier, et « le peuple périt faute de vision » (Pr 29,18) (29). Il n’y a pas qu’un appétit de nourriture, mais de sens. Comme le disait le Chapitre d’Oakland, « c’est faire acte de justice que d’intervenir pour dire la vérité » (109). Saint Basile le Grand dit que si nous avons des vêtements en trop, ils appartiennent aux pauvres. L’un des trésors que nous possédons et que devraient protéger et faire partager nos centres d’études, c’est la poésie, l’histoire des gens, la musique, la sagesse populaire. Tout cela est une richesse pour la construction d’un monde humain.
Être un prophète n’est pas une raison de ne pas étudier les Écritures. Nous méditons la Parole de Dieu, pour chercher à connaître Sa volonté et non pour trouver des preuves que Dieu est de notre côté. II est facile d’utiliser les Écritures comme livre source de slogans faciles, mais l’étude de la Parole de Dieu est la recherche d’une libération plus profonde que nous ne saurions l’imaginer. Par la discipline de l’étude, nous cherchons à saisir l’écho d’une voix qui nous appelle à une liberté ineffable, la liberté même de Dieu. Lorsque Lagrange affrontait les problèmes posés par la critique historique, il cita les mots de saint Jérôme: « Sciens et prudens, manum misi in ignem. » (30) (C’est en toute connaissance de cause que j’ai plongé la main dans le brasier). Conscient que cela pouvait lui coûter souffrance et douleur, il a plongé sa main dans le feu. L’engagement de Lagrange dans les nouvelles disciplines intellectuelles de son temps était un véritable signe de confiance que la Parole de Dieu apparaîtrait avec évidence comme une parole libératrice, et que nous n’avions pas à craindre de passer par le doute et le questionnement. Il soumit la Parole de Dieu à une analyse rigoureuse parce qu’il croyait qu’elle se montrerait impossible à dominer. Osons-nous partager son courage? Osons-nous plonger nos mains dans le feu, ou préférons-nous ne pas être dérangés?
LE DON D’UN AVENIR
- « Il sera grand, et sera appe1é Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n’aura pas de fin » Mais Marie dit à l’ange: « Mais comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme? » (Luc 1,32-34)
Comment cela se peut-il? Comment une vierge peut-elle donner le jour à un enfant? Comment une femme de cette petite colonie sans importance de l’Empire romain peut-elle donner naissance au Sauveur du monde? Qui eût pu deviner que l’histoire de ce peuple portait la semence d’un pareil avenir? Il y a deux mille ans, il semblait que la lignée de David allait s’éteindre, mais contre toute attente, il lui fut donné un fils pour s’asseoir sur son trône.
La plupart de nos études concernent le passé. Nous étudions l’histoire du peuple d’Israël, l’évolution de la Bible, l’histoire de l’Église, de l’Ordre, et même de la philosophie. Nous apprenons sur le passé. Au coeur de l’étude se trouve l’acquisition d’une mémoire. Mais ce n’est pas pour que nous puissions accumuler les connaissances. Nous étudions le passé pour y découvrir les semences d’un inimaginable avenir. Exactement comme une femme vierge ou stérile devient enceinte d’un enfant, de même notre monde apparemment stérile se découvre porteur de possibilités dont il n’avait jamais rêvé, celles du Royaume de Dieu.
« L’Histoire fait plus qu’aucune autre discipline pour libérer l’esprit de la tyrannie de l’opinion actuelle. » (31) L’histoire nous montre que les choses n’ont aucune nécessité d’être ce qu’elles sont, et que l’histoire peut déboucher sur un avenir inattendu. Nous découvrons, dans les paroles de Congar, qu’il n’y a pas uniquement la Tradition, mais une multitude de traditions qui révèlent des richesses que nous n’avions jamais rêvées. Le Concile Vatican II fut le moment d’un nouveau départ parce qu’il racontait à nouveau le passé. Nous avons été ramenés avant les divisions de la Réforme, avant le Moyen-Âge, pour redécouvrir un sens de Église antérieur aux divisions entre l’est et l’ouest. Ce fut donc un souvenir qui nous rendit libres pour de nouvelles choses.
L’Histoire nous fait pénétrer dans une communauté qui s’étend au delà de ceux seuls qui se trouvent être vivants aujourd’hui. Nous découvrons que nous sommes membres de la communauté des saints et de la communauté de nos ancêtres. Il ont eux aussi voix à nos délibérations. Nous mesurons nos idées à l’aune de leur témoignage, et ils nous invitent à une vision plus large que celle que nous pourrions apercevoir dans les étroites limites de notre propre temps.
Redire à nouveau l’histoire ne nous libère pas uniquement de l’opinion actuelle, mais des « princes de ce monde » (1 Co 2,8). L’histoire est normalement racontée du point de vue du vainqueur, du fort, de ceux qui construisent les empires, et l’histoire qu’ils racontent les confirment en leur pouvoir. Nous devons apprendre à dire l’histoire d’un autre point de vue, du côté du petit et de l’oublié, et c’est une histoire qui nous libère. C’est pour cela que se souvenir est un acte religieux, l’acte religieux primordial de la tradition judéo-chrétienne. Lorsque nous nous rassemblons pour prier Dieu, nous « (nous rappelons) quelles merveilles Il a faites » (Ps 105,5).
En fin de compte, nous sommes ramenés au souvenir d’un peuple petit et apparemment insignifiant, le peuple d’Israël. Nous racontons l’histoire, non pas du point de vue des grands empires, des Égyptiens ou des Assyriens, des Persans, des Grecs ou des Romains, mais d’un petit peuple dont l’histoire était à peine mentionnée dans les livres des grands et des puissants, dont l’histoire, pourtant, portait en elle la naissance du Fils du Très-Haut. Et l’histoire dans laquelle nous nous découvrons, est finalement celle d’une vierge qui entend le message de l’ange et celle d’un homme qui a été cloué sur une croix, dans une infinité de croix, un homme dont l’histoire fut celle de l’échec. Voilà quelle histoire nous rappelons à chaque Eucharistie. Dans cette histoire, nous apprenons à raconter l’histoire de l’humanité et c’est une histoire qui ne s’achève pas sur la croix.
Osons-nous raconter l’histoire de l’Église, et même celle de l’Ordre avec ce courage? Osons-nous raconter une histoire de l’Église qui soit libérée de tout triomphalisme et arrogance, et qui reconnaisse les moments de division et de péché? Sûrement, la Bonne Nouvelle, le fondement de notre espérance, c’est que Dieu a accepté comme Son peuple, précisément un peuple si faillible, si querelleur. Si souvent, lorsque nous apprenons l’histoire dominicaine, on nous parle des gloires du passé. Osons-nous raconter les échecs, les conflits? Le précédent archiviste de l’Ordre, Emilio Panella, o.p., a écrit une étude (32) sur ce que les chroniques ne racontent pas, ce qu’elles ont omis. Cette histoire nous donne en fin de compte davantage d’espoir et de confiance puisqu’elle montre que Dieu travaille toujours avec « des vases d’argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous » (2 Co 4,7). Il peut même accomplir quelque chose à travers nous. Au Chapitre Général de Mexico, nous avons osé nous souvenir du cinquième centenaire de notre arrivée aux Amériques. Nous nous sommes souvenu non seulement des hauts faits de nos frères, de Las Casas et Montesino, mais aussi des silences et des défaites d’autres. Mais ils sont tous nos frères. Avant tout, nous nous sommes souvenus de ceux qui furent réduits au silence ou voués à la disparition. Nous nous sommes souvenus pour espérer en un monde plus juste.
Il y a des souvenirs difficile à supporter, Dachau, Auschwitz, Hiroshima et le bombardement de Dresde. Il y a des actes si terribles que nous préférerions les oublier. Quelle histoire raconter qui puisse soutenir toute cette souffrance? Et pourtant, à Auschwitz, le monument aux morts dit: « Ô terre, ne recouvre pas leur sang. » Peut-être pouvons-nous oser nous souvenir et raconter le passé en vérité, si nous nous souvenons de Celui qui a embrassé sa mort, qui s’est offert a ceux qui l’avaient trahi, qui a fait de sa passion un don et une communion. En ce souvenir, nous osons espérer. Nous pouvons comprendre que « l’histoire n’est pas en fin de compte aux mains du tueur. Le mort peut être nommé; le passé doit être connu. En nommant, en connaissant, c’est à la rencontre de Dieu que l’on va, et en Dieu réside la possibilité pour nous d’un monde différent, une libération du pouvoir, une voix pour le muet » (33). « Car le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espoir des malheureux ne périt pas à jamais. » (Ps 9,19)
Saint Dominique allait en chantant par les campagnes, ce n’était pas seulement parce qu’il était courageux, et qu’il avait un tempérament joyeux. Des années d’étude lui avaient donné un coeur formé à espérer. Étudions afin de partager sa joie.
- « History says, Don’t hope On this side of the grave: But then, once in a lifetime The longed-for tidal wave Of justice can rise up, And hope and history rhyme. So hope for a great sea-change On the far side of revenge. Believe that a further shore Is reachable from here. » (34)
- (« L’histoire dit: n’espère rien de ce côté-ci de la tombe. Mais, une fois au cours d’une vie, le raz-de-marée si ardemment désiré de la justice peut s’élever, et l’espoir rimer avec l’histoire. Alors espère en un grand retour des eaux de l’autre côte de la vengeance. Crois qu’un autre rivage est encore à ta portée.
Frère Timothy Radcliffe, o.p.
Maître de l’Ordre
Fête de la Présentation de Notre-Dame
21 novembre 1995
Prot. : 50/95/1885MO
Notes
1 Cecilia Miracula B. Dominici, 15 Archivium Fratrum Praedicatorum XXXVII, Rome 1967, pp. 5 ff.
2 Procès de Canonisation n° 29.
3 Simone Weil, Attente de Dieu, éditions du Vieux Colombier, Paris, 1950, p. 114.
4 B. Montagnes, Le Père Lagrange, Cerf, Paris, 1995, p. 57.
5 Thomas de Chantrimpé.
6 Cornelius Ernst op, Multiple Echo, ed. Fergus Kerr op and Timothy Radcliffe op, London, 1979 p. 1.
7 Dante, Inferno, Canto 1, 40.
8 Simone Weil, op. cit., p. II 8.
9 Métaphysique III, lec. 3.
10 Bernard Montagnes, Le Père Lagrange, Cerf, Paris, 1995, p. 54.
11 Somme Théologique I a 12 xiii ad 1. cf Caleruega 32. Ce texte a provoqué l’un des débats les plus passionnants du Chapitre. Comme c’était bon de voir les frères débattre de théologie!
12 Confessions III 6.
13 God Matters, London, 1987, p. 241.
14 Reflections on the Beatitudes, London, 1979, p. 100.
15 Jonathan Sachs, Faith in the Future, London, 1995, p. 5.
16 Lettre 226, Catherine of Siena, Passion for truth, Compassion for Humanity, ed. Mary O’Driscoll op, New York, 1993, p. 26.
17 Saint Jean de la Croix, Canciones de Alma 5.
18 Constitutions Primitives 1 13.
19 Mary O’Driscoll op, ibid., p. 127.
20 Allocution du frère Congar, en remerciement à la Remise du Prix de l’Unité Chrétienne, le 24 novembre 1984.
21 Dalle Prediche di fra Gerolamo Savonarola, ed. L. Ferretti, in Memorie Domenicane XXVII 1910.
22 De Modo Studenti.
23 In Libr. viii Politicorum.
24 Libellus 7.
25 Dialogue 7.
26 Lettre à Oskar Pollak, 27 janvier 1904.
27 Vincent de Couesnongle, Le Courage du Futur, ch. 8.
28 M.-D. Chenu, « Prophètes et Théologiens dans l’Église, Parole de Dieu » in La Parole de Dieu 11, Paris, 1964, p. 211.
29 Voir le Jamaican National Anthem.
30 Ibid., p. 85.
31 Owen Chadwick, Origins, 1985, p. 85.
32 « Quel che la Cronica Conventuale non dice » in Memorie Domenicane 18, 1987, 227-235.
33 Rowan Williams, Open Judgement, London, 1994, p. 242.
34 Seamus Heaney, The Cure at Troy: Version of Sophocleses’ Philocpetes, London, 1990.
L'identité des religieux aujourd'hui (1996)
Conférence donnée le 8 août 1996, lors de l’assemblée de la Conférence des supérieurs majeurs des États-Unis à Arlington
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 Il y a bien des années, je m’en souviens, je m’étais rendu pour la première fois à l’Assemblée des supérieurs majeurs d’Angleterre et du pays de Galles. Un peu nerveux, j’endossai mon habit religieux et descendis affronter la foule. Et voilà que, sur le palier, je fus stoppé par une religieuse à l’aspect revêche que je n’avais jamais rencontrée auparavant. Elle me dévisagea d’un oeil torve et me dit: » Il faut vraiment que vous soyez bien peu sûr de vous pour que vous vous mettiez ça sur le dos! «
Il y a bien des années, je m’en souviens, je m’étais rendu pour la première fois à l’Assemblée des supérieurs majeurs d’Angleterre et du pays de Galles. Un peu nerveux, j’endossai mon habit religieux et descendis affronter la foule. Et voilà que, sur le palier, je fus stoppé par une religieuse à l’aspect revêche que je n’avais jamais rencontrée auparavant. Elle me dévisagea d’un oeil torve et me dit: » Il faut vraiment que vous soyez bien peu sûr de vous pour que vous vous mettiez ça sur le dos! «
Où sont parties toutes les vocations ?
Il y a belle lurette que nous, religieux, nous nous interrogeons sur notre identité. Qui sommes-nous ? Comment nous insérons-nous dans le tissu et la structure de l’Église ? Sommes-nous des clercs, des laïcs ou des hybrides à part ?
Il me semble que nous n’obtiendrons aucune réponse valable si nous ne partons pas du fait que nous partageons avec la plupart des hommes de notre époque une crise d’identité. Qu’est-ce qui nous différencie ? Eh bien, certainement pas l’absence de crise d’identité. Tel est le lot commun que nous partageons avec les autres. Cette crise ne vaut la peine qu’on y réfléchisse que dans la mesure où elle nous aide à vivre la Bonne Nouvelle pour toutes ces âmes inquiètes, hantées par la même question: qui suis-je ?
Veuillez me pardonner si je partage avec vous quelques observations des plus simplistes sur la question suivante: pour quelle raison le problème de l’identité est-il une obsession de la modernité ? En ce siècle, et tout particulièrement depuis 1945, nous avons été les témoins d’une profonde transformation sociale. En Europe – et aussi sans doute aux ÉtatsUnis -, nous avons assisté à l’affaiblissement de toutes les formes d’institutions qui donnaient une identité, définissaient une profession, un rôle, une vocation. Les universités, les professions médicales ou juridiques, les syndicats, les Églises, la presse, les différents métiers, toutes ces institutions ne fournissaient pas seulement des moyens pour gagner sa vie, un métier à exercer, mais aussi une manière d’être un homme, un sentiment de vocation. Être musicien, avocat, enseignant, infirmière, charpentier, plombier, agriculteur, prêtre, etc., ce n’était pas seulement avoir une profession; c’était être quelqu’un. On appartenait à une corporation dotée d’institutions qui définissaient un comportement approprié, on partageait une sagesse, une histoire, une solidarité.
Ce que nous avons pu constater au cours de ces dernières années, c’est l’aspect corrosif d’un modèle nouveau, plus simple, de société. En effet, nous nous sommes tous trouvés membres du marché global, achetant et vendant, achetés et vendus. Les institutions fondamentales de la société civile qui soutenaient les professions ou les vocations ont beaucoup perdu de leur autorité et de leur indépendance. Comme tout le reste, elles doivent courber la tête devant les impératifs du marché.
Quel choix faire de sa propre vie ? Cela est devenu de moins en moins clair au fil des années. Il fallait répondre aux exigences de l’offre et de la demande. Ce n’était pas seulement nous, religieux, qui perdions le sens de la vocation c’était l’idée même de vocation qui posait problème. Nicholas Boyle, philosophe anglais, a écrit: » Il n’y a plus de vocations pour qui que ce soit; la société n’est pas constituée de gens qui engagent leur vie de telle ou telle manière, mais de fonctions qui doivent être remplies dans la mesure où il y a un désir à satisfaire. » (Understanding Thatcherism, New Blackfriars, p. 320.)
Toutes ces professions, ces métiers, ces savoir-faire, étaient comme de petits écosystèmes qui offraient des manières différentes d’être un être humain. Ces écosystèmes se sont affaiblis, se sont écroulés, comme les fragiles habitats des crapauds ou des escargots. La société est en voie d’homogénéisation. Tout ce qui subsiste, c’est l’individu et l’État, voire la consommation et le marché. C’est plus simple, mais plus solitaire, plus vulnérable.
Dans l’Église, je le crains, nous avons reçu de plein fouet ce même vent glacé, qui nous a laissés avec une communauté plus simple, mais aussi moins sûre d’elle-même. L’Église, en effet, fait partie de la société civile. Nous avons été les témoins d’une société complexe avec toutes sortes d’institutions qui nous procuraient une identité. Nous aussi, nous avions des universités, des écoles, des professions et, par-dessus tout, des ordres religieux qui proposaient aux gens des vocations, des identités respectées et honorées.
L’Église avait toutes sortes de hiérarchies et de structures qui se contrebalançaient les unes les autres. Une mère supérieure ou une directrice d’école catholique, c’était une personne avec laquelle il fallait compter. Les prêtres tremblaient lorsqu’ils sonnaient à leur porte. Mais, d’une certaine façon, notre Église a subi la même transformation que le reste de la société. Ce qui nous est resté, ce n’est pas le consommateur individuel, l’État ou le marché, mais le croyant individuel et la hiérarchie. Nous avons perdu confiance dans les autres identités. Et c’est là sans doute l’une des raisons pour laquelle le problème du sacerdoce et de l’aspirant à la prêtrise est une question si grave pour nous. Pour la raison que, si vous ne pouvez pas mettre un pied sur cette échelle, vous ne pouvez devenir une personne de quelque importance.
Nous, religieux, qui sommes-nous ? Comment nous insérons-nous dans le tissu et la structure de l’Église ? Souvent, nous tentons d’y répondre en nous situant par rapport à la hiérarchie. Sommes-nous des laïcs ou des clercs, ou bien nous insérons-nous quelque part entre les deux ? Ou bien nous pouvons répondre en nous plaçant face à la hiérarchie, comme des individus serrant les poings contre » l’Église institutionnelle « . Mais ce n’est pas la carte qui convient. C’est comme si on cherchait les montagnes Rocheuses sur une carte qui donne les frontières des États américains. Sontelles dans le Colorado ou dans le Wyoming ? Pourquoi ne pouvons-nous voir les montagnes ?
Cette carte de l’Église qu’est la hiérarchie est bonne et valable. Nous y figurons tous d’une manière ou d’une autre. Certains religieux sont des laïcs, certains sont prêtres, et certains sont même évêques! Mais nous ne pouvons recourir à cette carte pour situer la vie religieuse. Elle ne montre pas qui nous sommes vraiment, tout comme les Rocheuses ne figurent pas sur une carte qui présente les frontières des États. Et on ne peut même pas y trouver d’indices sur leur emplacement. Là où il n’y a pas de villes, il pourrait y avoir aussi des montagnes. Il faut donc un autre genre de cartes si on veut voir clairement les montagnes.
Bien souvent, les gens se plaignent de la cléricalisation de l’Église. Il semble paradoxal qu’à Vatican II nous ayons proclamé une autre théologie de l’Eglise. Nous avions découvert une nouvelle théologie du laïcat: nous étions tous membres du peuple de Dieu en pèlerinage vers le Royaume. Mais, en fait, l’Église a donné l’impression de devenir de plus en plus cléricale.
Au lieu d’attribuer ce phénomène à un sinistre complot, il faut, me semble-t-il, le mettre au compte de la profonde transformation de la culture occidentale. Dans un monde de marché global, il n’y a pas de véritable place pour des gens qui ont une vocation, qu’il s’agisse d’enseignants, d’infirmières ou de religieux. Un emploi n’est qu’une réponse à la demande. Et lorsque l’Église catholique est entrée à grand fracas dans le monde moderne, quand Jean XXIII a ouvert toutes grandes les fenêtres, un vent froid a balayé, dans l’Église aussi, toutes les formes d’identités fragiles des vocations.
Face à la cléricalisation de l’Église, il y a bien sûr des mesures qui peuvent être prises pour assurer des postes d’influence aux laïcs et aux femmes, desserrer la prédominance d’une caste cléricale. Mais c’est là le sujet d’une autre conférence. Ce que je voudrais dire ici, c’est ceci: ce serait une erreur de penser que la réponse à notre crise d’identité serait d’abolir toute hiérarchie et de préconiser une Église qui ressemblerait davantage à notre société libérale, individualiste. Cela ne nous donnerait pas ce que nous recherchons. Ce que nous pouvons voir dans notre propre société, dans les rues de nos grandes cités sauvages, c’est que cet individualisme est cruel. Il crée des déserts urbains où bien peu de gens peuvent s’épanouir.
Une anthropologue, Mary Douglas, affirme même que la situation des femmes, par exemple, serait encore pire dans une société plus individualiste. » Les processus de l’individualisme, écrit-elle, écrasent ceux qui échouent sur le plan économique et ne peuvent que créer des laissés-pour-compte ou des mendiants. Les membres de la culture individualiste n’ont pas conscience de leur comportement d’exclusion. La situation des personnes exclues de manière non intentionnelle, par exemple des clochards dormant dans les rues, choque les visiteurs provenant d’autres cultures. » (In the Wilderness: The Doctrine of Defilement in the Book of Numbers, Sheffield, 1993, p. 46.)
Selon Mary Douglas, une société saine est une société dotée de toutes sortes de structures et d’institutions qui se contrebalancent, donnant la parole aux différents groupes, de telle sorte qu’aucune manière d’être homme ne domine et qu’aucune carte unique ne vienne nous dire comment sont les choses. Ce dont nous avons peut-être besoin, c’est de ne pas reproduire le désert homogénéisé du monde de la consommation, mais d’être plus semblables à une forêt tropicale possédant de multiples niches écologiques pour les manières différentes d’être un homme.
En ce sens, nous avons besoin, non pas de moins de hiérarchie, mais de plus de hiérarchie. Il nous faut des tas d’institutions et de structures qui donnent voix et autorité aux différentes manières d’être membres du peuple de Dieu comme femmes, couples mariés, universitaires, médecins, religieux. Au Moyen Âge, il en était davantage ainsi. L’empereur et la noblesse, les grandes abbayes de femmes et d’hommes, les universités et les ordres religieux, tout cela fournissait des foyers alternatifs de pouvoir et d’identité. On disposait de cartes plus nombreuses où les gens pouvaient se retrouver.
J’ai lu autrefois chez le cardinal Newman – mais je n’ai pas pu retrouver le passage – que l’Église est florissante quand nous reconnaissons différentes formes d’autorité. Il nomme spécifiquement la tradition, la raison et l’expérience. Chacune d’entre elles exige le respect et a besoin d’institutions et de structures pour la soutenir: la tradition est sauvegardée par les évêques, la raison par l’Université, et l’expérience par tous les types d’institution, depuis les ordres religieux jusqu’à la vie conjugale, là où les gens entendent la Parole et y réfléchissent dans leur vie.
Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas de l’individualisme du désert urbain moderne, mais de quelque chose qui ressemble davantage à une forêt tropicale avec toutes sortes de niches écologiques pour des animaux étranges qui peuvent prospérer, se multiplier et louer Dieu dans des centaines de voies différentes.
Nous, religieux, qui sommes-nous et quelle est notre vocation dans l’Église ? La réponse à cette question est d’importance. Mais non pas seulement parce qu’elle pourrait nous donner la confiance pour aller de l’avant ou même attirer de nouvelles vocations. Elle est importante parce que, pour l’aborder, nous devons réfléchir à cette crise d’identité qui afflige la plupart des gens aujourd’hui. Nul n’est créé par Dieu pour être uniquement un consommateur ou un travailleur, pour être acheté et vendu sur la place du marché comme un esclave. Si nous pouvons retrouver confiance en notre vocation, alors nous serons peut-être capables de manifester quelque chose de la vocation humaine. Le problème que nous devons affronter concerne la signification même de l’être humain.
J’ai lu l’autre jour l’histoire d’un jeune Américain appelé Jimmy, qui a connu des ennuis parce que sa famille et luimême insistaient sur son droit à porter des boucles d’oreilles dans son école. Et ils se fondaient sur le principe que » toute personne a le droit de choisir qui il est « . Bien entendu, en un sens, on voudrait dire bravo à ce Jimmy. Oui, en un sens, il a raison.
C’est à lui qu’il revient d’être quelqu’un, d’avoir une identité, de faire des choix qui ont un sens et de dire: » C’est moi. Je veux porter ces boucles d’oreilles. » Mais on ne peut choisir d’être absolument n’importe qui. Si je décidais de porter des boucles d’oreilles, un blouson de cuir et de circuler sur une moto à Rome, j’ai l’impression que mes frères élèveraient des objections et diraient: » Timothy, mais ce n’est pas vous! » Du moins, j’espère qu’ils réagiraient ainsi. Je ne puis décider de devenir un punk, pas plus que je ne puis décider d’être Thomas d’Aquin.
Être quelqu’un, c’est être capable de prendre des décisions d’importance au sujet de sa propre vie. Mais ces décisions doivent tenir ensemble, constituer un récit. Avoir une identité, c’est, pour les choix que chacun fait tout au long de sa vie, avoir une direction, une unité narratives (Voir Alasdair MACINTYRE, After Yirtue: A Study ofMoral Theory, Londres, 1981, chap. 15.). Ce que je fais aujourd’hui doit prendre sens à la lumière de ce que j’ai fait auparavant. L’une des raisons pour lesquelles les professions et les métiers étaient si importants pour l’identité humaine, c’est le fait qu’ils procuraient une structure à de larges segments de la vie d’une personne. Être un musicien, un homme de loi ou un charpentier, ce n’est pas seulement ce que l’on fait; c’est une vie, de la jeunesse à la vieillesse, avec la détente et le travail, dans la maladie et la bonne santé.
Mais notre vocation de religieux met en lumière la structure narrative la plus profonde de tout être humain. Lors de mon premier cours au noviciat, le maître des novices avait tracé un grand cercle au tableau en nous disant: » Eh bien, mes amis, voilà toute la théologie que vous avez besoin de savoir. Tout vient de Dieu et tout va vers Dieu. » La réalité s’est avérée quelque peu plus complexe! Mais l’affirmation de notre foi est que toute vie humaine est la réponse à la demande de Dieu de partager la vie de la Trinité. Tel est, en profondeur, le sens de toute vie humaine. Je découvre qui je suis en répondant à cet appel.
Ce qu’il a dit à Isaïe, il me le dit, à moi: » Avant ma naissance, le Seigneur m’a appelé; dès le sein de ma mère, il m’a donné un nom. » Un nom, ce n’est pas une étiquette commode, c’est une invitation. Être quelqu’un, ce n’est pas choisir une identité sur un rayon de supermarché (Hell’s Angel, pop star, franciscain). C’est répondre à celui qui me convoque à la vie: » Samuel, Samuel! » dit la voix dans la nuit. Et Samuel répond: » Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. «
Jimmy – j’espère qu’il porte maintenant ses boucles d’oreilles – a en partie raison. L’identité consiste à faire des choix. Mais ce n’est pas seulement une question de choisir celui que vous voulez être, comme l’on choisit la couleur de ses chaussettes. Le choix consiste à répondre à cette voix qui appelle à la vie. L’identité est un don et l’histoire de ma vie est faite de tous les choix que je fais d’accepter ou de refuser ce don.
Paul écrit aux Corinthiens: » Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur » (1 Co 1, 9). Ce que je voudrais vous suggérer ce matin, c’est que la vie religieuse est une manière particulière et radicale de dire oui à cet appel. D’une manière très forte et nue, elle met en évidence la texture de toute vie humaine, qui est réponse à un appel. Dans notre bizarre manière de vivre, nous explicitons le drame de toute recherche humaine d’identité, car tout être humain essaie de capter l’écho de la voix de Dieu l’appelant par son nom. D’autres vocations chrétiennes, comme le mariage, le font aussi, mais de manière différente, comme je le montrerai plus loin.
Tout laisser
Lorsque nous, religieux, discutons de notre identité, vous pouvez être pratiquement sûrs qu’avant longtemps l’adjectif » prophétique » viendra sur le tapis. Nos voeux sont en contradiction tellement directe avec les valeurs de notre société, qu’il est approprié d’en parler comme d’une prophétie du Royaume. L’exhortation apostolique Trta consecrata emploie ce terme. Je suis aux anges quand d’autres personnes recourent à cet adjectif à notre sujet, mais je suis réticent quand j’entends les religieux le revendiquer pour eux-mêmes. Cela pourrait être teinté d’arrogance: » Les prophètes, c’est nous! » Souvent, nous ne le savons pas. Et j’ai l’impression que les vrais prophètes hésiteraient à s’approprier ce titre.
Comme Amos, ils tendent à rejeter une telle prétention et disent: » Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. » Je préfère penser que nous sommes ceux qui laissent derrière eux les signes habituels de l’identité.
Le jeune homme riche demande à Jésus: » « Que me restet-il à faire ? » Jésus lui dit: « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens, et suis-moi. » Entendant cela, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens » (Mt 19, 20-22).
En premier lieu, notre vocation montre quelque chose sur la vocation de l’homme en raison de ce que nous laissons derrière nous. Nous abandonnons bien des choses qui donnent une identité aux êtres humains dans notre monde argent, statut, partenaire dans le mariage, carrière. Dans une société où l’identité est si fragile, si mal assurée, nous laissons derrière nous tout ce en quoi les hommes recherchent la sécurité, les soutiens de notre inquiète interrogation sur ce que nous sommes. Sans cesse, nous posons la question qui sommes-nous ? Mais nous sommes des gens qui refusons les balises habituelles de l’identité. Voilà ce que nous sommes. Il n’est pas étonnant que nous ayons des problèmes! Nous le faisons de manière à mettre en lumière la vraie identité et la vraie vocation de tout être humain. Tout d’abord, nous montrons que toute identité humaine est un don. Nulle identité autocréée n’est jamais au niveau de ce que nous sommes. Toute petite identité que nous pouvons nous forger dans cette société est vraiment trop petite. Ensuite, nous montrons que l’identité humaine, en définitive, n’est pas donnée maintenant. C’est l’histoire entière de nos vies, du début jusqu’à la fin et au-delà, qui nous montre qui nous sommes.
Saint Jean écrit: » Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous savons que, lors de cette manifestation, nous serons semblables à Lui parce que nous Le verrons tel qu’Il est » (1 Jn 3, 2). Rejeter loin de nous tout soutien, c’est un signe que toute identité humaine est une surprise, un don et une aventure.
Permettez-moi de concrétiser cela à travers quelques exemples. Il va de soi qu’il ne saurait aucunement être question d’un traité complet de théologie sur les voeux; il s’agit simplement de quelques suggestions sur la manière dont ils touchent à la question de l’identité humaine.
L’obéissance
Dans l’Ordre dominicain, lorsqu’on fait profession, on met ses mains entre celles de son supérieur, et l’on promet obéissance. Je crois bien que, dans toutes nos congrégations, d’une manière ou d’une autre, le pincement au coeur se produit lorsqu’on se met entre les mains de ses frères et de ses soeurs, et que l’on dit: » Me voici; envoyez-moi où vous voulez. «
Erik Erikson définit ainsi la perception de l’identité: » Le sentiment de savoir où l’on va, et la reconnaissance, intérieurement anticipée, de la part de ceux qui comptent. » (Cité par Theodore ZELDIN, An Intimate History of Humanity, Londres, 1955, p. 380.) Eh bien, l’obéissance efface carrément ce sentiment de savoir où l’on va. On nous donne la splendide liberté de ne pas savoir où l’on nous dirige. Le religieux est une personne libérée du fardeau d’avoir une carrière.
La carrière est l’une des façons par lesquelles l’être humain trace la longue histoire de sa vie et, ce faisant, entrevoit ce qu’il est. La carrière, du moins pour ceux qui sont assez heureux pour en avoir une, assure séquence et structure aux étapes de la vie d’une personne, à mesure qu’elle grimpe les barreaux de l’échelle, qu’il s’agisse d’une université, de l’armée ou de la banque. Lorsque j’ai fait ma profession, le 29 septembre 1966, ma carrière a pris fin. Je suis religieux et ne pourrai jamais être autre chose. On m’a dit qu’il existe en France un document juridique qui englobe dans la liste des » sans-profession » prêtres et prostituées. Alors que j’étais aumônier d’université, mon rôle, je m’en souviens, était d’être dans le campus une personne sans rôle, un » rôdeur avec préméditation « , comme le dit la police anglaise lorsqu’elle arrête des individus suspects.
Et ce ne sont pas seulement nos frères et nos soeurs qui nous convoquent pour que nous allions là où nous sommes envoyés. Nous obéissons aux voix de ceux qui nous lancent un appel de différentes manières. Je me souviens d’un dominicain français qui était venu à Oxford apprendre le bengali. Il avait été prêtre-ouvrier pendant seize ans, il fabriquait des voitures chez Citroën ou bien, plus souvent qu’à son tour, il prenait la tête des grèves, veillant à ce que l’on ne produise pas de voitures! Et voici que maintenant Nicolas et son provincial étaient arrivés à la conviction que sa vie était entrée dans une nouvelle étape, et qu’il se rendrait à Calcutta pour y vivre avec les plus pauvres. Je m’entends encore lui demander ce qu’il avait l’intention de faire. Il me répondit que ce n’était pas à lui de le dire. On lui dirait ce qu’il fallait faire.
L’appel pressant peut venir des gens les plus surprenants. Nos frères du Viêt-nam ont subi de nombreuses années de persécution, d’emprisonnement, et bien souvent ont dû se cacher au milieu des habitants. L’un d’entre eux, un homme charmant prénommé François, après s’être caché pendant un certain temps, fut soudain arrêté par la police et Jeté en prison. Et il a dit à ceux qui l’arrêtaient: » Je devrais vous remercier. Car nous, les dominicains, nous vivions entre nous, mais lorsque vous êtes venus nous chercher, vous nous avez envoyés vers les gens. «
Le voeu d’obéissance nous interpelle au-delà de toutes les identités qu’une carrière pourrait nous donner, et aussi au-delà de toutes les identités que nous pourrions jamais construire. Le voeu désigne une identité ouverte à tous ceux dont la vie ne mène nulle part, qui n’ont jamais eu de carrière, qui n’ont jamais eu d’emploi, passé un examen ou réussi quoi que ce soit dans la vie. Notre renoncement à une carrière est le signe que toutes les vies humaines, en définitive, vont quelque part, même si en apparence elles se heurtent à une impasse, car il y a un Dieu qui convoque chacun d’entre nous à la vie.
Chaque année, la commission Justice et Paix de la Conférence irlandaise des supérieurs majeurs élabore une critique du budget du gouvernement, et les ministres tremblent dans l’attente dudit document. Mais un jour, après un rapport tout particulièrement sauvage, le premier ministre, Charlie Haughley, l’écouta en disant qu’il était difficile de prendre au sérieux des critiques émanant d’un groupe qui s’intitulait » majeurs » et » supérieurs « . La commission en prit bonne note et se dénomme désormais » Conférence des religieux « .
La chasteté
Si le voeu de chasteté est parfois si difficile à vivre, c’est qu’il touche à bien des aspects de notre identité. Les autres intervenants vont sans doute en parler en long et en large! Et c’est pourquoi je me contenterai d’en dire seulement quelques mots.
Pour la plupart des êtres humains, le signe le plus fondamental de leur identité est l’existence d’un autre être pour lequel ils sont le centre et le coeur: leur mari, leur femme ou leur partenaire. Cela, nous ne l’avons pas. Quelque nombreux que soient ceux que j’aime et qui m’aiment, je ne puis me définir moi-même par un tel type de relation. C’est là une telle perte, une telle privation, que, je le crois, elle ne peut être vécue de manière féconde que si ma propre vie est nourrie en profondeur par la prière.
L’un des points les plus douloureux, du moins pour moi, est que l’on se refuse la possibilité d’avoir des enfants. Dans certaines sociétés, cela signifie que l’on ne peut jamais être accepté comme un homme. Je me rappelle la désolation d’un jeune prêtre nouvellement ordonné qui était allé célébrer l’eucharistie dans un couvent à Édimbourg. Lorsque la porte d’entrée finit par s’ouvrir, la religieuse le dévisagea et dit: » Oh, c’est vous, père, j’attendais un homme. «
Cela me fait aussi penser à un frère américain, dont l’un des prénoms était Marie, en vertu d’une pieuse coutume irlandaise. Il était en train de pester contre un monde rempli de gens bizarres et pervers. Un autre frère laissa tomber le journal qu’il était en train de lire et lui dit: » Allons, allons, vous croyez que vous êtes vous-même normal. Vous vous appelez Marie et vous portez une robe. «
On laisse derrière soi père, mère, frère, soeur, le réseau tout entier de relations humaines qui donne à chacun un nom et une place dans le monde.
J’ai visité l’Angola pendant la guerre civile. Je n’oublierai jamais une rencontre avec les postulants et les postulantes à la capitale, Luanda. Ils étaient coupés de leurs familles par les conflits qui entouraient la ville et se trouvaient confrontés à un dilemme moral. Devaient-ils tenter de franchir la zone de guerre pour retrouver leurs familles et les soutenir pendant cette terrible épreuve ? Ou bien devaient-ils rester auprès de l’Ordre ? Pour des Africains, avec leur sens profond de la famille, c’était là une douloureuse situation. Je n’oublierai jamais la jeune religieuse qui se leva en disant: » Laissez les morts enterrer les morts, nous devons rester pour prêcher l’Évangile. «
Ainsi donc, nos vies sont marquées par une grande absence, par un vide. Mais cela ne prend sens que si nous le vivons comme le chapitre d’une histoire d’amour qui est le profond mystère de toute vie humaine. Cela doit donc être vécu passionnément comme signe de cet amour de Dieu qui appelle chaque être humain à la plénitude de la vie. Sinon, tout n’est que désert et stérilité.
Ainsi, à travers notre voeu de chasteté, nous devons être signe de ce qu’est la destinée de tout être humain. Chacun est appelé à cet amour, même ceux dont la vie semble dépourvue d’affection, qui n’ont ni époux ni épouse, ni famille, ni enfant, ni tribu, ni clan, ceux qui sont totalement seuls.
La pauvreté
Il est évident que le voeu de pauvreté nous plonge au coeur de ce qui donne aux hommes leur identité dans le marché global. C’est le renoncement au statut, qui va de pair avec les revenus, avec la capacité d’être quelqu’un qui achète et qui vend. Il nous appelle à être un véritable contre-signe dans notre culture de l’argent. Bien sûr, nous ne sommes pas souvent ainsi. Tandis que j’écris ces lignes, tout en haut de la colline qui domine le Tibre, dans notre antique et imposant prieuré de Sainte-Sabine, je peux apercevoir une petite baraque sur le bord du fleuve, où vit une famille; le linge sèche sur une corde. En cas de pluie, si les eaux montent, la maison sera balayée. Je regarde, et je rougis en me demandant ce que cette famille pense de nous.
Cela me remet en mémoire que l’une de nos provinces avait conclu une semaine de discussions sur la pauvreté par un repas de gala dans un restaurant de luxe. Et l’un des frères de faire cette remarque: » Eh bien, si la semaine sur la pauvreté aboutit ici, où irons-nous tous l’an prochain, après toute une semaine à discuter de la chasteté ? «
Cela dit, partout au cours de mes voyages, j’ai rencontré des communautés religieuses d’hommes et de femmes de toutes les congrégations, partageant la vie des pauvres, signes vivants qu’aucune vie humaine n’est destinée à s’achever sur un monceau d’immondices, que tout être humain a la dignité d’un fils de Dieu. À Noël dernier, j’ai célébré la messe de minuit avec l’un de nos frères, Pedro, qui vit littéralement dans les rues de Paris. Il a célébré la fête avec un millier de clochards, sous une grande tente. L’autel était fait de boîtes de carton pour symboliser que le Christ était né cette nuit pour tous ceux qui vivent dans des boîtes de carton sous les ponts de Paris. Lorsqu’il a fait sauter le bouchon de la bouteille de vin pour l’offertoire, l’auditoire a éclaté en bravos!
Dans chacun de ces voeux, nous voyons comment un pilier de l’identité humaine est abandonné. Nous délaissons les choses habituelles qui nous disent qui nous sommes, que nous avons de l’importance et que notre vie débouche quelque part. Il n’est pas étonnant que nous nous interrogions sur notre identité. Mais peut-être notre liberté ne consiste-t-elle même pas à nous soucier de ce que nous sommes. Nous devons être bien plus intéressés par Dieu. Comme l’a écrit Thomas Merton: » Vous m’avez appelé ici, non pour porter une étiquette qui me permettrait de me reconnaître dans telle ou telle catégorie. Vous ne voulez pas que je réfléchisse sur ce que je suis, mais sur ce que vous êtes, vous. Ou plutôt, vous ne voulez même pas que je réfléchisse beaucoup sur quoi que ce soit, car vous m’élèveriez au-dessus du niveau de la pensée. Et si je suis toujours en train de me demander ce que je suis, où je suis et pourquoi je suis, comment ce travail sera-t-il effectués ? » (Épilogue: Meditatio Pauperis in Solitudine.)
Dans son autobiographie La Longue Marche vers la liberté, Nelson Mandela décrit sa grande fierté et sa grande joie quand il acheta sa première maison à Johannesburg. Ce n’était pas grand-chose, mais il était devenu un homme. Un homme doit posséder une terre et engendrer des enfants. Mais, en raison de sa lutte pour son peuple, il vécut à peine dans cette maison, et c’est à peine aussi s’il vit sa famille. Il choisit une voie qui ressemble fort à nos voeux. Il écrit ceci :
C’est cette aspiration à la liberté de mon peuple pour qu’il vive dans la liberté et le respect de soi, qui a été le moteur de ma vie, qui a transformé un jeune homme effrayé en un homme audacieux, qui a poussé un avocat respectueux des lois à devenir un hors-la-loi, qui a changé un mari plein d’amour pour sa famille en un homme sans foyer, qui a forcé un homme qui aimait la vie à vivre comme un moine. Je ne suis pas plus vertueux ou plus enclin au sacrifice que l’homme d’à côté, mais je découvris que je ne pouvais même pas prendre plaisir à la pauvre liberté bien limitée qu’on m’autorisait à avoir, lorsque je savais que mon peuple n’était pas libre. La liberté est indivisible. Les chaînes de n’importe quel membre de mon peuple étaient les chaînes de tous. Les chaînes de mon peuple tout entier étaient les miennes. (The Long Walk to Freedom, p. 750.)
Mandela perdit sa femme, sa famille, sa carrière, sa fortune et son statut social, tant il était assoiffé de liberté pour son peuple. Son emprisonnement était le signe de la dignité cachée de son peuple, qui serait un jour révélée. Peu de communautés religieuses sont aussi austères que la prison de Robben Island, mais nous aussi nous laissons derrière nous bien des choses qui pourraient nous donner une identité, en tant que signe de la dignité cachée de ceux qui sont morts dans le Christ. Comme l’écrit saint Paul aux Colossiens: » Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire » (3, 3).
Le matin de Pâques, Pierre et le disciple bien-aimé rivalisent de vitesse pour se rendre au tombeau vide. Pierre ne voit qu’une perte, l’absence d’un corps. L’autre disciple voit avec les yeux de quelqu’un qui aime, et il voit un vide rempli de la présence du Ressuscité. Notre vie aussi peut sembler marquée par une absence et une perte, mais ceux qui voient avec les yeux de l’amour peuvent la voir remplie de la présence du Seigneur ressuscité.
Je n’entends élever aucune prétention exclusive en faveur de notre vocation de religieux ou de religieuses. Toutes les vocations humaines, comme médecins, enseignants, travailleurs sociaux, etc., disent quelque chose sur cette vocation humaine consistant à répondre à l’appel de Dieu qui nous invite dans le Royaume. Ce qui est spécifique à notre vocation, c’est qu’elle montre cette destinée universelle à travers l’abandon des autres identités. L’exhortation apostolique Vita consecrata parle de nous comme de » symboles eschatologiques « . Et cela est certainement vrai. De plus, cela m’enchante. Comme il serait agréable de mettre sur sa demande de passeport, au-dessous de la profession, » symbole eschatologique « . Mais on pourrait rétorquer que, plus que nous encore, c’est le mariage qui est le symbole eschatologique. C’est la consommation de l’amour, ce » shabbat » de l’esprit humain, lorsque deux personnes reposent dans l’amour mutuel, qui nous donne un symbole de ce Royaume auquel nous aspirons. Peut-être sommes-nous un signe du voyage, et les couples mariés un signe de la destinée.
Une écologie pour s’épanouir
J’ai essayé de donner une définition de l’identité de la vie religieuse. C’est une définition paradoxale parce qu’elle nous définit comme ceux qui abandonnent l’identité telle que la comprend notre société. Mais nous ne pouvons nous arrêter ici, quelque envie que nous en ayons!
Dans notre société, hostile à l’idée globale de vocation et en passe de subvenir la perception de l’identité et de la vocation de tout être humain, une définition bien claire ne suffit pas. C’est comme si on essayait de réconforter les tigres menacés d’extinction avec une définition bien troussée de la » tigritude » !
Dans ce désert humain qu’est le marché global, il nous faut bâtir un contexte où les religieux puissent véritablement s’épanouir et être une invitation vitale à marcher sur la route du Seigneur. Ce que fait un ordre ou une congrégation religieuse, c’est offrir un tel contexte. Dans le monde d’aujourd’hui, nous pouvons être tentés de penser les ordres religieux comme des multinationales en compétition: achetez-vous de l’essence jésuite à haut degré d’octane ou de l’essence franciscaine sans plomb ? Mais l’image qui me vient plutôt à l’esprit, c’est que chaque institut est comme un écosystème qui abrite une bizarre forme de vie. Pour prospérer comme papillon, il vous faut plus qu’une jolie définition; il vous faut un contexte écologique qui vous fera passer de l’oeuf à la chenille, et du cocon au papillon. Certains papillons ont besoin de chardons, de mares et de certaines plantes rares; sans quoi ils n’y arrivent pas. Pour d’autres variétés de papillons, la présence de crottes de mouton semble vitale. Chaque congrégation religieuse est différente, offrant une niche écologique différente, en vue d’une façon particulière d’être un être humain. Je résisterai à la tentation de préciser à quelles variétés de papillons nos divers ordres religieux me font penser. Du moins pour le moment!
Un ordre religieux est comme un environnement. Construire la vie religieuse, c’est comme implanter une réserve naturelle sur une ancienne zone construite. Il nous faut planter quelques chardons ici, creuser une mare là, et ainsi de suite. Qu’est-ce que nos frères et nos soeurs doivent faire prospérer au long de ce voyage, alors qu’ils laissent derrière eux carrière, richesse, statut et l’assurance d’un unique partenaire ? De quoi ont-ils besoin en faisant ce dur pèlerinage du noviciat à la tombe ? Chaque congrégation a ses propres exigences, ses propres besoins écologiques, son identité propre.
Et ceci me conduit à un paradoxe apparent: j’ai défini l’identité de la vie religieuse par le fait que l’on abandonne son identité, qu’on laisse derrière soi les soutiens, les repères qui disent aux gens ce qu’ils sont. Et pourtant nos ordres et nos congrégations nous offrent bel et bien des identités. Chacun d’entre eux a son style différent. C’est la raison pour laquelle il y a ces désopilantes plaisanteries sur les Jésuites, les Franciscains et les Dominicains remplaçant une ampoule électrique.
Je me souviens que lorsque je dis à un de mes grands-oncles, un bénédictin, que j’avais l’intention de devenir dominicain, il parut hésiter et me demanda: » Es-tu sûr que ce soit une bonne idée ? Est-ce qu’ils ne sont pas supposés être plutôt intelligents ? » Il s’interrompit et poursuivit: » Au fait, j’y pense, j’ai connu des tas de dominicains stupides! «
Mais le paradoxe n’est qu’apparent. Chaque congrégation offre une identité, mais il s’agit d’une façon particulière de marcher à la suite du Seigneur, une manière particulière d’oubli de soi. Un carme devrait être heureux d’être carme, non pas parce que cela lui donne un statut, mais parce que c’est une manière particulière de l’abandonner. Je dois trouver mon plaisir dans mon ordre, avec ses histoires, ses saints, ses traditions, de manière à trouver le courage de laisser derrière moi tout ce que notre société considère comme important. J’aime beaucoup l’anecdote du bienheureux Réginald d’Orléans, l’un des tout premiers frères, qui, sur son lit de mort, déclara qu’il n’avait eu aucun mérite à être dominicain tant il avait aimé cette vie. J’ai besoin de récits comme celui-là pour m’encourager à m’épanouir comme religieux pauvre, chaste et obéissant, pour pouvoir prendre plaisir à cette vie, comme une liberté et non comme une prison. J’ai besoin de récits comme celui-là pour me libérer de la préoccupation de moi-même.
Voilà pourquoi j’ai une grande sympathie pour les jeunes religieux qui réclament aujourd’hui des signes clairs de leur identité en tant que membres d’un ordre religieux. La tendance de ma génération, élevée dans un profond sentiment d’identité catholique et même dominicaine, fut de rejeter les symboles qui nous mettaient à part des autres, comme l’habit religieux, et de nous immerger dans la modernité, de nous laisser tenter par ses doutes et de partager ses interrogations.
Et cela était juste et fécond. Mais les jeunes qui viennent aujourd’hui chez nous sont souvent les fruits de cette modernité, et ils ont été hantés par ses interrogations depuis leur enfance. Ils ont parfois d’autres besoins, ils recherchent des signes clairs de participation à une communauté religieuse, afin de les soutenir dans cette très étrange manière d’être un être humain.
Une remarque pour finir: nous avons besoin d’un cadre de vie qui nous soutienne dans notre croissance personnelle. Le fait que nous soyons appelés à laisser derrière nous ce que notre société regarde comme le symbole du statut et de l’identité ne signifie pas que nous soyons à l’abri des difficultés pour devenir des êtres humains, adultes et responsables. Nous connaissons tous des frères qui veulent des ordinateurs toujours plus onéreux tout en proclamant que le voeu de pauvreté les dispense de se préoccuper de l’argent.
Ce que nous pouvons voir de nos propres yeux, c’est que l’abandon de la famille, du pouvoir, de l’argent et de l’autodétermination ne fait pas de nous des demi-portions. Nul n’oserait dire que Nelson Mandela est une personnalité falote! Mais cette croissance en maturité exige que nous traversions des moments de crise. Nos communautés sont-elles alors pour nous des soutiens ? Nous aident-elles à vivre ces moments de mort comme des temps de re-naissance aussi ? On demandait un jour à un vieux moine ce que l’on faisait dans le monastère. Il répondit: » Oh, nous tombons et nous nous relevons, nous tombons et nous nous relevons, nous tombons et nous nous relevons… » (Cité par Joan CHITTESTER, The Fire in These Ashes, Kansas City, 1995, p. 7.) Nous avons besoin d’un environnement où nous puissions tomber et nous relever alors que, titubants, nous marchons vers le Royaume.
Conclusion
Permettez-moi de conclure en résumant en une minute le voyage que nous avons entrepris dans cette conférence. La question que l’on m’avait posée était la suivante: quelle est l’identité de la vie religieuse aujourd’hui ? J’y réponds en disant qu’il nous faut la replacer dans le contexte d’une société où la plupart des gens souffrent d’une crise d’identité. Le marché global efface tout sens de vocation, que l’on soit médecin, prêtre ou conducteur d’autobus.
La valeur de la vie religieuse est qu’elle donne une expression frappante de ce qu’est la destinée de tout être humain. En effet, tout être humain découvre sa propre identité en répondant à l’appel que Dieu lui lance pour partager la vie divine. Nous sommes appelés à apporter une réponse particulière et radicale à cette vocation en laissant derrière nous toute autre identité qui pourrait séduire nos coeurs. D’autres vocations, telles que le mariage, procurent des expressions autres à cette destinée humaine.
Mais je concluais tout à l’heure en disant qu’il ne suffit pas de s’arrêter à une belle définition. Nous avons besoin de quelque chose de plus pour que nous puissions poursuivre notre route. Chaque ordre ou congrégation se doit d’offrir le nécessaire cadre de vie pour nous soutenir en chemin. Et si nous ne sommes pas séduits par la société de consommation, si nous voulons offrir des îlots de contre-culture, nous devons travailler d’arrache-pied pour construire cet environnement pour que nos frères et nos soeurs puissent s’épanouir dans notre marche en avant.
Va et Prêche : Lettre aux jeunes dominicains (1996)
Lettre aux jeunes des Provinces francophones de l’Ordre des Prêcheurs. Rome, 21 mai 1996
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 Chers frères et soeurs, vous allez vous rassembler en novembre pour votre sixième session. Le sujet que vous avez choisi nous réjouit car il touche le coeur de notre vie dominicaine: « Va et prêche. » C’est un appel à nous mettre en route sur les chemins de la mission, à la suite de Dominique qui allait et prêchait avec courage et confiance. Nous aimerions partager avec vous quelques réflexions et questions autour de cinq aspects de cet appel.
Chers frères et soeurs, vous allez vous rassembler en novembre pour votre sixième session. Le sujet que vous avez choisi nous réjouit car il touche le coeur de notre vie dominicaine: « Va et prêche. » C’est un appel à nous mettre en route sur les chemins de la mission, à la suite de Dominique qui allait et prêchait avec courage et confiance. Nous aimerions partager avec vous quelques réflexions et questions autour de cinq aspects de cet appel.
1. Va : mais aller où?
Jésus envoie ses disciples: Allez. Dominique fera de même avec ses frères. Tout commence par un déplacement, un mouvement vers un pays inconnu, qui peut être tout près ou très loin de son propre univers culturel et spirituel. Partir mais pour aller où ? Vers quelles personnes et quels milieux, aujourd’hui, sommes-nous appelés à marcher? Quels besoins percevons-nous, qui font appel à notre charisme dominicain?
Dominique a entendu les questions venant des nouveaux courants religieux, il a vu la soif d’une Parole de vie chez les chrétiens, il a envoyé ses frères dans les villes et les universités, il a rêvé d’aller évangéliser des pays lointains. C’est à partir des attentes et questions que vous entendez, des souffrances et blessures qui touchent votre compassion, que vous pourrez trouver vers où aller.
Pour notre part, nous voulons simplement indiquer ici quelques lieux possibles sur votre parcours. Nous voyons des jeunes désorientés, cherchant des appartenances dans une société fragmentée, s’interrogeant sur leur avenir et celui du monde, souvent livrés à la précarité des travaux et des relations, mais portés par un désir d’être reconnus et de trouver un horizon de sens. Nous entendons des questions difficiles, qui touchent des problèmes éthiques inédits, aux frontières de la vie et de la mort, qui posent le défi du rapport à la création ou qui parlent d’appauvrissements et d’exclusions. Nous voyons des gens, de tout âge, attirés par des nouveaux groupes religieux où s’entremêlent des quêtes spirituelles profondes et des recettes de bonheur immédiat. Nous voyons des visages blessés par la violence, celle des mots comme celle des armes, celle du passé ou du présent, vivant l’exil en un nouveau pays ou en eux-mêmes. Nous entendons des baptisés qui n’ont qu’une vague idée de la foi chrétienne ou qui sont essoufflés et perdent confiance. Nous voyons des gens cherchant à nommer ce désir radical qui les habite mais ne sachant vers qui se tourner pour saisir le mystère qui les saisit.
Et vous, que voyez-vous, qu’entendez-vous, qui vous donne le goût de vous mettre en route pour prêcher? Où voulez-vous aller? À vous de faire votre carte de ces lieux, d’en tracer les centres et les lignes, mais en étant prêts aussi à modifier votre itinéraire, une fois sur place!
2. Et prêche : mais prêcher quoi?
Sur ces routes, en ces lieux, nous voulons prêcher, mais prêcher quoi? De qui et de quoi parlerons-nous? Dans le contexte actuel, cela ne va pas de soi. Il ne s’agit pas de parler pour parler mais d’écouter avec attention et de trouver les mots et gestes qui sauront rendre compte de notre espérance. Il s’agit d’entrer dans une conversation où chacun apprend de l’autre, où chacun se livre dans ses convictions et ses fragilités. Le voyage vers l’autre mène au-delà de soi-même, là où sont traversées les frontières des mentalités et sensibilités.
Notre prédication s’inscrit dans une quête de vérité qui nous inclut toujours et qui cherche ce qui est vrai, partout où il se trouve. Le frère Fergus Kerr, dans sa prédication à l’ouverture du récent chapitre provincial d’Angleterre, en parlait ainsi:
- « Cet engagement à chercher la vérité, à écouter pour saisir ce avec quoi nous pouvons être d’accord dans ce sur quoi nous sommes en désaccord, à sauver ce qui est vrai dans ce que les autres pensent (…) Depuis que je suis dans l’Ordre, (…) ce que j’apprécie de plus en plus, c’est une manière de penser — de s’attendre à ce que les autres aient des idées qui différeront peut-être des nôtres, de s’attendre aussi à comprendre pourquoi ils croient ceci ou cela — si seulement nous avons l’imagination, le courage, la foi dans la puissance ultime de la vérité, la charité, pour écouter ce que disent les autres, pour écouter en particulier ce dont ils ont peur quand ils semblent réticents à accepter ce que nous voulons qu’ils voient. »
Des questions devront être approfondies dans ces années à venir pour voir plus clair dans notre mission même. Nous ne prêchons pas n’importe quoi. Les Écritures nous accompagnent sur notre route et nous nous inscrivons dans une tradition vivante, avec son développement doctrinal et institutionnel. Comment tenir ensemble la nécessité de la proclamation de foi et celle d’un authentique dialogue avec autrui? Nous avons besoin de retravailler notre théologie de la mission. Notre monde est marqué par des fondamentalismes qui se méfient de ce qui est historique, incarné et changeant, et qui ont peur de ce qui est différent. Il est aussi influencé par des courants dits de post-modernité, qui accentuent la relativité de tout discours, l’éclatement des certitudes, l’impossibilité de parvenir ensemble à une vérité. Notre tâche est de développer une humble confiance, qui nous rende modestes dans nos affirmations et respectueux des autres, mais qui soit une vraie confiance en la capacité humaine de chercher et de découvrir ce qui est vrai, de l’exprimer et de le partager, dans l’incessante alliance de la grâce de Dieu et de nos efforts humains.
Nous n’avons pas à être gênés ou honteux d’avoir une parole à annoncer. Mais prêcher, c’est entrer en dialogue avec des questions et des attentes, c’est savoir les entendre et trouver la juste attitude, les «propos bienveillants, relevés de sel, avec l’art de répondre à chacun comme il faut» (Col. 4,6.) Cela suppose de mieux saisir ce qui aujourd’hui dans la foi chrétienne fait difficulté, rebute, mais aussi attire et éclaire. La question centrale demeure celle du visage de Dieu, suscitant étonnement, crainte, indifférence, malentendus, appelant à l’engagement ou à la fuite, donnant courage ou lassant. Parler de Dieu, c’est faire face à tout cela en nous et chez les autres. C’est parler de la vie quotidienne, des choix moraux pris au fil des jours sans s’en rendre compte, des souffrances ou joies profondes qui construisent chacun. Ce qui ne semble qu’une série incohérente d’expériences et d’événements peut devenir, à la lumière de l’Évangile, une histoire unique et sainte, celle d’une alliance avec les autres et avec Dieu, avec ses passages où le mystère pascal est à l’oeuvre. Mais prêcher, c’est aussi parler de la communauté chrétienne, dans sa réalité locale et universelle, avec les débats que cela suscite. Prêcher, c’est nommer aussi ce lieu intérieur où dans le silence peut s’entendre une voix qui guérit et appelle. C’est inviter à visiter ce lieu secret et c’est offrir une nourriture pour ce voyage, celui de la contemplation.
Prêcher est fait de tout cela, écouter, converser, questionner, annoncer, accompagner. Comment voyez-vous cette mission de prêcher, aujourd’hui, dans le monde tel qu’il est? Prêcher pour parler de qui, de quoi? Quelles paroles peuvent être entendues et quels obstacles vont-elles rencontrer?
3. Va et prêche : mais comment, et avec qui?
Prêcher vise à témoigner du Dieu vivant. Pour Dominique, ce visage était avant tout celui de la miséricorde. Ses paroles, ses gestes, ses débats, son approche des personnes étaient profondément marqués par son sens de la compassion. Dans un monde blessé, indifférent ou obsédé par la performance, cette miséricorde prend aujourd’hui le nom d’espérance. Comment dire l’espérance? Quel langage l’exprimera le mieux?
Prêcher ne peut se faire sans explorer le monde des langages actuels, qui sont si variés, et apprendre à les maîtriser pour les utiliser pleinement. Langage des mots quotidiens et denses, qui touche les gens; celui plus technique des sciences et de la philosophie, qui requiert exactitude et rigueur; celui des symboles, des images et des sons, qui rejoint souvent le plus intime des gens, là où se construisent les images de soi-même, de Dieu, de l’univers; langage des médias et des nouvelles technologies, qui fait de l’univers un vaste réseau de communication. Langages du sens commun, de la pensée critique, de l’imagination, de la technologie: chacun de vous a des dons dans l’un ou l’autre. À vous de les développer, en sachant aussi apprécier ceux des autres!
Dominique envoyait ses frères deux à deux. Il s’agissait plus d’un Allez que d’un Va. Il est vraiment important que les nouveaux projets apostoliques soient portés, pensés, mis en oeuvre par plusieurs dominicains ensemble. Prêcher est plus qu’une tâche individuelle, c’est le but même de notre vie en commun. Nous ne sommes pas des gens qui vivons ensemble pour des raisons d’utilité et, à l’occasion, parlons de notre travail. Nous sommes en fraternité pour pouvoir les uns avec les autres annoncer l’Évangile. Et cette vie communautaire est déjà prédication. Cela n’empêche pas la spécialisation et la diversité des engagements. Il s’agit plutôt d’une façon de comprendre notre vie apostolique. Nous vous invitons à penser et réaliser ensemble de nouveaux projets, à ne pas vous isoler chacun sur son sentier. C’est important pour le soutien mutuel mais aussi pour la mission elle-même.
Nous avons aussi cette grande chance, comme famille dominicaine, d’être liés à tant d’autres, de pouvoir compter sur des frères, des soeurs, des laïcs, des moniales, tous marqués par l’esprit de Dominique. Dans l’avenir, nous verrons sûrement des formes nouvelles de collaboration entre nous, non seulement de bonnes relations amicales, mais une collaboration face au défi même de prêcher. Pour aller dans ces nouveaux pays et appeler à l’espérance, pour dire pleinement la bonne nouvelle d’un Dieu miséricordieux, nous avons besoin les uns des autres. Cela ne peut se faire seul.
Il y a bien d’autres conditions pour que Va et prêche se réalise: apprendre à préparer et bâtir un projet ensemble, trouver le style de vie communautaire adapté, savoir trouver l’appui des anciens et faire appel à leur expérience, se donner des objectifs réalisables et évaluer le parcours accompli, demeurer attentifs aux changements de contexte, etc.
Comment voulez-vous prêcher? Quels langages voulez-vous apprendre et utiliser? Avec qui voulez-vous prêcher? Et quand vous regardez des projets auxquels vous avez participé ou que vous avez connus, qu’avez-vous appris sur les conditions qui en favorisent la réalisation et l’évolution? Qu’est-ce qui a marché ou non, et pourquoi?
4. Va et prêche : mais les études?
Une autre question qui nous tient à coeur, comme dominicains, est celle de la relation entre la prédication et notre vie d’étude. Plusieurs d’entre vous êtes encore aux études institutionnelles ou vous venez de les terminer. Et si vous êtes en pleine action, l’étude continue de faire partie de votre vie, nous l’espérons! Comment pouvons-nous assurer une véritable interaction entre les engagements apostoliques divers et la vie d’étude, pour qu’ils se nourrissent l’un l’autre et ne soient pas des parallèles? Cela se joue à l’intérieur de l’équilibre de vie de chacun mais aussi dans notre façon de vivre en communauté, les temps que nous nous donnons pour la formation permanente, l’étude commune à partir des expériences et perspectives de chacun. Une lettre à l’Ordre sur l’étude a été publiée récemment, aussi nous ne voulons pas trop développer ce point, mais vous pouvez la relire!
Pour commencer ou continuer d’aller et de prêcher, quelle place l’étude peut-elle tenir dans une vie dominicaine bien remplie? Comment va-t-elle soutenir votre marche et votre prédication et comment celles-ci peuvent-elles stimuler votre étude?
5. Va et prêche : mais par quelle voie?
Pour notre itinérance apostolique, qui connaît élans et fatigues, enthousiasmes et essoufflements, nous avons besoin d’une spiritualité inspirante, qui nous intègre comme personnes dans cette mission, qui nous soit une force de ressourcement et qui puisse se communiquer à d’autres. La spiritualité qui ressort de notre tradition dominicaine a des traits particuliers. Elle met l’accent sur certaines façons de vivre avec les autres, d’aborder le mystère de la création et du salut, de chercher Dieu et d’en parler. Nous en soulignons brièvement quelques éléments.
C’est une spiritualité de la route, avec tout ce que cela évoque: le goût et la peur de l’inconnu, le compagnonnage sur le chemin, le sens de l’amitié de Dieu, la mobilité et la légèreté des bagages. Elle met en valeur les Écritures, à méditer, étudier, partager et mettre en pratique. Elle invite à la joie de vivre ensemble, dans la douceur de la fraternité. Elle se manifeste de plusieurs manières, entre autres dans notre forme de gouvernement, avec son sens du partage des responsabilités, et dans des témoins tout au long de notre histoire, Catherine de Sienne, Las Casas, Agnès de Langeac, Marie Poussepin, Lacordaire, Lataste, Lagrange, La Pira, et tant d’autres figures, qui disent autant que tout texte les traits vifs de notre vie dominicaine.
Quelle spiritualité de la mission va vous soutenir sur vos chemins de prédication? Quels traits et figures de notre tradition peuvent vous inspirer davantage?
Ce que l’Ordre attend de vous, c’est que vous deveniez encore plus vous-mêmes, avec vos dons et vos espoirs, vos sensibilités et vos convictions. Notre Ordre sera vraiment catholique, c’est-à-dire universel, dans la mesure où il accueillera ce que les cultures et générations nouvelles lui apportent. Nous avons besoin de recevoir ce que vous seuls pouvez donner et que peut-être vous ignorez encore. Vous le découvrirez en vous confrontant, avec d’autres, au défi d’aller et de prêcher, à la suite de Dominique.
Fraternellement en saint Dominique,Frère Timothy Radcliffe, o.p.
Maître de l’Ordre des Prêcheurs
Liberté et responsabilité, vers une spiritualité du gouvernement dans l'Église (1997)
Rome, le 10 mai 1997. Fête de saint Antonin
fr. Timothy Radcliffe, o.p.

Dominique nous fascine par sa liberté. C’était la liberté d’un prêcheur pauvre et itinérant, liberté de fonder un Ordre qui ne ressemblât à aucun de ceux qui avaient existé auparavant. Il était libre de disperser la fragile petite communauté qu’il avait rassemblée autour de lui et d’envoyer les frères dans les universités, et libre d’accepter les décisions des frères en chapitre, même lorsqu’il n’était pas d’accord avec eux. C’était la liberté d’un homme de compassion, qui osait voir et répondre.
L’Ordre s’est toujours épanoui lorsque nous avons vécu avec la liberté de coeur et d’esprit de Dominique. Comment pouvons-nous renouveler aujourd’hui cette liberté profondément propre à l’Ordre? Elle a de nombreuses dimensions: une simplicité de vie, l’itinérance, la prière. Dans cette lettre, je souhaite juste me centrer sur l’un des piliers de notre liberté, à savoir le bon gouvernement. Je suis convaincu, après avoir visité tant de provinces de l’Ordre, que la liberté dominicaine typique s’exprime dans notre mode de gouvernement. Dominique ne nous a pas laissé une spiritualité qui soit manifeste dans une série de sermons ou de textes théologiques. Au lieu de cela, nous avons hérité de lui et des tout premiers frères, une forme de gouvernement qui nous rend libres de répondre avec compassion à ceux qui ont faim de la Parole de Dieu. Lorsque nous offrons nos vies pour la prédication de l’Évangile, nous prenons dans nos mains le livre de la Règle et des Constitutions. La plupart de ces Constitutions ont trait au gouvernement.
Cela peut sembler surprenant. Dans la culture contemporaine, on considère généralement que le gouvernement est une affaire de contrôle, de limitations des libertés de l’individu. Et en effet, bien des dominicains seraient tentés de penser que la liberté consiste à échapper au contrôle de supérieurs envahissants! Mais notre Ordre ne se divise pas en « gouvernants » et « gouvernés ». Bien plutôt, le gouvernement nous rend capables de partager la responsabilité commune de notre vie et notre mission. Le gouvernement est à la base de notre fraternité. Il nous forme comme frères, libres d’être « utiles au salut des âmes ». En acceptant un frère dans l’Ordre, nous exprimons notre confiance qu’il sera capable de prendre sa place dans le gouvernement de sa communauté et de sa province, qu’il contribuera à nos débats, et qu’il nous aidera à parvenir à des décisions fécondes et à les mettre en oeuvre.
Notre époque est tentée par le fatalisme, la croyance selon laquelle, confrontés aux problèmes de notre monde, nous ne pouvons rien faire. Cette passivité peut aussi gagner la vie religieuse. Nous partageons la liberté de Dominique quand nous sommes tellement touchés par l’urgence de prêcher l’Évangile, que nous osons prendre des décisions difficiles, qu’il s’agisse de lancer une nouvelle initiative, de fermer une communauté, ou de persister dans un apostolat qui est dur. Pour cette liberté, un bon gouvernement est nécessaire. L’opposé du gouvernement n’est pas la liberté mais la paralysie.
Dans cette lettre, je n’essaierai pas de détailler des observations sur l’application des Constitutions. C’est la responsabilité des chapitres généraux. Je voudrais plutôt suggérer comment nos Constitutions touchent à certains des aspects les plus profonds de notre vie religieuse: notre fraternité et notre mission. Il ne suffit pas simplement d’appliquer les Constitutions comme si elles étaient un ensemble de règles. Nous devons développer ce que l’on pourrait appeler une spiritualité du gouvernement, afin que grâce à elle, nous puissions grandir ensemble, comme frères et prêcheurs.
Ces commentaires seront fondés sur mon expérience du gouvernement par les frères. Aussi ce que j’aurai à dire ne sera-t-il pas toujours applicable aux autres branches de la Famille dominicaine. Je l’espère cependant utile à nos moniales, nos soeurs, notre laïcat, vous qui faites face à de semblables défis.
« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » (Jn 1,14) Les mots de Jean aideront à structurer ces réflexions fort simples sur le gouvernement. Il peut sembler absurde de prendre un texte théologique d’une telle richesse pour base d’une exploration sur le thème du gouvernement. Je voudrais montrer comment le défi du bon gouvernement est que se fassent chair parmi nous cette grâce et cette vérité.
1. Le Verbe qui vient parmi nous est « plein de grâce et de vérité »
La première partie de la lettre réfléchit sur le but de tout le gouvernement, à savoir que nous soyons libérés pour la prédication de l’Évangile. Tout gouvernement dans l’Ordre a pour objectif la mission commune.
2. Ce Verbe « habite parmi nous »
Dans la seconde partie de la lettre, nous examinerons les principes fondamentaux du gouvernement dominicain. Au coeur de notre pratique du gouvernement figurent notre réunion en chapitre, notre engagement dans le débat, nos votes et prises de décisions. Mais ces réunions ne seront que pure administration dans le meilleur des cas, et politique partisane au pire, si elles ne relèvent pas de notre accueil du Verbe de Dieu prenant demeure parmi nous. Le gouvernement a besoin d’être nourri par une fraternité vécue.
3. Ce Verbe de Dieu s’est fait chair
Enfin, cette belle théorie du gouvernement doit se faire chair dans la réalité complexe de nos vies, dans nos couvents, nos provinces et l’Ordre entier. Dans la dernière partie, je partagerai quelques observations sur les relations entre les différents niveaux de responsabilité dans l’Ordre.
1. LE BUT DU GOUVERNEMENT DOMINICAIN
1.1 La liberté pour la mission
Dans la vision de sainte Catherine, le Père dit de Dominique: « Il s’est chargé du Verbe, mon Fils unique. Il est apparu clairement comme un apôtre dans le monde, tant il a semé ma parole avec vérité et lumière, dissipant les ténèbres et donnant la lumière. » Tout gouvernement au sein de l’Ordre a pour but la mise au monde de la Parole de Dieu, le prolongement de l’Incarnation. La mesure du bon gouvernement réside dans ce service de la mission. C’est pourquoi, depuis le commencement de l’Ordre, un supérieur a le pouvoir de dispenser de nos lois, « chaque fois qu’il l’estime opportun principalement en tout ce qui pourrait faire obstacle à l’étude, à la prédication, ainsi qu’au bien des âmes ».
Il est fondamental pour la vie des frères que nous nous réunissions en chapitre, qu’il soit conventuel, provincial ou général, pour prendre les décisions concernant nos vies et notre mission. Depuis le commencement de l’Ordre, nous parvenons à ces décisions de façon démocratique, par un débat qui conduit à un vote. Mais ce qui rend ce processus démocratique proprement dominicain, c’est que nous ne cherchons pas simplement à découvrir la volonté de la majorité, mais quels sont les besoins de la mission. À quelle mission nous envoie-t-on? La Constitution fondamentale de l’Ordre explicite bien ce lien entre notre gouvernement démocratique et la réponse aux besoins de la mission : « Ce gouvernement communautaire est particulièrement apte à promouvoir l’Ordre et à le rénover fréquemment. (…) Ce n’est pas seulement l’esprit de conversion chrétienne permanente qui réclame cette mise au point continue ; c’est la vocation même de l’Ordre qui le presse d’assumer à chaque génération sa présence authentique au monde. » (LCO I, § VII)
Nos institutions démocratiques nous permettent de prendre nos responsabilités ou de les fuir. Nous sommes libres de prendre des décisions qui vont peut-être bouleverser nos vies, ou bien nous pouvons choisir l’inertie. Nous pouvons élire des supérieurs qui oseront nous demander plus que nous ne sentons pouvoir donner, ou bien nous choisissons un frère qui nous laissera en paix. Mais soyons bien clairs sur ce point : notre démocratie n’est dominicaine que si notre débat et notre vote sont une tentative d’entendre la Parole de Dieu nous appelant à marcher sur la voie des disciples.
Toute institution peut être tentée de faire de sa perpétuation son but ultime. Une entreprise qui produit des voitures n’existe pas par un désir miséricordieux de répondre au besoin de voitures de l’humanité, mais pour que l’organisation elle-même puisse croître et se développer. Nous pouvons nous aussi tomber dans ce piège, et tout particulièrement si nous parlons de nos propres institutions en des termes qui dérivent du monde des affaires: le provincial et son conseil deviennent « l’administration », et le syndic « directeur financier »! On peut même parler des frères comme du « personnel ». Quelle mère a jamais annoncé la naissance d’un nouvel enfant en disant que le personnel de la famille s’est accru? Mais nos institutions existent dans un tout autre but, extérieur à nous-mêmes, celui de mobiliser les frères pour la mission.
Une histoire des Vies des frères raconte comment un grand avocat de Vercelli arriva en courant vers Jourdain de Saxe, se jeta à ses pieds et tout ce qu’il put dire fut : « J’appartiens à Dieu. » Jourdain répondit : « Puisque tu appartiens à Dieu, en son nom, nous te remettons à Lui. » Chaque frère est un don de Dieu mais il nous est donné afin que nous puissions nous-mêmes en faire don en le formant pour la mission et le libérant pour la prédication.
Le commencement de tout bon gouvernement est l’attention, écouter ensemble la Parole de Dieu, ouvrir nos yeux aux besoins des gens. Dans une bénédiction dominicaine du XIIIe siècle, les frères priaient pour que l’Esprit Saint « nous illumine et nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des mains pour accomplir le travail de Dieu, et une bouche pour prêcher la parole de salut, et l’ange de la paix pour veiller sur nous et nous conduire enfin, par la grâce de notre Seigneur, au Royaume ». Chaque fois que nous nous réunissons en conseil ou en chapitre, nous prions l’Esprit Saint afin d’avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, mais aussi pour que ce que nous voyons et entendons nous appelle bien là où nous préférerions ne pas aller. La compassion peut bouleverser nos vies.
Et si la mission est la fin de tout notre gouvernement, alors quel en est le commencement? Sûrement, le fait que « nous avons entrevu sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique ». Si le gouvernement est l’exercice de la responsabilité, alors il exprime en dernier ressort notre réponse à celui qui nous a révélé sa gloire. La contemplation du Fils unique est la racine de toute mission, et donc le ressort premier de tout gouvernement. Sans ce repos il n’y a pas de mouvement. Tout gouvernement nous amène de la contemplation à la mission. Sans cela, nous ne faisons qu’administrer.
1.2 La charge du gouvernement est la mission commune
« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. » La Parole de salut nous rassemble dans la communion, dans la Trinité et les uns avec les autres. Dans cette Parole, nous découvrons notre véritable liberté, la liberté d’appartenir les uns aux autres dans la grâce et la vérité. La bonne nouvelle que nous prêchons, c’est que nous pouvons trouver notre demeure dans la vie du Dieu Trinitaire.
Si la prédication de l’Évangile est l’appel à la communion, alors le prêcheur ne saurait être un solitaire, engagé seulement dans sa mission. Toute notre prédication est le partage d’une charge commune, l’invitation à appartenir à la demeure commune. Si la fin du gouvernement dans l’Ordre est la mission de prêcher, alors son principal défi consiste à rassembler les frères dans la mission commune, la mission de l’Ordre et de l’Église. Les disciples ne sont pas envoyés seuls.
Rien ne paralyse autant le bon gouvernement que l’individualisme, par lequel un frère épouse à tel point « son propre projet », « son propre apostolat », qu’il cesse d’être disponible à la mission commune de l’Ordre. Cette privatisation de la prédication ne nous rend pas seulement difficile de développer et de soutenir des projets communs. Plus radicalement, elle risque d’offrir une fausse image du salut auquel nous sommes appelés, l’unité dans la grâce et la vérité. En fin de compte, c’est la soumission à une fausse image de ce que signifie être véritablement humain: celle de l’individu solitaire dont la liberté est l’autodétermination, libéré de l’interférence des autres.
L’un des principaux défis du gouvernement consiste à refuser de laisser paralyser la mission commune de l’Ordre par ce type d’individualisme. Cette liberté de Dominique, que nous trouvons si caractéristique de l’Ordre, n’est pas la liberté de creuser son propre sillon, libre de l’intervention des supérieurs. C’est la liberté de faire don de nous-mêmes, sans réserve, avec la folle générosité du Verbe fait chair.
Certaines formes de prédication de l’Évangile ne sont pas facilement partageables. Par exemple, un frère ou une soeur qui prêche par la poésie, la peinture, ou même la recherche, devra souvent travailler seul. Même dans ce cas, nous devons montrer qu’ils ne font pas seulement « leur truc à eux », qu’ils contribuent eux-aussi à la mission commune. L’Ordre est la plupart du temps vivant lorsqu’il canalise le dynamisme des frères. Parfois, l’acte le plus libératoire que puisse faire un supérieur est d’ordonner à un frère d’accomplir ce que ce dernier veut le plus profondément et dont il est capable. Parfois, la mission commune nous demandera d’accepter des charges que nous n’aurions pas choisies, d’abandonner, pour le bien commun, un apostolat aimé. Nous n’avons pas seulement besoin de prédicateurs et de pasteurs, mais de syndics, de secrétaires, de supérieurs et d’administrateurs. Mais cela fait aussi partie de la prédication de cette Parole qui nous rassemble en communauté.
2. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU GOUVERNEMENT DOMINICAIN
Les Constitutions nous disent que « notre première raison d’être rassemblés en communauté, c’est d’habiter ensemble, et d’avoir en Dieu une seule âme et un seul coeur » (LCO 2, § I). Cela pourrait sembler en contradiction avec le projet fondamental de l’Ordre, qui est de nous envoyer prêcher la Parole de Dieu. En fait, c’est là une saine et nécessaire tension qui a toujours marqué la vie dominicaine. Au nom de la grâce et de la vérité que l’on nous envoie prêcher, nous devons vivre ensemble, sinon nous n’aurons rien à dire. La mission commune que nous partageons s’enracine dans la vie commune que nous vivons.
Cette tension se retrouve dans notre gouvernement. Car si la fin de tout gouvernement est que les frères soient libérés pour la prédication, elle se fonde cependant sur notre fraternité. Si nous ne cherchons pas à vivre ensemble dans une unité de coeur et d’âme, notre démocratie échouera. Dans sa vision, le Père dit à sainte Catherine que dans le navire de saint Dominique, « aussi bien le parfait que le moins parfait ont leur place ». L’Ordre est une demeure pour les pécheurs. Et cela implique que pour établir un bon gouvernement, il ne suffit jamais de se contenter d’appliquer les Constitutions, de tenir les chapitres, de voter et prendre des décisions. T. S. Eliot nous parle de gens qui « rêvent de systèmes tellement parfaits que personne n’aura besoin d’être bon ». Notre système de gouvernement s’enracine en fin de compte dans une recherche de la vertu. La chair doit se faire verbe et communion, et le groupe hétéroclite d’individus que nous sommes, une communauté.
2.1 Pouvoir, autorité et responsabilité
Le bon gouvernement dépend d’une juste manière de vivre nos relations de pouvoir, d’autorité et de responsabilité. Il peut paraître étrange que je n’inclue pas une section sur l’obéissance. C’est que j’ai déjà écrit longuement sur l’obéissance dans ma Lettre à l’Ordre « Donner sa vie pour la mission ». La présente lettre sera bien assez longue sans que j’y répète ce que j’ai déjà écrit ailleurs! Et puis, pratiquement tout ce que j’écris dans cette lettre sur le gouvernement commente les implications de notre voeu d’obéissance, par lequel nous nous donnons sans réserve à la mission commune de l’Ordre.
Le pouvoir
Notre vie commune nous confronte inévitablement à la question du pouvoir. En général, nous n’aimons pas parler de pouvoir, à moins que nous sentions que des abus en sont commis. Le mot semble presque impropre pour parler de la relation de fraternité qui nous unit. Et pourtant toute communauté humaine est marquée par des relations de pouvoir, et les communautés dominicaines ne font pas exception. En faisant profession, nous nous remettons entre les mains des frères. Nos frères prendront, concernant nos vies, des décisions que nous n’apprécierons pas toujours, et parfois même ressentirons comme injustes. Nous serons peut-être assignés à des lieux où nous ne voudrions pas aller, ou élus à des postes de responsabilité que nous ne voudrions pas occuper.
Chaque frère a du pouvoir, par ce qu’il dit ou ne dit pas, et par ce qu’il fait ou ne fait pas. Toutes les questions que nous allons aborder dans cette lettre — la démocratie du chapitre, les élections, les relations entre les différents niveaux de gouvernement dans l’Ordre — toutes explorent des aspects du pouvoir que nous détenons tous dans nos relations les uns avec les autres. Et pour que notre prédication ait du pouvoir, nous devons vivre ces relations de pouvoir de manière ouverte, saine et conforme à l’Évangile.
La vie de Jésus montre une relation paradoxale au pouvoir. Il était l’homme des paroles puissantes: il a appelé les disciples à le suivre, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a fait lever les morts et a osé affronter les autorités religieuses de son époque. Et pourtant il était l’impuissant qui a refusé la protection de l’épée de Pierre, et qu’on a cloué sur une croix.
Chez cet homme fort et vulnérable, le pouvoir guérissait toujours et donnait la vie. Jamais il ne rabaissait, ne réduisait, ne diminuait, ne détruisait. Ce n’était pas tant un pouvoir sur les gens, qu’un pouvoir qu’il leur donnait. Et en effet il fut le plus puissant justement en refusant d’être un canal de violence, en la portant dans son corps, en la laissant prendre fin avec lui. Il a pris sa passion, sa mort, dans ses propres mains, et il l’a rendue féconde, il en a fait un don, l’Eucharistie.
Le bon gouvernement dans nos communautés exige que nous vivions les relations de pouvoir de cette manière, en accordant du pouvoir à nos frères plutôt que de les miner. Cela exige de nous le courage d’être vulnérables. Josef Pieper écrivait: « La force d’âme suppose la vulnérabilité ; sans vulnérabilité, il n’y a aucune possibilité de force. Un ange ne peut être courageux parce qu’il n’est pas vulnérable. Avoir du courage signifie être prêt à supporter une blessure. Comme les êtres humains sont substantiellement vulnérables, oui nous pouvons être courageux. » Notre gouvernement invite à vivre cette vulnérabilité courageuse.
L’autorité
Tout gouvernement dépend de l’exercice de l’autorité. Que l’autorité suprême de l’Ordre soit le chapitre général est une reconnaissance du fait que pour nous, l’autorité est accordée à tous les frères. La succession de nos chapitres généraux, de définiteurs, et de provinciaux, suggère que pour nous, l’autorité est multiface. Les supérieurs jouissent de l’autorité en vertu de leur charge; les théologiens et les penseurs par la vertu de leur savoir; les frères engagés dans des apostolats pastoraux jouissent de l’autorité en raison de leur contact avec les gens dans leur combat pour vivre la foi; les frères âgés jouissent de l’autorité en considération de leur expérience; les frères plus jeunes ont l’autorité qui vient de leur connaissance du monde contemporain et de ses questions.
Le bon gouvernement fonctionne bien lorsque nous prenons en considération et respectons l’autorité dont jouit chaque frère, et refusons de rendre absolue toute forme unique d’autorité. Si nous rendions absolue l’autorité des supérieurs, l’Ordre cesserait d’être une fraternité; si nous rendions absolue l’autorité des penseurs, nous ne deviendrions alors qu’une étrange institution académique; si nous rendions absolue l’autorité des pasteurs, nous trahirions notre mission dans l’Église; si nous rendions indiscutable l’autorité des anciens, alors nous n’aurions plus d’avenir; si nous ne donnions autorité qu’aux jeunes, nous n’aurions pas de racines. La santé de notre gouvernement dépend de la possibilité d’interaction entre toutes les voix qui façonnent notre communauté.
Bien plus, nous faisons partie de la Famille dominicaine. Cela signifie que nous sommes aussi appelés à être attentifs à la voix de nos moniales, de nos soeurs, de notre laïcat. Ils doivent eux aussi avoir autorité dans nos délibérations. Les moniales ont une autorité qui découle de leurs vies consacrées à la contemplation; nos soeurs ont une autorité qui vient de leurs vies de femmes à la vaste expérience pastorale. Souvent, elles peuvent nous en apprendre beaucoup grâce à leur proximité avec le peuple de Dieu, en particulier les pauvres. Et de plus en plus souvent aussi, des soeurs ayant une formation théologique ont beaucoup à nous apprendre. Les laïcs ont une autorité de par leurs expériences et connaissances différentes, parfois parce qu’ils sont mariés, ont des enfants. En partie, ce que nous offrons à l’Église consiste en une communauté où chacune de ces autorités doit être reconnue.
La responsabilité
Tout gouvernement est l’exercice de notre responsabilité partagée, pour la vie et pour la mission de l’Ordre. Son fondement est la confiance que nous devrions avoir les uns dans les autres. Quand saint Dominique envoya prêcher les jeunes frères, les Cisterciens se scandalisèrent de sa confiance en eux, et il leur dit: « Je sais, je sais avec certitude, que mes jeunes vont partir et revenir, qu’ils seront envoyés et rentreront; mais vos jeunes seront tenus enfermés et s’en iront quand même. »
L’objectif de toute notre formation est de préparer des frères libres et responsables, et c’est pourquoi les Constitutions disent que la responsabilité première de la formation personnelle incombe au candidat lui-même (LCO 156). Notre gouvernement est fondé sur une confiance dans les frères. Nous montrons notre confiance en acceptant un frère à la profession; cette même confiance se manifeste dans l’élection des supérieurs. Les supérieurs aussi doivent se fier aux frères qu’ils chargent de responsabilités. Nous serons parfois déçus, mais ce n’est pas une raison pour renoncer à cette confiance mutuelle fondamentale. Comme l’a écrit Simon Tugwell OP: « En dernière analyse, pour que les dominicains fassent correctement leur travail, ils doivent être exposés à certains aléas, et on doit leur faire confiance pour faire face à ces aléas — et l’Ordre dans son entier doit accepter le fait que quelques individus, peut-être beaucoup, abuseront de cette confiance. »
Pareille confiance nous demande de dépasser la peur, peur de ce qui arrivera si les frères ne sont pas contrôlés! Nous devons former les frères à vivre avec cette liberté de Dominique. Comme le dit Felicísimo Martínez OP: « Il n’y a pas de plus grand service à rendre à une personne que de l’éduquer à la liberté. (…) La peur de la liberté peut prendre racine dans la bonne volonté de ceux qui se sentent responsables des autres, et elle peut être légitimée par un appel au réalisme, mais cela n’en fait pas moins un manque de foi dans la vigueur et la force de l’expérience chrétienne. La peur et le manque de foi vont toujours de pair. »
La peur détruit tout bon gouvernement. Sainte Catherine écrivait au Pape Grégoire XI: « Je désire vous voir libre de toute crainte servile, car je vois bien que dans la crainte, l’homme affaiblit la sainte résolution et le bon vouloir. (…) Debout mon Père, courage! Car je vous le dis, vous n’avez rien à craindre! » La peur est servile, et par conséquent incompatible avec notre statut d’enfants de Dieu, et de frères et soeurs. Elle est par-dessus tout mauvaise chez un supérieur, appelé à aider ses frères à croître en confiance et hardiesse.
Mais cette confiance réciproque n’est pas une excuse pour une négligence mutuelle. Parce que j’ai confiance en mon frère, cela ne veut pas dire que je peux cesser de penser à lui et le laisser simplement aller son chemin. Si le bon gouvernement nous donne une responsabilité partagée, il s’enracine donc dans la responsabilité réciproque que nous sommes appelés à assumer les uns pour les autres. Quand nous faisons profession, nous mettons nos mains dans celles d’un frère. C’est un geste d’extraordinaires vulnérabilité et tendresse. Nous remettons notre vie à nos frères, et nous ne savons pas ce qu’ils en feront. Nous sommes dans les mains les uns des autres.
Les vies des Frères nous parlent d’un certain Tedalto dont la vocation traversait une période difficile. « Tout ce qu’il voyait et sentait lui semblait une deuxième mort. » Il était à son entrée dans l’Ordre un homme agréable et calme, mais était devenu à présent de si mauvaise humeur qu’il alla jusqu’à frapper le sous-prieur avec le Psautier. Nous avons tous fait cette expérience! Quoique nous puissions considérer que Tedalto n’aurait jamais dû être accepté dans l’Ordre, Jourdain de Saxe refusa de l’abandonner, et pria avec lui jusqu’à ce que son coeur fût apaisé. En l’acceptant à la profession, nous acceptons la responsabilité d’un frère, de son bonheur et de son épanouissement. Sa vocation est notre souci commun.
Luttons-nous toujours pour la vocation de nos frères? Si un frère traverse un moment de crise, est-ce que je détourne le regard? Vais-je prétendre que le respect de son intimité justifie ma négligence? Ai-je peur d’écouter les doutes qu’il pourrait me faire partager? J’espère bien que si jamais j’en arrive à frapper le sous-prieur avec le bréviaire, mes frères auront soin de moi! Aussi dois-je avoir la confiance, dans les moments de crise, de partager avec mes frères, assuré de leurs compréhension et miséricorde.
En tant que prêcheurs du Verbe fait chair, nous sommes particulièrement responsables des paroles que nous prononçons. Le Verbe doit se faire chair par-dessus tout dans les paroles de « grâce et vérité ». Les Premières Constitutions ordonnent au maître des novices d’enseigner aux novices « à ne jamais parler des absents sinon pour en dire du bien » (I, 13). Ce n’est pas là un excès de pieux scrupules nous évitant la confrontation avec la réalité de nos frères tels qu’ils sont. C’est une invitation à prononcer des paroles de « grâce », une reconnaissance du pouvoir qu’ont nos mots de blesser, de détruire, de bouleverser et miner nos frères.
C’est un aussi grand défi que d’apprendre à dire des paroles de vérité. Il est fondamental pour notre démocratie que nous osions parler en vérité entre nous, que nous osions mettre en mots les tensions et les conflits qui blessent la vie commune et font obstacle à la mission commune. Nous le faisons bien souvent avec n’importe quel frère sauf l’intéressé. Si le comportement d’un frère nous inquiète, alors nous devons oser en parler franchement avec lui, avec délicatesse et fraternellement. Un chapitre n’est pas toujours le premier endroit pour cela. Nous devons oser aller frapper à sa porte et lui parler seul à seul (Mt 18,15). Nous devons prendre le temps de nous parler les uns aux autres, surtout aux frères dont nous sommes plus distants. La communication à l’intérieur d’un chapitre dépendra d’un large travail de communication en dehors. Si nous faisons cet effort, nous aurons renforcé la fraternité entre nous de sorte que nous pourrons aborder ensemble les questions difficiles. Alors nous pourrons avoir ces débats ouverts sur notre vie commune, comment nous échouons et comment nous pouvons croître, ce qui était le but des anciens chapitres des coulpes. Le chapitre général de Caleruega (43,2) fait d’excellentes recommandations sur la manière dont cela peut avoir lieu aujourd’hui.
L’un des signes de cette confiance dans les frères se manifeste lorsque nous sommes prêts à les élire à des postes de responsabilité, même s’ils sont jeunes ou sans expérience. Jourdain a été choisi pour être provincial de Lombardie alors qu’il avait à peine plus d’un an dans l’Ordre, et il en a été Maître au bout de deux ans. Quel extraordinaire signe de confiance dans un homme qui aujourd’hui n’aurait même pas encore fait sa profession solennelle. On trouve parfois dans l’Ordre des hommes âgés qui s’accrochent à des responsabilités, peut-être par peur de ce que les jeunes pourraient faire et où cela pourrait nous conduire. Et souvent ces « jeunes » ne sont même pas si jeunes de toute façon, sûrement bien assez vieux pour être pères de famille et occuper des postes importants dans le monde séculier. Quelques fois, ils ne sont même pas beaucoup plus jeunes que moi! Mais notre formation et notre mode de gouvernement devraient nous faire oser confier nos vies à des frères qui nous amènerons nous ne savons pas où. À sa profession, un frère met ses mains dans les nôtres. Mais l’accepter comme frère avec une voix, le droit de vote, signifie que nous avons nous aussi mis nos mains dans les siennes.
2.2 La démocratie
Quand on me demanda, lors d’une interview à la télévision française, ce qui était au coeur de notre spiritualité, je fus presque aussi surpris que l’interviewer de m’entendre répondre: « la démocratie ». Pourtant elle est au coeur de nos vies. Être frère, c’est avoir une voix et le droit de vote. Néanmoins, nos votes ne sont pas simplement ceux de groupes de simples particuliers cherchant à arranger leurs décisions de façon à laisser à chacun la plus grande liberté personnelle possible. Notre démocratie devrait exprimer notre fraternité. Elle est une expression de notre unité dans le Christ, corps unique.
La démocratie est pour nous plus qu’un vote qui révèle la volonté de la majorité. Elle implique aussi la découverte de la volonté de Dieu. Notre attention à notre frère est expression de cette obéissance au Père. Cette attention requiert de l’intelligence. Hélas, Dieu ne parle pas toujours clairement par la bouche de mon frère. À vrai dire, ce que dit celui-ci est parfois manifestement faux! Et pourtant, il y a au coeur de notre démocratie la conviction que même si ce qu’il dit est idiot et erroné, un brin de vérité attend encore d’en être retiré. Quelque soit l’ampleur de mon désaccord, ce frère peut m’apprendre quelque chose. Apprendre à écouter cela est un exercice d’imagination et d’intelligence. Il faut que j’ose douter de ma propre position, m’ouvrir à ses questions, devenir vulnérable à ses doutes. C’est un acte de charité, né d’une passion pour la vérité. C’est en fait la meilleure préparation à être prêcheur « de grâce et de vérité ».
Fergus Kerr OP disait dans son sermon d’ouverture au chapitre de la province d’Angleterre en 1996 :
« S’il y a bien une chose que nous devrions certainement réussir dans un chapitre, c’est démontrer cet engagement à chercher la vérité, à écouter pour saisir ce avec quoi nous pouvons être d’accord dans ce sur quoi nous sommes en désaccord, à sauver ce qui est vrai dans ce que les autres pensent. (…) Depuis que je suis dans l’Ordre, (…) ce que j’apprécie de plus en plus, c’est une manière de penser — de s’attendre à ce que les autres aient des idées qui différeront peut-être des nôtres, de s’attendre aussi à comprendre pourquoi ils croient ceci ou cela — si seulement nous avons l’imagination, le courage, la foi dans la puissance ultime de la vérité, la charité, pour écouter ce que disent les autres, pour écouter en particulier ce dont ils ont peur quand ils semblent réticents à accepter ce que nous voulons qu’ils voient: il y a bien des voies pour découvrir la vérité, mais j’espère que celle-ci, l’Ordre des Prêcheurs essaiera toujours de la suivre. »
Notre bien-aimée démocratie prend du temps. C’est du temps que nous nous devons réciproquement. Cela peut être ennuyeux. Peu de gens s’ennuient autant que moi aux longues réunions. Elles ne sont pas efficaces. Je ne crois pas que nous serons jamais parmi les Ordres les plus efficaces de l’Église, et ce serait une erreur de notre part que de chercher à le devenir! Rendons grâce à Dieu, il y a des Ordres plus efficaces que le nôtre. Grâce à Dieu, nous ne cherchons pas à rivaliser avec eux. Une certaine efficacité est nécessaire pour que la paralysie ne nous fasse pas perdre notre liberté. Mais si nous faisons de l’efficacité notre objectif, nous risquons de ruiner cette liberté qui est notre don à l’Église. Notre tradition d’accorder une voix et le droit de vote à chaque frère n’est pas toujours le moyen le plus efficace de parvenir aux meilleures décisions, mais elle témoigne des valeurs évangéliques que nous offrons à l’Église, et dont l’Église a besoin aujourd’hui plus que jamais.
2.3 Le vote
Le but du dialogue dans nos chapitres est que la communauté parvienne à l’unanimité. Cela n’est pas toujours possible. Nous devons alors arriver à une décision par un vote. Une des responsabilités les plus délicates d’un supérieur est de juger du moment où un vote doit avoir lieu. Il doit amener les frères aussi près que possible de l’unanimité, sans attendre trop longtemps que la communauté reste paralysée par l’indécision.
Quand on en vient au vote, le but n’est pas de gagner. Un chapitre qui vote est absolument différent d’un parlement ou d’un sénat. Notre vote, comme le débat, fait partie du processus par lequel nous cherchons à discerner ce qui est nécessaire au « bien commun ». L’objet du vote n’est pas de déterminer si c’est ma volonté ou celle des autres frères qui triomphera, mais de découvrir ce que requièrent la construction de la communauté et la mission de l’Ordre.
Le vote, dans notre tradition, n’est pas un concours entre groupes, mais le fruit d’une attention portée à ce que tous les frères ont dit. Dans la mesure du possible, sans trahir aucune conviction fondamentale, je devrais m’efforcer de voter pour des propositions qui reflètent les préoccupations, les craintes et les espoirs de tous les frères, pas seulement de la majorité. Sans quoi il se pourrait en effet que je « gagne », mais c’est la communauté qui perdra. En politique, un vote exprime la fidélité à un parti. Pour nous, le vote exprime qui nous sommes, des frères voués à la mission commune de l’Ordre.
Il s’ensuit que le résultat d’un vote est une décision de la communauté et non pas de ceux-là seuls qui ont voté en sa faveur. C’est la communauté qui est parvenue à une décision. Je suis libre de ne pas être d’accord avec le résultat, et même de faire ensuite campagne pour son annulation, mais j’exprime mon identité de membre de la communauté en mettant en oeuvre la décision. Se fier à la simple majorité fut une profonde innovation de la tradition dominicaine. Auparavant, le choix du supérieur avait été soit le résultat d’un consensus, soit la décision des frères les plus « avisés ». L’on considérait trop risqué de se fier à la majorité. C’est pour nous l’expression de notre confiance dans les frères.
Cela n’est jamais aussi vrai que dans l’élection des supérieurs. Il est bien naturel, avec des frères qui pensent comme nous, de discuter qui ferait un bon supérieur, mais il serait contraire à la nature de notre démocratie de présenter un frère comme le « candidat » d’un parti. C’est pourquoi je doute qu’il soit bien approprié de contacter un frère à l’avance pour lui demander s’il est prêt à se poser en candidat. Il est bien sûr utile de savoir si un frère accepterait ou refuserait son élection, mais le danger est qu’il apparaisse comme le candidat d’un groupe, et accepte l’élection en tant que son représentant. Et puis, peu des frères qui feraient de bons supérieurs auront le désir d’être candidats, tandis qu’ils accepteront plus probablement l’élection comme un acte d’obéissance à leurs frères. Chercher des candidats qui déclarent leur consentement à être supérieurs pourrait bien nous conduire à ne pas choisir les frères les plus adaptés à la fonction.
Un supérieur est élu pour servir tous les frères, pour le bien commun de l’Ordre. Son élection est le résultat d’un vote que « nous » avons fait, qu’importe pour qui nous avons voté. Une fois élu, il a besoin du soutien de la communauté tout entière, car nous l’avons élu, et qu’importe pour qui j’ai personnellement voté. Nous avons prié pour être guidés par l’Esprit Saint avant le vote, et nous devons croire que cette orientation nous a bien été donnée.
L’une des responsabilités les plus solennelles que puisse exiger de nous notre démocratie est de voter l’admission dans l’Ordre de candidats, ou la profession de nos frères. C’est une très belle expression de notre responsabilité commune. Notre vote est alors recherche de la vérité, participant du processus qui permettra de discerner si ce frère est appelé par Dieu à partager notre vie. Il ne saurait en aucun cas être l’expression d’une politique partisane, ni de nos affinités ou notre aversion pour un frère. Le vote doit être l’expression d’une charité vraie, cherchant à discerner ce qui est le mieux pour ce frère. Dans ce cas, un frère à qui l’on refuse la profession ne se sentira pas rejeté, mais que nous l’avons aidé à discerner ce qu’est en fait la volonté de Dieu à son endroit. Si notre vote exprime des conflits de pouvoir au sein de la communauté, des luttes idéologiques, des amitiés ou inimitiés, nous aurons alors trahi une immense responsabilité. Nous encouragerons ainsi les frères en formation à dissimuler leur être véritable, et formerons des frères inaptes à gouverner à leur tour.
3. LES NIVEAUX DU GOUVERNEMENT DOMINICAIN
3.1. La responsabilité à saisir
Le Verbe que nous proclamons n’est pas une parole abstraite, car il s’est fait chair et sang. Ce que nous prêchons n’est pas une théorie du salut mais la grâce incarnée dans la vie, la mort et la résurrection d’un homme, il y a quelque deux mille ans. De même pour nous, ne suffit-il pas d’avoir une belle théorie de la responsabilité. Nous devons la vivre. Nous avons de formidables structures démocratiques, qui nous offrent la liberté, mais c’est une liberté que nous devons saisir.
J’ai acquis la conviction au long de mes visites aux provinces, que l’un des problèmes majeurs que nous affrontons est de répondre de manière efficace et responsable aux défis actuels. Nous souffrons parfois de ce que j’ai souvent appelé « le mystère de la responsabilité disparue ». Comment se fait-il que nous, pour qui la responsabilité est essentielle, la laissions si souvent filer entre nos doigts? Nos chapitres, général et provincial, sont normalement des moments de vérité, où nous regardons avec honnêteté ce qui doit être fait et comment nous allons le faire. De grandes décisions y sont prises. Des textes formidables y sont écrits. Mais parfois, après avoir tout vu et analysé si clairement, nous sommes comme « un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s’observe, part, et oublie comment il était » (Jc 1, 23).
Une des raisons pour lesquelles nous fuyons la responsabilité, quoique nous soyons appelés à la liberté, est que la liberté nous fait peur, la responsabilité est ennuyeuse et il est donc tentant de fuir. Nous avons de nombreux niveaux de responsabilité dans l’Ordre, et il est souvent attirant de s’imaginer que c’est à un autre niveau qu’elle devrait être exercée. « Il faut faire quelque chose », mais c’est en général quelqu’un d’autre qui doit le faire, le supérieur, ou le chapitre, ou même le Maître de l’Ordre! « La province doit agir », mais qu’est-ce que la province sinon nous-mêmes? Pour être véritablement les héritiers de la liberté de Dominique, nous devons identifier la responsabilité qui nous incombe justement et nous en saisir. Nous devons articuler les relations entre les différents niveaux de gouvernement de l’Ordre.
Les Constitutions disent que notre gouvernement se distingue par « la collaboration organique et équilibrée de toutes les parties », et que « son pouvoir, qui est universel dans sa tête (…) se trouve proportionnellement participé par les provinces et les couvents, dotés chacun de l’autonomie convenable » (LCO I. § VII). Pour que notre gouvernement soit dans les faits « organique et équilibré », et reconnaisse l’autonomie convenable à chaque frère, couvent et province, nous devons clarifier les relations entre les différents niveaux de gouvernement dans l’Ordre. Je n’aime pas le mot « niveaux » mais je n’ai pas réussi à trouver de terme meilleur.
Les relations entre les différents niveaux de responsabilité dans l’Ordre s’articulent au moins autour de trois principes fondamentaux.
a) L’itinérance
Aucun frère n’est ou ne devrait être trop longtemps supérieur. Il y a une limite au nombre de mandats qu’un frère peut exercer comme prieur ou provincial sans postulation. Nous n’avons pas d’Abbés à vie. Il ne devrait pas y avoir de caste des supérieurs, car le gouvernement est la responsabilité commune de tous les frères. Si nous sommes élus supérieurs, c’est un service que nous devons offrir. Mais il n’y a ni carrière, ni promotion, dans l’Ordre des Frères Prêcheurs.
b) Nous devons nous affermir mutuellement
Il ne peut y avoir de compétition pour le pouvoir de la responsabilité, ni pour s’en emparer, ni pour l’éviter. Nous devons nous affermir mutuellement. L’une des responsabilités primordiales d’un prieur est d’affermir ses frères, d’avoir confiance en leur capacité à donner plus qu’ils ne l’ont jamais imaginé, et de les soutenir quand ils prennent une position courageuse sur quelque problème que ce soit. Lorsque Montesinos prêcha son célèbre sermon sur les droits des Indiens, c’est son prieur, Pedro de Córdoba qui le soutint, en disant que c’était la communauté tout entière qui avait prêché ce sermon. Chaque frère est un don pour la communauté et c’est une obligation pour le supérieur d’accueillir et de valoriser les talents des frères que Dieu nous a donnés.
Mais cette relation est réciproque. Chaque frère est à son tour particulièrement responsable du frère que nous avons élu. Une des façons que nous avons d’affirmer la valeur d’un frère, c’est de l’élire supérieur. Ayant placé une charge sur ses épaules, nous avoir le devoir de le soutenir, d’avoir soin de lui, et de l’encourager. Et s’il échoue, il a besoin de notre pardon. Si nous avons un supérieur inefficace, ou manquant de vision, c’est bien parce que nous avons choisi ce frère. Ne le blâmons pas pour des fautes que nous connaissions déjà lorsque la communauté l’a choisi. Plutôt que de l’accabler sous le poids de son échec, nous devons l’aider à faire tout ce dont il est capable.
Ce que le Seigneur a dit à Pierre, il nous le dit à tous: « Affermis tes frères » (Luc 22, 32). Si notre système de gouvernement, avec toute sa complexité, travaille à nous ôter mutuellement tout pouvoir, alors nous sommes totalement paralysés et avons perdu la liberté de Dominique. Mais s’il travaille à l’affermissement de tous, alors nous pouvons faire de grandes choses.
c) Discerner le bien commun
Le discernement et la poursuite du bien commun sont la tâche principale du gouvernement, et c’est là que les relations entre les différents niveaux de gouvernement peuvent devenir plus tendues et douloureuses (cf. 1.2). Un frère se trouvera assigné à une communauté dans laquelle il ne souhaite pas vivre ou à une tâche pour laquelle il ne se sent pas fait. Ou bien une province se verra demander de laisser partir pour quelque mission de l’Ordre un frère qu’elle peut difficilement supporter de perdre. Cela est dur, et pourtant c’est la plus claire expression de notre unité en une mission commune, et souvent, le bien commun, plus large, doit avoir la priorité sur le bien plus local, pour que l’Ordre ne se fragmente pas en une vague association d’individus.
La demande est douloureuse, des deux côtés. Au lieu de faire face à cette souffrance, le supérieur pourrait être tenté de demander des volontaires, ou de déclarer qu’on ne peut rien faire. Mais ce serait là une fuite devant la responsabilité pour laquelle on l’a élu, et elle mènerait à la paralysie.
Il faut parfois oser gouverner, justement parce que nous tenons à la liberté qui est au coeur de la vie dominicaine. Nous chérissons cette liberté des frères de se réunir en chapitre et de prendre des décisions sur notre mission et notre vie communes, décisions qui peuvent être mises en oeuvre et ne resteront pas de simples déclarations sur le papier. Nous chérissons aussi la liberté avec laquelle un frère a fait don de sa vie à l’Ordre et à sa mission commune. Ne pas oser demander à un frère de se donner pour une mission serait manquer au respect de ce libre don de soi qu’il a fait à sa profession. J’admets avoir souvent hésité à demander à un frère ce que je soupçonne qu’il ne veut pas donner. Qui suis-je pour demander cela à mon frère ? Je ne demande cependant pas une soumission à ma volonté, mais l’acceptation de ce bien commun que les frères ont déterminé ensemble. Il arrive parfois que l’on doive insister, « au nom de l’obéissance ». Mais dans ce cas, ce serait une erreur de croire que c’est la meilleure image de l’obéissance, puisqu’elle est pour nous avant tout fondée sur une attention mutuelle, dans laquelle nous cherchons tous deux à comprendre ce qui est juste et meilleur.
Je vais à présent vous faire partager quelques brèves observations sur quelques uns des défis que nous relevons en saisissant la responsabilité aux différents niveaux de gouvernement dans l’Ordre. Ce n’est en aucune manière un tableau exhaustif. Il y faudrait un livre.
3.2 Le gouvernement conventuel
Il est fondamental pour la vie de l’Ordre que nous partagions la responsabilité dans les communautés où nous vivons. Nous n’élisons pas un frère supérieur de la communauté pour nous décharger de la responsabilité de nos vie et mission communes, mais pour nous aider à les partager. Dans certaines provinces, il est difficile de trouver des frères qui acceptent leur élection au priorat. Une raison possible est que nous comptons sur lui pour assumer seul toutes les responsabilités. Le prieur, ayant d’abord été une figure majestueuse, est parfois devenu le régisseur de la maison, celui qui doit perpétuellement résoudre les problèmes de la communauté. Que mon ampoule ne marche plus ou que le chauffage central ne fonctionne pas, c’est au prieur de résoudre le problème. Ce n’est qu’en devenant prieur d’Oxford que j’ai rencontré le problème de savoir comment le lait va de la vache au pot, pour que je puisse mettre du lait dans mon café! En vérité le prieur est appelé à « servir par la charité » (LCO 299), mais cela ne signifie pas que nous pouvons lui entasser toutes les responsabilités sur les épaules, et le laisser seul et sans secours. Le droit que nous avons d’élire un supérieur implique le devoir de le soutenir dans la construction de notre vie et notre mission communes.
Les supérieurs ont aussi besoin du soutien du provincial et de son conseil. Plusieurs provinces tiennent des réunions annuelles des supérieurs, où discuter les défis qu’ils affrontent et s’offrir mutuellement soutien et encouragement. La province de Saint-Albert-le-Grand aux États-Unis a même édité un excellent manuel pour aider les nouveaux supérieurs à comprendre leur rôle et comment y survivre.
Serviteur du bien commun, le prieur a parmi ses tâches principales celle de présider le chapitre et d’aider les frères à rechercher un consensus. Il doit par-dessus tout s’assurer que tous les frères ont une voix, en particulier les plus timides ou ceux qui soutiennent des idées minoritaires. Il est là pour protéger le faible contre le fort. « Il y a des frères fragiles qui peuvent beaucoup souffrir de l’écrasement que leur imposent, bien involontairement, les fortes personnalités. Le rôle du prieur est de les protéger, d’une part en mettant leurs dons en valeur, et d’autre part en faisant prendre conscience aux fortes personnalités du devoir qui leur incombe de ne pas écraser les autres. » Sainte Catherine écrivait aux dirigeants de Bologne qu’ils laissaient souvent les forts s’en sortir à bon compte, alors qu’avec les faibles « qui sont bien peu de chose et dont ils n’ont rien à craindre, ils montrent un grand zèle pour la justice; et sans nulle pitié ni miséricorde, ils infligent de sévères châtiments à la moindre faute ». Même un supérieur de communauté dominicaine peut être tenté de montrer plus de zèle à désigner les manquements du faible que ceux du fort.
Le supérieur doit consacrer du temps à chaque frère. Il ne suffit pas de présider aux réunions de la communauté. Il doit être attentif à chaque frère, et les rencontrer régulièrement seuls, afin que chacun d’eux puisse partager ses espoirs et ses craintes librement, sûr de trouver une oreille attentive. Surtout, un supérieur doit avoir le souci de la dignité de chaque frère. Si je puis donner un conseil, c’est bien celui-ci: ne laissez jamais, au grand jamais, humilier un frère.
L’une des fonctions les plus importantes du supérieur consiste à aider la communauté à déterminer son « projet communautaire ». Son caractère central pour nos vie et mission communes a été souligné par les trois derniers chapitres généraux de l’Ordre, mais certaines provinces le négligent. Cela est parfois dû à un malentendu qui fait croire que chaque communauté doit identifier une tâche unique à laquelle tous les frères doivent se consacrer, comme par exemple une école ou une paroisse. La première étape est pour chaque frère de parler à la communauté de sa vie et de ses ministères, de partager les joies et les déceptions qu’il rencontre. Mais cela doit nous conduire plus loin, à une profonde collaboration dans nos tâches respectives, et à l’émergence d’une mission commune. C’est le moment pour la communauté d’évaluer ensemble la présence apostolique de l’Ordre dans une région, et jusqu’où elle est en cohérence avec les priorités de l’Ordre. Je soutiens fortement la recommandation 44 du chapitre général de Caleruega, que chaque communauté tienne des journées annuelles pour évaluer les ministères des frères et planifier l’année à venir.
La démocratie ne signifie pas que le prieur doive tout soumettre au chapitre. Nous élisons des frères pour assumer certaines responsabilités afin de pouvoir être libres pour la mission. Ayant élu un frère pour gouverner, nous devons le laisser libre de le faire. Les Constitutions définissent quand le prieur doit consulter la communauté, ou quand le chapitre ou le conseil a pouvoir de décider. Mais le supérieur ne devrait pas s’en servir comme excuse pour nier à la communauté la responsabilité de quoi que ce soit d’important pour les frères. « Ce qui concerne tous doit être approuvé par tous. » Le principe fondamental fut établi par Humbert de Romans au XIIIe siècle, selon lequel le prieur doit consulter la communauté pour tous les sujets d’importance, mais ce n’est pas la peine de le faire si la question est insignifiante, et pour ce qui est des sujets intermédiaires, la prudence voudrait qu’il consulte ses conseillers.
Le rôle démocratique du chapitre est tellement central pour notre vie que nous sommes parfois tentés de considérer que le prieur n’est que le président du chapitre, que son unique rôle est de guider les débats de manière que les frères parviennent, si possible, à un consensus. Mais les Constitutions (LCO 299, 300) précisent aussi clairement que le prieur a un rôle de garant de la vie religieuse et apostolique de la communauté. Par exemple, il doit prêcher aux frères régulièrement. Cela n’entame en aucune façon le principe démocratique. Cela démontre que la communauté locale fait partie de la province, tout comme la province fait partie de l’Ordre, et la communauté locale ne peut donc pas prendre de décisions en contradiction avec ce que les frères ont décidé en chapitre provincial ou général. C’est justement au nom de notre démocratie la plus large que le prieur local peut juger qu’il ne saurait accepter la volonté de la majorité. Si les frères devaient voter l’installation d’un sauna dans chaque cellule, il devrait refuser son consentement!
3.3 Le gouvernement provincial
Au chapitre général de Mexico, la province est décrite comme le centre normal d’animation du dynamisme apostolique de l’Ordre (N° 208). C’est au niveau de la province qu’une grande part de la planification effective de la mission de l’Ordre doit avoir lieu. Ayant à ce jour visité quelque trente-cinq entités de l’Ordre, je vais devoir faire de grands efforts pour limiter mon texte. Rendez grâce que je n’aie pas attendu une autre année pour écrire cette lettre ! Je regrette qu’il n’y ait pas eu de place pour parler des relations des vicariats avec les provinces.
a) Créer de nouveaux projets
Chaque province a besoin d’établir des projets et institutions qui donnent corps et forme à notre mission commune. Pour la plupart, nous sommes amenés à l’Ordre par notre désir d’être prêcheurs. Mais quelle forme prend cette prédication? Quels projets incarnent aujourd’hui notre charisme dominicain?
Nous pouvons succomber à la profonde suspicion envers les institutions qui fait partie de notre culture contemporaine, et pourtant la fondation de l’Ordre fut un acte de suprême créativité institutionnelle. Dominique et ses frères ont répondu au besoin de prêcher l’Évangile avec une extraordinaire imagination, l’invention d’une nouvelle institution, notre Ordre. Nous avons besoin d’une telle créativité. Les institutions ne sont pas nécessairement complexes ou coûteuses: une station de radio ou une page sur Internet, une université ou un groupe de musique, un couvent ou une galerie d’art, une librairie ou une équipe de prêcheurs itinérants. Tous sont des « institutions » pouvant soutenir de nouvelles voies de prédication. L’incarnation du Verbe de Dieu à de nouvelles frontières exige de nouvelles conceptions.
Quand nous nous réunissons en chapitre pour planifier les missions de nos provinces, nous devons toujours nous demander si les institutions que nous entretenons servent la mission de l’Ordre. Nous donnent-elles une voix dans les débats d’aujourd’hui? Saint Dominique envoya les frères dans les nouvelles universités, parce que c’était là que les questions importantes de l’époque étaient discutées. Où nous enverrait-il aujourd’hui?
La planification de la mission nous demande cette créativité institutionnelle, la capacité d’imaginer de nouveaux projets, de nouvelles chaires, qui donnent à l’Ordre une voix et une visibilité. À une certaine période, les jeunes dominicains français avaient inventé une nouvelle forme de mission: « la mission à la plage », qui fut très populaire! Un frère américain, chargé d’une mission dans le sud protestant du pays, transforma une caravane en chapelle itinérante avec une chaire. Si nous voulons vraiment partager de toute urgence la bonne nouvelle de Jésus Christ, alors nous utiliserons pleinement notre imagination.
Si nous n’avons pas ce courage et cette ingéniosité, soit nous resterons en panne, à attendre dans nos églises que les gens viennent à nous alors qu’ils seront ailleurs, assoiffés d’une parole. Ou bien nous nous retrouverons à travailler pour d’autres institutions, fondées par d’autres groupes, même des ordres religieux, qui auront eu plus d’audace et d’imagination que nous.
Nous avons besoin de frères jeunes et de vocations nouvelles pour prêcher de manières que nous ne pouvons encore imaginer. Quand la province de Chicago acceptait des novices voici quelques années, qui aurait alors deviné qu’aujourd’hui, ces jeunes prêcheraient sur le World Wide Web et envisageraient même la fondation d’un centre d’étude virtuel?
b) Planifier
« C’est dans les rêves que commence la responsabilité » écrivait W. B. Yeats. Les chapitres provinciaux devraient être des moments où nous osons répondre aux défis en rêvant de nouveaux projets. Souvent les chapitres prennent des décisions courageuses et audacieuses, de s’engager davantage pour la justice et la paix, de développer notre présence dans les médias, d’envoyer des frères dans les missions. Dieu merci! Et pourtant, souvent, quatre ans après, il ne s’est pas passé grand chose. Il y a une prière pour les chapitres dans l’ancien missel dominicain, dans laquelle les frères prient pour que l’Esprit Saint leur fasse don « de chercher à discerner ces choses qu'(Il) désire, et utiliser leurs forces pour les accomplir ». Probablement cette prière était-elle nécessaire parce que les frères, alors comme aujourd’hui, trouvaient plus facile de prendre des décisions que de les mettre à exécution. Mais si nous n’apprenons pas à la fois à prendre les décisions et à les mettre en oeuvre, nous deviendrons des désenchantés de tout gouvernement, et notre liberté et notre responsabilité seront détruites.
Incarner le Verbe dans notre temps, trouver de nouvelles formes de prédication maintenant, cela doit commencer par les rêves, mais aboutir à une planification rigoureuse et pratique. Le bon gouvernement repose sur la vertu de la prudence, une sagesse pratique. Nous devons parvenir à un accord sur ce que nous pouvons réaliser. Nous ne pouvons tout faire à la fois, aussi devons-nous déterminer l’ordre dans lequel réaliser les projets. Nous devons faire face aux conséquences de nos choix, même si cela implique une profonde réorientation de la mission et de la vie de la province. Nous devons décider du processus au cours duquel un projet sera planifié, proposé, évalué et mis en oeuvre. Si le processus ne fonctionne pas, nous devons alors chercher à comprendre pourquoi et comment y remédier.
c) Les défis de la croissance et de la diminution
Il y a dans la vie d’une entité de l’Ordre des moments spécifiques où une planification attentive est particulièrement importante.
La transition vers une identité pleinement dominicaine
Il y a des temps successifs dans la naissance de l’Ordre dans un nouveau pays. Il arrive parfois, dans les débuts, que pour nous faire accepter et entrer dans une nouvelle culture, nous devions accepter des apostolats qui n’expriment pas pleinement notre charisme de prêcheurs et d’enseignants.
Partout dans l’Ordre, en Afrique, en Amérique Latine, en Europe de l’Est et en Asie, j’ai vu l’excitation et la difficulté de passer cette transition vers l’étape suivante de la vie dominicaine. C’est un moment de profonde transformation, où les frères essaient de former des communautés, d’abandonner certaines paroisses, d’adopter de nouveaux apostolats, d’établir des centres de formation et d’étude, de monter un corps professoral. L’épanouissement de l’Ordre dépend de la capacité des frères à traverser ce moment de transition dans une compréhension et un soutien mutuel.
Pour les frères âgés, les « pères fondateurs » peut-être, ce sera un moment douloureux parce que les aspirations des jeunes paraissent rejeter tout ce qu’ils ont accompli. Ils ont accueilli dans l’Ordre des jeunes qui semblent vouloir détruire l’oeuvre de leur vie, en invoquant de plus le caractère « pleinement dominicain ». Pour les jeunes aussi ce sera une période d’angoisse, où ils se demandent s’ils seront capables de réaliser leurs rêves d’une vie dominicaine plus développée.
Dans ces moments de transition, nous avons besoin d’une planification et d’une consultation bien pensées. Mais ce n’est pas uniquement une question d’administration. Nous devons à la fois montrer que nous apprécions ce que les anciens ont fait, et vivre ce moment comme un temps de mort et de renaissance, sur les traces du Christ. Lors d’une retraite qu’il donnait aux frères du Pakistan à l’époque où naissait la nouvelle vice-province, Mgr Paul Andreotti dit aux frères venus de l’étranger: « Certains d’entre vous vont maintenant décider de rentrer dans leurs provinces, mais ceux qui choisiront de demeurer doivent être parfaitement sûrs de leurs motivations. Je crois que Jésus nous offre un chemin pour mourir. » Si les frères âgés peuvent parcourir ce chemin dans la joie, ils donneront aux jeunes la plus profonde formation. Car la formation, surtout pour un frère mendiant itinérant, c’est toujours un apprentissage du dépouillement.
Gilbert Márkus OP disait au chapitre général de Caleruega: « Si ces jeunes viennent à l’Ordre pour suivre le Christ, eux-mêmes devront aussi être guidés dans l’art de mourir. Ils se sont confiés à l’Ordre, et une partie de la responsabilité que nous assumons en recevant leur profession est la responsabilité de leur enseigner cet art. Il n’y a aucun espoir pour un jeune dominicain qui ne parvient pas à saisir un tant soit peu, au cours de sa formation, comment il doit se perdre, mourir à lui-même. Ce n’est pas une excuse pour que les frères plus âgés se tiennent sur la défensive, accrochés à leur propre position, ou résistent au changement. Ils doivent plutôt mener les jeunes sur le chemin du sacrifice, et cela veut dire le parcourir avec eux, donner un exemple de générosité. »
La diminution
Très peu de provinces de l’Ordre meurent, quoique plusieurs, en particulier en Europe occidentale, diminuent. Comment ces provinces peuvent-elles garder la capacité d’entreprendre de nouveaux projets et des initiatives nouvelles?
Une province doit se demander ce qu’elle veut vraiment. Quelle est sa mission aujourd’hui? À quels nouveaux défis doit-elle faire face? Quelles nouvelles formes de prédication peut-elle élaborer? Pour en avoir la liberté, elle pourrait bien devoir prendre des mesures radicales. Il sera peut-être nécessaire de fermer deux maisons pour gagner la liberté d’en ouvrir une autre, qui offrira de nouvelles possibilités. Mieux vaut prendre des mesures énergiques afin de nous libérer, plutôt que nous contenter de battre lentement en retraite, victimes passives de circonstances qui échappent à notre contrôle. Comment prêcher la liberté des enfants de Dieu si nous avons nous-mêmes renoncé à toute liberté? Comment être les messagers de l’espérance si nous avons abandonné tout espoir de faire quelque chose de neuf pour Dieu? À moins qu’on ne nous voie saisir cette liberté, nous n’attirerons ni ne retiendrons jamais de vocations.
d) Le provincial et son conseil
Le conseil provincial est élu pour assister le provincial dans son gouvernement de la province en proposant des avis et prenant des décisions. Les conseillers ont pu être élus parce qu’ils représentaient une diversité d’opinions, ou de couvents, ou d’intérêts, mais ils ne sont pas membres du conseil pour représenter un groupe ou une idéologie. Le développement d’une faction au sein du conseil minerait son service de la province. Son rôle est d’aider le provincial à mettre en oeuvre les décisions du chapitre et rechercher le bien commun. Cela demande un profond respect de la confidentialité, sans quoi le provincial ne pourra bénéficier du soutien dont il a besoin.
Dans sa mise en oeuvre des décisions du chapitre et dans sa recherche du bien commun, le provincial devra parfois prendre des décisions douloureuses. J’ai déjà évoqué la souffrance parfois provoquée par les assignations (3.1.c). On ne gouverne cependant pas une province selon le principe consistant à attendre que les frères se portent volontaires pour les ministères. Si demander des volontaires peut sembler le signe d’un respect de la liberté des frères, hormis quelques circonstances très exceptionnelles, c’est une erreur d’interprétation de la nature de la liberté dans laquelle nous nous sommes donnés à la mission de l’Ordre. Cela entame aussi la liberté de la province pour prendre des décisions et les mettre en oeuvre effectivement. Enfin, cela repose sur la supposition que le meilleur juge de ce dont un frère est capable est ce frère lui-même. Nous pouvons nous tromper radicalement. Parfois, un frère peut se prendre pour le véritable successeur de saint Thomas alors qu’il tient plutôt du boeuf muet. Plus souvent, les frères sous-estiment ce dont ils sont capables. Je me fie à mes frères pour savoir ce que je ferai le mieux. Cela fait partie de la confiance qui soude l’Ordre.
Un provincial ou le Maître de l’Ordre doit quelquefois casser une élection. Cela aussi peut être douloureux. On aura l’air de toucher aux droits démocratiques des frères à choisir leur supérieur. Pourtant, il faut parfois le faire, justement parce que ces supérieurs ont eux-mêmes été élus démocratiquement pour avoir le souci du bien commun de la province et de l’Ordre. Ce serait toucher à la démocratie que de refuser d’assumer la responsabilité pour laquelle ils ont été élus. Il y a différentes étapes dans ce processus. La communauté vote; le supérieur doit décider de confirmer ou casser l’élection; le frère élu peut accepter ou refuser; le supérieur doit décider d’accepter le refus ou d’insister. À chacun de ces moments, nous devons pouvoir exercer la responsabilité qui nous incombe, sans interférence ni pression, afin de pouvoir découvrir ce qui favorise vraiment le bien commun.
3.4 Le Maître de l’Ordre et le conseil généralice
Le gouvernement général de l’Ordre est lié aux autres niveaux de gouvernement selon les mêmes principes suggérés en 3.1, l’itinérance, le soutien mutuel, et la recherche du bien commun le plus large.
a) Affermir les frères
Le premier rôle du Maître de l’Ordre et du conseil généralice est de soutenir les frères, et en fait toute la Famille dominicaine. Partout où je voyage, je rencontre des frères et des soeurs qui prêchent l’Évangile avec un formidable courage, souvent dans des situations de pauvreté et de violence. C’est là une source d’inspiration pour le conseil et moi-même.
Le principal moyen pour le Maître de l’Ordre d’affermir les frères passe par les visites, en essayant de rencontrer tous les frères. C’est un privilège et une joie. Le programme est si rempli qu’il reste bien peu de temps pour autre chose. Entre novembre dernier et ce mois de mai, j’ai passé à Rome moins de quatre semaines. Je n’ai pas pu, comme je l’avais espéré, visiter les frères et soeurs de la région des Grands Lacs en Afrique, pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin. C’est une question que je poserai au chapitre général de Bologne: si nous ne devrions pas repenser la manière dont sont faites les visites, afin que le Maître de l’Ordre ait la liberté de répondre autrement aux besoins de l’Ordre.
Quand une province passe par un profond processus de renouvellement ou affronte une période de crise, une visite occasionnelle ne suffit pas. De plus en plus, le conseil généralice constate la nécessité d’accompagner certaines provinces de l’Ordre face à des défis difficiles. Nous devons les soutenir pour qu’elles trouvent la force et le courage de prendre les décisions pénibles nécessaires à leur renouvellement. Le socius du Maître pour la province en question a souvent un rôle exigeant, d’accompagnement des frères devant les défis d’une reconstruction de la vie et du gouvernement dominicains.
Il est rarement nécessaire que le Maître de l’Ordre intervienne directement dans le gouvernement d’une province. S’il le fait, cela peut être dur à supporter pour les frères. Il semble qu’on outrepasse leur droit démocratique à prendre des décisions touchant leur vie et leur mission. Pourtant toute intervention de ce type est toujours une tentative d’affermir les frères, et de les aider à trouver un renouveau dans leur liberté et leur responsabilité. Si le gouvernement au niveau provincial s’affaiblit ou se paralyse, le Maître doit parfois intervenir directement pour que les frères se retrouvent libres de faire face à l’avenir. C’est souvent le cas lorsque nous envisageons l’unification de provinces.
b) Le bien commun le plus large
Le Maître de l’Ordre doit promouvoir l’unité de l’Ordre dans sa mission commune. Nous voyons plus clairement cette mission commune dans l’établissement de nouvelles fondations, dans le renouveau de l’Ordre là où il est fragile, et dans les maisons sous la juridiction immédiate du Maître.
L’une des tâches les plus ardues du Maître de l’Ordre est de trouver les frères pour cette mission commune. Humbert de Romans écrivait à l’Ordre au XIIIe siècle que l’un des principaux obstacles à la mission de l’Ordre était « l’amour des frères pour leur terre natale, dont la séduction si souvent les piège que — leur nature n’ayant pas encore été touchée par la grâce –, plutôt que de quitter leur pays et leurs relations et d’oublier leur nation, ils souhaitent vivre et mourir au milieu de leur famille et de leurs amis, ne se souvenant pas qu’en de semblables circonstances le Sauveur ne s’est pas même laissé rejoindre par sa propre mère ». Il y a des choses qui ne changent pas!
En vérité, je peux dire que beaucoup de frères, en particulier les jeunes, ont un sens profond et croissant de cette mission commune de l’Ordre à laquelle nous sommes appelés. Certaines provinces sont profondément généreuses dans leur don de frères pour la mission commune de l’Ordre. Par exemple, nous avons trouvé des frères pour nous aider à reconstruire l’Ordre dans l’ex-Union Soviétique. Cependant, il est souvent difficile de trouver les frères dont nous avons besoin, par exemple pour soutenir les frères du Rwanda et du Burundi en cette période de souffrance. Nous avons besoin de frères pour la fondation de l’Ordre dans l’Ouest du Canada. Nous avons besoin de frères pour renouveler et soutenir nos centres d’étude internationaux.
Comment approfondir notre participation à la mission commune de l’Ordre? Cela nous demande de grandir ensemble, dans la grâce et la vérité du Verbe Incarné.
Nous sommes appelés à la totale et gratuite générosité du Verbe. Ce n’est pas seulement la générosité d’une province qui donne un frère disponible, ou même qui demande des volontaires. Ce sont souvent justement les frères qui ne sont pas disponibles dont nous avons besoin. Cela impose de redéfinir les priorités de la province à la lumière des besoins de notre mission commune. Par exemple, en Amérique Latine, nous essayons de renouveler l’Ordre en demandant aux provinces les plus solides de travailler étroitement avec les provinces où nous sommes plus fragiles. Nous évoluons vers une sorte de partenariat dans lequel on demande à une province d’accompagner une autre entité. Nous demandons à ces provinces de redéfinir leur mission à la lumière des besoins de l’Ordre.
Cela nécessite que nous vivions dans la vérité. Tout d’abord la vérité de ce que signifie être frère dominicain. Nous avons fait notre profession au Maître de l’Ordre pour la mission de l’Ordre. Bien sûr la mission de chaque province est une expression de cette mission. Mais il nous faudra parfois exprimer notre identité dominicaine la plus profonde par l’affranchissement, pour la mission, des limites de notre province.
Cela requiert que nous cherchions ensemble, en vérité, à savoir quelles sont nos ressources pour la mission commune. Cela exige de nous une immense confiance mutuelle. Lorsque le Maître de l’Ordre demande à un provincial s’il y a un frère qui conviendrait pour telle fonction dans notre mission commune, un instinct bien compréhensible va parfois à la protection des intérêts de la province. Il nous faut, pour discerner le bien commun, une profonde confiance et transparence, afin de pouvoir dialoguer sur la meilleure façon de répondre aux besoins de l’Ordre tout en respectant la situation de la province. Par le passé, il était courant pour les Maîtres de l’Ordre d’assigner tout simplement les frères hors de leur province, fut-ce contre la volonté des provinciaux. Il est encore nécessaire de le faire quelques fois, tout comme un provincial doit parfois assigner un frère d’un couvent à un autre, malgré la réticence du supérieur. Mais en fin de compte notre mission commune nous demande espoir et confiance réciproque, grâce et vérité.
3.5. L’incarnation du gouvernement dominicain dans des cultures différentes
Le Verbe s’est fait chair dans une culture particulière. Cependant, le Verbe transforme ce qu’il touche, levain d’une vie nouvelle. Une nouvelle forme de communauté est née, et la chair se fait verbe et communion.
De même le gouvernement dominicain porte la marque des temps et lieux de sa naissance, un moment déterminé dans l’histoire de l’Europe. Nous sommes nés à une époque d’expérimentation de nouvelles formes d’institutions démocratiques, et d’intense fermentation intellectuelle. Comment cette forme de gouvernement se fera-t-elle véritablement chair dans l’Ordre au cours des années qui viennent, alors que deux tiers des frères en formation sont issus d’une culture non-occidentale ? Comment s’incarnera-t-elle dans la culture occidentale contemporaine, avec ses forces et ses faiblesses, son amour de la liberté et sa tentation du consumérisme? Au coeur de notre tradition du gouvernement il y a la recherche de la vérité, par le débat et le dialogue. Comment soutiendrons-nous le gouvernement dominicain dans une société où l’idée même de vérité est en crise? L’incarnation du gouvernement dominicain dans toutes ces cultures est toujours à la fois un défi et une richesse. Il devrait témoigner d’une liberté et d’une responsabilité profondément évangéliques, mais les cultures différentes nous aideront à apprendre la véritable signification de ces valeurs.
Les cultures africaines par exemple, peuvent nous aider à comprendre la nature du débat, l’importance du temps et de la patience dans l’écoute de nos frères; en Amérique du nord, l’immense sens du respect de l’individu peut approfondir notre compréhension de la liberté dominicaine; en Europe de l’est, l’engagement passionné pour la foi peut nous aider à comprendre ce que veut dire donner sa vie à l’Ordre; en Amérique Latine, nous pouvons apprendre combien est essentiel à notre prédication l’engagement pour la justice.
Pour autant, il est également vrai que notre tradition dominicaine de gouvernement offre un défi à toutes les cultures dans lesquelles nous implantons l’Ordre. Elle peut interpeller le pouvoir de l’identité tribale en Afrique; elle critique l’individualisme de l’Amérique contemporaine; elle invitera les frères d’Europe de l’est à se libérer des effets d’années de pouvoir communiste et à croître dans une confiance mutuelle. En Amérique Latine, la tradition du coup d’état ne favorise pas toujours l’orientation vers un engagement profond pour nos structures élues de gouvernement.
Le défi consistera souvent à comprendre quand une culture nous invite à une nouvelle vision et quand elle risque de déformer ce qui est essentiellement dominicain dans notre gouvernement. Le respect pour les anciens dans la société africaine nous offre-t-il une nouvelle vision de l’autorité propre à chaque génération, ou est-il contraire à notre tradition démocratique? La pratique adoptée par certaines provinces occidentales, consistant à permettre aux frères d’avoir des comptes bancaires privés, conduit-elle à approfondir un véritable sens dominicain de la responsabilité, ou amène-t-elle une privatisation de la vie qui détruit notre vie commune?
Répondre à ces questions prendra du temps. Les chapitres généraux, les rencontres régionales de frères dans chaque continent, et jusqu’aux visites du Maître devraient apporter une aide aux frères pour trouver notre chemin vers la découverte du sens de la responsabilité et de la liberté dans une société particulière. Le temps, la prière, le débat honnête et le contact avec les dominicains d’autres cultures seront nécessaires pour parvenir à comprendre véritablement comment mettre en oeuvre le gouvernement dans chaque société. Il est bon de prendre ce temps, à la fois pour le profit de l’Ordre, et pour que nous construisions partout où nous sommes des communautés sachant offrir un témoignage vrai de fraternité.
CONCLUSION
Je n’ai pas abordé un grand nombre de thèmes centraux pour le gouvernement. Par exemple je n’ai pas discuté gouvernement et argent, ni l’importance des visites. Je n’ai dit qu’un mot à peine de la Famille dominicaine ou de la collaboration régionale. Il y a une limite à ce que l’on peut écrire dans une lettre.
Dans la vision de sainte Catherine, Dieu dit: « Dominique s’est allié à ma Vérité en montrant qu’il ne voulait pas que le pécheur meure, mais plutôt qu’il soit converti et qu’il vive. Il a fait son navire vaste, heureux, et parfumé, un jardin des plus délicieux » dans lequel « aussi bien le parfait que le moins parfait ont leur place ». Là, grâce et vérité du Verbe incarné s’unissent en miséricorde. C’est ce qui rend le navire si vaste, lieu où nous autres moins parfaits pouvons être chez nous. Ce navire peut aller de l’avant, lentement ; on ne sait pas toujours clairement dans quelle direction il va, et l’équipage change de rôles avec une fréquence surprenante. Mais c’est un endroit où nous pouvons espérer grandir dans la liberté de Dominique, avec nos hésitations et erreurs, confiants dans la miséricorde de Dieu et celle des autres.
Frère Timothy Radcliffe, o.p.
Maître de l’Ordre
Le 10 mai 1997, Fête de saint Antonin o.p.
L'ours et la moniale. Le sens de la vie religieuse aujourd'hui (1998)
Conférence au religieux supérieurs majeurs de France. Octobre 1999
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 On m’a demandé de vous parler de » La vie religieuse, quel sens aujourd’hui ? « . La question se pose avec urgence aux religieux parce que nombre d’entre nous se demandent si le mode de vie auquel nous nous sommes engagés a le moindre sens. Il y a moins de vocations en Europe occidentale qu’avant; en France, beaucoup de congrégations diminuent et certaines se meurent; être religieux n’apporte plus le même statut ni le respect qu’il suscitait. Nous avons l’air d’avoir perdu notre rôle dans une Église qui semble devenue plus cléricale, et d’avoir perdu notre importance dans une société où les laïcs font maintenant tant de choses auparavant assurées en grande partie par les religieux. Avec le nouveau sentiment de la sainteté du mariage, on ne considère même plus que notre mode de vie soit plus parfait qu’un autre. Il est compréhensible que nombre de religieux demandent : » La vie religieuse, quel sens aujourd’hui ? «
On m’a demandé de vous parler de » La vie religieuse, quel sens aujourd’hui ? « . La question se pose avec urgence aux religieux parce que nombre d’entre nous se demandent si le mode de vie auquel nous nous sommes engagés a le moindre sens. Il y a moins de vocations en Europe occidentale qu’avant; en France, beaucoup de congrégations diminuent et certaines se meurent; être religieux n’apporte plus le même statut ni le respect qu’il suscitait. Nous avons l’air d’avoir perdu notre rôle dans une Église qui semble devenue plus cléricale, et d’avoir perdu notre importance dans une société où les laïcs font maintenant tant de choses auparavant assurées en grande partie par les religieux. Avec le nouveau sentiment de la sainteté du mariage, on ne considère même plus que notre mode de vie soit plus parfait qu’un autre. Il est compréhensible que nombre de religieux demandent : » La vie religieuse, quel sens aujourd’hui ? «
1. À la recherche d’une histoire
Dans cette situation, il serait naturel d’essayer de trouver le sens de la vie religieuse dans quelque chose qui nous est particulier, quelque chose que nous faisons et que personne d’autre ne fait, quelque chose qui nous donne notre place spéciale, notre identité particulière. Nous sommes comme des maréchaux-ferrants dans un monde d’automobiles, à la recherche d’un nouveau rôle. J’ai l’idée que c’est une des raisons pour lesquelles nous, religieux, parlons souvent avec ardeur de nous-mêmes comme de prophètes. Nous prétendons être la partie prophétique de la vie de l’Église. Cela nous donne un rôle, une identité, un label. Je crois en effet que la vie religieuse est appelée à être prophétique, mais pas comme solution à notre crise d’identité! J’aimerais plutôt partir d’ailleurs, à savoir de la crise du sens que traverse la société occidentale. Je crois que la vie religieuse est plus importante qu’avant à cause de la manière dont nous sommes appelés à affronter la crise du sens de nos contemporains. Notre vie doit être une réponse à la question : » La vie humaine, quel sens aujourd’hui ? » Peut-être cela a-t-il toujours été le témoignage essentiel de la vie religieuse.
Comment peut-on seulement commencer à réfléchir à une question aussi vaste que la crise contemporaine du sens ? Pour dire quoi que ce soit d’approprié, il faudrait que j’aie étudié des livres sur le moderne et le postmoderne. Je n’en ai pas lu. Mon excuse, c’est qu’en vivant sur les routes, je n’avais pas le temps. Mais la vérité, c’est que si je lisais ces livres, je ne les comprendrais probablement pas. Ils sont principalement écrits par des Français intelligents et dépassent l’entendement d’un Anglais! Je tenterai au contraire une approche plus simple. Je voudrais vous proposer le contraste entre deux images, deux histoires implicites de la vie humaine.
Toute culture a besoin d’histoires pour incarner une compréhension de ce que signifie être un humain, de ce qu’est le modèle de la vie. Nous avons besoin d’histoires qui nous disent qui nous sommes et où nous allons. Quand une société vit une crise du sens, l’un des symptômes en est que les histoires racontées par cette société ne donnent plus sens à notre expérience. Elles ne sont plus adaptées. Quand une société traverse un moment de profond changement, elle a besoin d’un nouveau type d’histoires pour donner du sens à sa vie.
Je montrerai que la crise fondamentale du sens dans notre société, c’est que l’histoire sous-jacente à la culture européenne depuis plusieurs siècles n’a plus de sens. C’est une histoire de progrès, de survie du plus adapté, de triomphe du plus fort. Le héros de cette histoire est le moi moderne. Il (c’est généralement un homme!) est seul, et libre. C’est l’histoire implicite de nos romans, de nos films, de notre philosophie, de notre économie et de notre politique. Mais elle a cessé de donner du sens à notre expérience. Je prendrai pour symbole de cette histoire l’affiche d’un ours que j’ai souvent vue sur les murs de Rome.
Ainsi sommes-nous une société assoiffée d’une nouvelle histoire qui donne un sens à notre identité. Je crois que le sens de la vie religieuse consiste à répondre à cette question : » La vie humaine, quel sens aujourd’hui ? » Les gens doivent pouvoir reconnaître dans nos vies une invitation à être un humain d’une nouvelle manière. Le symbole de cette autre histoire sera pour moi une moniale chantant dans les ténèbres, au pied du cierge pascal.
J’aimerais donc vous proposer ce contraste entre deux images, deux histoires, celle d’un ours et celle d’une moniale. J’aimerais les mettre en contraste en considérant les trois éléments nécessaires à toute histoire : une intrigue qui évolue dans le temps; les événements qui font avancer l’action; ,t les acteurs. Si nos contemporains se sentent perdus et déroutés, c’est parce que les histoires modernes ne donnent )lus sens à notre expérience du temps, des événements et le ce que signifie être un individu. Nous, religieux, devrions incarner une autre manière d’être en vie.
2. L’intrigue et le temps
Permettez-moi de commencer par vous parler de mon ours. Il y a un an, les murs de Rome étaient couverts d’affiches d’un grand ours en colère. Et l’inscription sur l’affiche disait La forza del prezzo giusto (la force du juste prix). En attendant le bus, j’ai eu tout le loisir de contempler cet ours. Il capte bien l’histoire de la modernité.
En premier lieu, cet ours suggère que la trame fondamentale de l’histoire est un progrès irrésistible. C’est un ours dont Darwin aurait été fier, un vainqueur dans le processus d’évolution. L’histoire humaine est une marche en avant. C’est aussi un symbole de l’économie mondiale, le marché. Ce qui fait avancer l’histoire humaine, c’est l’économie. La forza del prezzo giusto (la force du juste prix). L’Histoire, c’est le récit d’un progrès inévitable, à travers la libération du marché. Le meilleur système économique triomphe. C’est l’ours le vainqueur.
Quand j’étais enfant (et, à vous voir, j’imagine que beaucoup d’entre vous l’étaient aussi), on pouvait encore tout juste croire que l’humanité était sur la voie d’un avenir radieux. Mais, déjà, des ombres se profilaient. Je suis né une semaine avant la fin d’une guerre qui a fait cinquante millions de morts. Nous avons appris peu à peu l’holocauste et les six millions de juifs morts dans les camps. J’ai grandi sous la menace de la bombe. Je me rappelle ma mère faisant des réserves de boîtes de conserve dans la cave, juste au cas où une guerre nucléaire éclaterait. Et pourtant, il était encore possible de s’accrocher à l’idée que l’humanité allait de l’avant. Chaque année voyait l’indépendance accordée à nos anciennes colonies, la médecine éliminait des maladies comme la tuberculose et la malaria. Sûrement, on verrait bientôt finir aussi la pauvreté. Même les avions et les voitures allaient plus vite chaque année. Les choses iraient encore en s’améliorant.
Aujourd’hui, nous sommes moins sûrs de nous. Le fossé entre riches et pauvres continue à se creuser. La malaria et la tuberculose sont de retour et, d’ici à un an, il y aura probablement quarante millions de personnes atteintes du Sida. Rien qu’en Europe, le chômage touche vingt millions de personnes. Les rêves d’un monde juste semblent s’être éloignés.
Où va l’humanité ? Notre histoire a-t-elle un sens, une direction ? Ou bien sommes-nous en train de tourner en rond, d’errer dans le désert, sans approcher le moins du monde de la Terre promise ? Même l’Eglise, qui semblait s’orienter vers un renouveau et une nouvelle vie au Concile Vatican II, ne paraît pas maintenant savoir où elle va.
Il y a, au coeur de la modernité, une contradiction, et c’est pour cela que son histoire n’est plus plausible. D’un côté, l’ours est effectivement irrésistible. De toutes parts, le marché mondial triomphe de tous ses ennemis. Le communisme est tombé en Europe de l’Est et, même en Chine, il paraît sur le point de succomber. Mais d’un autre côté, l’histoire ne nous conduit pas au Royaume. Ce que nous avons sous les yeux, c’est la pauvreté croissante et la guerre. Même les tigres asiatiques sont malades. L’ours est irrésistible, mais il est en train de nous déchiqueter. Ainsi la trame des temps modernes contient-elle une insupportable contradiction. Nous ne pouvons plus nous y retrouver.
Nous ne pouvons vivre sans histoires. Comme nous en sommes venus à douter de la marche en avant de l’humanité, il faut d’autres histoires pour combler le vide. Ce seront peut-être des histoires millénaristes de fin du monde, des histoires d’extraterrestres, des histoires de victoire à la Coupe du monde (bravo la France!). Assez souvent, c’est seulement ce que nous appelons en anglais des soap operas, les séries insignifiantes de la télévision. Récemment, le dernier épisode d’un soap opera a été regardé aux États-Unis par quatre-vingts millions de personnes. Les restaurants avaient fermé pour la soirée. L’annonce qu’un astéroïde géant heurterait la terre le 26 octobre 2028 a soulevé moins d’intérêt. Ayant cessé de croire dans le mythe du progrès, nous nous réfugions dans les fictions.
C’est peut-être la soif d’une histoire qui explique l’extraordinaire réaction à la mort de la princesse Diana. Les Anglais sont, comme vous le savez, des gens très peu émotifs, ou du moins les Français aiment-ils à le croire! Mais je n’ai jamais vu un tel chagrin. C’était comme si l’histoire au coeur de l’humanité avait pris fin sous un pont de Paris. Des millions de gens ont pleuré comme s’ils avaient perdu leur femme ou leur enfant ou leur mère. Partout où je vais dans le monde, je sais qu’à la fin, les gens vont m’interroger sur la princesse. Je m’attends à répondre à des questions sur elle après cette conférence. Au Viêt-nam, on m’a même dit que je ressemblais au prince William. J’en étais ravi, mais ces gens sont d’une politesse extrême! C’était le soap opera du monde. Peut-être son histoire parlait-elle à autant de gens justement parce qu’en elle, nous pouvions nous voir nous-mêmes. C’était une personne bonne mais pas parfaite, qui s’intéressait réellement aux autres, dont la vie aurait dû être merveilleuse et pourtant, inexplicablement, a été un échec. C’est une histoire triste et futile, évoquant la futilité ressentie par tant de personnes qui se demandent où va leur vie. Dans quel sens la vie religieuse peut-elle suggérer une autre trame, une contre-histoire ?
Permettez-moi de vous proposer une autre image. J’ai célébré Pâques cette année dans un monastère de moniales contemplatives dominicaines. Le monastère était bâti sur une colline derrière Caracas, au Venezuela. L’église était pleine de jeunes. Nous avons allumé le cierge pascal et l’avons placé sur son support. Et une jeune moniale a chanté en s’accompagnant à la guitare un chant d’amour au pied du cierge. Le chant avait toute la rauque passion de l’Andalousie. J’avoue avoir été complètement bouleversé par cette image d’une moniale chantant dans le noir un chant d’amour au feu nouveau-né. Cette image suggérait que nous sommes pris par un autre drame, une autre histoire. La voilà, notre histoire, et non pas celle de l’ours en colère qui dévore ses rivaux.
En premier lieu, la moniale qui chante dans la nuit suggère que l’intrigue fondamentale de l’histoire de l’humanité n’est plus celle que représentait l’ours. Dehors, dans le jardin, le célébrant avait gravé le cierge en disant ces mots : » Christ hier et aujourd’hui, commencement et fin, l’alpha et l’oméga. Le temps entier lui appartient, et tous les âges. À lui, la puissance et la gloire pour tous les temps. Amen. «
La vie religieuse est peut-être avant tout un vivant amen à cette perspective temporelle plus longue. C’est dans cette extension de l’histoire en l’alpha et l’oméga, de la Création au Royaume, que tout être humain doit trouver son sens. Nous sommes ceux qui vivent pour le Royaume, pour le temps où, comme l’a dit Julienne de Norwich, » Tout sera bien, toutes les choses qui existent seront bonnes « .
La vocation qui met le plus radicalement en lumière cette ouverture de l’avenir est celle des moines ou des moniales contemplatifs. Leur vie n’a aucun sens s’ils ne sont pas sur le chemin du Royaume. Le cardinal Basil Hume est le chrétien le plus respecté d’Angleterre, en partie parce qu’il est moine. Et il a écrit ceci des moines : » Nous ne considérons pas que nous ayons une mission ou une fonction particulière dans l’Église. Nous ne nous destinons pas à changer le cours de l’Histoire. Nous sommes là, c’est tout, presque par accident d’un point de vue humain. Et heureusement, nous continuons à « être là, c’est tout. «
Les moines sont là, c’est tout, et leur vie n’a donc aucun sens sinon d’annoncer l’achèvement des temps, cette rencontre avec Dieu. Ils sont comme ces gens qui attendent à l’arrêt du bus. Le seul fait qu’ils soient là indique que le bus doit sûrement arriver. Il n’y a pas de sens provisoire ou de sens partiel. Pas d’enfants, pas de carrière, pas de réalisations, pas de promotion, pas d’utilité. C’est par une absence de sens que leur vie révèle une plénitude de sens que nous ne pouvons définir. Tout comme la tombe vide annonce la Résurrection, ou le scintillement dans l’orbite d’une étoile indique l’invisible planète.
Le monachisme occidental est né dans un moment de crise. C’est pendant que l’Empire romain se mourait lentement sous les assauts barbares, que Benoît se rendit à Subiaco et fonda une communauté de moines. Alors que l’histoire de l’humanité semblait n’aller nulle part, Benoît fonda une communauté de gens dont la vie n’avait d’autre sens que d’indiquer cette fin ultime, le Royaume.
On pourrait dire que la vie religieuse nous force à vivre à découvert la crise moderne. La plupart des gens suivent un modèle de vie et une histoire permettant de garder la question principale à distance. Une vie peut tenir sa propre signification du fait de tomber amoureux, de se marier, d’avoir des enfants puis des petits-enfants. Ou bien l’histoire d’un autre trouvera son sens dans une carrière, en gravissant les degrés de la promotion, en faisant fortune et même en gagnant la notoriété. On peut raconter bien des histoires pour donner un modèle provisoire et un sens à notre séjour sur terre. Et cela est juste et bon. Mais nos voeux ne nous offrent pas cette consolation. Nous n’avons pas de mariage pour donner forme à notre vie. Nous n’avons pas de carrière. Nous sommes nus face à la question : » La vie humaine, quel sens ? «
Mais il ne suffit pas de s’asseoir et d’attendre la venue du Règne. Les frères les plus jeunes ne sont parfois pas d’accord avec moi, mais il faut bien se sortir du lit chaque matin pour faire quelque chose. Même les moines et les moniales doivent faire quelque chose! Je me souviens avoir demandé un jour à un frère particulièrement paresseux ce qu’il faisait. Il m’a répondu qu’il était un » signe eschatologique » , attendant la venue du Règne. Comment valorisons-nous ce que nous faisons maintenant ? La plupart d’entre nous passent leurs journées en activités utiles, enseigner, travailler dans les hôpitaux, aider dans les paroisses, s’occuper des oubliés. Comment notre vie quotidienne parle-t-elle de l’histoire de l’humanité ?
Revenons à nouveau à cette jeune moniale. C’est le coeur de la nuit et elle chante ce chant farouche. C’est la nuit qu’elle chante les louanges de Dieu. Même dans le noir, entre le commencement et la fin, on peut rencontrer Dieu et le glorifier. C’est maintenant l’heure. Attendant d’être assassiné, Jésus dit à ses disciples : » Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage! J’ai vaincu le monde. » (Jn 16, 33). C’est maintenant l’heure de la victoire et de la louange.
Ce que cela inspire, c’est un nouveau sentiment du temps. Ce qui donne sa forme au temps, ce n’est pas l’histoire de l’inévitable progression vers la richesse et le succès. La forme cachée de notre vie, c’est la croissance dans l’amitié de Dieu, comme nous le rencontrons en chemin et disons amen. Ce n’est pas seulement la fin de l’histoire qui lui donne un sens. Le modèle de ma vie, c’est la rencontre avec Dieu, et ma réponse à son invitation. C’est ce qui fait de ma vie non pas une simple suite d’événements mais une destinée. Comme l’a dit Cornelius Ernst, o. p. : » La destinée est l’appel et l’invitation du Dieu d’amour à ce que nous lui répondions par un consentement créateur et plein d’amour. » (Cornelius ERNST, The Theology of Grace, Dublin, 1974, p. 82.) Même dans les ténèbres, dans le désespoir, quand plus rien n’a de sens, nous pouvons rencontrer le Dieu de vie. Comme l’écrivait un philosophe juif : » Chaque instant peut être la petite porte par laquelle le Messie peut entrer. » L’histoire de nos vies est l’histoire de cette rencontre avec le Dieu qui vient dans l’obscurité comme un amant. C’est ce que nous célébrons en le glorifiant.
Les moments les plus émouvants que j’ai vécus ces six dernières années ont été des possibilités de partager avec mes frères et soeurs la louange de Dieu dans les circonstances les plus difficiles. Dans un monastère au Burundi, après avoir voyagé à travers un pays déchiré par la violence ethnique; en Irak, dans l’attente des bombes; en Algérie, avec notre frère Pierre Claverie avant son assassinat. Il est essentiel pour la vie religieuse que nous chantions les louanges de Dieu, même dans les ténèbres. Nous chantons les psaumes, les tehilim, le livre des louanges. Nous mesurons la journée aux heures de l’office divin, à la liturgie des psaumes, et pas seulement aux heures mécaniques de l’horloge. » Sept fois par jour je te glorifie. » Eh bien, au moins deux fois pour la plupart d’entre nous.
Je me souviens d’une histoire qui illustre bien comment le temps de la louange peut interagir avec le temps de l’horloge, le temps moderne. Quant l’un de mes frères était petit, à l’école, un dentiste vint un jour faire un cours d’hygiène dentaire aux enfants. Il demanda à la classe quand il faut se laver les dents. Silence absolu. Il insista : » Allons, vous savez bien quand vous devez vous brosser les dents : le matin et le soir… » Cela dut déclencher un ressort dans l’esprit de ces bons petits catholiques qui savaient leur catéchisme. Et ils enchaînèrent tous » avant et après les repas « . » Excellent » , dit le dentiste, et les enfants d’ajouter : » Dans la tentation et à l’heure de notre mort. » Eh bien, si nous nous brossions toujours les dents à l’instant des tentations, nous pourrions éviter bien des péchés!
Le rythme régulier de la louange est bien plus qu’un simple optimisme confiant que tout ira bien à la fin. Nous proclamons que dès maintenant, dans le désert, le Seigneur de vie vient à nous et donne forme à notre vie. En ce sens, la vie religieuse devrait être véritablement prophétique, car le prophète est celui qui voit l’avenir faire irruption dans le présent. Comme le dit Habaquq : » Car le figuier ne bourgeonnera plus; plus rien à récolter dans les vignes. Le produit de l’olivier décevra, les champs ne donneront plus à manger […]. Mais moi je me réjouirai en Yahvé, j’exulterai en Dieu mon sauveur! » (3, 17-18.)
J’ai rencontré récemment les promoteurs du mouvement Justice et Paix de l’Ordre en Amérique latine. C’est une nouvelle génération, pas de vieux soixante-huitards comme moi! De jeunes hommes et femmes qui tiennent un rêve en vie. Je m’attendais à les trouver découragés, vu la situation économique qui empire, la violence qui s’accroît, la désintégration sociale sur leur continent. Pas du tout! Ils disent que c’est justement maintenant, alors que toutes les utopies ont disparu, alors que le Royaume semble plus loin que jamais, que nous, religieux, devons jouer notre rôle. Personne d’autre ne pourrait rêver maintenant. Mais se battre aujourd’hui pour un monde plus juste, alors qu’on a l’impression de ne jamais progresser, signifie qu’il faut être une personne de profonde prière. Comme l’a écrit notre frère brésilien, Frei Betto, il faut être un mystique aujourd’hui pour croire dans la justice et la paix.
3. L’action
Il y a un deuxième contraste que j’aimerais marquer entre l’histoire de l’ours et celle de la moniale, concernant la manière dont les choses arrivent. Quel est le moteur de l’histoire ? Qu’est-ce qui fait avancer le récit ? Il nous faut à la fois une trame et des faits.
Nous avons déjà vu que l’ours représente la compétition pour la survie. Ce qui anime l’histoire, c’est cette compétition dans laquelle le faible périt et le fort prospère. Que l’on étudie l’évolution ou l’économie, c’est exactement ainsi que les choses se passent. C’est le principe de base de l’histoire moderne. Le moteur qui pousse l’histoire est la libre compétition qui élimine l’anormal, le désespéré, le non-viable.
Mais encore une fois, nous voyons là une contradiction. Car cet ours symbolise la liberté même qui est au coeur de la modernité : liberté de concurrence sur le libre marché, où chacun est libre de choisir ce qu’il veut. Pourtant nous avons vu que cette liberté est, elle aussi, dans une certaine mesure, illusoire. Car nous sommes pris dans une transformation générale du monde qui nous rend impuissants, et que personne n’est capable d’arrêter, une transformation qui détruit les communautés et dévore la planète. Ainsi trouve-t-on au coeur de l’histoire moderne une double contradiction. On nous offre le progrès, nous trouvons la pauvreté; on nous offre la liberté, nous nous trouvons impuissants. Quelle autre histoire la vie religieuse peut-elle incarner ?
Mais considérons à nouveau cette jeune moniale, qui chante son chant d’amour dans l’obscurité. Elle représente une autre manière de raconter. L’histoire qu’elle célèbre est celle d’un homme terrassé par les forts mais qui vit à jamais. Les gros ours de Rome et de Jérusalem dévorent le petit homme de Galilée. Ce que nous célébrons dans cette histoire, ce n’est pas la force supérieure de Dieu, le plus gros ours, mais son absolue créativité dans la résurrection de Jésus d’entre les morts.
Il n’y a d’histoire que s’il se passe quelque chose de nouveau. Les histoires racontent comment les choses changent. Mais le modèle de changement de l’ère moderne, c’est la survie du plus fort.
L’évolution, biologique ou économique, apporte du changement, mais à travers la compétition pour survivre. Alors que notre histoire de la moniale propose une nouveauté encore plus radicale, l’inimaginable don d’une vie nouvelle. Nous glorifions Dieu qui dit : » Voici, j’ai fait toutes choses nouvelles. » Nous, religieux, sommes appelés à être des signes de l’indicible nouveauté de Dieu, de son ineffable créativité.
Religieux, comment être des signes de cette étrange histoire du Dieu de mort et de résurrection ? Le signe le plus évident apparaît dans la présence de tous ces religieux qui refusent de quitter des lieux de mort et de violence, confiants dans le Seigneur qui ressuscite les morts. Partout où la violence sévit, au Rwanda, au Burundi, au Congo, au Chiapas, on peut trouver des religieux et des religieuses dont la présence est un signe de cette autre histoire, chantée par notre moniale. Naturellement, ici, en France, nous pensons aux nombreux religieux morts en Algérie. Vous devez tous connaître trop bien ces mots merveilleux de Christian de Chergé, prieur des moines trappistes, lorsqu’il écrivit son testament spirituel peu avant sa mort. J’espère que vous me permettrez de les répéter, une fois encore : » Quand un À-Dieu s’envisage. » S’il m’arrivait un jour – et ça pourrait être aujourd’hui – d’être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j’aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce pays. Qu’ils acceptent que le Maître Unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu’ils prient pour moi : comment serais-je trouvé digne d’une telle offrande ? Qu’ils sachent associer cette mort à tant d’autres aussi violentes laissées dans l’indifférence de l’anonymat […]. » » Cette vie perdue, totalement mienne, et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l’avoir voulue tout entière pour cette Joie-là, envers et malgré tout. «
La préparation d’un tel témoignage consiste certainement à ce que toute communauté religieuse soit un lieu où apprendre comment venir au monde à travers la mort et la résurrection. Une de mes grande-tantes est devenue soeur du Sacré-Coeur. À l’âge de sept ans, elle effraya ses nombreuses soeurs en épinglant sur le mur de la chambre d’enfants une feuille de papier qui disait » je veux être dissoute et unie au Christ » . Je doute que beaucoup de candidates à la vie religieuse fassent ce genre de geste de nos jours, grâce à Dieu! Mais une communauté religieuse doit certainement être un lieu où nous apprenons à mourir et ressusciter, un lieu de transformation. Nous ne sommes pas les prisonniers de notre passé. Nous pouvons croître en sainteté. Nous pouvons mourir et être renouvelés.
Cela n’arrivera probablement pas si nous fuyons le face-à-face avec la mort de nos propres institutions. Aujourd’hui, en Europe occidentale, nombre de congrégations, communautés, monastères et provinces doivent faire face à la mort. Il y a bien des stratégies pour éviter cette vérité. On peut béatifier un fondateur, lancer de lourds programmes de construction, écrire de magnifiques documents sur des projets qui ne seront jamais mis en oeuvre. Quand nous envoyons des frères ou des soeurs aux Philippines, en Colombie, au Brésil, est-ce dans un soudain et nouveau zèle missionnaire ou parce que nous voulons des vocations pour pouvoir survivre ? Si nous ne pouvons affronter la perspective de la mort, qu’avons-nous donc à dire du Seigneur de vie ? Je visitais un jour un monastère dominicain en Angleterre avec un frère âgé. Le monastère touchait de toute évidence à la fin de sa vie, mais l’une des moniales dit à mon compagnon : » Mon Père, certainement, notre cher Seigneur ne saurait laisser mourir ce monastère! » À quoi il répondit : » Cependant, n’a-t-il pas laissé mourir son Fils ? «
Une de nos manières de vivre cette inimaginable histoire de mort et de résurrection est bien sûr de mettre au monde une vie nouvelle dans des lieux inattendus. Nous devons être ceux qui vont dans la vallée de la mort et montrent leur foi dans le Dieu qui ressuscite les morts. Je me rappelle un de mes frères écossais, qui était poète et lutteur, invraisemblable association, mais il était de toutes façons un homme invraisemblable. Il lança un programme en Écosse pour initier les détenus à l’art. Il était convaincu que si nous ne croyions pas en leur créativité, ils ne guériraient jamais. Sa première tentative eut lieu dans une prison très dure à Glasgow. Il demanda aux détenus à quoi ils aimeraient s’essayer : peinture, poésie, sculpture, danse. Vous pouvez imaginer les réactions! Alors il remonta ses manches et dit : » Si quelqu’un parmi vous pense que l’art, ce n’est pas pour les vrais hommes, bon, je me battrai contre lui! » Et c’est ce qu’il fit… avec chacun d’eux. Et ils commencèrent tous des cours de poésie et de peinture! Heureusement, ce n’est pas là l’unique manière d’amener les gens à la foi dans le Dieu qui fait toutes choses nouvelles.
Une autre manière, peut-être plus traditionnelle, par laquelle les religieux ont toujours été un signe du Dieu éternel créateur, c’est par la beauté. Vous en avez toujours été plus conscients en France que dans bien d’autres pays. Il y a quelques semaines, j’ai rencontré en Allemagne un vieux dominicain peintre et sculpteur. Et je lui ai demandé ce qu’il aime le mieux faire. Il a répondu qu’il a toujours adoré graver les pierres tombales! Il y a des blessures si profondes que seule la beauté peut les guérir. Devant certaines souffrances, l’espérance ne peut s’exprimer que par l’art. Une très belle pierre tombale peut parler avec éloquence de l’espérance en la résurrection, du Dieu qui sait ressusciter les morts.
Enfin, il y a la beauté de la liturgie, la beauté du chant de louange à Dieu, qui parle du Dieu qui transforme toutes choses. C’est la beauté par laquelle nous avons commencé, celle d’une jeune moniale chantant un chant d’amour la nuit devant un cierge. C’est la beauté d’un chant plein de la passion des gens du sud de l’Espagne qui m’a bouleversé. Cela me fait penser à Pablo Neruda qui disait qu’entre les drames de la naissance et de la mort, il avait choisi la guitare!
4. L’acteur
Enfin, on n’a pas d’histoire sans acteurs, sans personnages. Chaque histoire doit avoir son héros. Et quelle meilleure image du moi moderne pourrait-on trouver que notre ours, en colère et seul. Mais ce » moi moderne » est en crise.
Ce nouveau sentiment de ce que signifie être un humain est fondamental pour l’ère moderne; un moi séparé et autonome, détaché et libre, et en fin de compte : seul. C’est le fruit d’une évolution qui dure depuis des siècles, où les liens sociaux se sont dissous, et où le privé est devenu possible, et même un idéal. Il est notre héros depuis l’époque de Descartes. Nous le voyons dans n’importe quel western américain, figure solitaire.
La crise de la modernité est en partie due au fait que ce » moi moderne » renferme une contradiction. Parce qu’on ne peut pas être un » moi » tout seul. On ne peut exister comme un atome solitaire, autonome. On ne peut exister sans communauté, sans des gens à qui parler, sans ce que Charles Taylor appelle » des réseaux d’interlocutionl » (Sources of the Self, Cambridge, 1989, p. 36.).
C’est la contradiction qui est au coeur de l’Histoire moderne : nous nous voyons comme essentiellement solitaires, alors qu’en fait, personne ne peut être un individu en dehors de toute forme de communauté. Il n’est pas possible d’être longtemps un » moi moderne « . L’ours de l’affiche représente un idéal impossible. Seul, il mourrait.
Revenons une dernière fois à notre moniale, chantant devant le cierge pascal. Elle n’est pas seule. À peine visible à la lueur du cierge, il y a la foule des jeunes. La veillée pascale est un rassemblement du Peuple de Dieu. Ce qui naît cette nuit-là, c’est une communauté. Nous nous réunissons pour rappeler notre baptême dans le corps du Christ et réciter ensemble une foi commune. Cela représente une autre vision de ce que signifie être une personne.
» La vie humaine, quel sens aujourd’hui ? » Une des manières d’essayer de répondre à cette question dans la vie religieuse, c’est de vivre en communauté. Trouver son identité dans cette communauté, en frère, en soeur, c’est vivre une autre image du moi, une autre façon d’être un humain. Elle incarne une contre-histoire à celle du héros moderne. Dans les débuts, on appelait une communauté dominicaine une sacra proedicatio, une » sainte prédication » . Vivre ensemble en frères » avec un seul coeur et un seul esprit » était une prédication, avant même que quiconque ait prononcé une seule parole. Probablement les jeunes sont-ils davantage amenés à la vie religieuse par la recherche d’une communauté que par nulle autre raison. Selon l’Exhortation apostolique post-synodale sur la vie religieuse, nous sommes un signe de communion pour l’Église entière, un témoignage de la vie de la Trinité.
Mais si c’est la communauté qui amène les jeunes à la vie religieuse, c’est aussi la difficulté de la vie commune qui en conduit autant à abandonner. Nous aspirons à la communion et pourtant, elle est bien douloureuse à vivre. Quand je rencontre de jeunes dominicains en formation, je leur demande souvent ce qu’ils trouvent de meilleur et de pire dans la vie religieuse, et en général, ils donnent la même réponse aux deux questions : vivre en communauté. C’est que nous sommes les enfants de notre époque, façonnés par sa perception du moi moderne. Nous ne sommes pas des loups sous une peau de mouton. Nous sommes des ours sous une peau de moniale!
On pourrait peut-être dire que dans la vie religieuse, nous vivons en miroir l’image de la crise du moi moderne. L’individu moderne aspire à une autonomie, une liberté, un détachement qui sont intenables, parce qu’on ne peut pas être humain tout seul. Nous avons besoin d’appartenir à des communautés pour être humains, quoi que nous en pensions. Mais nous, religieux, vivons le reflet de ce drame. Nous entrons dans la vie religieuse en aspirant à la communauté, désirant véritablement être frères et soeurs les uns des autres, mais nous sommes quand même des produits de l’ère moderne, marqués par son individualisme, sa peur de l’engagement, sa soif d’indépendance. La plupart d’entre nous sont nés dans des familles de 1,5 enfants, et c’est dur de vivre avec la foule. Aussi l’individu moderne et le religieux sont-ils deux aspects d’une même tension. L’individu moderne rêve d’une impossible autonomie, et nous, religieux, aspirons à une communauté qui est dure à supporter.
L’ours ne peut pas se faire moniale en l’espace d’un an de noviciat. II y a la lente éducation à devenir humain, à apprendre à parler et à écouter, briser l’emprise de l’égocentrisme et de l’égoïsme, qui font de moi le centre du monde. C’est la lente renaissance par la prière et la conversion qui me libérera des fausses images de Dieu et des autres.
En cela nous vivons, dépouillés, intensément, le drame de l’Église moderne. Jamais auparavant l’Église ne s’est présentée avec autant d’insistance comme une communauté. Koinonia est le coeur de toutes les ecclésiologies contemporaines. Et pourtant, jamais auparavant l’Église, du moins en Europe occidentale, n’avait offert aussi peu de véritable communion. Nous parlons le langage de la communion, mais la vivons rarement. Le langage et la réalité sont séparés. Une de nos tentatives pour donner corps à ce rêve de communion est assurément d’oser construire des communautés dans les lieux impossibles, là où tous les autres ont abandonné. Bien souvent ces dernières années, j’ai trouvé de petites communautés de religieux, en général des femmes, qui bâtissaient une communauté là où tous les autres semblent désespérer, où les êtres humains sont écrasés et désespérés par la violence et la pauvreté. Là où tout semble sans espoir, on trouvera quelques soeurs qui installent une maison à la porte ouverte.
Une seule image résumera bien des souvenirs. Le jour suivant la veillée pascale célébrée avec cette moniale au monastère, je suis allé visiter une petite chapelle tenue par les frères à Caracas, dans l’un des barrios les plus violents d’Amérique latine. La chapelle était criblée de trous de projectiles. En moyenne, quelque vingt-huit personnes sont assassinées par balle chaque week-end dans la paroisse. Sur le mur derrière l’autel, il y a une fresque peinte par des enfants du quartier. C’est une peinture de la Cène, avec Jésus en train de manger, entouré de dominicains et de dominicaines. Dominique caresse son chien. Mais le disciple qu’il aimait, endormi à côté de Jésus, est un enfant du quartier, un gamin des rues. Symbole de l’enfant qui a enfin trouvé une appartenance dans ce monde violent, la promesse d’un foyer.
5. Conclusion
Il me faut conclure. J’affirmais en commençant que nous ne pouvons trouver le sens de la vie religieuse qu’en comprenant que c’est une réponse à la recherche de sens de la vie humaine. J’ai suggéré ensuite qu’une des manières de comprendre l’actuelle crise du sens de la société occidentale se formule ainsi : l’histoire fondamentale que nous racontons pour dire qui nous sommes et où nous allons ne fonctionne plus. Cela est symbolisé par notre cher ours. C’est une histoire pleine de contradictions. Elle parle de progrès, mais semble nous conduire à la pauvreté. Elle offre la liberté et cependant, nous nous retrouvons souvent impuissants. Elle invite à être le » moi moderne » , autonome et solitaire, mais nous découvrons que nous ne pouvons pas être humains sans communauté.
Aussi la vie religieuse ne peut-elle répondre à cette soif de sens qu’en incarnant une autre histoire, une autre vision de ce que c’est qu’être humain, dont nous voyons le symbole dans notre encore plus chère moniale, qui chante devant le cierge dans la nuit. Et c’est une histoire qui offre un autre sens du temps. Ce n’est plus tant l’inévitable marche du progrès que le récit du comment nous rencontrons le Seigneur qui nous appelle à Lui. Et ce qui anime cette histoire, ce n’est pas la libre compétition, mais l’inimaginable créativité de Dieu qui ressuscite les morts. Et le héros de cette histoire n’est pas le héros solitaire des temps modernes, mais le frère et la soeur qui se trouvent en communauté, et construisent pour les autres une communauté.
La vie religieuse n’est rien d’autre qu’une tentative de vivre cette autre histoire, l’histoire pascale de la mort et de la résurrection. Comme l’a écrit Bruno Chenu dans son excellent livre, que j’ai lu trop tard : » Les religieux veulent mettre en oeuvre une certaine logique du baptême, une vie en Christ poussée jusqu’en ses ultimes conséquences. » (L’Urgence prophétique. Dieu au défi de l’Histoire, Paris, 1997, p. 262.) Les voeux ne donnent pas un sens différent ou spécial à notre vie. Mais ils rendent public et explicite notre rejet de l’histoire de l’ours. L’obéissance, par exemple, est un clair rejet de l’image du moi autonome, solitaire et désengagé. C’est une déclaration de notre intention de vivre par cette autre histoire, de découvrir qui nous sommes dans la vie commune des frères. C’est un engagement à se libérer de l’insoutenable fardeau du moi moderne et solitaire. Dans l’obéissance, nous rejetons aussi l’image de la vie comme combat pour la force, de même que dans la pauvreté, nous renonçons publiquement à la compétition pour le succès, la foire d’empoigne de la société de consommation. Dans la chasteté, nous acceptons que la fertilité la plus profonde que nous puissions jamais avoir est celle du Dieu créateur qui ressuscite les morts.
Ces voeux nous laissent nus et exposés. Ils renversent n’importe quelle autre histoire qui viendrait donner un sens provisoire à notre vie et nous permettre de continuer, encore un jour. Nous promettons d’abandonner carrière, succès financier, toutes les cachettes qui pourraient suggérer qu’après tout, l’ours a raison. Si cette histoire pascale n’est pas vraie, alors nos vies n’ont aucun sens et » nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes » (1 Co 15, 19).
Ce n’est pas facile. Nous sommes les enfants de l’ère moderne et nous avons été formés par ses histoires, nous avons partagé ses rêves. Je sais, par exemple, que je ressemble moi-même plus à l’ours qu’à la moniale. Mes réponses instinctives sont plus souvent celles du moi solitaire que celles d’un frère. Je sais que j’ai à peine commencé le processus de renaissance.
Mon imagination n’est qu’à demi remodelée. Quand j’attends à l’arrêt de bus à Rome et regarde les affiches, c’est moi-même que je vois.
J’en tire deux conclusions. Tout d’abord, je peux au moins partager avec mes contemporains un combat pour quitter le masque de l’ours et prendre figure humaine. Si je ne partageais pas ce combat, je n’aurais rien à répondre à la question : » La vie humaine, quel sens aujourd’hui ? » Le religieux n’est pas un être céleste, échappant à la modernité, mais une personne dont les voeux ont rendu inévitable et sans échappatoire le combat pour renaître. Nous partageons avec les autres les affres de la renaissance. Si nous sommes honnêtes sur nos combats, peut-être ces autres partageront-ils notre espérance.
Ensuite, parce que c’est difficile, nous devons donc véritablement nous consacrer à bâtir des communautés où cette nouvelle vie pascale soit possible. Une communauté religieuse doit être davantage qu’un endroit où prendre nos repas, dire quelques prières et rentrer dormir tous les soirs. C’est un lieu de mort et de résurrection, où nous nous aidons réciproquement à nous faire nouveaux. Je commence à m’attacher à l’idée de la vie religieuse comme écosystème, concept que j’ai développé ailleurs’. Un écosystème est ce qui permet à des formes de vie étranges de s’épanouir. Toute forme de vie étrange a besoin de son écosystème. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes qui viennent maintenant à la vie religieuse, n’étant souvent venus à la foi en Dieu que récemment. Une grenouille rare ne peut vivre et se reproduire et avoir un avenir que si elle dispose de tous les éléments indispensables de son écosystème : un étang, de l’ombre, diverses plantes, beaucoup de boue, et d’autres grenouilles.
Être religieux, c’est choisir une forme de vie étrange, et chacun de nous aura besoin de son environnement porteur : prière, silence, communauté. Sans quoi, nous ne pourrons nous développer. Aussi un bon supérieur est-il un écologiste qui aide ses frères à construire les environnements nécessaires à leur bon développement. Mais les écosystèmes ne sont pas de petites prisons qui nous couperaient du monde moderne. Un écosystème permet à une forme de vie de s’épanouir et de réagir de manière créative à d’autres formes de vie.
Nous avons besoin d’écosystèmes qui soutiennent en nous le sens du temps pascal, le rythme de l’année liturgique qui nous porte de l’Avent à la Pentecôte. Nous avons besoin de communautés qui soient marquées par ses rythmes, par ses cadres de célébration et de jeûne. Nous avons besoin de communautés où nous ne nous contentions pas d’expédier quelques psaumes avant de partir travailler, mais où l’on soutienne en nous celui qui, même dans le désert, finira par chanter les louanges. Nous avons besoin de construire des communautés où partager notre foi, et partager notre désespoir, afin de nous aider mutuellement à traverser le désert. Nous avons besoin de communautés où pouvoir lentement renaître en frères et soeurs, fils du Dieu vivant.
La moniale chante dans l’obscurité, comme Dominique chantait en cheminant dans le sud de la France. Telle est la vocation chrétienne. Saint Augustin nous disait : » Suivez le chemin. Chantez en marchant. C’est ce que font les voyageurs pour alléger leur fardeau […]. Chantez un chant nouveau. Ne laissez personne venir vous seriner les vieux refrains. Chantez les chansons d’amour de votre pays […]. Comme chantent les voyageurs, et ils chantent souvent la nuit. Tous les bruits qu’ils entendent alentour sont effrayants. Mais ils chantent même quand ils ont peur des bandits. » (SAINT AUGUSTIN, Enarrationes in Psalmos, 66, 6.) Ou des ours !
Prier le Rosaire (1998)
Conférence donnée à Lourdes, octobre 1998
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 Quand on m’a demandé de parler du Rosaire, je dois avouer que j’ai eu un instant de panique. Je n’ai jamais rien lu sur le Rosaire, pas plus que je n’y ai réfléchi de toute ma vie. Je suis sûr que la plupart d’entre vous ont sur le Rosaire des idées bien plus profondes que les miennes. Le Rosaire est juste quelque chose que j’ai fait, sans y penser, comme respirer. Respirer est fort important pour moi. Je respire tout le temps, mais je n’ai jamais fait de conférence sur la respiration. Prier le Rosaire, comme respirer, c’est tout simple. Qu’y a-t-il à en dire?
Quand on m’a demandé de parler du Rosaire, je dois avouer que j’ai eu un instant de panique. Je n’ai jamais rien lu sur le Rosaire, pas plus que je n’y ai réfléchi de toute ma vie. Je suis sûr que la plupart d’entre vous ont sur le Rosaire des idées bien plus profondes que les miennes. Le Rosaire est juste quelque chose que j’ai fait, sans y penser, comme respirer. Respirer est fort important pour moi. Je respire tout le temps, mais je n’ai jamais fait de conférence sur la respiration. Prier le Rosaire, comme respirer, c’est tout simple. Qu’y a-t-il à en dire?
1. La simplicité
Il peut sembler curieux qu’une prière aussi simple que le Rosaire soit particulièrement associée aux Dominicains. On pense rarement aux Dominicains comme à des gens simples. Nous avons la réputation d’écrire des ouvrages de théologie longs et complexes. Pourtant, nous nous sommes battus pour conserver le Rosaire. Il est nostra sacra haereditas, » notre saint héritage » (1. F. BAGGIANI, » Statuti, cinquecenteschi di Confraternità del Rosario « , Memorie Domenicane, 26 (1995), p. 221.). Il y a une longue tradition iconographique de Notre-Dame tendant le Rosaire à saint Dominique. À un certain moment, d’autres ordre religieux, jaloux, se mirent à commander des tableaux de Notre-Dame tendant le Rosaire à d’autres saints, saint François et même saint Ignace. Nous nous sommes défendus et, au XVIIe siècle je crois, avons convaincu le pape de mettre fin à la compétition. On permit de représenter Notre-Dame tendant le Rosaire uniquement à Dominique!
Mais pourquoi cette simple prière est-elle si chère aux Dominicains ? Peut-être parce qu’au coeur de notre tradition théologique réside une aspiration à la simplicité. Saint Thomas d’Aquin disait que nous ne pouvons comprendre Dieu parce que Dieu est parfaitement simple. Sa simplicité dépasse toutes nos conceptions. Nous étudions, affrontons des problèmes théologiques, éprouvons nos esprits, avec l’objectif d’approcher le mystère de Celui qui est totale simplicité. Nous devons aller au-delà de la complexité pour parvenir à la simplicité.
Il y a une fausse simplicité, dont nous devons nous défaire. C’est la simplification de ceux qui ont toujours trop facilement réponse à tout, qui savent tout d’avance. Ils sont soit trop paresseux, soit incapables de penser. Et il y a la véritable simplicité, celle du coeur, la simplicité des regards clairs. Et nous ne pouvons y parvenir que lentement, avec la grâce de Dieu, en nous approchant de l’aveuglante simplicité de Dieu. La Rosaire est simple en effet, bien simple. Mais de la simplicité sage et profonde à laquelle nous aspirons, et dans laquelle nous trouverons la paix.
On dit qu’en devenant vieux saint Jean l’évangéliste devint totalement simple. Qu’il aimait à jouer avec une colombe, et tout ce qu’il disait aux gens qui venaient le voir, c’est : » Aimez-vous les uns les autres. » Ni vous ni moi ne nous contenterions de cette réponse! Personne ne nous croirait. Seul quelqu’un comme saint Jean, qui a écrit le plus riche et le plus complexe des Évangiles, peut parvenir à la véritable simplicité de la sagesse et ne rien dire de plus que : » Aimez-vous les uns les autres. » De même, seul un saint Thomas d’Aquin, après avoir écrit sa grande Summa theologica, peut dire que tout ce qu’il a écrit est » comme une brindille » . Oui, le Rosaire est très simple. Peut-être est-il une invitation à découvrir cette simplicité profonde de la véritable sagesse. On disait de Lagrange, l’un des fondateurs des études bibliques modernes, qu’il faisait trois choses chaque jour : étudier la Bible, lire les journaux et prier le Rosaire!
J’aimerais aussi montrer que non seulement le Rosaire est d’une simplicité vraie et profonde, mais aussi que nombre de ses caractéristiques sont authentiquement dominicaines.
2. L’ange, ce prêcheur
Le Je vous salue Marie commence par les mots de l’Ange Gabriel : » Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Les anges sont des prêcheurs professionnels. C’est leur être même que de proclamer la Bonne Nouvelle. Les paroles de Gabriel sont un parfait sermon. Et en plus, il est bref ! Il proclame l’essence de toute prédication : » Le Seigneur est avec vous. » C’est là que nous trouvons le coeur de notre vocation : nous dire les uns aux autres » Ave Daniel, Ave Éric, le Seigneur est avec toi. » C’est pour cela que Humbert de Romans, l’un des premiers maîtres de l’Ordre, disait que nous, les Dominicains, sommes appelés à vivre comme les anges. Même s’il faut bien avouer que, selon mon expérience, la plupart des dominicains ne sont pas particulièrement angéliques!
En décembre dernier, je me trouvais à Hô Chi MinhVille, durant la visite canonique de la province du Viêtnam. À la fin de notre journée de travail, mon socius et moi-même aimions partir nous perdre dans les petites rues de la ville. Un des plaisirs consistait à échapper à l’espion que le gouvernement envoyait pour voir ce que nous pouvions bien fabriquer. Nous avons traîné des heures durant à travers le labyrinthe d’étroites ruelles, pleines de vie, de gens qui pariaient, mangeaient, parlaient, jouaient au billard. Dans beaucoup de maisons, on voyait des images de Bouddha. Et puis un soir, au détour d’une rue, nous sommes entrés dans un petit parc, et là, en plein milieu, se trouvait l’immense statue d’un dominicain avec des ailes. C’était saint Vincent Ferrier, que l’on représente toujours en ange. Il était le grand prêcheur. Daniel me dit qu’on le considérait comme l’ange de l’Apocalypse, annonçant la fin du monde. Bon, aucun prêcheur ne peut avoir toujours raison! Ainsi, l’archange Gabriel est-il un bon modèle pour nous, Dominicains.
Par un autre aspect encore, Je vous salue Marie est une sorte d’homélie. Une homélie ne nous parle pas seulement de Dieu. Elle naît de la Parole que Dieu nous adresse. La prédication n’est pas uniquement le récit des événements liés à Dieu. Elle nous donne la Parole de Dieu, Parole qui rompt le silence entre Dieu et nous.
Les premiers mots de la prière sont ceux que l’ange adresse à Marie : » Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Le commencement de toute chose est la Parole que nous entendons. Saint Jean écrivait : » En ceci consiste l’amour ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés » (1 Jn 4, 10). En fait, à l’époque de saint Dominique, l’Ave Maria n’était formé que des seuls mots de l’ange et d’Élisabeth. Notre prière était faite des paroles que l’on nous avait données. Ce n’est que plus tard, après le concile de Trente, que fut ajouté notre propre discours à Marie.
Bien souvent, nous concevons la prière comme l’effort fait pour parler à Dieu. La prière a parfois l’air d’une lutte pour atteindre un Dieu distant. Nous entend-il seulement?
Mais cette simple prière nous rappelle qu’il n’en va pas ainsi. Ce n’est pas nous qui brisons le silence. Quand nous parlons, c’est en réponse à des paroles reçues. Nous pénétrons dans une conversation qui a déjà commencé sans nous. L’ange proclame la Parole de Dieu. Et cela crée un espace dans lequel nous pouvons parler à notre tour: » Sainte Marie, mère de Dieu. «
Notre vie souffre si souvent du silence. Il y a le silence du ciel, qui semble parfois nous être fermé. Il y a le silence qui semble nous séparer les uns des autres. Mais la Parole de Dieu vient à nous par la bonne prédication, et ouvre tout grand ces barrières. Nous sommes libérés de notre mutisme, rendus capables de parole. Nous sentons les mots venir, les mots destinés à Dieu et les mots entre nous.
Peut-être pouvons-nous aller plus loin. Maître Eckhart a dit: » Nous ne prions pas; nous sommes priés. » Nos propres paroles sont la résonance, le prolongement de la Parole qu’on nous a adressée. Nos prières sont Dieu qui prie en nous, bénit, glorifie en nous. Comme l’écrivit saint Paul, quand nous crions : » Abba, Père « , » l’Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu… » Les saluts de l’ange et d’Élisabeth à Marie se poursuivent par les mots que nous lui adressons. La seconde moitié de la prière fait écho à la première. L’ange a dit : » Je vous salue Marie, pleine de grâce » ; dans notre bouche, cela devient le même salut : » Sainte Marie. » Élisabeth dit : » Le fruit de vos entrailles est béni » et nous disons » mère de Dieu » . Nous sommes gagnés par la Parole de Dieu. Notre prière, c’est Dieu qui parle en nous. Nous sommes entraînés dans la conversation qui est la vie de la Trinité.
Aussi voudrais-je regarder cette simple prière du Je vous salue Marie comme une petite homélie modèle. Elle proclame la Bonne Nouvelle. Et comme toutes les bonnes homélies, elle fait bien davantage. Elle ne se contente pas de nous donner des renseignements. Elle offre une Parole de Dieu, une parole qui fait écho dans nos propres mots, une parole qui va au-delà de notre silence et nous donne voix.
3. Une prière pour la maison et une prière pour le voyage
Il y a encore un autre aspect de cette prière qui est très dominicain. C’est une prière pour la maison, et une prière pour la route. C’est une prière qui construit une communauté et en même temps qui nous jette dans le voyage. C’est là une tension bien dominicaine. Nous avons besoin de nos communautés. Nous avons besoin de lieux où nous sommes chez nous, avec nos frères et nos soeurs. Et en même temps, nous sommes des prêcheurs itinérants, nous ne pouvons nous fixer trop longtemps, mais devons nous lancer dans la prédication. Nous sommes contemplatifs et actifs. Permettez-moi d’expliquer maintenant comment le Je vous salue Marie est marqué par cette même tension.
Pensez aux grands tableaux de l’Annonciation. Ils nous présentent en général une scène domestique. L’ange est allé chez Marie. Marie est là, dans sa chambre, en général elle lit. Souvent, on aperçoit dans le fond un rouet ou un balai appuyé contre le mur. Dehors, un jardin. C’est ici que l’histoire commence, chez elle. Et il est juste que ce soit ainsi, car la Parole de Dieu fait chez nous son foyer. Dieu vient planter sa tente parmi nous.
D’une certaine manière, le Rosaire est souvent la prière du chez soi et de la communauté. Traditionnellement, on le disait chaque jour dans les familles et dans les communautés. Dès le milieu du xve siècle, on voit la fondation de confraternités du Rosaire, qui se réunissent pour prier ensemble. Ainsi le Rosaire est-il profondément associé à la communauté, à la prière partagée. Je dois avouer que j’ai des souvenirs assez ambigus du Rosaire en famille! Chez nous, on ne le disait pas, mais j’allais souvent chez des cousins qui le récitaient ensemble chaque soir. C’était souvent une catastrophe. Quelque soin qu’on ait mis à fermer les portes, les chiens faisaient toujours irruption dans la pièce et au milieu de la famille, venant lécher les visages. Aussi, peu importaient nos pieuses intentions, nous finissions par éclater de rire. J’en suis arrivé à redouter le Rosaire en famille.
Mais le salut de l’ange ne laisse pas Marie rester chez elle. L’ange vient déranger sa vie domestique. Je pense souvent à une merveilleuse Annonciation peinte par notre frère dominicain Petit, qui vit et travaille au Japon. Il montre Gabriel en grand messager, couvrant une partie de la toile; Marie est cette jeune fille japonaise, gracieuse et réservée, dont la vie est bouleversée. Elle est poussée dans un voyage qui la conduira chez Élisabeth, à Bethléem, en Égypte, à Jérusalem. Ce voyage l’emportera jusqu’à briser son coeur, au pied de la croix. Ce voyage l’emmènera finalement jusqu’au ciel et à la gloire.
Le Rosaire est donc aussi la prière de ceux qui voyagent, des pèlerins, comme vous. J’ai appris à aimer le Rosaire justement comme prière pour mes voyages. C’est une prière pour les aéroports et les avions. C’est une prière que je dis souvent en atterrissant dans un lieu nouveau, quand je me demande ce que j’y trouverai, et ce que j’ai à donner. C’est une prière pour redécoller, rendre grâce pour tout ce que j’ai reçu des frères et des soeurs. C’est une prière de pèlerinage à travers l’Ordre.
Je pense que la structure de ce voyage marque le Rosaire de deux manières. Elle est présente dans les mots de chaque Je vous salue Marie. Et elle est présente dans le parcours des mystères du Rosaire.
Je vous salue Marie – L’histoire de l’individu
Chaque Ave Maria évoque le voyage individuel que chacun de nous doit faire, de la naissance à la mort. Il est marqué .par le rythme biologique de toute vie humaine. Il cite les trois seuls moments de notre vie dont nous pouvons être absolument sûrs : nous sommes nés, nous vivons maintenant et nous mourrons un jour. Il commence au commencement de toute vie humaine, la conception dans le sein maternel. Il nous situe maintenant, au moment où nous demandons à Marie ses prières. Il envisage la mort, notre mort. C’est une prière incroyablement physique. Elle est marquée par l’inévitable drame corporel de tout corps humain, qui est né et doit mourir.
Et cela est bien dominicain, assurément. Car la prédication de Dominique commence dans le sud de la France, pas très loin d’ici, contre les hérétiques qui méprisaient le corps, et qui considéraient l’entière création comme mauvaise. Il se confrontait à l’une de ces vagues de spiritualité dualiste qui ont régulièrement déferlé sur l’Europe. Saint Augustin, dont nous suivons la Règle, fut pris dans un autre de ces mouvements quand, jeune homme, il était manichéen. Et aujourd’hui encore, un grand pan de la pensée populaire est profondément dualiste. Des études ont montré que les scientifiques modernes pensent généralement le salut en termes d’échappatoire au corps.
Mais la tradition dominicaine a toujours souligné que nous sommes des êtres physiques, corporels. Tout ce que nous sommes vient de Dieu. Nous recevons en nourriture le sacrement du corps et du sang de Jésus; nous espérons la résurrection des corps.
Le voyage que chacun de nous doit parcourir est en premier lieu physique, biologique, et il nous mène du ventre de notre mère à la tombe. C’est dans cet espace temporel que nous rencontrerons Dieu et trouverons le salut. Et cette simple prière nous aide sur le parcours de ce chemin.
La conception
Les paroles de l’ange promettent la fertilité, la fertilité pour une vierge et pour une femme stérile. La bénédiction de Dieu nous rend fertiles. Chacun de nous, par sa naissance individuelle, est le fruit d’entrailles bénies. Je crois que la bénédiction promise par l’ange prend toujours la forme de la fertilité, dans toute vie humaine. C’est la bénédiction de nouveaux commencements, la grâce de la fraîcheur. Peut-être sommes-nous faits à l’image et à la ressemblance de Dieu parce que nous partageons la créativité de Dieu. Nous sommes ses associés dans la création et recréation du monde. L’exemple le plus dramatique et miraculeux en est la naissance d’un enfant. Les hommes également, qui ne peuvent pourtant pas faire ce miracle, sont bénis par la fertilité. Face à la stérilité, l’aridité, la futilité, Dieu vient offrir un monde fertile. Chaque fois que Dieu s’approche de nous, c’est pour nous rendre créatifs, nous transformer, nous renouveler, que ce soit en labourant la terre, en plantant et semant, ou par l’art, la poésie, la peinture.
» Le fruit de vos entrailles est béni. » Alors, peut-être la meilleure manière de prêcher le miracle de cette fertilité est-elle l’art, la peinture, le chant, la poésie. Car ce sont là de modestes partages de cette bénédiction même, de cette infinie fertilité de Dieu.
Une histoire charmante, citée par Malraux à Picasso (Voir B. BRO, La beauté sauvera le monde, Éd. du Cerf, Paris, 1990, p. 298-299.), raconte comment, lorsque Bernadette de Lourdes entra au couvent, une foule de gens lui envoyèrent des statuettes de la Vierge. Mais elle ne les tint jamais dans sa chambre car, disait-elle, ces statues ne ressemblaient pas à la femme qu’elle avait vue. L’évêque lui envoya des albums de célèbres tableaux de la Vierge, peints par Raphaël, Murillo et d’autres. Elle observa les vierges baroques, dont elle avait vu des représentations, et les vierges de la Renaissance. Mais aucune ne lui semblait exacte. Puis elle vit la Vierge de Cambrai, copie, datant du XIVe siècle, d’une très ancienne icône byzantine, et qui ne ressemblait à aucun des tableaux que Bernadette avait vus. Et elle dit : » C’est elle! » Il n’est peut-être pas surprenant que la jeune fille qui avait vu la Vierge la reconnaisse dans une icône, fruit de l’art sacré, fruit d’une sainte créativité. Marie apparaît avec plus de clarté dans l’oeuvre d’un peintre rendu fertile par la grâce de Dieu.
Maintenant
Le Rosaire évoque aussi un autre moment, non seulement celui de la naissance, mais le moment présent. » Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. » Maintenant, c’est l’instant présent dans le pèlerinage de notre vie, quand nous devons tenir, survivre, poursuivre notre chemin vers le Royaume.
Il est intéressant de noter que cet instant présent est considéré comme un moment où nous, pauvres pécheurs, avons besoin de compassion. C’est une compassion profondément dominicaine. Vous vous souvenez que Dominique priait toujours Dieu ainsi : » Seigneur, pitié pour ton peuple. Qu’adviendra-t-il des pécheurs ? » Le présent est un moment où nous avons besoin de compassion, de miséricorde. Dans la chapelle Sixtine, il y a sur la fresque du Jugement dernier un homme hissé hors du purgatoire par un ange au Rosaire.
Le présent est le temps durant lequel nous devons survivre, ignorant jusques à quand il nous faudra attendre le Royaume. Un dominicain américain qui retournait en Chine il y a quelques années, y trouva divers groupes de laïcs dominicains qui avaient survécu aux années de persécution et d’isolement. Et la seule chose qu’ils avaient gardée durant toutes ces années, c’était de réciter le Rosaire tous ensemble. C’était le pain quotidien de la survie. Et, s’étant rendu dans des régions reculées du Mexique pour y rencontrer des groupes de laïcs dominicains n’ayant pas eu de contact avec l’Ordre depuis des années, plusieurs de nos frères découvrirent la même chose. La seule pratique qui se poursuivait était celle du Rosaire. C’est la prière pour les survivants du temps présent.
Bede Jarrett, provincial anglais dans les années trente, envoya en Afrique du Sud un membre de la province, nommé Bertrand Pike, pour aider la nouvelle mission de l’Ordre. Mais Bertrand se sentit dépassé et incapable de faire face. C’était plus qu’il ne pouvait assumer. Il lui manquait le courage de continuer. Et Bede lui rappela dans une lettre une époque, pendant la guerre, où il avait puisé son courage dans le Rosaire.
» Te souviens-tu de ce jour terrible où tu devais traverser les tranchées à Ypres, quand le courage te manquait, et ce n’est qu’après trois ou quatre tentatives que tu t’étais forcé à passer, et tu t’étais aperçu que les bords découpés des grains de ton rosaire avaient mordu la chair de ton doigt, dans ton inconscient mouvement de les agripper pour puiser un nouvel élan de courage en les serrant… Mais, mon cher Bertrand, courage et peur ne sont pas opposés. N’ont de courage que ceux qui font leur devoir même quand ils ont peur. » (B. BAILEY, A. BELLINGER et S. TUGWELL (éd.), The Letters of Bede Jarrett o. p., p. 190.)
Ainsi Bertrand doit-il tenir son rosaire bien serré pour trouver du courage » maintenant et à l’heure de sa mort « . Le Rosaire est notre prière à tous, nous qui avons besoin de courage pour continuer, pour triompher devant la peur. Il nous donne le courage du pèlerin.
À l’heure de notre mort
Le dernier moment de notre vie corporelle dont nous soyons sûrs, c’est la mort. » Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. » Devant la mort, nous prions le Rosaire. Je viens de rentrer de Kinshasa, au Congo, où beaucoup de nos soeurs ont affronté la mort ces dernières années. La provinciale des soeurs missionnaires de Grenade, soeur Christina, m’a raconté comment, durant la dernière guerre, elle et ses soeurs ont dû fuir leur maison au nord du Congo. Des amis les ont cachées dans la brousse. Elle est médecin et, dans la fuite, elle a croisé un homme dont elle avait sauvé la femme. Il lui a dit que c’était maintenant son tour de lui sauver la vie. Ils entendaient tout autour l’explosion des fusillades. On leur dit que les rebelles avaient découvert leur cachette et qu’ils viendraient bientôt les tuer. Devant cette mort annoncée, les soeurs prièrent le Rosaire. C’est la prière que Marie fera pour nous lorsque nous ferons face à la mort. Nous ne serons pas seuls.
Je pense aussi à mon père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ma mère et ses trois plus grands enfants restèrent à Londres. Je devais bientôt naître. Malgré les bombes qui, nuit après nuit, s’écrasaient sur Londres, ma mère tenait beaucoup à rester disponible dans l’éventualité où mon père pourrait avoir une permission et venir à la maison. Et mon père promit que, si toute sa famille survivait à la guerre, il prierait le Rosaire tous les soirs. Aussi, parmi mes souvenirs d’enfance, je revois mon père, chaque soir, avant le repas, arpenter le salon en priant le Rosaire. Il rendait grâce, chaque soir, de ce que nous avions survécu à cette menace de mort. Et l’un de mes derniers souvenirs de mon père se situe peu de temps avant sa mort. Il était alors trop faible pour pouvoir encore prier lui-même. Aussi sa famille, sa femme et ses six enfants, se réunirent-ils autour de son lit et prièrent le Rosaire pour lui. C’était la première fois qu’il ne pouvait le faire lui-même. Sa mort, alors qu’il était entouré de nous tous, était une réponse à cette prière qu’il avait tant de fois répétée. Priez pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort.
T. S. Eliot implore dans l’un de ses poèmes : » Priez pour nous, maintenant et à l’heure de notre naissance. » ( » Animula « , dans Ariel Poems.) Et il a raison. Car nous devons affronter ces trois moments de notre vie : la naissance, le présent et notre mort. Mais à chaque instant nous aspirons à la même chose : une nouvelle naissance. Ce à quoi nous aspirons maintenant, comme pécheurs, ce n’est pas une pitié qui se contenterait d’oublier ce que nous avons fait, mais la miséricorde qui fera de nos actions aussi un moment de renaissance, de nouveau commencement. Et face à la mort, nous désirons de nouveau que les mots de l’ange viennent nous annoncer une nouvelle fertilité. Car toute notre vie est ouverte à l’infinie nouveauté de Dieu, à son inépuisable fraîcheur. L’ange vient et revient, avec de nouvelles annonciations de la Bonne Nouvelle.
Les mystères du Rosaire – L’histoire du salut
L’Ave Maria individuel est donc la prière du voyage que chacun de nous doit parcourir, de la naissance à la mort en passant par le moment présent. Mais en fin de compte, notre vie n’a pas de sens en elle-même, comme histoire privée, individuelle. Notre vie n’a de sens que prise dans une histoire plus vaste, qui s’étend du tout début jusqu’à la fin inconnue, de la Création au Royaume. Et cette plus longue étendue est donnée par les mystères du Rosaire, qui racontent l’histoire de la Rédemption.
On a comparé les mystères du Rosaire à la Summa theologica de saint Thomas. Ils racontent à leur manière comment tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Car chaque mystère du Rosaire fait partie d’un unique mystère, celui de notre Rédemption dans le Christ. Comme l’écrivait Paul aux Éphésiens, » Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu’Il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis : ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres » (Ep 1, 9).
On pourrait donc dire que chaque Ave Maria représente une vie individuelle, avec son histoire entière de la vie à la mort. Mais tous ces Ave Maria sont embrassés dans une histoire plus longue, celle de la Rédemption. Nous avons besoin des deux dimensions, une histoire à deux niveaux. Il me faut donner une forme et un sens à ma vie, à l’histoire de ma chair et de mon sang, avec mes échecs et mes victoires. S’il n’y a pas de place pour mon histoire unique, je serai tout simplement perdu dans l’histoire de l’humanité. Car le Christ me dit : » Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis. » J’ai besoin de cet Ave Maria individuel, mon petit drame personnel, pour faire face à ma petite mort personnelle. Ma mort ne signifie peut-être pas grand-chose pour l’humanité, mais pour moi, elle sera plutôt importante.
Cependant, il n’est pas suffisant de s’en tenir à ce niveau personnel. Je dois voir ma vie s’insérer dans le drame plus vaste du dessein de Dieu. Seule, mon histoire n’a pas de sens. Mon Ave Maria individuel doit trouver place dans les mystères du Rosaire. Ainsi le Rosaire propose-t-il le parfait équilibre dont nous avons besoin pour la recherche du sens de notre vie, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif.
4. La répétition
J’ai tenté de donner succinctement quelques raisons pour lesquelles le Rosaire est bien une dévotion profondément dominicaine. L’Ave Maria porte toutes les caractéristiques d’une homélie parfaite et brève. Et le Rosaire dans son ensemble est marqué par le thème du cheminement, le nôtre et celui de l’humanité. Tout cela s’accorde très bien à la vie d’un ordre de prêcheurs itinérants. J’aurais pu insister sur d’autres aspects, comme les fondements bibliques des mystères. Car il y a là une méditation prolongée sur la Parole de Dieu dans les Écritures. Mais j’ai assez parlé!
Je dois toutefois répondre à une dernière objection. J’ai voulu évoquer la richesse théologique du Rosaire. Le fait est, pourtant, qu’en priant le Rosaire on pense rarement à quoi que ce soit. En réalité, nous ne pensons pas à la nature de la prédication, ou à l’histoire humaine et à son lien avec l’histoire du salut. Nous faisons un grand vide dans notre esprit. Il nous arrivera même parfois de nous demander pourquoi donc nous répétons sans cesse les mêmes mots, sans y penser. Ça n’est certes guère dominicain! Pourtant, dès le tout début de notre tradition, nos frères et. nos moniales ont aimé cette répétition. On prétend que notre frère Romeo, mort en 1261, récitait mille Ave Maria par jour !
Tout d’abord, de nombreuses religions portent la marque de cette tradition de la répétition de paroles sacrées. Dimanche dernier, me demandant ce que j’allais dire du Rosaire, j’ai entendu à la BBC une cérémonie bouddhiste qui consiste apparemment en une perpétuelle répétition de paroles sacrées, le mantra. Il a souvent été rappelé que le Rosaire est assez semblable à ces traditions de prière orientale, et que la constante répétition des mêmes mots peut réaliser dans notre coeur une lente mais profonde transformation. Cela étant bien connu, je n’insiste pas.
On pourrait aussi souligner que cette répétition n’est pas nécessairement le signe d’un manque d’imagination. Un pur plaisir, un plaisir exubérant, peut nous faire répéter les mots. Quand nous aimons, nous savons bien qu’il ne suffit jamais de dire une seule fois » je t’aime » . Nous voulons le dire encore et encore, espérant aussi que l’autre souhaitera l’entendre encore et encore.
G. K. Chesterton a expliqué que la répétition est une caractéristique de la vitalité des enfants, qui aiment qu’on leur raconte les mêmes histoires, avec les mêmes mots, encore et toujours, nullement par ennui ou manque d’imagination, mais par joie de vivre.
Chesterton écrivait : » C’est parce que les enfants débordent de vitalité, parce qu’ils sont farouches et libres d’esprit, qu’ils veulent que les choses se répètent et ne changent pas. Ils demandent toujours « encore! » ; et la grande personne recommence, encore, jusqu’au bord de l’épuisement car les grandes personnes ne sont pas assez fortes pour exulter dans la monotonie. Peut-être Dieu est-il assez fort, Lui, pour exulter dans la monotonie. Peut-être Dieu dit-il tous les matins au soleil : « Allez, encore »; et tous les soirs à la lune : « Allez, encore. » Ce n’est pas forcément une absolue nécessité qui fait toutes les marguerites semblables; peut-être Dieu crée-t-il chaque marguerite séparément, mais ne se lasse jamais de les faire ainsi. Peut-être Dieu a-t-il un éternel appétit d’enfance; car si nous avons péché et nous avons grandi, notre Père est plus jeune que nous. La répétition dans la nature n’est peut-être pas une simple récurrence, mais, comme au théâtre, un bis où le ciel rappellerait l’oiseau qui a pondu. » (Orthodoxy, Londres, 1908, p. 92.) Ou encore notre répétition du Rosaire!
Enfin, il est vrai qu’en priant le Rosaire on ne pense pas toujours à Dieu. On peut continuer des heures durant sans la moindre pensée. On est juste là, on dit nos prières. Et cela peut aussi être bon. Quand nous récitons le Rosaire, nous célébrons que le Seigneur est vraiment avec nous, que nous sommes en sa présence. Nous répétons les paroles de l’ange : » Le Seigneur est avec vous. » C’est une prière de la présence de Dieu. Et si nous sommes en groupe, nous n’avons pas à penser aux autres. Comme l’a écrit Simon Tugwell, » Je ne pense pas à mon ami quand il est à côté de moi; je suis bien trop occupé à goûter sa présence. C’est quand il est absent que je commence à penser à lui. Le fait de penser à Dieu nous entraîne bien aisément à le traiter comme s’il était absent. Mais il n’est pas absent. » (Prayer in Practice, Dublin, 1974, p. 35.)
Aussi n’essayons-nous pas, dans le Rosaire, de penser à Dieu. Au contraire, nous goûtons les paroles de l’ange adressées à chacun de nous : » Le Seigneur est avec vous. » Nous répétons continuellement les mêmes mots, avec l’exubérance vitale inépuisable des enfants de Dieu, qui se réjouissent de la Bonne Nouvelle.
La promesse de vie (1998)
« Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » (Jn 10,10) Rome, 25 février 1998. Mercredi des Cendres
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 En donnant l’habit aux frères, saint Dominique leur promit « le pain de vie et l’eau du ciel » (1). Pour être les prêcheurs d’une parole qui donne vie, nous devons trouver le « pain de vie » dans nos communautés. Celles-ci nous aident-elles à nous épanouir, ou simplement à survivre?
En donnant l’habit aux frères, saint Dominique leur promit « le pain de vie et l’eau du ciel » (1). Pour être les prêcheurs d’une parole qui donne vie, nous devons trouver le « pain de vie » dans nos communautés. Celles-ci nous aident-elles à nous épanouir, ou simplement à survivre?
Peu après mon entrée dans l’Ordre, ma province fut visitée par le frère Aniceto Fernandez, alors Maître de l’Ordre. Il me posa une seule question, la question traditionnelle de tous les visiteurs: « Es-tu heureux? » Je m’attendais à une question plus profonde, sur la prédication de l’Évangile ou les défis affrontés par la province. Je réalise aujourd’hui que c’est la première question que nous devons poser à nos frères: « Êtes-vous heureux? » Il existe un bonheur propre au fait d’être au monde comme dominicain, et il est source de notre prédication. Il ne s’agit pas d’un contentement illimité, d’une infatigable bonhomie. Il comporte une capacité d’être peiné. Il peut être absent pour un temps, voire longtemps. C’est un avant-goût de cette abondance de vie que nous prêchons, la joie de ceux qui ont commencé à partager la vie même de Dieu. Nous devrions avoir la capacité de nous réjouir car nous sommes les enfants du Royaume. « Se réjouir est le caractère intrinsèque d’une vie bienheureuse et d’une vie qui par la grâce du Saint Esprit est sur la voie de la béatitude » (2). Dans notre chant à Dominique, nous terminons par la prière: « Nos junge beatis ». Unis-nous aux bienheureux. Puissions-nous aujourd’hui partager un avant-goût de leur bonheur.
Si nous voulons construire des communautés où la vie soit en abondance, nous devons reconnaître qui nous sommes et ce que nous sommes et ce que signifie pour nous être vivants, hommes et femmes, frères et soeurs, et prêcheurs.
Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres doués de passion, animés de désirs animaux de nourriture et d’accouplement. Telle est la nature que la Parole de vie accepta en embrassant la nature humaine. Nous ne pouvons faire moins. C’est de là que part le chemin vers la sainteté.
Mais nous sommes créés par Dieu à son image, destinés à l’amitié de Dieu. Nous sommes capax Dei,affamés de Dieu. Être en vie, c’est s’embarquer pour cette aventure qui nous conduit au Royaume. Nous avons besoin de communautés qui nous soutiennent au long du chemin. Le Seigneur a promis: « J’ôterai de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. » (Ez 36, 26) Nous avons besoin de frères et de soeurs qui soient avec nous quand nos coeurs seront brisés et attendris.
Tout sage sait depuis toujours qu’il n’est pas de chemin vers la vie qui ne traverse le désert. Le voyage de l’Égypte à la Terre Promise passe par le désert. Pour être heureux et véritablement en vie, nous devons nous aussi passer par là. Nous avons besoin de communautés qui nous accompagneront dans ce voyage, et nous aideront à croire que lorsque le Seigneur conduit Israël dans le désert, c’est pour pouvoir « parler à son coeur » (Os 2,16). Si tant de gens ont quitté la vie religieuse ces trente dernières années, ce n’est peut-être pas qu’elle soit plus difficile qu’auparavant, mais parce que nous avons parfois perdu de vue le fait que ces nuits obscures font partie de notre renaissance comme êtres vivants avec la joie du Royaume. Aussi nos communautés ne doivent-elles pas être des lieux où nous nous contentons de survivre, mais des lieux où nous trouvons la nourriture pour notre voyage.
Pour reprendre une métaphore que j’ai développée ailleurs (3), les communautés religieuses sont comme des systèmes écologiques destinés à porter de curieuses formes de vie. Une espèce rare de grenouille aura besoin de son propre écosystème pour s’épanouir et parcourir son hasardeux chemin de l’oeuf au têtard jusqu’à la grenouille. Si la grenouille est menacée d’extinction, il faut construire un environnement lui offrant sa nourriture, et les étangs et le climat dans lesquels elle puisse prospérer. La vie dominicaine requiert elle aussi son propre écosystème, si nous voulons la vivre pleinement et prêcher une parole de vie. Il ne suffit pas d’en parler; nous devons planifier activement et construire de tels écosystèmes dominicains.
C’est en premier lieu la responsabilité de chaque communauté. C’est aux frères et aux soeurs qui vivent ensemble de créer des communautés dans lesquelles nous ne nous contentions pas de survivre mais puissions nous épanouir, nous offrant mutuellement « le pain de vie et l’eau du ciel ». Tel est le sens fondamental du « projet communautaire » proposé par les trois derniers chapitres généraux. Cela ne se réalisera que si nous osons parler ensemble de ce qui nous touche le plus profondément comme êtres humains et comme dominicains. Mon espoir est que cette lettre à l’Ordre ouvrira la discussion sur certains aspects de notre vie dominicaine. Je parle de la vie apostolique, la vie affective et la vie de prière. Ce ne sont pas trois différentes parties de la vie (vie contemplative de 7 h à 7 h 30; vie apostolique de 9 h à 17 h; vie affective?). Elles appartiennent à la plénitude de toute vie véritablement humaine et dominicaine. Nicodème demande comment l’on peut renaître. C’est aussi notre question: comment nous entraider, dans cette transformation, pour devenir des apôtres de vie?
Toutes les communautés ne seront pas capables de se renouveler et d’atteindre l’idéal envisagé par nos Constitutions et récents chapitres généraux. Les provinces devront par conséquent élaborer un plan de renouvellement progressif des communautés dans lesquelles les frères puissent s’épanouir. C’est dans ces seules communautés que les jeunes frères doivent être assignés. Ce sont elles qui porteront la semence d’avenir de la vie dominicaine. Une province qui ne prévoit pas la construction de telles communautés va mourir. Une province qui a trois communautés dans lesquelles les frères s’épanouissent dans la vie dominicaine a un avenir, avec la grâce de Dieu. Une province qui a vingt communautés dans lesquelles nous nous contentons de survivre pourrait bien n’en avoir aucun.
1. LA VIE APOSTOLIQUE
1.1 Une vie déchirée
La vie dominicaine est en premier lieu apostolique. On pourrait facilement interpréter qu’un bon dominicain est toujours actif, engagé dans des « apostolats ». Mais la vie apostolique n’est pas tant ce que nous faisons que ce que nous sommes: ceux qui sont appelés à « vivre la vie des apôtres sous la forme conçue par saint Dominique » (4). Quand Diego rencontra les délégués cisterciens envoyés pour prêcher aux Albigeois, il leur dit: « Allez humblement, suivant l’exemple de notre bien-aimé Maître, enseignant et agissant, voyageant à pied sans or ni argent, en toute chose imitant la vie des apôtres. » (5) Être apôtre, c’est une vie, pas un emploi.
Et la première caractéristique de cette vie apostolique est d’être un partage de la vie du Seigneur. Les apôtres sont ceux qui l’ont accompagné « tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous » (Ac 1,21). Par lui ils furent appelés, ils marchèrent avec lui, l’écoutèrent, se reposèrent et prièrent avec lui, débattirent avec lui et par lui furent envoyés au loin. Ils partagèrent la vie de celui qui est l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». Le moment culminant de cette vie fut le partage du dernier repas, le sacrement du pain de vie. Quoique l’un d’eux partît plus tôt parce qu’il avait trop à faire.
La vie apostolique est donc pour nous bien plus que les divers apostolats que nous menons. C’est un mode de vie. Yves Congar, op écrivait de la prédication que c’est une « vocation qui est la substance de ma vie et de mon être » (6). Si les exigences de l’apostolat impliquent que nous n’ayons pas le temps de prier et manger avec nos frères, de partager leurs vies, alors, tout actifs que nous puissions être, nous ne serons pas des apôtres dans le plein sens du terme. Maître Eckhart écrivait: « Les gens ne devraient pas tant se préoccuper de ce qu’ils doivent faire; ils feraient mieux de s’occuper de ce qu’ils doivent être. Si nous-mêmes et notre manière d’être sommes bons, ce que nous ferons rayonnera » (7). Dominique était un prêcheur de tout son être.
Mais cette vie apostolique nous déchire nécessairement. C’est là sa douleur et la source de sa fertilité. Car la Parole de Dieu, dont les apôtres partagent la vie, s’étend à tout ce qui est le plus éloigné de Dieu et l’embrasse. Selon Maître Eckhart, la Parole continue à ne faire qu’un avec le Père tout en se déversant de par le monde. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. La vie de Dieu est tendue, ouverte jusqu’à faire la place pour tout ce que nous sommes; Il devient semblable à nous en toute chose sauf le péché. Il prend sur lui nos doutes et nos peurs; Il pénètre notre expérience de l’absurde, ce désert où toute signification s’est perdue.
Aussi, pour nous, vivre pleinement la vie apostolique, c’est découvrir que nous aussi sommes ouverts, déchirés. Être prêcheur, ce n’est pas seulement parler de Dieu aux gens. C’est porter au sein même de nos vies cette distance entre la vie de Dieu et ce qui en est le plus éloigné, aliéné et blessé. Nous n’avons une parole d’espérance que si nous entrevoyons de l’intérieur la souffrance et le désespoir de ceux à qui nous prêchons. Nous n’avons pas pour eux de paroles de compassion sans connaître en quelque sorte comme nôtres leurs échecs et leurs tentations. Nous n’avons pas de parole qui propose un sens à la vie des gens à moins d’avoir été touchés par leurs doutes et d’avoir entrevu l’abîme. Je pense à certains de mes frères français, qui après une journée d’enseignement théologique et de recherche, vont arpenter les trottoirs, de nuit, à la rencontre des prostituées pour écouter leurs peines et leurs souffrances, et leur offrir une parole d’espoir. Pas étonnant que depuis le début, nous, dominicains, ayons mauvaise réputation! C’est un des risques de la vocation. Giordano da Rivolto, au XIVe siècle, disait aux gens de ne pas être trop durs avec les frères s’ils étaient un peu « crasseux ». Cela fait partie de notre vocation: « À être là au milieu des gens, à regarder les choses du monde, c’est impossible qu’ils ne se salissent pas un peu. Ce sont des hommes en chair et en os comme vous, et dans la fraîcheur de la jeunesse; c’est encore une merveille qu’ils soient aussi propres. Ce n’est pas ici la place des moines! » (8)
La vie apostolique ne nous offre donc pas un « style de vie » équilibré et sain, avec de bonnes perspectives en terme de carrière. Car elle nous déséquilibre, nous renverse dans ce qui est le plus « autre ». Si nous partageons la vie de la Parole de Dieu de cette manière, nous sommes creusés, ouverts tout grand, afin de faire la place et le silence nécessaires à la naissance d’une nouvelle parole, comme pour la première fois. Nous sommes des gens de foi qui ouvrons tout grand nos coeurs à ceux qui ne croient pas. Parfois, nous douterons nous-mêmes de ce que tout cela signifie. Nous sommes comme les apôtres, qui furent convoqués par le Christ et marchèrent vers Jérusalem avec lui, sachant que lui seul détenait les paroles de la vie éternelle. Et pourtant ils discutèrent qui était le plus grand, et n’avaient bien souvent aucune idée d’où ils allaient.
Aussi la vie apostolique nous invite-t-elle à vivre une tension. Nous avons promis de construire notre vie avec nos frères et soeurs dominicains. « Pour nous désormais, être humain, être nous-mêmes, c’est être l’un des frères prêcheurs, nous n’avons pas d’autre histoire » (9). Là est notre demeure et nous ne pouvons en avoir d’autre. Mais l’élan de la vie apostolique nous propulse dans des mondes différents. Il a mené nombre de nos frères dans le monde de l’industrie, le monde des usines et des syndicats. Il en conduit d’autres aux universités. Il nous entraîne dans le monde cybernétique d’Internet. Un nouveau projet des dominicains français, Jubilatio, nous emmène dans le monde des jeunes. Un projet au Bénin nous fait entrer dans le monde de l’agriculture écologique. Nous sommes présents dans le monde de l’Islam et celui du judaïsme. Cette tension peut nous déchirer, nous ouvrir tout grand, afin que la seule vie que nous ayons ne soit pas construite ou planifiée par nous, mais reçue comme un don quotidien, « pain de vie » que promettait Dominique.
1.2 Le travail dans la société contemporaine
Dans notre société contemporaine, cette tension se transforme facilement en simple division. Nous pouvons devenir des personnes à double vie, notre vie de dominicain dans notre communauté et la vie vécue dans nos apostolats. Ceci est dû à la manière dont le travail est perçu de nos jours. Et quand cela se produit, alors, la belle, la douloureuse, la fertile tension au coeur de la vie apostolique se brise, et nous risquons de n’être plus que des gens qui travaillent, et rentrent le soir dans un hôtel qui se trouve être religieux. Voyons pourquoi cela constitue un défi particulier que nous devons affronter aujourd’hui.
a) La fragmentation de notre vie
La société occidentale contemporaine fragmente la vie. La semaine est séparée du week-end, le travail des loisirs, la vie active de la retraite, du moins pour ceux qui ont la chance d’avoir un emploi. On peut être professeur d’histoire le jour, parent le soir et chrétien le dimanche. Cette fragmentation nous rend difficile de vivre des vies unifiées, formant un tout. Les dominicains ont une variété de manières de prêcher quasi infinie. Nous sommes prêtres de paroisse et professeurs, travailleurs sociaux et aumôniers d’hôpitaux, poètes et peintres. Comment vivons-nous ces apostolats en tant que frères, membres de nos communautés, frères et soeurs consacrés? Je me souviens avoir été touché par un jeune dominicain journaliste qui me faisait part de ses difficultés à vivre dans l’univers des médias. Le jour, il vivait dans un monde, avec ses présupposés moraux, son « style de vie ». Le soir, il rentrait dans sa communauté religieuse. Comment faire pour être un: frère et journaliste? Quand nous rentrons dans notre communauté le soir, comme tout le monde dans le reste de la société, nous voulons fermer la porte sur les poids de la journée. Ce que nous faisons au travail est « une autre vie ».
b) La professionnalisation du travail
De plus en plus, le travail est professionnalisé. Pour la prédication de l’Évangile, il nous arrive souvent de devenir des professionnels qualifiés. Il est même possible d’obtenir un diplôme de prédication ou un doctorat d’études pastorales. Aucun de ceux que Jésus appela n’avait son diplôme d’apôtre! Non qu’il y ait à redire à cette professionnalisation. Nous devons être tout aussi qualifiés et professionnels que ceux avec qui nous travaillons. Et pourtant nous devons être conscients des séductions de devenir un « professionnel ». Cela apporte statut et position sociale. Cela nous situe dans une société stratifiée. Cela donne une identité et nous invite à un mode de vie. Éventuellement nous ramenons un salaire à la communauté. Comment ce docteur, ce professeur, ce pasteur, fera-t-il pour être un mendiant, un frère ou une soeur itinérant(e)? Notre profession nous enferme-t-elle dans un étroit sentier, avec une promotion pour tout horizon? Nous laisse-t-elle libres pour les exigences inattendues de nos frères et de Dieu?
c) L’éthique du travail
Enfin, dans la société occidentale, c’est l’éthique du travail qui triomphe. C’est lui qui justifie l’existence. Le salut non par les oeuvres mais par le travail. Les chômeurs sont exclus du Royaume. Quoi que nous prêchions, ce fiévreux activisme si souvent rencontré dans l’Ordre pourrait suggérer que nous aussi, parfois, croyons pouvoir nous sauver par ce que nous faisons. Nous louons en Dominique le Praedicator Gratiae, mais si nous prêchons que le salut est un don, est-ce bien là ce que nous vivons? Vivons-nous comme ceux pour qui la vie, la plénitude de la vie, est un don ? Est-ce ainsi que nous regardons nos frères? Entrons-nous en compétition pour faire voir à quel point nous sommes occupés et importants ?
1.3 Le désert de l’absurde
Donc, être prêcheur, c’est voir sa vie descellée. Nous avons en quelque sorte à partager l’Exode de la Parole de Dieu, qui vient du Père embrasser tout ce qui est humain. Parfois cet Exode peut nous entraîner dans le désert, sans nulle apparence de déboucher sur la Terre Promise. Il peut nous arriver d’être comme Job qui s’assied sur le tas de fumier et proclame que son Rédempteur est vivant. Sinon que parfois nous nous asseyons seulement sur le tas de fumier. Si nous nous laissons entamer par les doutes et les croyances de nos contemporains, nous pouvons nous retrouver dans un désert au milieu duquel l’évangile n’a plus de sens. « Il a dressé sur ma route un mur infranchissable » (Job 19,8).
La crise fondamentale de notre société est peut-être celle du sens. La violence, la corruption et la drogue sont les symptômes d’un malaise plus profond, la soif d’un sens à notre existence humaine. Pour faire de nous des prêcheurs, Dieu peut nous conduire dans ce désert. Là s’évanouissent nos vieilles certitudes, et le Dieu que nous connaissions et aimions disparaît. Il nous faut alors partager la nuit obscure de Gethsémani, quand tout semble absurde et insensé, et quand le Père se montre absent. Et pourtant, c’est seulement en nous laissant porter jusque là, où plus rien n’a aucun sens, que nous pourrons entendre la Parole de grâce que Dieu offre à notre temps. « La grâce apparaît lorsque nous traversons le désespoir pour affirmer la louange » (10).
Confrontés au vide, nous pouvons être tentés de le remplir, par des platitudes que nous croyons à demi, par des substituts du Dieu vivant. Le fondamentalisme que nous observons si souvent dans l’Église aujourd’hui est peut-être la réaction effrayée de ceux qui se sont retrouvés à l’entrée de ce désert, mais n’ont pas osé l’endurer. Le désert est un lieu de silence terrifiant, que nous essaierons peut-être de couvrir en ressortant de vieilles formules assénées avec une terrible sincérité. Mais le Seigneur nous conduit dans le désert pour nous montrer sa gloire. Aussi, dit Maître Eckhart: « Tenez bon, et ne vacillez pas devant votre vide » (11).
1.4 Les communautés de vie apostolique
Comment nos communautés peuvent-elles nous soutenir dans cette vie apostolique? Comment pouvons-nous nous entraider lorsqu’un frère ou une soeur se trouve dans ce désert, où absolument plus rien n’a de sens?
a) L’apôtre est l’envoyé. Les apôtres n’ont pas postulé pour l’emploi! Nous donnons nos vies à l’Ordre pour pouvoir être envoyés en mission pour lui. Dans la plupart des communautés dominicaines existe ce rythme régulier de sortir le matin et rentrer le soir. Mais nous n’allons pas juste travailler, comme un professionnel sortant de chez lui. C’est la communauté qui nous envoie. Et « à leur retour, les apôtres lui racontèrent tout ce qu’ils avaient fait » (Lc 9,10). Écoutons-nous ce que nos frères ont fait durant la journée, à leur retour le soir? Leur donnons-nous l’occasion de partager les défis qu’ils rencontrent dans leurs apostolats? Ils sont à l’extérieur, dans les paroisses ou les salles de classe, pour nous, de notre part, pour nous représenter. La communauté est là présente en ce frère ou cette soeur.
Comment faire pour que les prières que nous partageons matin et soir ne soient pas juste l’accomplissement commun d’une obligation, mais fassent partie du rythme d’une communauté qui envoie ses membres au dehors et les accueille à leur retour? Prions-nous pour nos frères et avec eux dans leurs apostolats? Dans le cas contraire, comment dire notre communauté « apostolique »? Elle peut n’être plus qu’un hôtel.
Le chapitre général de Caleruega a fourni d’excellentes et très claires suggestions sur la manière dont les communautés peuvent planifier et évaluer leur mission commune, afin que les frères progressent dans un véritable sentiment de collaboration. Je demande fortement à toutes les communautés de mettre en oeuvre ces recommandations (n° 44).
b) Dans nos communautés, nous devrions pouvoir partager et notre foi et nos doutes. Pour la plupart d’entre nous, en particulier ceux qui entrent dans l’Ordre aujourd’hui, il ne suffit pas simplement de réciter les psaumes ensemble. Nous avons besoin de partager la foi qui nous a amenés dans l’Ordre et nous soutient maintenant. C’est là le fondement de notre fraternité. Peut-être ne réussirons-nous à faire que de timides tentatives, mais même dans ce cas, nous pouvons offrir à nos frères et soeurs « le pain de vie et l’eau du ciel ». Les chapitres généraux recommandent fréquemment qu’il soit prêché à l’occasion de chaque liturgie publique. La raison n’en est pas simplement que nous sommes l’Ordre des Prêcheurs, mais aussi que nous puissions partager notre foi.
Nous devons aussi pouvoir partager nos doutes. C’est plus encore quand un frère entre dans ce désert où plus rien n’a de sens que nous devons le laisser parler. Nous devons respecter son combat et ne jamais l’humilier. Qu’un frère ose partager ces moments de ténèbres et d’incompréhension, si nous osons l’écouter, et cela peut devenir le don le plus immense qu’il nous offrira jamais. Le Seigneur conduit parfois un frère dans l’obscure nuit de Gethsémani. Irons-nous dormir tandis qu’il lutte? Rien ne lie plus étroitement une communauté qu’un combat pour atteindre ensemble la foi. Que cela se passe dans une faculté de théologie ou un pauvre barrio d’Amérique Latine. En luttant ensemble pour donner du sens à qui nous sommes, et au fait que nous soyons appelés à la lumière de l’évangile, nous serons assurément surpris par ce Dieu toujours nouveau et inattendu. Nous pourrions même avoir la surprise de nous rencontrer et nous découvrir les uns les autres, comme pour la première fois.
2. LA VIE AFFECTIVE
2.1 En ceci consiste l’amour
« En ceci consiste l’amour: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres » (1 Jn 4, 10ss).
La vie apostolique tout entière est un partage de cet amour rédempteur de Dieu pour l’humanité. Si tel n’est pas le cas, notre prédication devient, au mieux, un emploi, et au pire, un exercice de manipulation des autres, la propagation d’une idéologie. Peut-être les églises sont-elles vides dans certains pays parce que la prédication de l’évangile est considérée comme un exercice de contrôle plus que comme l’expression de l’amour illimité de Dieu. Aussi devenir vivant, vivant en abondance, en prêcheurs, signifie découvrir comment bien aimer. « Ma vocation, c’est l’Amour » (12).
Mais on peut retourner l’idée: pour nous, dominicains, apprendre à aimer ne peut aller sans être gagnés par le mystère de la rédemption de l’humanité par Dieu. Voilà notre école de l’amour. Actuellement, les formateurs religieux du monde entier commencent à affronter la question de l’« affectivité », un mot que je n’aime pas. Comment former ceux qui entreront dans l’Ordre de sorte qu’ils sachent aimer bien et complètement, en religieux chastes? La plupart d’entre nous n’ont eu aucune formation, ou très peu, pour faire face à nos émotions, notre sexualité, notre soif d’aimer et d’être aimés. Je ne me souviens pas avoir jamais reçu la moindre formation dans ce domaine. Il semblait acquis, ou peut-être l’espérait-on nerveusement, qu’une bonne course à pied et une douche froide résoudrait le « problème ». Hélas, je ne peux pas courir et je déteste les douches froides!
Dans cette lettre, je ne discuterai pas de problèmes touchant spécifiquement à la formation et l’affectivité, car j’espère qu’une lettre à l’Ordre abordera prochainement le thème de la formation. Je dirai juste ceci. Il ne suffit pas d’espérer que tout se passera bien si nous recrutons de jeunes hommes et femmes équilibrés, libres de tout désordre émotionnel apparent. Est-ce que des gens équilibrés donneraient leur vie pour leurs amis? Est-ce qu’ils laisseraient les quatre-vingt-dix-neuf brebis pour aller chercher celle qui s’est égarée? Est-ce qu’ils iraient boire et manger avec des prostituées et des pécheurs? J’ai bien peur qu’ils ne soient trop raisonnables. Commentant l’évangile selon saint Jean, saint Augustin écrivait: « Montre moi quelqu’un qui aime, car il comprend ce que je dis. » (13) Seuls ceux qui sont capables d’amour pourront comprendre la passion de la vie apostolique. Si nous ne nous laissons pas emporter par la vague de cet immense amour, toutes nos tentatives pour être chastes pourraient bien se terminer en exercices de contrôle. Nous pouvons y réussir, mais au risque de faire grand tort à nous-mêmes. Nous pouvons échouer, au risque de causer de terribles torts à autrui. Aussi, à moins que notre élan apostolique et notre capacité d’amour ne s’intègrent profondément, ils deviennent une affaire de contrôle, soit des autres soit de nous-mêmes. Jésus, lui, a abandonné tout contrôle sur sa vie, et l’a placée entre nos mains.
2.2 « Nul n’a plus grand amour que celui-ci: donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15,13)
Aimer l’humanité peut être tout à fait admirable, mais peut paraître un substitut pâle et abstrait de cet amour profond et personnel dont nous avons parfois une telle soif. Est-ce vraiment suffisant? Et nous pouvons ressentir ceci d’autant plus fort dans la société contemporaine pour laquelle le modèle d’amour dominant est l’amour sexuel passionné entre un homme et une femme. Lorsque nous éprouvons cette nécessité puissante, pouvons-nous nous satisfaire de l’amour de l’humanité?
Cet amour passionné des époux est bien de fait un besoin humain profond, et j’en dirai quelques mots plus loin. Il peut aussi être une image de notre relation à Dieu, par exemple dans les commentaires médiévaux du Cantique des Cantiques. Mais il existe une autre tradition complémentaire, peut-être plus typiquement dominicaine. Elle se situe au coeur de l’évangile de Jean. « Nul n’a plus grand amour que celui-ci: donner sa vie pour ses amis. » Ainsi, voilà à quoi ressemble le mystère de l’amour, on donne sa vie pour ses amis. Nous trouvons là un amour profondément passionné, dans les relations de Jésus avec les disciples, avec les prostituées et les publicains, les malades et les lépreux, et même avec les Pharisiens. Cette passion est consommée dans la passion menant au Golgotha. N’est-ce pas aussi passionné que n’importe quelle histoire d’amour?
Notre société trouvera peut-être notre manière d’aimer incompréhensible, puisque nous avons apparemment rejeté l’expérience typique de l’amour, l’union sexuelle avec une autre personne. Nous-mêmes, peut-être ressentirons-nous parfois que nous avons manqué « la grande expérience », et que nous n’avons pas vécu. Mais saint Thomas d’Aquin nous a enseigné qu’au coeur de la vie du Dieu qui est amour se trouve l’amitié, l’ineffable amitié du Père et du Fils, qui est l’Esprit. Pour nous, vivre, devenir ineffablement vivants, c’est trouver notre demeure dans cette amitié et en être transformés. Elle se répandra sur tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes. Comme l’a écrit Don Goergen op: « Le célibat ne rend aucun témoignage. Mais les célibataires, si. » (14) Nous rendons témoignage au Royaume si l’on nous voit comme des gens dont la chasteté les rend libres de vivre.
Nos communautés doivent être des écoles d’amitié. Mourant, saint Hyacinthe répéta les mots de saint Dominique aux frères: « Ayez la bonté et la douceur (dulcedo) du coeur; Gardez l’amour de Dieu et la charité fraternelle. » (15) Sommes-nous toujours assez bons et doux de coeur les uns envers les autres? Dans la vie religieuse, on voit souvent une peur de l’amitié, mais peut-être est-elle moins présente dans la tradition dominicaine. Dès le commencement, ont existé des amitiés profondes et pleines d’amour: celle de Dominique pour ses frères et soeurs; celle de Jourdain de Saxe pour sa bien-aimée Diane et pour Henri; celle de Catherine de Sienne et Raymond de Capoue. Je me souviens d’un vieux dominicain disant lors d’un chapitre, quand j’étais jeune: « Je n’ai rien contre les amitiés particulières; c’est aux inimitiés particulières que je m’oppose! » Cette amitié n’est jamais exclusive, mais profondément transformatrice, nous libérant douloureusement et lentement de tout ce qui est dominateur ou possessif, de tout ce qui est condescendant ou méprisant. S’il est partage de la vie de la Trinité, cet amour élèvera l’autre à égalité et le libérera. Comme Bede Jarrett. op, provincial d’Angleterre, l’a écrit en 1932: « Ô Chère amitié, quel don de Dieu! N’en dites pas de mal. Au contraire, louez son Créateur et Modèle, la Bienheureuse Trinité » (16). Si cette amitié est véritablement celle de Dieu, alors elle nous propulsera dans la mission de prédication de la bonne nouvelle.
L’aboutissement de notre amour sera une dépossession. Ceux que nous aimons, nous devons les laisser partir; nous devons les laisser être. Mon amour donne-t-il à ceux que j’aime la liberté de faire leur propre vie, et me laisse-t-il libre pour la mission de l’Ordre? Mon amour pour cette femme, par exemple, l’aide-t-il à croître en amour pour son mari, ou bien suis-je en train de lier sa vie à la mienne et de la rendre dépendante? Cette douloureuse mais libératrice dépossession nous invite à passer au second plan dans la vie de ceux que nous aimons. Nous devons nous apercevoir que nous disparaissons du centre de leur vie, de sorte qu’ils puissent nous oublier et être libres, libres pour quelqu’un d’autre, libres pour Dieu. C’est la chose la plus difficile de toutes, mais je crois fermement qu’elle peut nous donner plus de joie que nous ne saurions le dire ou l’imaginer. C’est lorsque nos flancs sont grands-ouverts que peut jaillir l’eau vive.
L’un des magnifiques exemples de notre tradition dominicaine est certainement celui de l’amour entre le bienheureux Jourdain de Saxe, successeur de Dominique comme Maître de l’Ordre, et la moniale dominicaine, bienheureuse Diane d’Andalò. Il est évident qu’ils s’aimaient profondément l’un l’autre. Combien de Maîtres de l’Ordre ont écrit avec une telle ouverture de coeur à une femme? « Ne suis-je pas à vous, ne suis-je pas avec vous: à vous dans le travail, à vous dans le repos; à vous lorsque je suis avec vous, à vous lorsque je suis au loin? » (17) Et il est clair qu’elle lui a beaucoup appris sur comment aimer. Mais dans ses lettres, Jourdain la « donne » toujours au Seigneur. Il est l’ami du marié, dont le rôle est d’accompagner la mariée à son époux: « Pensez à Lui ». « Ce qui vous manque parce que je ne puis être auprès de vous, compensez-le par la compagnie d’un meilleur ami, votre époux Jésus Christ, que vous avez auprès de vous plus constamment, en esprit et en vérité, et qui vous parle plus doucement et pour de bien meilleurs fruits que ne le fait Jourdain. » (18)
Nous devons même, en un certain sens, être dépossédés de nos propres familles. Nous allons, à juste titre, continuer à les aimer et être heureux de leur amour pour nous, mais une fois faite notre profession dans l’Ordre, nous devrons être libres d’aller là où la mission de l’Ordre nous requiert, même si c’est loin de nos foyers familiaux. Cela fait partie de notre pauvreté. Désormais, notre première appartenance est l’Ordre et la prédication de l’évangile.
2.3. La sexualité, le corps et le désir
a) Un idéal inaccessible?
C’est une idée magnifique, mais qui peut sembler lointaine et inaccessible. Dans notre combat avec le désir sexuel, avec les fantasmes et les désirs de possession, cette amitié désintéressée peut paraître hors de notre portée. Les médias nous assurent chaque jour que cet idéal est « irréaliste ». Mais Dieu ne transforme pas l’humanité en nous invitant à grimper péniblement jusqu’au paradis. La vie divine vient à nous là où nous sommes, chair et sang. Jésus commande à Zachée de descendre de l’arbre pour le rejoindre sur le sol. La Parole se fait corps, prend sur elle nos désirs, notre passion, notre sexualité. Pour rencontrer le Seigneur et être guéri, nous devons nous aussi nous incarner, dans les corps que nous sommes, avec toutes nos passions, avec nos blessures et nos appétits.
Nous partons de qui nous sommes et ce que nous sommes. Quand on nous revêt de l’habit, nous apportons à l’Ordre cette personne, fruit d’une histoire et porteuse de ses blessures. C’est elle que le Seigneur a appelée, et pas quelque être humain idéal. Nous venons avec les cicatrices de l’expérience passée, peut-être avec les souvenirs encore à vif d’échecs amoureux, d’abus subis, d’expériences sexuelles. Nos familles nous ont enseigné à aimer; elles nous ont parfois aussi infligé des blessures qui prendront longtemps à guérir. Grandir dans cet amour semblable à celui du Christ prend du temps, et ce temps nous est donné. C’est un don et Dieu offre toujours ses dons dans la durée. Il a mis des siècles à former son peuple, préparer la voie pour la naissance de son Fils. Dieu nous donne vie, patiemment, pas en un instant. Si nous acceptons ses dons, nous devons accepter la manière dont Dieu donne, « je ne vous donne pas comme le monde donne » »(Jn 14,27). Accepter ce don du temps est peut-être tout particulièrement important pour notre société, dans laquelle l’adolescence est prolongée, et où ce n’est que tardivement que la plupart d’entre nous arrivent à la maturité. Nous devons partir de nos désirs, de nos appétits, de notre corps. Nous ne sommes ni des anges ni des bêtes, mais faits de chair, de sang et d’esprit, destinés au Royaume. Mais, comme l’a dit Pascal, si nous commettons l’erreur de penser que nous sommes des anges, c’est alors que nous deviendrons des bêtes.
b) Le désir
« J’ôterai de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. » (Ez 36,26) Pour que nos coeurs deviennent de chair, nous devons laisser transformer nos désirs.
Quels sont les désirs qui modèlent notre coeur, et que nous dissimulons aux autres, peut-être même à nous-mêmes? « Aucun de nous n’est à lui-même si transparent qu’il sache parfaitement ce qui lui tient vraiment à coeur. » (19). Tant que nous ne regarderons pas carrément nos désirs en face et n’apprendrons pas à bien désirer, nous serons donc sujets à leur contrôle et par conséquent prisonniers d’eux. C’est particulièrement difficile dans une société toute dévouée à la culture du désir. Notre société ne meurt pas de faim mais d’un excès de désir. La moindre publicité nous encourage à désirer plus, sans cesse, infiniment. Le monde se consume d’un désir immodéré, vorace, qui pourrait bien nous consommer tous. Un désir sexuel effréné est juste symptomatique de la manière dont on nous apprend à considérer le monde comme bon à être pris et consommé.
En premier lieu, cet amour qu’est l’amitié nous invite à voir les autres sans en rechercher la possession. Nous sommes heureux avec eux sans viser à la propriété. Il est difficile d’atteindre à cette liberté de coeur en restant captivé par la culture de marché, dans laquelle tout est là pour être acheté et utilisé, même les autres personnes. Aussi la véritable amitié nous demande-t-elle de rompre avec la culture dominante de notre temps. Nous devons apprendre à regarder avec clarté, avec des yeux qui ne dévorent pas les autres ni le monde. Saint Thomas écrivait: « Ubi amor, ibi oculus. Où il y a l’amour, il y a l’oeil. » (20) Il dit que quand nous convoitons, nous regardons l’autre comme le lion regarde le cerf, comme un repas à dévorer. L’amour est par conséquent inséparable d’une vraie pauvreté de coeur. Comme le demandait William Blake: « Se peut-il que soit Amour, ce qui boit l’autre comme une éponge boit l’eau? » (21)
Aussi la guérison du désir nécessite une manière différente de regarder le monde, une véritable pauvreté. Et quelle sorte de sens la chasteté pourrait-elle bien signifier si nous demeurions tout aussi « acquéreurs » dans les autres domaines? Comme l’a écrit Don Goergen, op: « Si je prends part à la société de consommation, défends le capitalisme, tolère le machisme, crois que la société occidentale est supérieure aux autres, et suis abstinent sexuellement, je témoigne simplement en faveur de ce que nous soutenons: le capitalisme, le sexisme, l’arrogance occidentale, et l’abstinence sexuelle. Cette dernière ne saurait guère être profondément significative et l’on comprend bien qu’elle soit mise en cause. » (22)
Nous avons aussi besoin d’envisager clairement la sexualité et de nous affranchir de la mythologie sexuelle de la société contemporaine. Nous devons démythifier la sexualité. D’un côté, une relation sexuelle est généralement considérée comme le point culminant de tous nos appétits de communion et la seule échappatoire à la solitude. On l’a appelée le dernier sacrement de transcendance restant, le seul signe que nous existons pour quelqu’un d’autre, ou même que nous existons tout court. Ne pas avoir de relation sexuelle est par conséquent être à moitié mort. D’un autre côté, la sexualité est banalisée. Une dame anglaise déclarait récemment que ce n’est pas plus important que de prendre une tasse de thé. C’est cette association de la déification de la sexualité et de sa banalisation qui rend le célibat si dur à supporter. On nous dit à la fois que c’est indispensable, et que c’est à faire sans devoir y songer un instant. La rééducation de nos coeurs humains exige que nous considérions clairement la sexualité. Elle est bien en effet un magnifique sacrement de communion avec une autre personne, le don de soi-même, et elle ne peut donc en aucun cas être banalisée. Mais il y a d’autres moyens d’aimer pleinement et complètement, aussi son absence ne nous condamne-t-elle pas à l’isolement et la solitude.
Enfin, face aux insatiables désirs du marché, nous sommes invités non pas à la répression, mais à une soif bien plus grande. Nous sommes des gens passionnés, et tuer toute passion serait nous rabougrir et dessécher notre humanité. Cela ferait de nous des prêcheurs de mort. Au contraire, nous devons être libérés en des désirs plus profonds, désirs de la bonté illimitée de Dieu. Comme le dit Oshida, dominicain japonais, nous implorons Dieu de se faire irrésistible. Si nos désirs font fausse route, ce n’est pas que nous demandions trop, mais parce que nous nous sommes contentés de trop peu, de satisfactions trop minuscules. « L’idéal pour nous est de ne pas contrôler du tout nos appétits, mais de leur lâcher totalement la bride dans le sillage d’un appétit de Dieu incontrôlé. » (23) Les publicités qui bordent nos routes nous invitent à combattre les uns contre les autres et nous piétiner mutuellement dans une compétition pour satisfaire nos désirs sans fin; notre Dieu offre la satisfaction d’un désir infini, libre et offert. Désirons plus profondément.
Cette transformation du désir impliquera sans doute quelque ascèse. C’est une conclusion à laquelle j’ai longtemps résisté! Dominique est sûrement parvenu à sa liberté, sa spontanéité, sa légèreté de coeur, en partie parce qu’il était modéré, mangeait et buvait peu. Il festoyait avec ses frères mais il jeûnait aussi. Il existe une ascèse qui n’est pas un rejet manichéen du monde de Dieu, mais nous enseigne à trouver en elle un plaisir juste. « Il s’agit de renoncer, non pas au désir lui-même -ce qui serait inhumain-, mais à sa violence. Il s’agit de mourir à la violence du plaisir, à sa toute-puissance. » (24). La mesure modère nos appétits face aux besoins réels de notre corps, et nous sauve ainsi des illusions du fantasme et de la tyrannie du désir.
c) Le corps
Je ne peux avoir une relation mature à ma sexualité tant que je n’ai pas appris à accepter les corps humains, le mien et celui des autres, et même à en être heureux. C’est là le corps que j’ai, et que je suis, qui devient vieux, gros, qui perd ses cheveux, évidemment mortel. Je dois me sentir à l’aise avec le corps des autres, les beaux comme les laids, les malades comme les bien portants, les vieux comme les jeunes, les hommes comme les femmes. Saint Dominique fonda l’Ordre pour sauver les gens de la tragédie d’une religion dualiste qui condamnait comme mauvais ce monde de la création. Au coeur de notre tradition se trouve dès les origines une appréciation de la corporalité. C’est là que Dieu vient à notre rencontre pour nous racheter, se faisant être humain, comme nous, chair et sang. Le sacrement central de notre foi est le partage de son corps; notre espérance finale est la résurrection des corps. Le voeu de chasteté n’est pas une fuite hors de notre existence corporelle. Si Dieu s’est fait chair et sang, et bien nous pouvons oser le faire également.
Nous découvrons ce que signifie pour nous être un corps dans cet apogée de la vie de Jésus, lorsqu’il nous donne son corps: « Ceci est mon corps donné pour vous. » Nous voyons là que le corps n’est pas simplement un morceau de viande, un sac de muscles, de sang et de graisse. L’Eucharistie nous montre la vocation de nos corps humains: nous en faire don mutuellement, la possibilité de la communion.
L’immense souffrance du célibat est que nous renonçons à un moment d’intense corporalité, où les corps se donnent mutuellement sans réserve. C’est là que l’on peut voir le corps dans son identité profonde, non pas comme un morceau de viande mais comme le sacrement de présence. Cet acte sexuel exprime notre désir profond de partager nos vies, et lui donne chair et sang. C’est pourquoi il est un sacrement de l’unité du Christ avec l’Église. Nous aussi, religieux, pouvons à notre manière rendre le Christ présent dans notre corporalité. Le prêcheur exprime la Parole, non seulement par ses mots, mais en tout ce qu’il ou elle est. La compassion de Dieu vise à devenir chair et sang en nous, dans notre tendresse, jusque dans nos visages.
Dans l’Ancien Testament, on trouve souvent la prière que le visage de Dieu rayonne sur nous. Cette prière a en fin de compte reçu sa réponse sous la forme d’un visage humain, le visage du Christ. Il regarde le jeune homme riche, il l’aime et lui demande de le suivre; il regarde Pierre dans la cour après son reniement; il regarde Marie-Madeleine dans le jardin et l’appelle par son nom. En tant que prêcheurs, chair et sang, nous pouvons donner corps à ce regard de compassion de Dieu. Notre corporalité n’est pas exclue de notre vocation. « Et l’homme qui est à la fois un prêcheur et un frère peut apprendre, douloureusement et probablement par à-coups, ce que signifie être un visage pour Dieu, précisément en ayant un visage humain, un visage qui peut sourire et rire et pleurer et montrer son ennui… C’est dans toute notre unicité et notre individualité, éternellement valables et désirées par Dieu, que nous sommes aussi la révélation, la manifestation, l’expression de Celui qui est La Parole sortie de toute éternité du silence de Dieu. » (25)
La véritable pureté de coeur ne consiste pas à s’être libéré de toute contamination par ce monde. Il s’agit bien plus d’être pleinement présent à ce que nous faisons et ce que nous sommes, d’avoir un visage et un corps qui nous expriment, au-delà de la tromperie et duplicité. Les coeurs purs ne se dissimulent pas derrière leur visage, guettant avec méfiance. Leurs visages sont transparents, sans défense, dans la nudité et la vulnérabilité du Christ. Ils ont sa liberté et sa spontanéité. « Seul un coeur pur peut rire en une liberté qui crée la liberté chez les autres. » (26)
d) Donner vie
Ce qui me manque plus que tout peut-être, c’est de ne pas avoir eu d’enfants. Et si je le ressens ainsi, en tant qu’homme, que signifiera pour une femme n’avoir pas donné naissance ? C’est là un désir fondamental que nous devons reconnaître. Mais si notre vie apostolique est emportée dans le fertile amour de Dieu pour l’humanité, alors, nous serons féconds. Maître Eckhart dit que l’amour de Dieu en nous est vert et fertile. Dieu est en nous « toujours verdoyant et fleurissant dans toute la joie et toute la gloire qu’il est en lui-même » (27). « Le but primordial de Dieu est de donner naissance. Il n’est satisfait que lorsqu’il a engendré son Fils en nous. Et l’âme non plus ne saurait être satisfaite tant que le Fils n’est pas né en elle. » (28)
Il appartient à notre amour des frères et soeurs de pouvoir les aider à être féconds. La vie apostolique n’est pas une simple question d’acharnement au travail. Si nos apostolats sont vivants de l’abondance de la vie même de Dieu, c’est alors que nous partagerons sa créativité.
Mais être parents, c’est passer par la joie et la douleur de laisser partir nos enfants. L’état de parent atteint son accomplissement en donnant aux enfants leur liberté et en les laissant construire des vies différentes de ce que nous avions espéré pour eux. Nous aussi devons laisser partir ce que nous avons fait naître. Nous savons avoir été réellement féconds lorsque les projets que nous avions lancés, et pour lesquels nous avons donné notre vie, partent dans des directions nouvelles et sont aux mains d’autres personnes. C’est dur, mais la générosité des parents est de donner la liberté à leurs enfants.
2.4 Comment nous soutenir mutuellement?
Si nous laissons cet amour qu’est Dieu nous toucher, nous prendrons lentement vie. Il pourrait sembler plus sûr de rester morts, invulnérables, intouchables. Mais en est-il bien ainsi? « La nature abhorre le vide. Des choses terribles peuvent arriver à un homme au coeur vide. En dernier ressort, mieux vaut courir le risque d’un scandale de temps en temps que d’avoir un monastère — un choeur, un réfectoire, une salle de récréation — pleins de morts. Notre Seigneur n’a pas dit: « Moi, je suis venu pour qu’ils aient la sécurité et qu’ils l’aient en abondance. » Certains d’entre nous donneraient absolument n’importe quoi pour se sentir en sécurité, sûrs de leur vie dans ce monde comme dans le prochain, mais nous ne pouvons pas avoir les deux: la sécurité ou la vie, il faut choisir. » (29) Si nous choisissons la vie, nous aurons besoin de communautés qui nous soutiennent dans notre venue à la vie, qui nous aident à grandir dans un amour véritablement saint, un partage des flots ruisselants de la Parole de Dieu.
a) Des communautés d’espérance
Par-dessus tout, nous devons nous offrir réciproquement espérance et miséricorde. Souvent, nous sommes amenés à l’Ordre par notre admiration des frères. Nous espérons leur devenir semblables. Bien vite, nous découvrons qu’ils sont en fait exactement comme nous, fragiles, pécheurs et égoïstes. Ce moment peut être une profonde désillusion. Je me souviens d’un novice qui se plaignait de cette triste découverte. Le maître des novices lui répondit: « Je me réjouis d’apprendre que tu ne nous admires plus. Maintenant, nous avons peut-être une chance que tu commences à nous aimer. » Le mystère rédempteur de l’amour de Dieu ne se manifeste pas dans une communauté de héros spirituels, mais dans une communauté de frères et de soeurs qui s’encouragent mutuellement au long du voyage vers le Royaume, avec espérance et miséricorde. Le Seigneur ressuscité apparaît au sein d’une communauté d’hommes timides et sans force. Si nous voulons le rencontrer, nous devons oser être là avec eux. Jourdain de Saxe écrivait aux frères de Paris, qui étaient, c’est clair, tout à fait comme nous: « Cela ne peut pas être, que Jésus apparaisse à ceux qui se sont coupés de l’unité de la fraternité: Thomas, pour n’avoir pas été avec les autres disciples quand vint Jésus, se vit refuser de le voir: et vous iriez vous penser plus saints que Thomas? » (30)
Par-dessus tout, nous aurons besoin de nos communautés si nous échouons en amour. Nous échouerons par exemple parce que nous entrons dans une période de stérilité où nous nous sentons incapables du moindre amour, où nos coeurs de chair ont été remplacés par des coeurs de pierre. Alors, nous aurons besoin de nos frères et soeurs pour croire à notre place que:
— qu’importe un passé de trahison
ou combien perverti —
enfouie au fin fond de soi
la semence de l’amour demeure. » (31)
Nos communautés doivent être des lieux dans lesquels il n’y a pas d’accusation, « puisqu’on a jeté bas l’accusateur de nos frères » (Ap 12,10). Il peut nous arriver de pécher et sentir que nous avons anéanti notre vocation, que nous devons quitter l’Ordre honteusement. C’est alors que nos frères et soeurs devront croire pour nous en la miséricorde de Dieu quand nous trouverons peut-être dur d’y croire nous-mêmes. Si Dieu peut faire fleurir l’arbre mort de Golgotha, il peut tirer des fruits de mes fautes. Nous aurons peut-être besoin de nos frères pour croire, quand nous en serons incapables, qu’un échec n’est pas la fin de tout, mais que Dieu, dans son infinie fertilité, peut en faire une étape sur le chemin de la sainteté. Même nos péchés peuvent participer de nos maladroites tentatives pour aimer. Toutes ces années d’aventures sexuelles d’Augustin firent peut-être partie de sa quête de celui qui fut le bien-aimé, et cette chasteté ne fut pas la fin de son désir mais sa consommation.
b) La communauté et l’orientation sexuelle
C’est là que les différences culturelles sont le plus clairement visibles. Il nous faut beaucoup de délicatesse pour éviter de scandaliser ou de blesser nos frères et soeurs. Dans certaines cultures, admettre à la vie religieuse des personnes d’orientation homosexuelle est de fait impensable. Chez d’autres, c’est accepté sans problème. Tout ce qui s’écrit sur le sujet est probablement examiné à la loupe pour savoir si l’on est « pour » ou « contre » l’homosexualité. Ce n’est pas la bonne question. Ce n’est pas à nous de dire à Dieu qui appeler ou non à la vie religieuse. Le chapitre général de Caleruega a affirmé que les mêmes exigences de chasteté s’appliquent à tous les frères quelque soit leur orientation sexuelle, et par conséquent personne ne peut être exclu sur cette base. Cette question a été fort débattue à Caleruega et je suis sûr que cela va continuer.
Comment nos communautés peuvent-elles aider et soutenir les frères confrontés à la question de leur orientation sexuelle? Nous devons tout d’abord reconnaître qu’elle touche profondément le sentiment intime de qui nous sommes. C’est par conséquent une question délicate et importante pour de nombreux jeunes qui entrent dans l’Ordre, pour deux raisons. Premièrement, il y a souvent une profonde soif d’identité. Pour nombre de jeunes, la question primordiale est: « Qui suis-je? » Deuxièmement, en raison de l’adolescence prolongée qui caractérise de nombreuses cultures aujourd’hui, la question de l’orientation sexuelle n’est souvent résolue que fort tard. Nous recevons parfois des demandes de dispenses de frères qui n’ont réalisé que tardivement dans la vie qu’ils sont au fond hétérosexuels et peuvent donc se marier.
Quand un frère parvient à la conclusion qu’il est homosexuel, il est important qu’il sache qu’il est accepté et aimé tel qu’il est. Il vit peut-être dans la terreur d’être rejeté et accusé. Mais cette acceptation est du pain pour son voyage à la découverte d’une identité plus profonde, celle d’enfant de Dieu. Car aucun de nous, hétérosexuel ou homosexuel, ne trouve son identité la plus profonde dans son orientation sexuelle. Qui nous sommes au fin fond, nous le découvrons dans le Christ. « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu’il est. » (1 Jn 3,2) Par nos voeux, nous nous engageons à suivre le Christ, et à découvrir notre identité en lui. Cela fait partie de notre pauvreté que d’être entraînés au-delà de ces petites identités. « À la racine de tous les autres désirs possessifs, réside le désir — en fin de compte possessif — d’être un « moi »: le désir de trouver en mon coeur non pas cet innommable abîme dans lequel, comme dans le vide, le Dieu sans nom est inévitablement submergé, mais une identité que je puisse posséder, une identité définie par la possession que j’en ai. » (32) Tout frère qui placerait son orientation sexuelle au coeur de son identité publique se tromperait sur son identité la plus profonde. Il s’arrêterait sur le bord de la route alors qu’il est appelé à marcher jusqu’à Jérusalem. Ce qui est fondamental, c’est que nous puissions aimer, et soyons donc des enfants de Dieu, et non vers qui nous sommes attirés sexuellement. Mais cela ne concerne pas seulement un sentiment personnel d’identité individuelle. Nous avons une identité réciproque de frères et de soeurs. Nous sommes responsables des conséquences sur nos frères de notre manière de nous présenter, en particulier dans un domaine aussi sensible que celui de l’orientation sexuelle.
Aussi chaque frère doit-il être accepté tel qu’il est. Mais l’émergence, à l’intérieur d’une communauté, de sous-groupes basés sur l’orientation sexuelle serait un puissant facteur de division. C’est une menace pour l’unité de la communauté; cela peut rendre plus difficile aux frères de pratiquer la chasteté à laquelle nous sommes voués. Cela peut pousser les frères à penser à eux-mêmes d’une manière qui n’est pas centrale à leur vocation de prêcheurs du Royaume, et dont ils découvriraient peut-être en fin de compte qu’elle est fausse.
c) Tomber amoureux
Quelque suprême que nous présentions la révélation par l’amitié de cet amour qui est la vie de Dieu, malgré tout, nous pouvons tomber amoureux, et il arrive que ce soit l’une des expériences les plus significatives de notre existence. Une des premières questions que l’on m’ait posées en public après mon élection comme Maître de l’Ordre, durant la réunion d’une grande foule d’étudiants dominicains des Philippines, fut la suivante: « Timothy, es-tu déjà tombé amoureux? » Et la seconde question fut: « C’était avant ou après ton entrée dans l’Ordre? » Si cela arrive, nous aurons alors vraiment besoin du soutien et de l’amour de notre communauté.
Pour un frère ou une soeur qui a fait profession de sa vie dans l’Ordre, tomber amoureux est quasiment à coup sûr un moment de crise. Mais, comme Jean-Jacques Pérennès, op ne manque pas de nous le rappeler au conseil généralice, une crise est un moment d’opportunité. Elle peut être féconde. Toute expérience d’amour peut être une rencontre avec le Dieu qui est amour. Tomber amoureux peut être le moment où se déchire notre égocentrisme et nous découvrons que nous ne sommes pas le centre du monde. Cela peut démolir, au moins pour un temps, ce souci de soi qui nous tue. Tomber amoureux, c’est « pour beaucoup de gens la plus extraordinaire et révélatrice expérience de leur vie, par laquelle le centre signifiant est soudain arraché au moi et l’ego rêveur se cogne à la conscience d’une réalité entièrement distincte » (33).
Après avoir passé par cette profonde expérience de « décentrement », on ne peut pas continuer simplement sa vie comme si de rien n’était. On ne peut pas faire semblant de n’avoir jamais rencontré cette personne, et de pouvoir retourner à notre ancienne vie comme si de rien n’était. Et ce peut être l’une des raisons pour lesquelles un frère qui tombe amoureux peut demander une dispense de ses voeux, car cette ancienne vie à laquelle il s’était voué est dépassée.
Alors que Thomas Merton, cistercien américain, était au sommet de sa célébrité d’auteur spirituel, il tomba amoureux fou d’une infirmière qui l’avait soigné à l’hôpital. Il écrivit dans son journal: « (J’étais) tourmenté par la réalisation progressive que nous étions amoureux et que je ne savais pas comment vivre sans elle. » (34) Comme le dit Othello à la perte de sa bien-aimée Desdémone: « C’est en elle que j’ai engrangé mon coeur, en elle que je dois vivre ou ne plus supporter de vivre, elle, la fontaine qui fait jaillir ma source ou l’assèche. »
Dans ces moments là nous ne pouvons imaginer une vie sans la personne que nous aimons et nous devons donc prier de recevoir le don d’une vie que nous ne pouvons absolument pas imaginer, une vie qui ne peut venir que comme un don de Dieu. Sur la croix, Jésus n’attend pas de vie imaginable, mais l’inconcevable et abondante vie que le Père lui donnera. Dans ces moments-là nous ne pouvons faire notre vie. Elle doit nous être donnée.
C’est tellement difficile alors de nous laisser aller entre les mains du Père, confiants que cette mort ouvrira la voie à la résurrection. Comme jamais auparavant, nous aurons besoin de nos amis et de nos frères et de nos soeurs, qui devront peut-être croire pour nous quand nous ne pourrons pas, que dans ce désert, nous pouvons rencontrer le Seigneur de vie. Peut-être ne nous étions-nous jamais senti si vivant, si vital. Peut-être sentons-nous que cet amour est ce que nous avons attendu toute notre vie. Comment prendre le risque de le perdre? Nous pouvons devenir desséché, de mauvaise humeur et frustré! À ce moment là, nous devons croire que si nous restons fidèle à nos voeux, Dieu sera fidèle aussi. Nous recevrons la vie en abondance. Le biographe de Merton dit qu’en fin de compte, l’expérience amoureuse de Merton lui a apporté « une libération intérieure, qui lui a donné un nouveau sentiment de sûreté, l’abandon de ses précautions, de ses défenses dans sa vocation et au fin fond de lui-même » (35).
Je pourrais avoir l’air de suggérer qu’une telle expérience est quasiment une étape nécessaire sur la voie de notre développement spirituel. Tel n’est pas du tout mon propos. « Nul n’a plus grand amour que celui-ci: donner sa vie pour ses amis. » Comme religieux, nous nous engageons à recevoir la plénitude de la vie dans le mystère de cette amitié dénuée de possessivité. Aussi pouvons-nous, prêtres et religieux, infliger de terribles blessures à nous-mêmes et aux autres en tombant amoureux. Les autres nous perçoivent parfois comme « sans danger » et nous-mêmes nous considérons tels. Nous pouvons facilement abuser des autres en nous livrant à une forme de « tourisme émotionnel », qui nous laisse libre de retourner à notre communauté quand les choses deviennent trop dangereuses mais en laissant éventuellement l’autre blessé, et sa confiance en l’Église, voire en Dieu, à jamais entamée.
d) Le désert de la solitude
Dans notre développement de personnes capables d’amour, nous devons parfois traverser le désert. Ce peut être parce que nous nous sentons incapables d’amour, ou parce que nous tombons amoureux, ou nous manquons à nos voeux. Si la vie apostolique nous conduit à la déroute de Gethsémani, où la vie perd toute signification, la crise en amour peut alors nous confronter à la solitude de la croix.
L’expérience de la solitude révèle sur nous-mêmes une vérité fondamentale, à savoir que seuls, nous sommes incomplets. Contrairement à la perception dominante d’une grande partie de la société occidentale, nous ne sommes pas des êtres autosuffisants, indépendants. La solitude révèle que tout seul, je ne peux pas vivre, je ne peux pas être. Je n’existe que grâce à mes relations avec les autres. Seul, je meurs. Cette solitude révèle un vide, une vacuité au coeur de ma vie. Nous pouvons être tentés de le combler par tout une série de choses, la nourriture, l’alcool, le sexe, le pouvoir ou le travail. Mais le vide demeure. L’alcool ou autre n’est qu’une soif de Dieu camouflée. Je soupçonne que nous ne pouvons pas même remplir ce vide par la présence des autres. Une pièce pleine de gens seuls ne change rien. « L’horreur de cette solitude se montre justement dans le fait que tous la partagent, nul ne peut la soulager. » (36) Quand Merton tomba amoureux, il découvrit que ce qu’il recherchait n’était peut-être pas sa bien-aimée, mais une solution à ce creux au milieu de son coeur. Cette personne était « celle dont j’essayais le nom comme une formule magique pour briser l’emprise de l’affreuse solitude de mon coeur » (37).
En fin de compte, je soupçonne que cette solitude ne doit pas simplement être supportée. Elle doit être vécue comme une entrée dans la solitude du Christ à sa mort, qui porte et transforme toute la solitude humaine. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » Si nous le faisons, le voile du temple sera arraché à moitié et nous découvrirons le Dieu qui est au coeur de notre être, nous accordant à tout moment l’existence: « Tu autem eras interior intimo meo. Tu es plus près de moi que moi-même. » (38) Si nous prenons sur nous la croix de la solitude et marchons avec elle, il nous sera révélé que la perception moderne du moi n’est pas exacte. La plus profonde vérité de nous-mêmes est que nous ne sommes pas seuls. Au fin fond de mon être Dieu me donne abondance de vie. Sainte Catherine se décrivait dans le Dialogue comme « demeurant dans la cellule de la connaissance de soi, afin de mieux connaître la bonté de Dieu envers (elle) ». La profonde connaissance de soi ne révèle pas le moi solitaire de l’ère moderne mais celui dont l’existence est inséparable du Dieu qui nous accorde la vie à chaque instant.
Si nous pouvons entrer dans ce désert et y rencontrer Dieu, nous deviendrons libres d’aimer sans possessivité, librement, sans domination ni manipulation. Nous pourrons regarder les autres non pas comme des solutions à nos besoins ou des réponses à notre solitude, mais simplement là pour se réjouir. « Aussi, tenez bon, et ne vacillez pas devant votre vide. » C’est au pied de la croix, là où Jésus donna l’un à l’autre sa mère et le disciple qu’il aimait, qu’est née la communauté de l’Église.
3. LA VIE DE PRIÈRE
- « Je vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. » (Jn 15,15).
Celui qui est touché par l’abondance de vie aime sans possessivité, spontanément, joyeusement. Son coeur de pierre devient un coeur de chair. Cette profonde transformation de notre humanité implique, suivant notre tradition, tout à la fois l’étude et la prière. Jourdain de Saxe nous dit qu’elles nous sont toutes deux aussi nécessaires que le boire et le manger. Par l’étude, nous remettons le coeur humain à neuf. Nous découvrons cette « illumination intellectuelle qui nous fait entrer dans l’affection de l’amour » (39). L’étude et la prière font toutes deux partie de la vie contemplative à laquelle tout dominicain est appelé. Mais les réflexions supplémentaires sur l’étude vous seront épargnées, puisque j’ai déjà écrit une lettre sur le sujet. Je vous ferai partager quelques pensées sur la prière et la plénitude de la vie.
3.1 La communauté de la Parole
À la fin de la plupart des visites canoniques, le visiteur fait quelques remarques édifiantes sur la nécessité de prier davantage. Nous acquiesçons sagement et formons de vagues résolutions. Est-ce qu’on a l’impression que l’enjeu est bien de redonner vie à ces ossements desséchés ?
Dès la naissance, les parents commencent immédiatement à parler à l’enfant. Bien avant qu’il ne soit capable de comprendre, un enfant est nourri de mots, baigné et bercé de mots. Le père et la mère ne parlent pas à leur enfant pour lui transmettre de l’information. Ils l’animent de leur parole. Il devient humain dans cet océan de langage. Petit à petit, il saura trouver une place dans l’amour que partagent ses parents. Sa vie croît en humanité.
De même nous sommes transformés par l’immersion dans la Parole de Dieu qui nous est adressée. Nous ne lisons pas la Parole pour y chercher de l’information. Nous y réfléchissons, nous l’étudions, la méditons, vivons avec elle, la buvons et la mangeons. « Que ces paroles que je te dicte aujourd’hui restent dans ton coeur! Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. » (Dt 6,6 ss). Cette parole de Dieu travaille en nous, nous rend humains, nous anime, nous forme à cette amitié qui est la vie véritable de Dieu. Comme l’écrivait Jourdain à Diane dans sa lettre de Noël 1229: « Relisez cette parole en votre coeur, retournez-la en votre esprit, laissez-la devenir douce comme le miel sur vos lèvres; méditez-la, habitez-la, afin qu’elle puisse habiter avec vous et en vous à jamais. » (40)
Un couple de mes amis a adopté un enfant. Ils l’ont trouvé dans une immense salle d’hôpital à Saigon, orphelin de la guerre du Viêt-nam. Les premiers mois, à l’hôpital, personne n’avait eu le temps de s’en occuper ou lui parler. Il a grandi sans savoir sourire. Mais ses parents adoptifs lui ont parlé et souri, oeuvre d’amour. Je me souviens du jour où, pour la première fois, il a renvoyé un sourire. La Parole de Dieu nous nourrit, afin que nous prenions vie, en humains, et devenions même capables de renvoyer le sourire de Dieu. Dans une communauté qui offre la vie, nous découvrirons cette Parole de Dieu chérie et partagée. Il ne suffit pas simplement de dire davantage de prières. Elles peuvent même nous suffoquer, surtout récitées à toute vitesse. Lorsque Dominique priait, il se régalait de la parole de Dieu, « savourait les paroles de Dieu dans sa bouche et, ce faisant, prenait plaisir à se les réciter à lui-même » (Cinquième voie), comme on goûterait un bon vin français. Albert le Grand disait que nous devions « être souvent nourris par la douceur (dulcedo, à nouveau) de la parole de Dieu » (41).
Ainsi nourri des mots de ses parents, l’enfant fait la terrifiante et libératrice découverte qu’il n’est pas le centre du monde. Derrière le sein, il y a une mère. Tout ne marche pas à sa commande. Il se découvre lui-même partie de la communauté humaine. Dans la conversation de nos parents, nous découvrons un monde auquel nous pouvons appartenir. Ainsi, de même, nourris par la parole de Dieu, nous sommes introduits dans un monde plus vaste. Le bon pasteur venu pour qu’on ait la vie, et qu’on l’ait en abondance, est celui qui ouvre les portes pour que nous puissions sortir à la découverte d’immenses espaces libres. En prière, nous partons en exode, au-delà de la minuscule coquille de notre nombrilisme. Nous pénétrons dans l’univers plus vaste de Dieu. La prière est une « discipline qui m’empêche de me prendre tout naturellement pour le centre immuable d’un petit univers, et me permet de me trouver, me perdre et me retrouver en permanence dans la trame d’un monde que je n’ai pas fait et que je ne contrôle pas » (42).
L’enfant mûrit dans la conversation de ses parents, et découvre qu’il n’est pas seul. De même, nous sommes gagnés par l’amitié de Dieu, guéris de notre égocentrisme, et nous commençons à entrevoir le monde réel. Yeats écrivait: « Nous avons nourri le coeur de fantasmes; à ce régime, le coeur en grandissant est devenu brutal. » (43) La prière guérit nos coeurs des fantasmes. Saint Thomas dit que prier le Notre Père « façonne notre vie affective toute entière » (44). Par la prière pour que soit faite la volonté de Dieu et que son Règne vienne, nos coeurs sont remis à neuf.
En nous libérant de nos fantasmes égocentriques et en pénétrant dans l’univers plus vaste de Dieu, nous découvrons que d’autres souffrent violence et désolation. Le frère Vincent de Couesnongle, op parlait de « la contemplation de la rue ». Pour Dominique, les affligés et les opprimés « font partie du ‘contemplata’ dans ‘contemplata aliis tradere’… La blessure de conscience qui délie l’esprit et le coeur de Dominique dans la contemplation, et lui permet, avec une vulnérabilité impressionnante, de ressentir les souffrances et les besoins de ses prochains, ne peut simplement se justifier par l’observation de certains souvenirs écrasants de souffrances ou même par sa propre compassion naturelle » (45). C’est, dit le frère. Paul Murray, une « blessure contemplative ». C’est pourquoi la vie contemplative est au coeur de toute recherche d’un monde juste. La contemplation nous rend capables de regarder de manière désintéressée.
3.2 Des communautés de célébration et de silence
En grandissant, l’enfant va cesser de crier et devenir capable à la fois de discours et de silence. Il apprendra et à parler et à écouter. De même pour nous, construire des communautés de prière exige davantage que de rajouter un psaume aux Vêpres. Nous devons créer un environnement dans lequel nous puissions à la fois parler et écouter, nous réjouir et nous taire. C’est l’écosystème dont nous avons besoin pour nous épanouir.
Dans la tradition dominicaine, s’adresser à Dieu est par-dessus tout demander ce que nous désirons. Ce n’est pas infantile, c’est du réalisme. Cela montre que nous nous sommes réveillés du petit monde de fantasmes du marché, où tout est à vendre, et reconnaissons que dans le monde réel, tout est don de celui qui est « source de toute bonté pour nous » (II II 83 a 2, ad 3). Quand nous commençons à demander, nous sommes alors sur la voie de l’âge adulte. Quand nous prions ensemble, osons-nous demander à Dieu ce que nous désirons au plus profond? Ou bien nous contentons-nous de réciter quelques suppliques du bréviaire?
L’exode de notre Égypte d’égocentrisme est un moment d’extase. Nous sommes libérés du petit monde obscur et rétréci de l’ego. Comme Myriam après la traversée de la mer Rouge, nous serons certainement exubérants. Nous exultons d’être entrés dans les immenses espaces libres de l’amitié de Dieu. David dansait comme un fou devant l’arche; Marie se réjouissait du Seigneur et des merveilles qu’il avait faites pour elle. La prière du prêcheur doit assurément être exultante, extatique. Nous sommes appelés « À louer, à bénir, à prêcher ». Quand les psaumes disent: « Chantons au Seigneur un chant nouveau », et bien, faisons-le! Dominique était exubérant dans sa prière. Il se servait de tout son corps, il étendait les bras, il s’allongeait sur le sol, il s’agenouillait et faisait beaucoup de bruit. Le corps entier sauvé par la grâce, prie. Plusieurs de mes souvenirs de prière les plus beaux sont avec les frères. Je pense à l’Eucharistie extatique célébrée en Haïti, au milieu de telles pauvreté et violence, à la danse et aux chants de nos soeurs Zoulous en Afrique du Sud, au chant merveilleux et passionné d’une veillée pascale à Cracovie, aux pétards et aux sirènes un an plus tard à Taiwan. Est-ce qu’en célébrant la liturgie nous nous réjouissons ensemble du Seigneur qui a fait pour nous des merveilles ? N’est-elle à nos yeux qu’une obligation à remplir? C’est bien d’une obligation qu’il s’agit en effet, cette très solennelle obligation qui naît de l’amitié. Nous nous réjouissons de faire des choses pour nos amis.
Eckhart écrivait que « l’attitude la meilleure et la plus noble entre toutes dans cette vie, c’est de se taire et laisser Dieu travailler et parler à notre coeur » (46). Il n’y a pas d’amitié sans silence. Si l’on n’a pas appris à s’arrêter, se tenir tranquille et écouter l’autre, on restera clos dans son propre petit univers, dont on est le centre et le seul vrai habitant. Dans le silence, nous faisons la découverte formidable et libératrice que nous ne sommes pas des dieux, mais juste des créatures.
Il y a plusieurs types de silence. Il y a le silence des femmes au tombeau, qui « ne dirent rien à personne, car elles avaient peur » (Mc 16,8). C’est le silence par lequel nous mettons de côté l’absolument inattendu, le nouveau, l’impensable. C’est le silence par lequel je ferme la porte au nez des paroles indésirables qui risqueraient de m’arracher à ma tranquillité d’esprit. Et puis il y a le silence des disciples sur la route d’Emmaüs, qui écoutent le Seigneur leur expliquer les Écritures. Sur le moment, ils ne disent rien, mais après coup, ils s’exclament: « Notre coeur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? » (Lc 24,32). Paul Philibert, op a appelé la prière l’ouverture de notre coeur aux initiatives secrètes de Dieu. Dans ce silence vulnérable, nous le laissons réaliser des choses nouvelles et insoupçonnées. Nous sommes ouverts à l’étonnement devant la nouveauté du Dieu des surprises: « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21,5).
C’est le silence qui prépare la voie à une parole de prédication. Ignace d’Antioche disait que la Parole naissait du silence du Père. Que c’était une Parole puissante, claire, décidée et vraie, parce qu’elle était née dans le silence. Il « n’a pas été oui et non; il n’y a eu que oui en lui. Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui » (2 Co 1,19 ss). Souvent, notre parole manque d’autorité, parce qu’elle est oui et non; elle fait des insinuations et pousse du coude; elle est tintée d’allusions et d’ambiguïtés, elle porte de petites flèches et de menus ressentiments. Nous devons créer ce silence dans lequel concevoir et partager une parole vraie.
Comment redécouvrir ce silence en nous-mêmes et dans nos communautés? D’après mon expérience, il n’y a pas d’autre moyen que prendre simplement le temps de faire silence en présence de Dieu chaque jour (voir LCO 66.11). C’est la discipline que j’ai poursuivie et fuie, atteinte et laissée s’échapper depuis mon entrée dans l’Ordre. C’est ainsi que j’ai passé la plupart du temps à penser aux repas et aux fax. Pour ce silence contemplatif, nous avons besoin d’un soutien mutuel. Nous avons besoin de communautés qui nous aident à croître dans un silence paisible. Un moine bouddhiste disait à Merton: « Avant de pouvoir méditer, tu dois apprendre à ne pas claquer les portes. » Quiconque vit près de moi sait bien que je ne maîtrise pas encore cet art! Chaque communauté doit réfléchir sur la manière de créer des temps et des lieux de silence.
Il ne s’agit pas du déprimant silence de morgue que l’on trouvait parfois dans le passé, le silence qui laissait les autres au-dehors. Nous avons soif d’un silence qui nous prépare à la communication au lieu de la refuser. C’est le silence confortable qui vient avant et après le partage d’une parole, plutôt que le silence embarrassé de ceux qui n’ont rien à se dire. Quand j’étais enfant, mon plus jeune frère et moi-même allions souvent dans les bois, à la recherche d’animaux et d’oiseaux. Le secret était d’apprendre à faire le silence ensemble. C’était une communion dans une attention commune. Peut-être pouvons-nous trouver cela, quand nous écoutons ensemble dans l’attente d’une parole à venir.
3.3 Le désert de la mort et la résurrection
Jésus nous appelle à la vie et, et à l’avoir en abondance. C’est là la bonne nouvelle que nous prêchons. Pourtant nous avons vu qu’en répondant à cet appel nous nous retrouvons parfois dans le désert. Prêcheurs de la parole, nous découvrons que nous n’avons pas de parole à offrir, que rien n’a plus de sens. Nous qui prêchons l’amour de Dieu, nous nous trouvons désolés, seuls et abandonnés. Nous qui sommes invités à nous découvrir dans la vie-même de Dieu, nous serons confrontés à notre mortalité. Nous sommes des créatures, pas des dieux, et nous devons mourir. Alors, nous nous écrierons peut-être comme les Israélites à Moïse: « Manquait-il de tombeaux en Égypte, que tu nous aies menés mourir dans le désert? » (Ex 14,11). Alors, il nous faudra « tenir bon et ne pas vaciller devant notre vide », confiants que la vie nous sera donnée.
Comment nous entraider et nous encourager devant notre condition de mortels? Tout d’abord, nous devons nous encourager mutuellement avec la liberté de Jésus. Sachant que le Fils de l’homme devait mourir, il a tourné son visage vers Jérusalem. C’est une liberté que j’ai parfois vue chez les frères et les soeurs, qui donnent leur vie. Dans les années précédant son assassinat, le frère Pierre Claverie, évêque d’Oran, prit la route de Jérusalem, refusant de céder aux menaces et d’abandonner son peuple. En 1994, il disait dans un sermon: « J’ai milité pour le dialogue et l’amitié entre les gens, les cultures, les religions. Tout cela mérite probablement la mort et je suis prêt à en assumer le risque. » (47)
La liberté de Jésus face à la mort culmina la nuit précédant sa mort, lorsqu’il prit son corps et le donna à ses disciples, dans un geste de stupéfiante liberté. C’est ce qu’il nous est donné de faire ensemble, face à notre état de mortels. Je me souviens, un matin de Pâques, à Blackfriars, avoir célébré joyeusement l’Eucharistie avec un frère qui se mourait du cancer. La communauté tout entière s’était entassée dans sa chambre. Après quoi nous bûmes du champagne en l’honneur de la résurrection. Je me souviens avoir célébré l’Eucharistie avec les frères et soeurs d’Iraq, il y a quelques semaines à peine, en attendant l’attaque militaire qui aurait sûrement lieu. L’Eucharistie ne doit pas être le centre de notre vie commune parce que nous nous sentons unis, ou même pour que nous puissions nous sentir unis. Elle est le sacrement de cette abondance de vie qui est pur don, le « pain de vie » dont Dominique promit que nous le trouverions dans l’Ordre. Nous le recevons ensemble, en nous offrant mutuellement la nourriture pour la traversée du désert.
Nous vivons le sens de l’Eucharistie en nous libérant les uns les autres, en nous transmettant mutuellement l’incommensurable liberté du Christ. Peut-être à travers la petite liberté d’un pardon généreusement donné, ou en laissant se briser un vieux schéma de vie, ou en prenant un risque. Nous lâchons prise. Comme l’écrivait Lacordaire: « Je vais où Dieu me mène, incertain de moi mais sûr de lui. » Sur toutes ces voies, nous nous laissons emporter dans le mouvement de l’Esprit qui jaillit du Père et du Fils, et crie en nos coeurs « Abba Père ». Comme le dit Eckhart: « Nous ne prions pas, nous sommes priés. » Mais c’est aussi là que nous entrons en liberté et en spontanéité, que nous sommes le plus en vie. Nous nous laissons emporter par le mouvement, comme un danseur s’abandonnant au rythme y trouve grâce et liberté.
La sagesse a dansé en présence de Dieu en créant le monde. Saint Thomas disait que la contemplation d’un sage est comme un jeu, en ce qu’elle est plaisante et qu’elle est à elle-même sa propre fin, comme une danse. « L’excès de sérieux révèle un manque de vertu, car il méprise complètement le jeu qui est aussi nécessaire à une bonne vie humaine que le repos. » (48) L’abondance de vie nous conduit à l’enjouement de ceux qui se sont défaits du fardeau d’être de petits dieux. Nous pouvons laisser tomber le terrible sérieux de ceux qui croient pouvoir porter le monde sur leurs épaules. Alors, nos communautés pourraient bien être vraiment des lieux où nous initier au bonheur du Royaume. Saint Dominique, Nos junge beatis. Unis-nous aux bienheureux, et puissions nous aujourd’hui partager un avant-goût de leur bonheur.
Frère Timothy Radcliffe, o.p.
Maître de l’Ordre des Prêcheurs
25 février, Mercredi des Cendres 1998
Notes
1 Étienne de Salagnac 1, 9, éd. Thomas Kaeppeli, op, MOPH XXII, Rome, 1949, p. 81.
2 Cornelius Ernst, op, The Theology of Grace, Dublin, 1974, p.42.
3 The Identity of Religious today. The Conference of Major Superiors of Men, USA, 1996.
4 Constitution fondamentale IV.
5 Cernai 21, cité par Tugwell (éd), Dominic, Londres, 1997, p. 125.
6 Dominican Ashram, mars 1982, « What is my licence to say what I say? », p. 10.
7 Die deutsche Predigten und lateinischen Werke, Stuttgart, 1936, vol. V, p. 197.
8 Prediche del b. Fra Giordano da Rivolto, éd. A. M. Bisconi et D. M. Manni, Florence, 1739, p. 9.
9 Herbert McCabe, op, God Matters, Londres, 1987, « On being Dominican », p.240.
10 Cornelius Ernst, op, op cit, p.72.
11 Sermons and Treatises, traduction anglaise de M. O’C. Walshe, vol. 1, Londres, 1979, p. 44.
12 Sainte Thérèse de Lisieux, Manuscrits autobiographiques, Paris, p. 226.
13 In Jn 26.
14 Conférence à paraître in Review for Religious, mars 1998.
15 D.A. Mortier, op, Histoire des maîtres généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, vol. 1, Rome, 1903, p. 528.
16 The Letters of Bede Jarrett, op, éd. Bede Bailey, Aidan Bellenger and Simon Tugwell, Bath, 1989, p. 182.
17 Lettre 46, traduction anglaise tirée de G. Vann op, To heaven with Diana, Londres, 1959, p. 120.
18 Lettre 48, ibid p. 28.
19 Nicholas Lash, The Beginning and the End of Religion, Cambridge, 1996, p.21.
20 Sentences 3 d 35, 1, 2, 1.
21 Vision of Albion 7.17.
22 Op. cit.
23 Simon Tugwell, op, Reflections on the Beatitudes, Londres, 1980, p. 78.
24 Jean-Louis Bruguès, op, Les idées heureuses, Paris, 1996, p. 56.
25 S. Tugwell, op cit, p. 96.
26 Joseph Pieper, A brief Reader on the Virtues of the Human Heart, San Francisco, p. 44.
27 Maître Eckhart, Walshe, op, op cit, Sermon 8.
28 Ibid, Sermon 68.
29 Gerald Wann op, op. cit., p. 46 et suivantes.
30 Ibid, p. 157.
31 Paul Murray , op, « A Song for the Afflicted » (« Un chant pour les affligés »), poéme inédit.
32 Rowan Williams, Open for Judgement, Londres, p. 184.
33 Iris Murdoch, The Fire and the Sun: Why Plato banished the Artists, Oxford, 1979, p. 36, cité par Fergus Kerr, op, Immortal Longings: Versions of Transcending Humanity, Indiana, 1997, p. 72.
34 John Howard Griffin, Thomas Merton: The Hermitage Years, Londres, 1993, p. 60.
35 Griffin, op. cit., p. 87.
36 Sebastian Moore, osb, The Inner Loneliness, Londres, 1982, p. 40.
37 Op. cit., p. 58.
38 Saint Augustin, Confessions, 3. 6. 11.
39 Somme Théologique 1.43, a 5, ad 2.
40 Lettre 41, Vann op cit, p. 112.
41 Sermon, Recherches de théologie ancienne et médiévale 36 (1969) p. 109.
42 Rowan Williams, ibid, p. 120.
43 « Meditations in time of Civil War », Collected Poems, Londres, 1969, p. 230.
44 Somme Théologique II.II 83. a. 8.
45 Paul Murray op, « Dominican grounded in Contemplative experience », conf. River Forest Chicago, juin 1997.
46 Walshe, op cit, vol. 1, p. 6.
47 Sermon après la mort de fr. Henri et sr Paule-Hélène, dans La vie spirituelle, octobre 1997, p. 764.
48 Eth. ad Nic. iv ib 854.
Lettre à nos frères et soeurs en formation initiale (1999)
En la fête du Bienheureux Jourdain de Saxe, 1999
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 Chers frères et soeurs en saint Dominique,
Chers frères et soeurs en saint Dominique,
Vous êtes un don de Dieu à notre Ordre, et nous honorons notre créateur en accueillant ses dons. C’est ce que nous devons faire en vous donnant la meilleure formation possible. L’avenir de l’Ordre en dépend, voilà pourquoi tous les chapitres généraux de l’Ordre passent tant de temps à discuter de formation. Ces dernières années, l’Ordre a produit d’excellents documents sur la formation, aussi, plutôt que d’écrire une longue lettre sur la formation en répétant tout ce qui a été dit, j’ai jugé préférable de réunir ces documents afin que vos formateurs et vous-mêmes puissiez aisément les étudier. Mais je souhaite partager quelques mots, qui s’adressent directement à vous, mes frères et soeurs qui commencez votre vie dominicaine, tout en sachant que certains de vos formateurs liront peut-être par-dessus votre épaule. Je parlerai de la formation des frères, car c’est ce que je connais le mieux. J’espère être aussi pertinent pour l’expérience de nos soeurs.
L’un de mes grands plaisirs durant mes visites dans l’Ordre est de vous rencontrer. Je suis souvent ému par votre enthousiasme pour l’Ordre, votre désir d’étudier et de prêcher, votre vraie joie dominicaine. Mais la formation comportera aussi des moments de souffrance, d’égarement, de découragement, et une perte du sens. Vous vous demanderez parfois pourquoi vous êtes là, et si vous devez y rester. De tels moments sont une part nécessaire et douloureuse de la formation, du devenir dominicain. S’ils n’avaient pas lieu, c’est que votre formation ne vous toucherait pas profondément.
La formation, dans notre tradition, n’est pas le modelage d’un sujet passif, dans le but de fournir un produit standard : « un dominicain ». C’est notre manière de vous accompagner, tandis que vous répondez librement au triple appel reçu : du Seigneur ressuscité qui vous invite à le suivre, des frères et des soeurs qui vous invitent à devenir l’un d’entre eux, des impératifs de la mission. Si vous répondez pleinement et généreusement à ces exigences, vous en serez changés. Cela vous demandera une confiance absolue dans le Seigneur qui donne la résurrection. Ce sera à la fois douloureux et libératoire, passionnant et terrifiant. Cela fera de vous la personne que Dieu vous appelle à être. Ce processus se poursuivra tout au long de votre vie dominicaine. Les années de formation initiale en sont juste le commencement. Je vous écris cette lettre en offrande d’encouragement pour la route. Ne laissez pas tomber quand c’est dur!
Pour explorer ce thème, je prendrai le texte de la rencontre de Marie-Madeleine, sainte patronne de l’Ordre, avec Jésus au jardin (Jean 20, 11-18).
« QUI CHERCHES-TU ? »
Lorsque Jésus rencontre Marie-Madeleine, il lui demande « Qui cherches-tu ? » Notre vie dans l’Ordre commence par une question semblable, quand nous gisons étendus sur le sol : « Que cherches-tu? » C’est la question que Jésus pose aux disciples au début de l’Évangile.
Vous êtes venus à l’Ordre le coeur assoiffé, mais de quoi? Est-ce parce que vous avez découvert l’Évangile récemment et souhaitez le partager avec tous? Est-ce parce que vous avez rencontré un dominicain, l’avez admiré et voulez l’imiter? Est-ce pour fuir le monde et toutes ses complications, la souffrance de créer des relations humaines? Est-ce parce que vous avez toujours voulu devenir prêtre, tout en sentant le besoin d’une communauté? Est-ce parce que vous vous interrogez sur le sens de votre vie et souhaitez le découvrir avec nous? Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Nous ne pouvons pas répondre à cette question à votre place, mais nous pouvons être auprès de vous au moment où vous l’affrontez, et vous aider à trouver une réponse honnête.
Au cours de notre vie dominicaine, nous pouvons répondre différemment à cette question selon les moments. Les raisons qui nous amènent à l’Ordre ne sont pas forcément celles qui nous y font demeurer. Quand j’ai rejoint l’Ordre, j’étais surtout poussé par la soif de comprendre ma foi. La devise de l’Ordre, « Veritas », m’attirait. Je doutais d’avoir jamais le courage de prêcher en chaire. Plus tard, je suis resté parce que ce désir s’était emparé de moi. Nous ne voyons pas toujours bien clairement pourquoi nous sommes encore là, ni à quoi nous aspirons. Ce qui nous fait tenir n’est parfois guère qu’un vague sentiment : c’est là que nous sommes appelé. Pour la plupart, nous restons en fin de compte parce que, comme Marie-Madeleine au jardin, nous cherchons le Seigneur. Une vocation c’est l’histoire d’un désir, d’une soif. Nous restons parce que nous sommes accrochés à l’amour, et non à la promesse d’un accomplissement personnel ou d’une carrière. Eckhart dit : « Car l’amour ressemble à l’hameçon du pêcheur. Le pêcheur ne peut attraper le poisson tant qu’il ne s’est pas accroché à l’hameçon Celui qui pend à cet hameçon est pris si vite que bras et jambes, bouche, yeux, coeur, et tout ce qui est à cette personne n’appartient qu’à Dieu. Ne cherchez que cet hameçon, afin d’être bienheureusement pris, car plus vous êtes pris, plus vous êtes libres » (1).
Peut-être découvrirez-vous que vous êtes bien à la recherche du Seigneur ressuscité, mais appelé à le trouver dans une autre forme de vie, par exemple en disciple marié. Peut-être Dieu vous a-t-il appelé dans l’Ordre le temps de vous préparer à être prêcheur d’une autre manière.
La joie de cette rencontre de Pâques est au coeur de notre vie dominicaine. C’est un bonheur que nous partageons par notre prédication. Mais nous ne développons ce bonheur qu’en traversant des moments de perte. Celui que Marie-Madeleine aimait a disparu. « Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je l’enlèverai ». Elle pleure la perte de l’aimé. L’entrée dans l’Ordre est parfois marquée par la même expérience de désolation. On est entré plein d’enthousiasme. On allait se donner à Dieu, prier des heures durant en extase. Mais Dieu semble s’être éclipsé. Prier devient la fastidieuse répétition de longs psaumes, jamais au bon moment, avec des frères qui chantent mal. On peut même penser que c’est la faute des frères, avec leur manque de dévotion, si Dieu a disparu. Et pourquoi ne se présentent-ils même pas à l’office? Leur enseignement semble miner la foi qui m’avait conduit ici. La Parole de Dieu est disséquée dans leurs conférences, et on nous dit qu’elle n’est pas littéralement vraie. Où ont-ils enterré mon Seigneur?
- « Jésus lui dit : ‘Marie !’ Se retournant, elle lui dit en hébreu : ‘Rabbouni !’ -ce qui veut dire : ‘Maître’ ».
Il nous faut perdre le Christ pour pouvoir le retrouver, incroyablement vivant et étonnamment proche. Nous devons le laisser partir, nous désoler, pleurer son absence, pour pouvoir découvrir Dieu plus proche de nous que nous n’aurions su l’imaginer. Si nous ne passons pas par là, nous resterons coincés dans une relation à Dieu puérile et infantile. Être désorienté, devenir comme Marie au jardin, ne sachant ce qui se passe, participe à notre formation. Sans quoi nous ne serons jamais surpris par une nouvelle intimité avec le Seigneur ressuscité. Et c’est ce qui doit se produire, et se reproduire, à mesure que le pêcheur nous remonte. Le Seigneur perdu apparaît à Marie-Madeleine et lui parle, puis lui demande de le laisser partir à nouveau : « Ne me touche pas ».
Lorsqu’il semble qu’on a enlevé le corps du Seigneur, n’abandonnez pas, ne partez pas. Quand Jésus eut disparu, Pierre, en homme typique, retourna au travail. Ce peut être une tentation, d’aller reprendre notre ancienne vie. Marie n’a pas laissé tomber, mais a continué de chercher, ne fût-ce qu’un corps sans vie. Si nous tenons bon, comme elle, nous serons surpris. Je me souviens d’une longue période de désolation, durant les années de profession simple. Je ne doutais pas de l’existence de Dieu, mais Dieu paraissait insoutenablement loin, et sans grand-chose à voir avec moi. C’est des années plus tard, après la profession solennelle, dans le jardin de Gethsémani, à Jérusalem, un été, que le vide s’est comblé. Il se peut que je doive à nouveau supporter cette absence un jour, et peut-être serez-vous, mes frères et soeurs, ceux qui m’aideront à tenir et continuer jusqu’à la surprise de la rencontre suivante.
Jésus ne lui dit qu’un mot, son nom : « Marie ! ». Dieu nous appelle toujours par notre nom. « Samuel ! », appela Dieu, trois fois dans la nuit. Qui nous sommes, notre identité la plus profonde, nous le découvrons en répondant à l’appel de notre nom. « Le Seigneur m’a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom » (Is 49, 1). Aussi notre vocation dominicaine n’est-elle pas une histoire d’emploi à trouver, ni même de service utile à l’Église et à la société. C’est mon « oui » à Dieu qui m’appelle, « oui » aux frères avec qui je vis, et « oui » à la mission où l’on m’envoie. Je suis appelé à la vie, comme celui qui fut appelé à sortir de la tombe par une voix qui lançait : « Lazare, viens dehors ! ».
Ainsi, on peut dire que l’objectif fondamental de la formation est de nous aider à devenir des chrétiens, à dire « oui » au Christ. Sinon, ce n’est qu’un passe-temps. Mais cela signifie-t-il que devenir dominicain soit sans importance, un simple détail secondaire? Non, parce que c’est la voie de Dominique pour suivre le Christ. Le premier nom du christianisme fut peut-être « la Voie » (Actes 9, 2). Quand Dominique partit sur les routes dans le sud de la France, il découvrit une voie vers le Royaume. L’Ordre nous offre pour voie un mode de vie, avec sa prière commune, sa forme de gouvernement, sa manière de faire de la théologie et d’être un frère. En faisant profession, nous gageons que cet étrange mode de vie peut nous conduire vers le Royaume.
Aussi n’attendrai-je pas d’être un bon chrétien pour devenir prêcheur. Partager la Parole de Dieu participe à ma recherche du Seigneur dans le jardin. Quand je m’évertue à trouver une parole à prêcher, je suis alors comme Marie-Madeleine, je supplie le jardinier de me dire où l’on a mis le corps de mon Seigneur. Si je puis partager ma lutte avec la parole, je puis aussi partager ce moment de révélation où le Seigneur dit mon nom. Il faut oser se pencher vers l’intérieur du tombeau, et voir l’absence du corps, pour pouvoir partager aussi la rencontre qui viendra. Être prêcheur, c’est partager tous les moments de ce drame au jardin de Pâques : désolation, interrogation, révélation. Mais si je parle en personne qui sait tout, impénétrable au doute, pour impressionnés qu’ils soient par ma connaissance, les gens trouveront peut-être qu’elle a bien peu à voir avec eux.
« VA TROUVER MES FRÈRES »
Jésus appelle Marie-Madeleine par son nom, et l’envoie trouver ses frères. Nous répondons à l’appel de Dieu en devenant l’un des frères.
Devenir frère est bien plus que rejoindre une communauté et revêtir un habit. Cela suppose une profonde transformation de l’être. Être frères de sang, c’est bien autre chose que d’avoir les mêmes parents ; cela signifie des relations qui ont lentement fait de nous ce que nous sommes. De manière analogue, devenir l’un des frères de Dominique exige une transformation patiente et parfois douloureuse. Il y aura des moments, longs peut-être, de mort et de résurrection.
S’il est vrai que la plupart des frères dominicains sont prêtres, et que nous appartenons à un « institut clérical », l’ordination ne nous rend pas moins frères pour autant. Au cours de mes années de formation, j’ai appris à aimer être l’un des frères. Je n’en désirais pas plus. J’ai accepté l’ordination parce que mes frères me la demandaient, et pour le bien de la mission. J’ai fini par valoriser le sacerdoce pour l’expression sacramentelle que la communion et la miséricorde, qui sont au coeur de notre vie fraternelle, y trouvent pour l’Église universelle. Mais je suis resté aussi frère qu’avant. Il n’y a pas de titre plus élevé dans l’Ordre. C’est l’une des raisons pour lesquelles je crois tant à l’importance, pour l’avenir de l’Ordre, de promouvoir la vocation de frère coopérateur -terme que je n’ai jamais aimé. Ces derniers nous rappellent qui nous sommes, les frères de Dominique. Il ne saurait y avoir de frère de seconde classe dans l’Ordre.
Je me rappelle la visite, quand j’étais étudiant, d’un prêtre d’une autre province à notre communauté d’Oxford. À son arrivée, un dominicain était en train de balayer l’entrée. Le visiteur lui demanda « Vous êtes un frère ? ». « Oui », répondit ce dernier. « Mon frère, s’il te plaît, va me chercher une tasse de café ». Après son café, il demanda au frère de porter ses bagages à sa chambre. Et enfin, le visiteur dit : « Maintenant mon frère, je voudrais voir le Père prieur ». Et l’autre de répondre : « Je suis le prieur ».
Être frère : différentes visions
Être frère, c’est découvrir votre appartenance à notre groupe. C’est se sentir chez soi avec les frères. Mais nous, dominicains, pouvons avoir bien des conceptions différentes de ce que signifie être frère.
L’un des chocs possibles au moment d’entrer au noviciat est la découverte que mes collègues novices sont venus avec des visions de la vie dominicaine fort différentes de la mienne. À mon arrivée, j’étais très fortement attiré non seulement par la recherche de la Veritas, mais aussi par la pauvreté dominicaine. Je m’imaginais mendiant mon pain par les rues. Je me suis vite aperçu que la plupart de mes collègues novices jugeaient cela d’un romantisme ridicule. Certains d’entre vous sont poussés par un amour de l’étude ; d’autres par un désir de lutter pour un monde plus juste. L’un se scandalisera de voir d’autres novices déballer d’énormes quantités de livres ou un lecteur de CD. Certains veulent porter l’habit vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d’autres l’ôtent dès que possible. On piétine facilement les rêves des autres.
Il y a souvent de telles tensions entre générations de frères. Parmi les jeunes qui arrivent dans l’Ordre aujourd’hui, certains accordent beaucoup de valeur à la tradition et aux signes visibles de l’identité dominicaine : l’étude de saint Thomas, les chants ou les antiennes traditionnels, le port de l’habit, la célébration de nos saints. Les frères d’une génération précédente s’étonnent souvent de ce désir d’identité dominicaine claire et explicite. Pour eux, l’aventure a justement consisté à quitter les formes anciennes qui semblaient s’élever entre nous et la prédication de l’Évangile. Il fallait se lancer sur les routes, là où se trouvaient les gens, regarder avec leurs yeux, être anonymes pour être proches. De temps en temps, cela provoque une certaine incompréhension, voire une suspicion réciproque. Les provinces aujourd’hui florissantes sont généralement celles qui ont réussi à dépasser ce genre de conflits idéologiques. Comment construire une fraternité plus profonde que ces différences ?
Tout d’abord, en apprenant à reconnaître en chacun le même élan évangélique profond. Avec ou sans l’habit, nous prêchons le même Seigneur ressuscité. Je me suis toujours senti chez moi avec les frères : que je sois assis avec quelques uns au bord d’une rivière d’Amazonie, en bras de chemise, à réciter les psaumes, ou que je célèbre à Toulouse une liturgie polyphonique très travaillée. Au-delà des exigences objectives de nos voeux et Constitutions, on reconnaît certains airs de famille : une qualité de joie ; un sens de l’égalité de tous les frères ; une passion pour la théologie, même si les tendances sont assez contradictoires ; une confiance dans notre tradition démocratique ; une absence de prétention. Tout cela évoque un mode de vie que nous partageons, si grandes que soient les différences superficielles.
Ensuite, nos différentes visions de la vie dominicaine peuvent être formées par différents moments de l’histoire de l’Église et de l’Ordre. Un grand nombre de ceux qui, comme moi, sont devenus dominicains à l’époque du Concile Vatican II ont grandi dans un catholicisme confiant, sûr de son identité. Notre aventure consistait à atteindre ceux qui étaient loin du Christ, en renversant les barrières. Ce qui anime les frères et les soeurs de cette génération est parfois le désir d’être proche du Christ invisible présent dans chaque usine, chaque barrio, chaque université. On supprimait l’identité visible pour le bien de la prédication. Nos prêtres-ouvriers, par exemple, étaient un signe de ce Dieu proche même de ceux qui semblent avoir oublié son nom.
Beaucoup de ceux qui viennent à l’Ordre aujourd’hui, en particulier en Occident, ont suivi un parcours différent, grandissant loin du christianisme. Peut-être voulez-vous maintenant célébrer et affirmer la foi que vous avez embrassée et vous êtes mis à aimer. Vous souhaitez être vus comme dominicains, car cela aussi participe de la prédication. Le même élan évangélique peut conduire certains frères à porter l’habit et d’autres à l’ôter.
Cette tension est en fin de compte féconde et nécessaire à la vitalité de l’Ordre. Accepter les jeunes dans notre Ordre nous met à l’épreuve. Tout comme la naissance d’un enfant change la vie de toute la famille, ainsi chaque génération de jeunes qui vient à nous modifie la communauté fraternelle. Vous arrivez avec vos questions, pour lesquelles nous n’avons pas toujours de réponse, avec vos idéaux, qui révèlent parfois nos insuffisances, avec vos rêves, que nous ne partageons pas forcément. Vous arrivez avec vos amis et vos familles, votre culture et votre tribu. Vous venez nous déranger, et c’est pourquoi nous avons besoin de vous. Vous arrivez en général avec des exigences qui sont en fait essentielles à notre vie dominicaine, mais que nous avons parfois oubliées ou dépréciées : une prière commune plus profonde, plus belle; une fraternité plus intime, dans laquelle nous nous soucions davantage les uns des autres ; le courage de quitter nos anciens engagements et de nous remettre en route. Souvent, l’Ordre se renouvelle parce que les jeunes arrivent et insistent pour tenter de construire la vie dominicaine telles qu’ils l’ont lue décrite dans les livres ! Continuez à insister !
Pour nous qui sommes venus plus tôt, il est facile de vous dire, irrités : « C’est vous qui nous rejoignez ; ce n’est pas nous qui vous rejoignons ». De fait, ce n’est vrai qu’à demi. Car en entrant dans l’Ordre, nous nous sommes remis entre les mains des frères qui étaient encore à venir. Nous avons promis obéissance à ceux qui n’étaient pas encore nés. Il est vrai que nous n’avons pas à réinventer l’Ordre à chaque génération, mais le génie de Dominique fut entre autres de fonder un Ordre dont l’adaptation et la flexibilité sont des parties intégrantes. Nous devons être renouvelés par ceux qu’a gagnés l’enthousiasme de la vision de Dominique. Nous ne devons pas vous recruter pour mener nos vieilles batailles. Il nous faut résister à la tentation de vous ranger dans les catégories de notre jeunesse, et de vous étiqueter « conservateurs » ou « progressistes », de même vous devez vous abstenir de nous considérer comme de vieux débris des années soixante-dix à écarter.
Vous aussi serez mis à l’épreuve par ceux qui sont venus avant vous, du moins je l’espère. Accepter qu’il y ait différentes manières d’être dominicain ne veut pas dire que chacun peut simplement inventer sa propre interprétation. Je ne peux pas, par exemple, décider qu’avoir une maîtresse et une voiture de course est, selon moi, compatible avec les voeux. Notre mode de vie comporte certaines exigences inévitables et objectives, qui doivent au bout du compte m’inviter à subir une profonde transformation de mon être. Si je m’y soustrais, je ne deviendrai jamais l’un des frères.
Surtout, des conceptions différentes de ce qu’est un dominicain ne devraient jamais réellement nous diviser parce que l’unité de l’Ordre ne réside pas dans une orientation idéologique commune, ni même dans une seule spiritualité. Si tel avait été le cas, nous nous serions scindés voilà bien longtemps. Ce qui nous unit, c’est un mode de vie qui permet une grande diversité et flexibilité, c’est une mission commune, et une forme de gouvernement qui donne voix à chaque personne. Le lion dominicain et l’agneau dominicain peuvent très bien vivre ensemble et jouir mutuellement de leur compagnie.
Au début de la vie de l’Ordre, on écrivit « La vie des frères » pour rappeler le souvenir de la première génération de nos frères. Nous sommes liés en une communauté par les histoires du passé autant que par les rêves de l’avenir. Les signes visibles de l’identité dominicaine ont leur valeur et disent quelque chose d’important sur qui nous sommes, mais ils ne doivent pas devenir les étendards de partis différents. Les dominicains dont nous chérissons fort justement la mémoire étaient souvent tellement pris dans la passion de prêcher qu’ils n’avaient guère le temps de réfléchir à leur identité de dominicains. Comme l’a écrit Simon Tugwell, « tout au long de l’histoire, c’est quand l’Ordre était le plus fidèle à lui-même qu’il se préoccupait le moins d’être dominicain » (2).
La formation doit bien nous donner un fort sens de l’identité dominicaine, et nous enseigner notre histoire et nos traditions. Non pas pour contempler la gloire de l’Ordre, et combien nous sommes importants, ou combien nous le fûmes, mais pour que nous puissions prendre la route, et marcher ensemble à la suite du Christ pauvre et itinérant. Un fort sens de notre identité libère du souci de penser sans cesse à nous, sans quoi nous serons trop occupés de nous-mêmes pour entendre la voix qui nous demande : « Qui cherches-tu ? ».
Aussi la fraternité se fonde-t-elle sur davantage qu’une unique vision. Elle se construit patiemment, en apprenant à s’écouter les uns les autres, à être forts et fragiles, en apprenant la fidélité réciproque et l’amour des frères.
Parler et écouter
Nous reconnaissons que nous sommes chez nous à ce que nous pouvons parler aisément entre nous, confiants que nos frères essaieront au moins de nous comprendre. Telle est probablement notre attente lorsque nous entrons dans l’Ordre. Jésus dit à Marie-Madeleine : « Va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Elle est chargée de partager sa foi dans le Seigneur ressuscité, même si ses frères pensent qu’elle se leurre. Ainsi construisons-nous un foyer commun dans l’Ordre en osant partager ce qui nous a conduit ici. Ce sera dur, quelquefois. Nous sommes probablement arrivé croyant trouver des gens avec la même vision des choses, les mêmes rêves et les mêmes manières de penser. Mais nous découvrons que les autres sont venus à l’Ordre par des chemins si différents que nous ne pouvons nous reconnaître dans ce qu’ils disent. Nous hésiterons peut-être à exposer ce qu’il y a de plus précieux, notre foi fragile, à la critique et à l’examen. Partager notre foi exige une grande vulnérabilité. C’est parfois plus facile quand on ne doit pas vivre ensemble.
L’un des principaux défis pour les formateurs, est de vous donner suffisamment confiance pour que vous osiez parler librement. Martin Buber écrivait que « Ce qui est décisif, c’est si les jeunes sont prêts à parler. Si quelqu’un les traite avec confiance, leur montre qu’il croit en eux, ils lui parleront. La première nécessité est pour l’enseignant d’éveiller chez ses élèves ce bien précieux entre tous -une confiance authentique » (3). Il est tout aussi important que vous ayez confiance les uns dans les autres. Peut-être aurez-vous même quelquefois le courage de partager vos doutes.
La culture occidentale contemporaine cultive systématiquement la suspicion. On nous dit de fouiller les paroles des autres à la recherche de l’inavoué, du dissimulé, et même de l’inconscient. Dans l’Église, cela prend parfois la forme d’une chasse à l’erreur, où l’on scrute les déclarations pour y déceler l’hérésie. Ce frère est-il un véritable disciple de saint Thomas d’Aquin, ou de la théologie de la libération ? Est-il l’un de nous ? Il est plus facile de découvrir qu’un frère a tort et a renié un dogme de l’Église, ou quelques unes de mes idéologies personnelles, que d’écouter le petit grain de vérité qu’il s’efforce peut-être de nous faire partager. Mais cette suspicion est destructrice pour la fraternité. Elle naît de la peur et seul l’amour chasse la peur.
Apprendre à nous écouter les uns les autres dans la charité est une discipline intellectuelle. Benedict Ashley écrivait : « Il faut une nouvelle ascèse de la pensée, car rien n’est plus difficile que de préserver la charité dans un débat sincère sur des questions graves » (4). Aimer mon frère n’est pas simplement une émotion agréable et chaleureuse, mais une discipline intellectuelle. Je dois me garder d’écarter comme absurde ce que mon frère a dit, avant d’avoir entendu ce qu’il dit vraiment. C’est l’ascèse mentale consistant à ouvrir son esprit à une vision inattendue. Elle implique d’apprendre à se taire, pas seulement en attendant que l’autre cesse de parler, mais de façon à pouvoir l’entendre. Je dois taire mes objections défensives, et résister à l’urgent désir de l’arrêter avant qu’il ne dise un mot de plus. Je dois me taire et écouter.
La conversation construit une communauté de pairs, et c’est pourquoi nous devons construire la communauté de la Famille dominicaine en prenant le temps de parler avec nos soeurs et avec les laïcs dominicains, et d’y trouver du plaisir. La conversation édifie la grande maison de Dominique et Catherine. Elle « exige l’égalité entre les participants. En fait, c’est l’une des manières les plus importantes pour établir l’égalité. Ses ennemis sont la rhétorique, la controverse, le jargon, et les langages codés, ou le désespoir de n’être pas écouté et pas compris. Pour s’épanouir, elle a besoin de l’aide de ‘sages-femmes’ des deux sexes Ce n’est qu’en apprenant à converser que les gens commenceront à être égaux » (5). L’un des défis pour nous, les frères, est de permettre aux soeurs de nous former comme prêcheurs. La formation la plus profonde est toujours mutuelle.
Être forts et faibles
Nous sommes à notre place, chez nous, lorsque nous nous découvrons plus fort que nous ne l’aurions cru, et plus faible que nous n’oserions l’admettre. Et ce ne sont pas là des qualités opposées, car elles sont signes que nous commençons à nous conformer au Christ puissant et vulnérable.
Nous sommes en premier lieu formés comme chrétiens. Dans notre tradition, cela ne signifie pas tant nous soumettre peu à peu aux commandements, pour dompter notre nature indisciplinée, que gagner en vertu. Devenir vertueux nous rend forts, simples, libres et capables de nous tenir sur nos deux pieds. Comme l’a écrit Jean-Louis Bruguès op, la vertu est un apprentissage de l’humanité : « ce passage de la virtualité à la virtuosité » (6).
Devenir frères signifie recevoir notre force les uns des autres. Nous ne sommes pas des joueurs en solo. C’est une force qui nous libère, mais les uns avec les autres, non pas les uns des autres. En premier lieu, nous devenons forts parce que nous avons confiance les uns dans les autres. À l’origine de notre tradition se trouve l’infinie confiance de Dominique dans les frères. Il faisait confiance aux frères parce qu’il avait confiance en Dieu. Comme l’écrivit Jean d’Espagne, « Il avait une telle confiance en la bonté de Dieu qu’il envoya même prêcher des hommes ignorants en leur disant : « N’ayez crainte, le Seigneur sera avec vous et donnera force à votre bouche’« » (7).
Aussi le premier devoir de votre formateur est-il de vous donner confiance. Mais telle est aussi votre responsabilité les uns envers les autres, car le plus formateur dans les études est en général ce que l’on s’apprend réciproquement. Vous avez le pouvoir de saper un frère, de miner sa confiance, de vous moquer de lui. Et vous avez le pouvoir de redonner confiance, de vous donner réciproquement des forces, de vous former mutuellement comme prêcheurs de la puissante Parole de Dieu.
Il est dit dans nos Constitutions que « La responsabilité première de la formation personnelle incombe au candidat lui-même » (LCO 156). Nous ne devrions pas être traités en enfants incapables de prendre des décisions pour eux-mêmes. Nous devenons frères, membres égaux de la communauté, quand on nous traite en adultes mûrs. Au temps de Dominique, il n’y a pas trace du traditionnel « circator » monastique, dont la tâche consistait à fouiner partout pour voir si chacun était bien en train de faire son devoir. Mais c’est là une responsabilité que nous n’exerçons pas seuls. Si nous sommes frères, nous nous entraiderons, vers la liberté de penser, de parler, de croire, de prendre des risques, de transcender la peur. Nous oserons aussi nous remettre en question les uns les autres.
À mesure que nous devenons frères, nous trouvons la force d’affronter notre faiblesse et notre fragilité. C’est d’abord ce qu’un de mes amis appelle « la sagesse des créatures » (8). C’est savoir que nous sommes créés, que notre existence est un don, que nous sommes mortels et vivons entre la naissance et la mort. Nous nous éveillons au fait que nous ne sommes pas des dieux. Nous nous tenons sur deux pieds, ces pieds sont à nous, mais nos pieds sont un don.
Nous nous apercevons aussi que nous ne sommes pas entrés dans la communion des saints, mais dans un groupe d’hommes et de femmes faibles, irrésolus, et qui doivent constamment se remettre de leurs échecs. J’ai parlé ailleurs de ce moment de crise dans la formation d’un frère (9). Le héros aimé et admiré par le novice s’avère avoir des pieds d’argile. Mais il en a toujours été ainsi. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons pour sainte patronne de l’Ordre Marie-Madeleine, qui selon la tradition, était une femme faible et pécheresse, mais fut appelée à être le premier prêcheur de l’Évangile.
Il y a plus de cinq cents ans, Savonarole écrivait une lettre à un novice qui était de toute évidence scandalisé par les péchés des frères. Savonarole le met en garde contre ceux qui entrent dans l’Ordre en espérant entrer tout droit au paradis. Ils ne restent jamais. « Ils veulent en effet demeurer avec les saints, à l’exclusion de tous les hommes mauvais et imparfaits. Et comme ils ne trouvent pas cela, ils abandonnent leur vocation et se laissent aller à l’errance. () Mais si tu voulais fuir tous les hommes mauvais, tu devrais quitter ce monde » (10). Cette confrontation avec la fragilité est souvent un formidable moment dans la maturation d’une vocation. C’est alors que nous découvrons que nous sommes capables de donner et recevoir la miséricorde que nous demandons lors de notre entrée dans l’Ordre. Et si nous le pouvons, c’est que nous sommes en voie de devenir frère et prêcheur.
L’une des craintes qui peuvent nous freiner devant la foi en cette miséricorde, est le souci que si jamais les frères voyaient ce que nous sommes réellement, peut-être ne voteraient-ils pas leur accord à notre profession. Nous pouvons être tentés de cacher qui nous sommes tant que nous ne serons pas entrés vraiment, sains et saufs : profès et ordonnés et invulnérables. Accepter cela serait se préparer à une formation en tromperie. La formation deviendrait un exercice de dissimulation, et quel simulacre ce serait pour un Ordre dont la devise est « Veritas » ! Nous devons croire suffisamment en nos frères pour leur laisser voir qui nous sommes et ce que nous pensons. Sans cette transparence, il n’y a pas de fraternité. Cela ne signifie pas que nous devions nous lever de table pour proclamer nos péchés au réfectoire, mais nous ne pouvons créer un masque derrière lequel nous cacher. Si nous osons embrasser cette vulnérabilité, c’est que le Christ l’a fait avant nous. Elle nous prépare à prêcher une Parole digne de confiance et honnête.
La fidélité et l’amour des frères
Enfin, il y a une qualité de la fraternité assez difficile à définir, que je nommerai fidélité -pour Péguy, « le plus beau des mots ». Au coeur de notre prédication se trouve la fidélité de Dieu. Dieu nous a donné sa parole, et sa Parole est le Verbe fait chair. C’est une parole que nous pouvons croire, et qui fait de l’histoire de l’humanité une histoire qui va quelque part, au lieu d’une simple succession d’événements aléatoires. C’est la parole solide et puissante de celui qui a dit « Je suis qui je suis ». C’est une fidélité que nous devons tenter d’incarner dans notre vie. Le couple marié est un sacrement de la fidélité de Dieu, irrévocablement uni à nous dans le Christ. Cela fait aussi partie de notre prédication de l’Évangile que d’être fidèles les uns aux autres.
Qu’est-ce que cela signifie ? En premier lieu, c’est la fidélité à l’engagement que nous avons pris vis-à-vis de l’Ordre. Dieu nous a donné sa Parole, le Verbe fait chair, quoique cela conduisît à une mort insensée. Nous avons donné à Dieu notre parole, quoique notre promesse puisse sembler exiger de nous plus que ce que nous croyons possible. Je me souviens, lorsque j’étais provincial, avoir parlé avec un frère âgé venu me dire qu’il était en train de mourir d’un cancer. C’était un homme charmant et bon, qui avait traversé des moments difficiles et incertains dans sa vie dominicaine. Il me dit : « Apparemment, je vais réaliser mon ambition de mourir dans l’Ordre ». Cette ambition peut sembler maigre, mais elle est essentielle. Il avait offert sa parole et sa vie. Il se réjouissait de n’avoir pas, malgré tout, repris son don.
En second lieu, cela signifie que notre mission commune a priorité sur mon programme personnel. J’ai mes talents, mes préférences et mes rêves, mais j’ai fait don de moi à notre commune prédication de la Bonne Nouvelle. Cette mission commune peut requérir l’acceptation momentanée de charges non désirées, comme d’être syndic, Maître des novices, ou des étudiants, ou de l’Ordre, pour le bien commun. On peut trouver qu’un bus ressemble à une salle commune. Il est plein de gens assis tous ensemble, qui parlent ou lisent, partageant un espace commun. Mais quand le trajet du bus quitte la direction de mon propre voyage, je descends et continue ma route. Vais-je considérer l’Ordre davantage comme un bus, sur lequel je ne reste que tant qu’il me porte dans la direction où je veux aller ?
La fidélité implique également que je prenne position en faveur de mes frères, car leur réputation est la mienne. Dans nos Constitutions Primitives, et jusqu’à une période récente, l’un des devoirs du Maître des novices était d’enseigner à ces derniers à « soupçonner le bien » (11). L’on doit toujours donner la meilleure interprétation possible de ce que les frères ont fait ou dit. Si un frère rentre régulièrement tard la nuit, eh bien, plutôt que d’imaginer quels terribles péchés il peut avoir commis, on supposera, par exemple, qu’il est allé visiter des malades. Savonarole écrit à ce novice prompt à critiquer : « Si tu vois une chose qui te déplaît, pense qu’elle a été faite dans une bonne intention : nombreux sont les hommes intérieurement meilleurs qu’il ne paraît ». C’est bien plus qu’un optimisme naïf. Cela participe de cet amour qui voit le monde avec les yeux de Dieu : qui le voit bon. Sainte Catherine de Sienne écrivit un jour à Raymond de Capoue, le confirmant dans sa confiance en l’amour qu’elle lui portait, et lorsque nous aimons quelqu’un, nous donnons la meilleure interprétation de ce qu’il fait, confiants qu’il recherche toujours notre bien : « Au-delà de l’amour général, il y a un amour particulier qui s’exprime dans la foi. Et il s’exprime de telle manière qu’il ne saurait croire ni imaginer que l’autre pût désirer autre chose que notre bien » (12).
Si l’on condamne mon frère comme mauvais ou pas très orthodoxe, la fidélité implique que je fasse tout ce qui sera en mon pouvoir pour le soutenir et donner la meilleure interprétation possible de ses idées ou de ses actes. C’est à cause de cette fidélité mutuelle que le prologue des Constitutions de 1228 fixait pour règle, à observer « de manière inviolable et immuable, à perpétuité », que l’on ne fît jamais appel hors de l’Ordre contre les décisions prises par l’Ordre. Il devrait être, par conséquent, pratiquement inimaginable qu’un frère accuse un de ses frères ou s’en dissocie publiquement.
Cette fidélité implique non seulement que je défende mon frère, mais que je l’affronte. S’il est mon frère, je dois m’intéresser à ce qu’il pense, et oser n’être pas d’accord. Je ne peux laisser ce soin aux seuls supérieurs, comme si ce n’était pas mon problème. Mais je dois parler en face, et non dans son dos. On tremble parfois, redoutant hostilité et rejet. Mais d’après mon expérience, en précisant bien que l’on parle par l’amour de la vérité et par amour de notre frère, cette démarche conduit toujours à une amitié et à une compréhension plus profondes.
Voici donc quelques uns des éléments de la formation d’un frère : se parler et s’écouter les uns les autres ; apprendre à être fort et faible ; gagner en fidélité réciproque. Tout ceci fait partie du plus fondamental : apprendre à aimer les frères. Avec la fermeté qui caractérise souvent notre relation à l’autre, nous pourrions, dominicains, hésiter à utiliser ce langage. Il sonne peut-être sirupeux et sentimental. C’est pourtant la base première de notre fraternité. C’est ce qu’exige de nous celui qui nous appelle : « Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jean 15, 12). C’est le commandement fondamental de notre foi. Y obéir fait de nous des chrétiens et des frères. Saint Dominique disait qu’il avait appris « davantage dans le livre de la Charité que dans les livres des hommes » (13). Cela implique qu’en fin de compte, nous considérions l’autre comme un don de Dieu. Mon frère ou ma soeur peuvent bien m’agacer, je peux bien être totalement opposé à leurs opinions, mais j’apprends à goûter leur compagnie, et je vois leur valeur.
Il y a une relation fondamentale entre l’amour et la vocation. L’amour nous a amené beaucoup d’entre vous. Jésus a regardé le jeune homme riche et l’a aimé, et il l’a appelé à le suivre, de même qu’il a regardé Marie-Madeleine et l’a appelée par son nom. Étienne d’Espagne raconte ainsi qu’il alla un jour se confesser à Dominique : « il me regarda comme s’il m’aimait » (14). Plus tard ce même soir, Dominique le convoqua et le vêtit de l’habit. L’amour est, comme l’a dit Eckhart, l’hameçon du pêcheur qui attrape le poisson et ne le lâchera plus. Je dois avouer que j’ai décidé d’entrer dans l’Ordre avant d’avoir rencontré aucun dominicain, attiré par l’idéal que j’en avais lu. Peut-être est-ce aussi une bénédiction !
Il n’y a rien de sentimental dans cet amour. Il nous faut parfois y travailler, et nous efforcer de dépasser les préjugés et les différences. C’est le labeur de devenir frères. Je me souviens qu’il y avait à une époque un frère avec qui je trouvais dur de vivre. Quoique pût dire ou faire l’un de nous semblait énerver l’autre. Un soir, nous décidâmes d’aller au pub ensemble -solution typiquement anglaise. Nous avons parlé des heures, apprenant de l’autre son enfance, ses combats. Pour la première fois, j’ai pu voir à travers ses yeux et me voir tel que je devais lui apparaître. J’ai commencé à comprendre. Cela a inauguré amitié et fraternité.
« J’AI VU LE SEIGNEUR »
Marie-Madeleine va trouver ses frères et leur dit « J’ai vu le Seigneur ». Elle est le premier prêcheur de la résurrection. Elle est prêcheur parce qu’elle est capable d’entendre le Seigneur appeler, et de partager la bonne nouvelle de la victoire du Christ sur la mort.
Devenir prêcheur est donc bien plus qu’apprendre un certain nombre d’informations, pour avoir quelque chose à dire, et quelques techniques de prédication, pour savoir comment le dire. C’est être formé à pouvoir entendre le Seigneur, et prononcer une parole porteuse de vie. Isaïe dit : « Le Seigneur m’a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a abrité à l’ombre de sa main » (49, 1b-2a). La vie entière d’Isaïe, depuis son tout début, l’a façonné et préparé à dire une parole prophétique.
L’Ordre doit vous offrir davantage qu’une formation théologique : une vie qui fait de vous un prêcheur. Notre vie commune, la prière, les expériences pastorales, les combats et les échecs, nous rendront capables d’écouter et de proclamer, par des voies que nous ne saurions prévoir.
L’un de mes prédécesseurs en tant que provincial d’Angleterre était le fr. Anthony Ross. Il était célèbre comme prêcheur, historien, réformateur des prisons, et aussi comme lutteur ! Un jour, peu après son élection, une attaque cérébrale le réduisit quasiment au silence. Il dut donner sa démission de provincial et réapprendre à parler. Les quelques mots qu’il réussissait à prononcer étaient plus puissants que tout ce qu’il avait pu dire avant. On venait se confesser à lui, entendre ses paroles simples et apaisantes. Ses homélies d’une demi-douzaine de mots pouvaient changer la vie des gens. C’était comme si cette souffrance et ce silence avaient formé un prêcheur capable de nous donner des paroles plus vivifiantes que jamais. Je suis allé le voir avant de partir pour le chapitre général de Mexico -d’où, à ma grande surprise, je ne suis pas revenu à ma province. Son dernier mot avant mon départ fut « Courage ». Ce type de parole est le plus grand don que l’on puisse faire à un frère.
Une parole pleine de compassion
Marie-Madeleine annonce aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ». Ce n’est pas le simple constat d’un fait, mais le partage d’une découverte. Elle a partagé leur perte, leur égarement, leur peine, et elle peut donc maintenant partager avec eux sa rencontre avec le Seigneur ressuscité. Elle peut partager la bonne nouvelle avec eux parce que c’est une bonne nouvelle pour elle.
Ce Verbe que nous prêchons est celui qui a partagé notre humanité, et n’est « pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d’une manière semblable, à l’exception du péché » (Hébreux 4, 15). Pour prêcher nous devons nous incarner dans des mondes différents, que ce soit la culture de la jeunesse contemporaine, ou une île de Micronésie, le monde des drogués ou celui des directeurs commerciaux. Il nous faut pénétrer dans un monde, apprendre son langage, voir à travers les yeux de ses habitants, entrer dans leur peau, comprendre leurs faiblesses et leurs espoirs. En un sens, devenir eux. Alors, nous pouvons prononcer une parole qui soit une bonne nouvelle pour eux et pour nous. Cela ne signifie pas que nous devions être d’accord avec eux. Souvent, il nous faudra les mettre à l’épreuve. Mais pour cela nous devons d’abord sentir battre le coeur de leur humanité.
La tradition dans l’Église est de glorifier le Seigneur à l’aube. Nous persistons à être des veilleurs guettant l’aurore, pour pouvoir partager notre espérance avec ceux qui ne voient pas trace de soleil levant. C’est parce que j’ai de quelque manière entrevu leurs ténèbres, et peut-être pour les avoir traversées moi-même, que je peux partager avec eux les mots évoquant « la bonté du coeur de notre Dieu, qui vient nous visiter comme l’aube venue d’en haut » (Luc 1, 78).
Souvent, nous pouvons le faire grâce à ce que nous sommes et avons vécu. Marie-Madeleine a cherché le corps du Seigneur avec la tendresse apprise au cours d’une vie marquée, nous dit la tradition, par ses propres échecs et péchés. C’est cette vie qui l’a préparée à être celle qui cherche l’homme qu’elle aimait et le reconnaît lorsqu’il l’appelle par son nom. L’un des plus précieux dons que vous apportiez à l’Ordre est votre vie, avec ses échecs, ses difficultés, ses moments noirs. Après coup, je peux même considérer un péché comme une felix culpa : il m’a préparé à prononcer une parole pleine de compassion et d’espérance pour d’autres qui vivent la même déroute. Je peux partager avec eux le lever du soleil.
Dans d’autres domaines, nous avons besoin d’une formation à la compassion, d’une éducation du coeur et de l’esprit qui brise en nous tout ce qui a un coeur de pierre, pharisaïque, arrogant et critique. L’une des choses les plus utiles que j’aie faites durant mon noviciat plutôt inhabituel, était de visiter régulièrement en prison les auteurs de délits sexuels. Ce sont peut-être les personnes les plus méprisées de notre société. La révélation fut qu’en réalité, nous n’étions pas différents d’eux. Nous pouvons écouter l’Évangile ensemble. Ainsi notre formation devrait-elle faire céder nos défenses contre ceux qui sont différents, et peu sympathiques, ceux que notre société méprise : les mendiants, les prostituées, les criminels, le type de personnes avec qui le Verbe de Dieu passait son temps. Nous apprenons à recevoir les dons qu’ils ont à nous offrir, si nos mains sont ouvertes.
Le prêcheur idéal est celui qui est toute chose pour tous les êtres humains, parfaitement humain. Aucun dominicain de ma connaissance n’est ainsi, et nous serons confrontés à nos limites. Pendant des années, je suis allé une nuit par semaine dans un refuge de sans-abri à Oxford, préparer la soupe et discuter. Mais je dois avouer que je l’appréhendais. Je détestais l’odeur, et les conversations d’ivrognes m’ennuyaient ; je savais que ma soupe n’était pas une grande réussite, et j’avais hâte de rentrer lire. Pourtant je ne regrette pas ces heures. Le mur entre mes frères et soeurs de la rue et moi en a peut-être été quelque peu ébranlé.
La compassion remodèlera notre vie comme jamais nous ne l’aurions pensé. étudiant à Palencia, saint Dominique se laissa émouvoir de compassion pour les affamés, et vendit ses livres. Il ne demeura dans le sud de la France et ne fonda l’Ordre que parce qu’il était bouleversé par la situation désespérée de ceux qui s’étaient embarqués dans une hérésie destructrice. Toute sa vie fut modelée par la réponse à des situations qu’il n’avait pas prévues. Cet homme miséricordieux était à la merci des autres, vulnérable à leurs besoins. Apprendre la compassion nous arrachera des mains le strict contrôle de notre vie.
Une parole de vie
« J’ai vu le Seigneur ». C’est plus que le compte rendu d’un événement. Marie-Madeleine partage avec ses frères le triomphe de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. C’est une parole qui apporte l’aube dont elle fut le témoin « très tôt le matin ».
Catherine de Sienne dit à Raymond de Capoue que nous devons préférer « faire à défaire ou abîmer » (15). Nous devenons prêcheurs grâce à nos conversations ordinaires avec les autres, aux mots échangés dans la salle commune et les couloirs. Ce qui nous fait découvrir comment partager une parole de vie dans notre prédication, c’est devenir des frères qui s’apportent mutuellement des mots d’espoir, d’encouragement, des mots qui construisent et guérissent. Si nous proposons habituellement aux autres des mots qui blessent, minent, qui abattent et détruisent, tout intelligents et savants que nous soyons, nous ne serons jamais des prêcheurs.
Le dicton polonais « Wystygl mistyk ; wynik cynik » signifie : « Le mystique s’est refroidi, un cynique est apparu ». Quant à nous, nous pouvons bien être des « chiens du Seigneur », mais nous ne saurions être cyniques (16).
Le verbe du prêcheur est fertile. Il fructifie. Quand Marie-Madeleine rencontre Jésus, elle le prend pour le jardinier. Et elle ne se trompe pas, car Jésus est le nouvel Adam au jardin de la vie, où la mort est vaincue et l’arbre mort de la croix porte des fruits. Aussi les alliés naturels du prêcheur dans notre société sont-ils les créateurs. Qui s’efforce de donner du sens à l’expérience contemporaine ? Qui sont les penseurs, les philosophes, les poètes et les artistes, qui peuvent aujourd’hui nous apprendre une parole créative ? Eux aussi aideront à faire de nous des prêcheurs.
Une parole reçue
Comment trouver cette parole miséricordieuse et créative ? J’ai avoué au début de cette lettre qu’à mon entrée dans l’Ordre, je craignais de ne jamais savoir prêcher. Cette peur est encore souvent là. Aveu embarrassant pour un dominicain, quand on me demande de prêcher, ma première réaction est encore souvent : « Mais je n’ai rien à dire ». Mais ce qui doit être dit sera donné, même si c’est parfois au dernier moment. Pour recevoir la parole donnée, nous devons apprendre l’art du silence. Dans l’étude et dans la prière, nous apprenons à rester silencieux, attentifs, afin de pouvoir recevoir du Seigneur ce qu’Il nous donne à partager : « Pour moi, en effet, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis » (1 Co 11, 23).
Garder le silence est pour beaucoup la partie la plus difficile de la formation. Pascal écrivait : « J’ai découvert que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre » (17). En fin de compte, le prêcheur doit aimer « les plaisirs de la solitude » car c’est alors que nous recevons les dons. Nous devons nous clouer à notre chaise, non dans le but de maîtriser la connaissance, mais pour être vigilant et prompt lorsqu’elle arrivera à l’improviste, comme un voleur dans la nuit. À la fin, peut-être nous mettrons-nous à aimer en ce silence le centre le plus profond de notre vie dominicaine. C’est le temps des dons, dans la prière comme dans l’étude.
Il exige de la discipline. « En vérité tu es un dieu qui se cache » (Is 45, 15). Pour déceler la venue de Dieu, nous avons besoin d’oreilles fines, comme celles du chasseur. Eckhart demande : « Où est ce Dieu, que cherchent toutes les créatures, et dont elles tiennent leur être et leur vie ? Un homme qui se cache, et en toussant se trahit, tel est Dieu. Nul ne saurait découvrir Dieu si lui-même ne se révèle ». Mais Dieu est là, qui tousse discrètement, distribuant de petits indices à qui sait entendre, si on se tait. Souvent, plus avant dans votre vie dominicaine, vous serez débordé par les exigences qui mangeront votre temps. C’est maintenant qu’il faut prendre l’habitude d’un silence régulier en présence de Dieu, à laquelle vous accrocher toute la vie. Elle peut faire la différence entre un simple survivant et un dominicain épanoui.
On entre souvent dans l’Ordre avec un enthousiasme tout neuf pour le partage de la bonne nouvelle de Jésus Christ. On voudrait immédiatement se précipiter dans la rue, prendre le pupitre d’assaut, partager avec le monde sa découverte de l’Évangile. Ça peut être frustrant d’entrer dans l’Ordre des Prêcheurs pour s’apercevoir que pendant des années, on sera tenus à des heures d’étude ennuyeuse, à la lecture de livres arides dont les auteurs sont morts. On brûle d’aller par les routes, prêcher l’Évangile, ou d’être envoyé dans les missions. Peut-être ressemblons-nous à ces jeunes hommes dont parlait Dostoïevski dans Les Frères Karamasov, « qui ne comprennent pas que le sacrifice de sa vie est dans la plupart des cas peut-être le plus facile de tous, et que sacrifier, par exemple, cinq ou six ans de sa vie, pleine de juvénile ferveur, à de pénibles et difficiles études, ne fût-ce que pour multiplier par dix ses capacités de servir la vérité, et être en mesure de mener la grande oeuvre pour laquelle on a préparé son coeur -qu’un tel sacrifice est pratiquement au-delà des forces de beaucoup d’entre eux ».
Il est vrai que dès le début, nous trouvons des moyens de partager la bonne nouvelle, mais le patient apprentissage du silence est inévitable si vous voulons communiquer davantage que notre seul enthousiasme personnel. La mémoire de Dominique était «une sorte de grange pour Dieu, pleine à foison de toutes sortes de récoltes » (18). Il nous faut les années d’étude pour emplir cette grange. Il est vrai que Matthieu 10, 19 nous dit que nous ne devons pas chercher à l’avance ce que nous allons dire, mais Humbert de Romans apprend aux frères en formation que ce texte ne s’applique qu’aux apôtres ! (19)
Une parole que l’on partage
Il y a un an, je marchais dans les ruelles d’Hô Chi Minh-Ville, au Viêt-nam, quand je suis tombé sur une petite place, dominée par une statue de saint Vincent Ferrier. Élevé sur son piédestal, il semblait le prêcheur modèle, harangueur solitaire dressé au-dessus de la foule. On peut souhaiter être ce type de prêcheur, vedette singulière, centre d’attention et d’admiration.
La parole du prêcheur ne lui appartient pas. C’est une parole que nous recevons non seulement dans le silence de la prière et de l’étude, mais les uns des autres. Ainsi dans une communauté de prêcheurs devrait-on partager les plus intimes convictions, comme Marie-Madeleine partagea avec ses frères sa foi dans le Seigneur ressuscité. Au Conseil généralice, nous nous réunissons tous les mercredis pour lire ensemble l’Évangile. Nos homélies sont le fruit de notre réflexion commune. Les conceptions modernes de ce qu’est un auteur risquent de nous rendre possessifs vis-à-vis de nos idées, et nous pouvons penser qu’un frère qui les utilise commet un vol. Mais ce sont les riches qui croient fermement dans la propriété privée. Nous partageons ce que nous avons reçu et en tant que frères mendiants, nous ne devrions pas avoir honte de quêter une idée auprès de quelqu’un d’autre.
Notre formation doit aussi nous préparer à prêcher ensemble, dans une commune mission. Jésus a dépêché les disciples deux par deux. Il est tentant de proclamer sien un apostolat, et de le garder jalousement des autres frères. Ma responsabilité, mon affaire, ma gloire. En agissant ainsi, je risque bien de ne prêcher que moi-même. Humbert de Romans nous invite à nous méfier de ceux « qui se rendent compte que la prédication est une tâche particulièrement belle, et n’ont plus qu’elle en tête parce qu’ils veulent être importants » (20). En cédant à cette tentation, nous pourrions finir par penser que c’est nous, la bonne nouvelle dont tout le monde a soif. Le meilleur cours que j’aie jamais donné fut un enseignement de doctrine à Oxford, avec deux autres frères. Nous préparions le cours ensemble, et allions écouter les conférences de chacun des autres. Nous essayions d’enseigner en faisant participer les étudiants à nos discussions. L’idée était qu’en entrant dans notre conversation, ils pouvaient s’y trouver une voix, au lieu d’être les bénéficiaires passifs d’une instruction.
Chaque frère parle pour la communauté entière. On en trouve l’exemple le plus célèbre aux débuts de la conquête des Amériques. Alors qu’Antonio de Montesinos prêchait contre les injustices perpétrées contre les Indiens, les autorités de la ville allèrent le dénoncer au prieur. Mais le prieur répondit que lorsque Antonio prêchait, c’est toute la communauté qui parlait.
Tout ceci va à l’encontre de l’individualisme caractéristique des temps modernes et souvent aussi des dominicains. En effet, l’individualisme est souvent revendiqué avec quelque fierté comme une caractéristique typiquement dominicaine. Il est vrai que nous avons une tradition qui chérit la liberté et l’unicité des dons de chaque frère. Grâces en soient rendues à Dieu. Planifier des projets communs dans l’Ordre peut être un cauchemar. Mais nous sommes des frères prêcheurs et les plus grands de nos frères, quoique souvent représentés seuls, travaillaient à la mission commune : Fra Angelico n’était pas un artiste solitaire, mais formait des frères à ses talents ; sainte Catherine était entourée de frères et de soeurs ; Bartolomé de Las Casas oeuvra avec ses frères de Salamanque à défendre les droits des Indiens. Congar et Chenu se sont développés au sein d’une communauté de théologiens. Même saint Thomas avait besoin d’une équipe de frères pour transcrire ses paroles.
Aussi notre formation doit-elle nous libérer des effets débilitants de l’individualisme contemporain, et faire de nous des frères prêcheurs. Nous serons bien plus authentiquement individuels et forts si nous osons cette libération. Dans certaines régions du monde, plus affectées par cet individualisme, c’est peut-être le grand défi de votre génération : inventer et promouvoir de nouvelles manières de prêcher ensemble l’Évangile. Voilà ce que vous pouvez faire. Les jeunes en formation sont nombreux, un frère sur six, et plus d’un millier de novices cette année pour les moniales et les soeurs. Ensemble, vous pouvez faire plus que nous ne l’imaginons encore.
CONCLUSION
En 1217, peu après la fondation de l’Ordre, saint Dominique dispersa les frères parce que « le grain entassé pourrit ». Il les envoya sur les routes sans argent, comme les apôtres. Mais un frère, Jean de Navarre, refusa de partir pour Paris sans un sou en poche. Ils discutèrent, et à la fin, Dominique céda et lui donna quelque chose. L’incident en scandalisa plus d’un, mais il est peut-être une bonne image de notre formation. Je ne dis pas que vos formateurs doivent céder à chacune de vos requêtes, mais que notre formation doit être à la fois exigeante et miséricordieuse, idéaliste et réaliste. Dominique invite Jean à la confiance, non pas une arrogante confiance en soi, mais la confiance dans le Seigneur qui pourvoira à tout durant le voyage, et la confiance dans son frère qui l’envoie sur les routes. Lorsqu’il constate qu’il n’en est pas encore là, il se montre miséricordieux.
Je prie pour que votre formation vous aide à croître dans la confiance et la joie de Dominique. L’Ordre a besoin de jeunes hommes et femmes courageux et joyeux, pour aider à le fonder dans de nouveaux lieux, le refonder ailleurs, et à développer de nouvelles manières de prêcher l’Évangile. Il se peut que parfois, comme le frère Jean, votre confiance faiblisse, que vous doutiez de vos forces pour le voyage, ou même s’il vaut la peine de l’entreprendre. Que ces moments de ténèbres et d’incertitude participent à votre développement de chrétien, de prêcheur, de frère, de soeur. Quand vous vous sentirez perdu et mal assuré, puissiez-vous entendre une voix, étonnamment proche, vous dire « Qui cherches-tu ?
Votre frère en saint Dominique,
Frère Timothy Radcliffe, o.p.
Maître de l’Ordre des Prêcheurs
Notes
1 M. Walshe, Meister Eckhart, Vol. 1, Londres, p. 46-47.
2. Simon Tugwell, « Dominican Spirituality » in Compendium of Spirituality, éd. E. De Cea OP, New York, 1996, p. 144.
3. Encounter with Martin Buber, Aubrey Hodes, Londres, 1972, p. 217.
4. The Dominicans, Collegeville, 1990, p. 236.
5. Theodore Zeldon, An Intimate History of Humanity, Londres, 1994, p. 49.
6. Les idées heureuses, Paris, 1996, p. 24.
7. Procès pour sa canonisation à Bologne, 26.
8. Rowan Williams, Open to Judgement, Londres, 1994, p. 248.
9. La promesse de vie, 2.4.
10. Lettre à Stefano Codiponte, 22 mai 1492.
11. Simon Tugwell, op. cit., p. 145.
12. Mary O’Driscoll OP, Catherine of Sienna : Passion for the truth, Compassion for Humanity, New City, 1993, p. 48.
13. Gérald de Frachet, 82.
14. Témoignage d’Étienne d’Espagne au procès pour la canonisation de saint Dominique.
15. Mary O’Driscoll op, op. cit., p. 48.
16. Vous voudrez bien pardonner ce petit jeu de mots, et vous reporter à l’étymologie de « cynique ».
17. Pensées, n° 205.
18. Jourdain de Saxe, Libellus, 7.
19. « Treatise on the Formation of Preachers » in Early Dominicans : Selected Writings, trad. Simon Tugwell op, ibid., p. 205.
20. Early Dominicans, op. cit., p. 236.
Glorifier, bénir, prêcher (Assemblée de Manille) (2000)
La mission de la Famille dominicaine (MANILLE 2000)
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 Quand on m’a demandé de parler à l’Assemblée de la Famille dominicaine, je me suis enthousiasmé. Je suis persuadé que si nous réussissons à partager une prédication commune de l’Évangile, elle renouvellera l’Ordre tout entier. Mais je me suis aussi senti peu compétent. Qui suis-je pour exprimer une vision de cette mission commune ?
Quand on m’a demandé de parler à l’Assemblée de la Famille dominicaine, je me suis enthousiasmé. Je suis persuadé que si nous réussissons à partager une prédication commune de l’Évangile, elle renouvellera l’Ordre tout entier. Mais je me suis aussi senti peu compétent. Qui suis-je pour exprimer une vision de cette mission commune ?
Comment quiconque, frère, soeur, moniale ou laïc dominicain pourrait-il le faire seul ? C’est ensemble, en s’écoutant les uns les autres, qu’il nous faut découvrir cette nouvelle vision, et c’est pourquoi nous sommes ici à Manille. Aussi ai-je pensé qu’il convenait d’écouter avec vous la Parole de Dieu. Toute prédication commence par l’écoute commune de l’Évangile. Comme nous sommes prêcheurs de la Résurrection, j’ai choisi le texte du Christ Ressuscité apparaissant aux disciples, dans l’Évangile selon saint Jean.
Le soir, ce même jour, te premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de Joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez lespéchés, ils leur seront remis : ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». Jean 20, 19-23.
Cette scène semble fort éloignée de notre rencontre de la Famille dominicaine, d’un côté vous avez un petit groupe de disciples, barricadés dans une chambre haute par peur de sortir. Et de l’autre côté, nous voici, à 9.000 kilomètres de là et près de 2.000 ans plus tard, dans cette grande salle de conférence. Ils étaient un petit groupe de Juifs, et nous sommes ici 160 personnes de 58 nationalités différentes, avec nos frères et soeurs de la Famille dominicaine des Philippines. Eux n’osaient pas quitter la pièce, alors que nous sommes venus de tous les coins de la planète.
Et pourtant, de bien des façons, nous sommes exactement comme eux. Leur histoire, c’est la nôtre. Nous aussi sommes enfermés dans nos petites chambres ; nous aussi sommes prisonniers de nos peurs. Le Christ Ressuscité vient aussi à nous, ouvrir tout grand les portes et nous envoyer sur les chemins. Nous aussi découvrirons qui nous sommes et quelle est notre mission de Famille dominicaine, non pas en fixant notre nombril, mais par la rencontre du Christ Ressuscité. A nous aussi, il vient dire : « Paix à vous », et il nous envoie prêcher le pardon et la réconciliation. C’est pourquoi je voudrais réfléchir à cette histoire, trouver ce qu’elle dit de notre mission commune. Il pourrait sembler absurde de comparer le renouveau de la Famille dominicaine à la Résurrection des morts. Mais pour les chrétiens, une vie nouvelle est toujours un partage de cette victoire. Saint Paul nous appelle à mourir et ressusciter avec le Christ chaque jour. Même les plus infimes défaites et victoires se modèlent sur ces trois jours, du Vendredi Saint au Dimanche de Pâques.
Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes. Là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, …
Les disciples se sont enfermés dans une chambre haute. C’est un moment d’attente, entre deux vies. Les femmes proclament qu’elles ont rencontré le Seigneur Ressuscité, mais les hommes ne l’ont pas vu. Comme d’habitude, les hommes sont un peu lents ! Ils n’ont vu qu’un tombeau vide, mais qu’est-ce que ça veut dire ? Leur ancienne existence auprès de Jésus est terminée : le temps où ils cheminaient avec lui vers Jérusalem, écoutant ses paraboles et partageant sa vie. Mais la nouvelle vie, la vie d’après la Résurrection, n’a pas encore commencé. Ils ont bien entendu dire que Jésus est ressuscité, mais ils ne l’ont pas vu de leurs yeux. Alors ils attendent ou bien retournent à leurs activités passées et vont pêcher des poissons. C’est un moment de transition.
Modestement, la Famille dominicaine vit actuellement un moment identique, dès le début, Dominique a rassemblé une famille de prêcheurs, hommes et femmes, laïcs et religieux, contemplatifs et prêcheurs, qui sont partis sur les routes. Il y a à Ste-Sabine des inscriptions anciennes mentionnant la Famille dominicaine. Elle a toujours fait partie de ce que nous sommes. Mais nous proclamons aujourd’hui qu’il se passe quelque chose de nouveau. Partout dans le monde, les soeurs et les laïcs dominicains clament leur identité de prêcheurs. Les Actes des chapitres généraux des frères disent que nous sommes à un nouveau moment de notre histoire.
Nous proclamons que tous les membres de la Famille dominicaine sont égaux et que nous partageons une mission commune. On trouve nombre de beaux documents. Mais certains d’entre nous sont comme les disciples. Nous n’avons pas encore vu beaucoup de signes de ce changement. La plupart des choses ont l’air de continuer à peu près comme avant. De formidables récits d’une nouvelle coopération circulent, mais on dirait que ça se passe toujours ailleurs, jamais là où nous sommes ! Alors on peut faire comme les disciples dans la chambre haute : attendre, avec espoir, mais incertitude.
C’est un peu l’expérience de toute l’Église actuellement. Nous avons des documents magnifiques du Concile Vatican II, qui proclament la dignité de la vocation laïque. Des déclarations sur la place des femmes dans la vie et la mission de l’Église. Nous avons une nouvelle vision de l’Église, comme Peuple pèlerin de Dieu. Et pourtant on a parfois le sentiment que pas grand chose n’a changé. De fait, il arrive même que l’Église semble encore plus cléricale qu’avant. Aussi est-ce pour de nombreux catholiques un moment de sentiments mêlés : espoir et déception, renouveau et frustration, joie et colère.
Et puis il y a la peur. C’est la peur qui bloque les disciples dans leur chambre haute. De quoi avons-nous peur ? Quelles sont ces peurs qui nous coincent dans un petit espace, peu enclins à tenter du nouveau ? II faut oser regarder en face les peurs qui nous enferment et nous empêchent de nous lancer corps et âme dans la mission de la Famille dominicaine. Peut-être craignons-nous de perdre la tradition distinctive de notre congrégation, avec son fondateur, son histoire unique, ses histoires particulières. Peut-être redoutons-nous d’essayer quelque chose de nouveau et d’échouer. Les frères appréhendent parfois de travailler avec des femmes, même leurs soeurs ! Les soeurs appréhendent parfois de travailler avec des hommes, même leurs frères ! Mieux vaut poursuivre ce que nous avons toujours fait : c’est plus sûr. Continuons donc à pêcher des poissons.
Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : « Paix à vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur.
C’est la vue des blessures du Christ qui libère les disciples de la peur et les remplit de joie. C’est le Christ blessé qui les transforme en prêcheurs.
Il n’y a de prêcheur que blessé. Le Verbe s’est fait chair, il a été blessé, il a été tué. Il était impuissant face aux pouvoirs de ce monde. Il a osé être vulnérable à ce que ces pouvoirs pouvaient lui causer. Si nous sommes prêcheurs de cette même Parole, nous serons blessés aussi. Au coeur de la prédication de sainte Catherine de Sienne, il y avait sa vision du Christ blessé, elle avait reçu ses blessures en partage.
Peut-être souffrirons-nous de blessures légères, la dérision, ne pas être pris au sérieux. Ou nous serons torturés, comme notre frère Tito de Alencar au Brésil, tués, comme Pierre Claverie en Algérie et Joaquin Bernardo en Albanie, comme nos quatre sœurs du Zimbabwe dans les années soixante-dix. La vision du Christ blessé mais vivant peut nous libérer de notre peur d’être blessés. Nous pouvons courir ce risque, car ni les blessures ni la mort n’auront le dessus.
La vue de ce Christ blessé nous permet de regarder en face le fait que nous sommes déjà blessés. Peut-être par notre enfance, pour avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle, ou par notre expérience de la vie religieuse, par des tentatives amoureuses avortées, par des conflits idéologiques au sein de l’Eglise, par le péché. Chacun de nous est un prêcheur blessé. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes prêcheurs parce que nous sommes blessés, Gerald Vann, dominicain anglais, est l’un des plus célèbres auteurs de spiritualité du monde anglophone d’après la Seconde guerre Mondiale. Toute sa vie, il a lutté contre l’alcoolisme et la dépression ; c’est pour cela qu’il avait quelque chose à dire. Nous trouvons des paroles d’espoir et de miséricorde parce que nous en avons eu besoin nous-mêmes. J’ai dans ma bibliothèque le livre d’un vieux dominicain français : « Les Cicatrices ». L’auteur y raconte comment il est venu au Christ à travers les blessures de sa vie. En me l’offrant, il l’avait dédicacé ainsi : « A Timothy, qui sait que les cicatrices peuvent devenir les portes du soleil ». Chacune de nos blessures peut devenir la porte d’un soleil levant. Un frère suggérait que je vous montre mes blessures. Mais je crois que vous devrez attendre mes mémoires !
Le plus douloureux pour les disciples, c’est qu’ils contemplent le Jésus qu’eux- mêmes ont blessé. Ils l’ont renié, abandonné, fui. Ils lui ont fait mal. Jésus ne les accuse pas, il leur montre simplement ses blessures. Nous devons accepter que nous aussi blessons les autres. Bien souvent j’ai vu les frères blesser involontairement d’autres membres de la Famille dominicaine, d’un mot condescendant, en n’arrivant pas à traiter les femmes ou les laïcs comme leurs égaux. Mais ça n’arrive pas qu’aux frères : nous avons tous le pouvoir de blesser : le pouvoir de dire des mots qui font mal, le pouvoir des prêtres sur les laïcs, des hommes sur les femmes et des femmes sur les hommes, des religieux sur les laïcs, des supérieurs sur les membres de leur communauté, des riches sur les pauvres, des confiants sur les anxieux.
On peut oser voir tes blessures infligées et les blessures reçues, et cependant se remplir de joie, car le Christ est ressuscité d’entre les morts. Nous boitillons peut-être sur un pied mais le Seigneur nous rend heureux. Telle était la joie de Dominique, sans laquelle il n’y a pas de prédication de la bonne nouvelle. Cette année, une équipe de la télévision française est venue passer quelques jours à Ste-Sabine pour réaliser un documentaire. A la fin, le réalisateur m’a dit : « C’est très bizarre. Dans cette communauté, vous parlez de choses sérieuses, et pourtant, vous riez sans Arrêt ». Nous sommes de joyeux prêcheurs blessés.
Il leur dit alors, de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ».
Jésus envoie les disciples loin de la sécurité d’une chambre close. Cet envoi est le début de la prédication. Être prêcheur, c’est être envoyé par Dieu, mais nous ne sommes pas tous envoyés de la même manière. Pour les frères et les soeurs, c’est souvent, littéralement, être envoyé ailleurs. Mes frères m’ont envoyé à Rome. Ce que j’espère, c’est qu’avec l’évolution du mouvement des volontaires, nous verrons bientôt des laïcs envoyés dans d’autres régions du monde, pour partager notre prédication : des Boliviens aux Philippines, et des Philippins en France. Pour beaucoup d’entre nous, être envoyé implique d’être prêt à faire ses bagages et partir. Je me souviens d’un vieux frère me disant qu’on ne devrait jamais posséder plus qu’on ne peut porter dans ses deux mains. Combien de nous en sont capables ?
Mais pour de nombreux membres de la Famille dominicaine, être envoyé ne signifie pas voyager. Les moniales sont membres d’un monastère et en général, elles y resteront toute leur vie. De nombreux laïcs dominicains sont mariés, ont un emploi… ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas tout bonnement se lever et partir. Être envoyé signifie donc davantage qu’une mobilité physique. Cela signifie venir de bien. C’est notre être même. Jésus est « l’apôtre », l’envoyé (He 3, l). Il est l’envoyé de Dieu, mais cela ne veut pas dire que Jésus a quitté les d’eux pour un autre endroit appelé terre. Son existence même est de venir du Père. L’envoyé, voilà qui il est, maintenant et pour toujours !
Être prêcheur signifie que chacun de nous est envoyé par Dieu à ceux qu’il rencontre. La femme est envoyée à son mari et le mari à sa femme. Chacun est une parole de Dieu pour l’autre. La moniale ne peut peut-être pas quitter son monastère, mais elle est tout aussi envoyée que n’importe quel frère. Elle est envoyée à ses soeurs, et le monastère tout entier est une parole de dieu qui nous est envoyée. Parfois, nous acceptons notre mission en demeurant là où nous sommes et en y étant une parole de vie.
Une des fraternités laïques que je préfère se trouve dans la prison de Norfolk, Massachusetts, aux USA. Les membres de cette fraternité ne peuvent aller nulle part. S’ils essayaient, on les en empêcherait par la force. Mais ce sont des prêcheurs, dans cette prison, envoyés pour être une parole d’espoir dans un lieu de souffrance. Ils sont envoyés pour être prêcheurs là où la plupart d’entre nous ne peuvent pas aller.
Mais Jésus n’envoie pas seulement les disciples hors de leur chambre close ; il les rassemble aussi en une communauté. Il les envoie aux confins de la terre, et leur ordonne de ne faire qu’un, de même que lui et son Père ne font qu’un. Ils sont unis dans la communauté et dispersés dans la mission. Je crois que ce paradoxe est au coeur de la vie dominicaine. Quand Dominique reçut du pape la Bulle confirmant l’Ordre, il retourna à sa petite communauté de Toulouse et dispersa les frères. A peine la communauté était-elle fondée, que déjà, elle était séparée. Les frères n’avaient pas du tout envie de partir, mais pour une fois, Dominique insista.
Pour Dominique, l’Ordre disperse les frères, et les rassemble dans l’unité. Nous sommes envoyés prêcher au loin, mais nous ne faisons qu’un parce que nous prêchons le Royaume unique de Dieu, où l’humanité entière est appelée. Comme l’écrit saint Paul, nous prêchons : « II n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit, comme il n’y a qu’une espérance au terme de l’appel que vous avez reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous… » (Éphésiens 4, 4). Nous ne pouvons à la fois prêcher le Royaume de Dieu et être divisés. C’est pourquoi nous avons toujours lutté pour ne pas nous diviser en des Ordres séparés. Ça n’a parfois tenu qu’à un fil !
Aussi est-ce pour les frères, depuis le début, la palpitation même de la vie que d’être envoyés au loin et rassemblés en retour dans l’unité. C’est la respiration de l’Ordre. Et le génie de Dominique fut de doter cette respiration de solides poumons : notre forme démocratique de gouvernement. Le gouvernement n’est pas un simple type d’administration. Il incarne une spiritualité de la mission. C’est le poumon qui nous souffle vers la mission et nous ré inspire dans la communauté.
Les premiers siècles, il y avait un chapitre général par an. Chaque année, les frères se réunissaient à Bologne ou Paris, et repartaient vers de nouvelles missions. Tout au long de l’année, il y avait des frères sur les routes, marchant vers Bologne, ou vers Paris, pour se réunir en chapitre, puis repartir vers de nouveaux lieux de mission exotiques, l’Angleterre par exemple !
La Famille dominicaine a différentes manières d’être envoyée. Comment ne faire qu’un ? Quelle forme prendra notre communion ? Où sont les poumons qui nous soufflent vers l’extérieur et nous inspirent à nouveau tous ensemble ? Nous ne sommes qu’au tout début de cette réflexion. Les monastères ressentent profondément leur appartenance à un Ordre unique, et pourtant, chaque monastère a sa propre, précieuse, autonomie. Pour beaucoup de branches de la Famille, jamais l’unité n’a été si importante. De nombreuses congrégations de soeurs sont nées d’un processus de fission, comme une division cellulaire. L’unité juridique n’était pas importante pour nos soeurs. Avec DSI (Soeurs Dominicaines Internationales), les soeurs ont commencé à trouver comment 160 congrégations peuvent coopérer et obtenir l’unité. Pour le moment, il n’y a pas de structure mondiale rassemblant les laïcs dominicains. Je crois qu’il faut commencer par trouver notre unité dans la mission.
Nous sommes envoyés de par le monde, ensemble, prêcher le Royaume unique où se réconcilie toute l’humanité. Nous découvrirons notre unité à mesure que nous partirons ensemble. Nous aurons besoin de nouvelles structures pour construire une mission commune. Déjà, ces structures commencent à émerger. Le chapitre général de Bologne, il y a deux ans, encourageait la Famille dominicaine d’un même lieu à se rencontrer et à planifier une mission commune. A Mexico ou à Paris, par exemple, la Famille entière peut se réunir pour décider de sa mission commune sur place.
Au niveau international, le conseil généralice des frères se réunit régulièrement avec l’équipe de coordination des USI pour partager leurs préoccupations respectives. Lorsque nous fondons l’Ordre dans de nouveaux lieux, nous devrions essayer dès le début de planifier la nouvelle présence comme une initiative de toute la Famille dominicaine. Pour notre rencontre actuelle, l’objectif n’est pas d’établir de nouvelles structures juridiques. Nous n’avons pas autorité pour le faire. A l’avenir, nous pouvons découvrir ensemble quelles structures serviront le mieux cette unité. Aujourd’hui nous avons la tâche bien plus fondamentale et importante de découvrir une vision commune de la mission. C’est le premier pas vers l’unité. Aussi, retournons à l’apparition du Christ Ressuscité, et voyons quelle vision de la mission nous y trouvons.
Jésus dit aux disciples : « Je vous envoie. »
II donne aux disciples autorité pour parler. Le prêcheur ne communique pas simplement de l’information. Nous avons autorité pour parler. Si nous voulons tous proclamer notre identité de prêcheur, nous devons reconnaître l’autorité de chacun pour prêcher l’Évangile.
En premier lieu, nous avons tous autorité pour prêcher parce que nous sommes baptisés. C’est ce qu’enseigne clairement l’Eglise dans Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio et Christifideles Laici. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, et devons donc le proclamer. Chacun de nous détient aussi une autorité unique, par ce qu’il est et les dons qu’il a reçus. Chacun de nous a une parole à proclamer, qui n’est donnée à nul autre. Dieu est dans notre vie d’époux, d’épouse de célibataire, de parent, d’enfant.
De ces expériences humaines de l’amour, ses triomphes et ses échecs, nous avons quelque chose à dire sur le Dieu qui est amour. Nous tenons aussi notre autorité de nos compétences et de nos savoirs. Nous sommes politiques, physiciens, cuisiniers, charpentiers ; nous sommes enseignants, chauffeur de taxi, avocats, économistes. Je suis allé à Goias au Brésil à une réunion des membres de la Famille dominicaine qui sont avocats. Ils avaient leur autorité spécifique d’avocats pour faire face aux problèmes de justice et de paix sur leur continent.
Enfin, l’autorité de notre prédication est celle de la vérité, Veritas. C’est la vérité pour laquelle les êtres humains sont faits, et qu’ils reconnaissent instinctivement. Quand le frère Luis Munio de Zamora OP établit la première règle pour les fraternités dominicaines, au treizième siècle, il ne se contenta pas de les inviter à être des pénitents, comme le voulait alors la tradition. Ils les voulut des hommes et des femmes de vérité, « de véritables enfants de Dominique dans le Seigneur, débordants d’un zèle fort et brûlant pour la vérité catholique, suivant des voies conformes à leur vie ».
C’est une vérité que nous devons rechercher ensemble, dans des lieux comme l’Institut Aquinas à St. Louis, USA, où des laïcs dominicains, des frères et des soeurs étudient et enseignent ensemble. Cette recherche peut être douloureuse. Elle peut faire de nous des incompris, et même nous faire condamner, comme notre frère Marie-Joseph Lagrange. Mais elle donne autorité à notre parole et elle répond à la plus profonde des soifs de l’humanité.
Soeur Christine Mwale, du Zimbabwe, a parlé ici de la marmite autour de laquelle se réunit la famille africaine. Cette marmite est posée sur trois pierres, qu’elle a comparées aux trois formes de l’autorité dans la Famille dominicaine : l’autorité que nous avons comme individus, l’autorité par délégation des aînés, et l’autorité du groupe. Pour être réellement une famille de prêcheurs, nous devons reconnaître aux autres leur autorité. Je dois être ouvert à l’autorité d’une soeur parce qu’elle parle avec la vérité de son expérience de femme, et aussi peut-être d’enseignante, de théologienne.
Je dois donner autorité au laïc qui en sait plus que moi sur bien des choses : par exemple le mariage, ou telle science, telle connaissance. Si nous reconnaissons l’autorité des autres, alors nous serons véritablement une Famille de prêcheurs. Ensemble nous pouvons gagner une autorité qu’aucun de nous n’aurait individuellement. Nous devons trouver notre voix ensemble. Pour de nombreux dominicains, la découverte que nous avons tous autorité pour prêcher est stimulante et libératrice. Et l’exclusion des non-ordonnés de la prédication après l’Évangile durant l’eucharistie est profondément douloureuse pour beaucoup. Elle est vécue comme une négation de votre pleine identité de prêcheurs.
Tout ce que je puis dire, c’est ceci : Ne vous découragez pas. Acceptez toutes les occasions de prêcher. Créons ensemble de nouvelles occasions. Que nous soyons d’accord ou pas avec cette décision n’est pas pour nous le noeud de la question. Prêcher en chaire n’est depuis toujours qu’une petite partie de notre prédication. De fait. on pourrait arguer que Dominique souhaitait porter la prédication de l’Évangile hors des confins de l’Eglise, dans les rues. Il voulait porter la parole de Dieu là où se trouvent les gens, là où ils vivent, où ils étudient, là où ils discutent, là où ils se détendent. Pour nous, le défi consiste à prêcher en des lieux nouveaux, sur Internet, par l’art, de mille autres manières. Quel paradoxe, si nous pensions que prêcher en chaire est la seule vraie manière de proclamer l’Évangile ! Ce serait une forme de fondamentalisme, allant à l’encontre de la créativité de Dominique, un pas en arrière pour l’Eglise.
Je sais que ce discours peut avoir l’air d’une fuite, d’une excuse pour priver les laïcs et les soeurs de la prédication active de la Parole au sens ordinaire du mot. Comme si je disais que les non-ordonnés doivent se contenter d’une forme mineure de prédication. Mais ce n’est pas le cas. L’Ordre des Prêcheurs est là pour sortir partager la bonne nouvelle, surtout avec ceux qui ne viennent pas à nous. Nous le faisons d’une infinité de manières : en écrivant des livres, en passant à la télévision, en visitant les malades. Quelque douloureuse et contestée que soit l’exclusion du pupitre, je ne crois pas que ce soit la question essentielle.
Nous sommes tous, de différentes manières, « de bons intendants d’une multiple grâce de Dieu » (IP 4, 10). Chacun de nous a reçu la gratia praedicationis, mais différemment. Les martyrs dominicains du Viêt-nam, de Chine, du Japon, au dix- septième siècle, furent des hommes et des femmes, des laïcs et des religieux, d’une extraordinaire diversité dans leurs manières d’être prêcheurs. Saint Dominique Uy, un laïc dominicain vietnamien, était connu sous le nom de « Maître prêcheur », il est donc évident qu’il proclamait la Parole ; Peter Ching, un laïc chinois, participa à des débats publics à Fogan pour défendre la vérité du christianisme, tout comme Dominique avec les Albigeois. Mais d’autres laïcs dominicains martyrisés étaient catéchistes, aubergistes, marchands, chercheurs.
Nous prêchons le Verbe qui s’est fait chair, et ce Verbe de Dieu peut se faire chair dans tout ce que nous sommes, et pas seulement dans ce que nous disons. Saint François d’Assise disait : « Prêchez l’Evangile à tout instant. Au besoin, servez-vous des mots ! » Nous devons devenir des paroles vivantes de vérité et d’espoir. Saint Paul écrit aux Corinthiens : « Vous êtes manifestement une lettre du Christ remise à nos soins, écrite non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs » (2Co 3, 3). Dans certaines situations, la parole la plus efficace est même parfois le silence. J’ai été frappé, au Japon, par la puissance du témoignage évangélique de nos monastères. Les bouddhistes rencontrent peut-être le Christ avec plus de force dans le silence des moniales que dans n’importe laquelle de nos paroles.
Je pense aux léproseries dirigées par les frères de Saint Martin, ici, aux Philippines, une incarnation de la compassion de Dominique. Le Verbe se rend aussi visible dans la poésie, la peinture, la musique, la danse. Tous les talents nous donnent un moyen pour diffuser la Parole. Par exemple Hilary Pépier, célèbre laïc dominicain, imprimeur, a écrit que « Le travail de l’imprimeur, comme tout travail, devrait être réalisé à la gloire de Dieu. Son travail étant de multiplier la parole écrite, l’imprimeur est donc au service du créateur de parole, et le créateur de parole est -ou devrait être- au service du Verbe fait Chair » (Ed. Aidan Nichols OP Dominican Gallery, Leominster 1997).
Nous ne prêchons pas cette parole de manière individuelle et dispersée, mais en communauté. Christifideles Laici dit que la communion avec Jésus « donne lieu à la communion des chrétiens entre eux… La communion donne lieu à la mission et la mission s’accomplit dans la communion » (n° 32). Comme vous le savez tous, au début, une communauté de frères était dite sacra praedicatio, sainte prédication. Quand Antonio de Montesinos prêcha sa fameuse homélie en défense des Indiens à Hispaniola en 1511, les conquistadores espagnols allèrent se plaindre au Prieur, Pedro de Cordoba. Et le Prieur répondit que quand Antonio prêchait, c’était la communauté tout entière qui prêchait. Nous devons être les sages-femmes les uns des autres, aidant nos frères et sœurs à dire la parole qui leur est donnée. Nous devons nous aider mutuellement à trouver l’autorité donnée à chacun. Ensemble nous sommes une parole vivante que nous ne pourrions former séparément.
J’ai rencontré récemment aux États-Unis un frère qui avait été opéré pour un cancer et avait perdu une partie de sa langue. Il devait totalement réapprendre à parler. Il a découvert combien il est complexe d’articuler le moindre mot. Nous utilisons pour cela des parties de notre corps auxquelles nous ne pensons jamais : la tête, les poumons, la gorge, les cordes vocales, la langue, les dents, la bouche. Il faut tout cela, juste pour dire : « Paix à vous ». Et pour le proclamer au monde, alors, nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir former ensemble ces paroles de vie. Ensemble nous sommes la tête, les poumons, la langue, la bouche, les dents, tes cordes vocales qui peuvent articuler une parole de paix.
J’étais cette année à une rencontre de ta Famille dominicaine à Bologne. Là est inhumé Dominique, mais là aussi sa Famille est vivante. Un groupe de laïcs travaille avec les frères et les sœurs à des missions de prédication au sein des paroisses. Un autre groupe, de laïcs et de frères qui ont la philosophie pour passion, conçoit sa mission comme une confrontation avec le vide intellectuel au cœur de la vie des gens. Ils prêchent par l’enseignement. Il y a encore un groupe de sœurs qui dirigent une université pour retraités et chômeurs. Et une fraternité de laïcs voulant soutenir la mission des autres par leur prière. Il n’y avait aucune compétition entre ces dominicains. Nul groupe ne saurait prétendre être celui des « vrais dominicains » ou que les autres sont des « citoyens de seconde classe ».
Il ne peut exister de compétition entre les moniales et les soeurs pour déterminer qui sont les plus dominicaines. Les fraternités laïques sont depuis les origines une part vitale de l’Ordre dominicain et le restent. Il est vrai qu’il y a beaucoup de nouveaux groupes laïcs. Comme les nouveau-nés, ils nécessitent peut-être davantage de soins et sont parfois l’objet d’une plus grande attention, mais ils ne menacent en aucune façon la position des fraternités au coeur de la vie de l’Ordre. Il ne peut exister de compétition entre nous. S’il y en a, nous n’incarnerons pas l’Evangile.
Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ».
Jésus souffle sur les disciples. Cela fait écho à la création de l’humanité, lorsque Dieu souffla sur Adam et en fit un être vivant. Jésus souffle sur les disciples pour qu’ils prennent pleinement vie. C’est l’achèvement de la création. Pierre dit à Jésus : « Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68). Le but de la prédication n’est pas de communiquer de l’information mais la vie. Le Seigneur dit à Ezéchiel : « Ainsi parle le Seigneur à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l’esprit et vous vivrez » (37, 4). Nous, prêcheurs, devrions dire les mots qui donnent vie aux ossements desséchés !
Soyons honnêtes, et reconnaissons que la plupart des prédications sont ennuyeuses, et se prêtent davantage à nous endormir qu’à nous éveiller, du moins nous poussent-elles à prier. Au bout de dix minutes, on regarde discrètement sa montre en priant que le prêcheur s’arrête. En Colombie, les dominicains disent : « Cinq minutes pour les gens, cinq minutes pour les murs, tout le reste va au diable ». Saint Paul lui-même, le plus grand des prêcheurs, finit pourtant par faire dormir Eutyque, qui en tomba par la fenêtre et faillit mourir ! Mais Dieu nous accorde parfois la grâce de dire les mots qui donnent la vie.
J’ai rencontré ici, aux Philippines, une femme appelée Clarentia qui avait attrapé la lèpre à l’âge de quatorze ans, et avait passé toute sa vie dans une léproserie, avec nos Frères de Saint Martin. Elle n’osait pratiquement pas quitter cet endroit, où elle était acceptée et accueillie. Aujourd’hui, à soixante ans, elle a découvert sa vocation de prêcheur. Elle a trouvé le courage de quitter sa « chambre haute » verrouillée, de sortir visiter les léproseries pour encourager les gens qui y vivent à trouver eux aussi leur liberté ; elle s’adresse à des associations et des agences gouvernementales. Elle a trouvé sa voix pour parler et son autorité. Voilà ce que signifie prêcher une parole de vie.
Pour nous, prêcheurs, tous les mots comptent. Chacune de nos paroles peut offrir la vie aux autres, ou la mort. La vocation de tous les membres de la Famille dominicaine est d’offrir des mots qui donnent la vie. Du soir au matin nous nous abreuvons réciproquement de paroles ; nous plaisantons, nous échangeons de l’information, nous parlons des absents. Ces mots apportent-ils la vie ou la mort, la guérison ou la blessure ? Un virus informatique, parti de Manille cette année, était camouflé dans un message intitulé « I love you ». Mais à l’ouverture, le message détruisait tous les programmes de l’ordinateur. Nous agissons parfois de même avec nos paroles. On peut très bien donner l’impression d’être sincère, juste, honnête : « C’est pour ton bien que je te dis ça, mon ami », au moment même où l’on injecte du poison !
L’une des devises de l’Ordre est « Laudare, benedicere, praedicare », glorifier, bénir, prêcher. Devenir prêcheur est bien davantage qu’apprendre à parler de Dieu. C’est la découverte de l’art de glorifier et bénir tout ce qui est bon. Il n’y a pas de prédication sans célébration. Nous ne pouvons prêcher si nous ne glorifions, si nous ne bénissons ta bonté de ce que Dieu a fait. Le prêcheur doit parfois, comme Las Casas, affronter et dénoncer l’injustice, mais dans le seul but que la vie l’emporte sur la mort, la résurrection sur la tombe, la glorification sur l’accusation.
Par conséquent, nous ne serons une Famille de prêcheurs épanouie que si nous nous fortifions les uns les autres et nous donnons mutuellement la vie. Nous devons nous insuffler mutuellement l’esprit de Dieu comme Jésus fit aux disciples. Sainte Catherine de Sienne était un prêcheur, non seulement par ce qu’elle disait et écrivait, mais par la force qu’elle donnait aux autres. Alors que le pape commençait à se laisser abattre, elle le réconforta et lui redonna courage. Lorsque son bien-aimé Raymond de Capoue, Maître de l’Ordre, s’effrayait, elle le poussait à continuer. Tous les Maîtres de l’Ordre en ont besoin quelquefois ! Un jour, un criminel fut condamné à mort, et elle l’aida à affronter l’exécution. Elle lui dit : « Courage mon cher frère, nous serons bientôt au banquet des noces… Ne l’oublie jamais. Je t’attendrai sur le lieu de l’exécution ».
La Famille dominicaine du Brésil a créé ce qu’elle appelle « le mutirao dominicain ». Mutirao signifie « travailler ensemble ». Chaque année, un petit groupe de frères, soeurs et laïcs part passer du temps auprès de ceux qui luttent pour leur vie, ou la justice, surtout les plus pauvres et les plus oubliés. Ils y vont juste pour être là avec eux, exprimer leur soutien, écouter ce qu’ils vivent, montrer que quelqu’un se souvient d’eux. Nous en avons besoin si nous voulons être forts.
La plupart d’entre nous ont appris en famille à être forts et humains. Nos parents, nos frères et soeurs, nos oncles et tantes, nos cousins nous ont enseigné à parler et écouter, à rire et à jouer, à marcher et nous relever quand nous tombons. On n’apprend pas à être humain tout seul. C’est peut-être pour cela que nous avons toujours vu l’Ordre comme une famille : les moniales, les laïcs et les frères. Dominique était éminemment humain, il prêchait le Dieu qui a embrassé notre humanité. Nous avons besoin de notre Famille dominicaine pour nous former en tant que prêcheurs humains, qui sachent se réjouir du Dieu qui partage notre humanité. Nous avons besoin de la sagesse des femmes, de l’expérience des couples et des parents, et de la profondeur des contemplatifs pour nous former comme prêcheurs humains.
Ainsi toute formation dominicaine devrait-elle être mutuelle. Dans de nombreux pays, les novices, frères et soeurs, font une partie de leur formation ensemble. Nous sous-estimons souvent de manière dramatique combien nos laïcs dominicains ont à enseigner aux autres branches de la Famille dominicaine. Nous ne sommes pas toujours attentifs à votre sagesse.
Inversement, dans beaucoup de régions du monde, les laïcs dominicains ont soif d’une formation complète sur la théologie et la spiritualité de l’Ordre, et nous ne la leur proposons pas toujours. C’est certaine- ment l’une des priorités les plus urgentes, maintenant. Comment y répondre ?
Et les derniers mots de Jésus que je vais commenter nous montrent ce qui se trouve au coeur de cette parole de vie :« Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.»
Par deux fois, Jésus leur dit : « Paix à vous », puis il leur donne le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés. C’est le coeur même de notre prédication. Au cours de cette assemblée nous avons vu émerger avec une insistance particulière l’engagement pour la Justice et la Paix comme objectif essentiel de notre commune mission de Famille dominicaine. Je pense par exemple à Dominican Peace Action en grande Bretagne, un groupe de moniales, soeurs, laïcs et frères, attachés à oeuvrer ensemble pour la paix, et en particulier pour l’abolition des armes nucléaires, par l’écriture et par la prédication, quitte à enfreindre la loi au besoin.
Mais prêcher la paix et le pardon est une vocation que l’on peut vivre de bien des manières. Maïti Girtanner, laïque dominicaine française, était une jeune et brillante pianiste. En 1940, sous l’occupation nazie, elle fonda en France un groupe de résistants. A la fin, elle fut capturée par la gestapo et torturée par un jeune médecin. Son système nerveux en sortit détruit, et elle souffrit pour le reste de ses jours. Cela détruisit aussi sa carrière de pianiste. Quarante ans plus tard, le médecin réalisa qu’avant de mourir, il devait lui demander pardon. Il retrouva Maïti, et lui demanda à se réconcilier. Elle l’a pardonné, et à son retour chez lui, il a pu se regarder en face, il a pu regarder sa famille et regarder sa mort en face. Comme l’a dit Maïti : « Vous voyez, le mal n’est pas le plus fort ». Cela aussi incarne la prédication de Jésus.
Une communauté de frères, à Rome, est chargée d’entendre les confessions dans basilique de Sainte-Marie Majeure. Pendant des heures, chaque jour – surtout en cette année de Jubilé – , et dans d’innombrables langues, ils sont là pour offrir pardon de bien. Ce sont là différentes manières de prêcher ces mêmes mots : « Paix à vous ». Mais nous ne pouvons prêcher cette paix si nous ne la vivons pas entre nous.
En faisant profession, les frères et les sœurs demandent la miséricorde de Dieu et celle de l’Ordre. Nous n’aurons rien à dire sur la paix et le pardon si nous ne savons nous les offrir les uns aux autres.
Quand la guerre a éclaté entre l’Argentine et la grande Bretagne à propos des Iles Malouines en 1982. les frères de la communauté d’Oxford sont descendus dans la rue en habit, portant des cierges. Nous sommes allés en procession jusqu’au mémorial de la guerre, où nous avons prié pour la paix. L’an dernier, je me trouvais justement en Argentine pour « la fête des Malouines », une journée où la nation renouvelle son engagement envers ces îles. J’étais à Tucuman, au nord du pays, et les rues étaient pleines de drapeaux argentins. Je dois avouer que je me suis demandé si j’avais vraiment choisi le bon moment pour ma visite ! L’après-midi, je participais à la rencontre d’un millier de membres de la Famille dominicaine, et là, il y avait aussi un petit drapeau anglais ! Et nous avons célébré ensemble l’Eucharistie pour tous les morts, les Argentins et les Anglais. La paix que nous prêchons, nous devons la vivre.
Il y a au nord du Burundi un monastère dominicain. Le pays entier a été détruit par la violente guerre civile opposant les Tutsis aux Hutus. Partout, les villages sont vidés et les champs brûlés. Mais en approchant de la colline au sommet de laquelle se trouve le monastère, on aperçoit du vert. Là, les gens viennent entretenir leurs champs. Dans ce désert de guerre, il y a une oasis de paix. Et cela, parce que les moniales elles-mêmes vivent en paix ensemble, quoiqu’elles soient aussi des Tutsis et des Hutus. Toutes ont perdu des membres de leur famille dans cette guerre. La paix et le pardon se sont faits chair dans leur communauté.
La paix que nous devrions partager va bien au-delà de l’absence de conflit. Elle est plus que le pardon réciproque des torts que nous nous sommes faits. Elle est l’amitié au coeur même de la spiritualité dominicaine. Avant de mourir, Jésus dit aux disciples : « Je vous appelle amis ». Trois jours plus tard, après avoir subi la trahison, le reniement, la souffrance, la mort, il apparaît au milieu d’eux et leur offre à nouveau son amitié : « Paix à vous ». Cette amitié transcenderait n’importe quelle trahison, n’importe quelle lâcheté, n’importe quel péché. Cette amitié est la vie même de Dieu, l’amour au coeur de la Trinité.
L’amitié est le fondement de notre égalité. Cela signifie que nous avons tous également place dans la Famille dominicaine. La Famille dominicaine est notre foyer commun. Nous sommes appelés à y être at home, en nuestra casa, chez nous. Les soeurs et les laïcs ont parfois l’impression que dans notre maison dominicaine, les frères se sont barricadés dans la chambre haute, essayant d’en tenir tous les autres à l’écart. L’un de nos plus grands défis consiste à construire et partager une conscience commune de l’Ordre, comme notre place à tous, notre appartenance. Être chez soi signifie ne pas avoir à justifier sa présence, se sentir à l’aise. Être accepté tel qu’on est. Et cela se voit à nos visages, à nos gestes, à nos paroles, dans l’accueil que nous faisons aux autres. Bien sûr, chaque communauté a besoin de ses propres temps et espaces. Nous ne pouvons pas tous faire irruption dans les monastères et demander à partager la vie des moniales. Les communautés de frères et de soeurs et les familles des laïcs ont toutes besoin de leur intimité.
Maintes petites tensions au sein de la Famille dominicaine, comme par exemple : qui peut apposer quelles initiales après son nom, qui peut porter l’habit et quand… sont des symptômes de cette aspiration plus importante et plus profonde à l’amitié, à un foyer, à une appartenance, à avoir sa place assurée à table ou autour de la marmite. Autrefois, on appartenait au Premier, au Second ou au Tiers Ordre. Cette terminologie a été abolie au chapitre général de River Forest en 1968, pour rendre évidente notre égalité. Personne n’est de première ou deuxième ou troisième classe. Mais nous avons perdu ainsi une manière d’affirmer notre unité dans un même Ordre. Ensemble, nous devons trouver des façons de construire ce foyer commun.
Et ce devra être un foyer ouvert, accueillant les amis de nos amis, accueillant de nouveaux groupes, même si leur identité dominicaine n’est peut-être pas toujours très claire, mais parce qu’ils souhaitent faire partie de la Famille. L’amitié qu’offre Jésus est immense et ouverte. Il accueille tout le monde. Il s’impatiente lorsque les disciples tentent d’empêcher quelqu’un de prêcher sous prétexte qu’il n’appartient pas au groupe des disciples. Jésus ne ferme pas les portes mais les ouvre à toute volée. Incarnons cette amitié au grand cœur avec la générosité de Dominique. Soyons un signe de cet accueil, afin de nous sentir tous à l’aise dans la Famille de Dominique. Que Dominique nous libère de la peur qui verrouille les portes.
Fr. Timothy Radcliffe OP
Maître de l’Ordre
Une vie contemplative (2001)
« Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d’un mont »
Lettre publiée en la fête de sainte catherine de Sienne, 2001
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
 Cette lettre s’adresse en premier lieu aux moniales, car c’est de votre vie qu’il s’agit, chères sœurs moniales. Je veux rendre grâces à Dieu pour votre présence au cœur de l’Ordre. Souvent, au milieu de visites canoniques menées tambour battant, mon passage dans les monastères a été un moment de joie, de rire et de fraîcheur. Je ne suis pas moniale, alors qu’ai-je à dire de votre vie ? Comme vous, je suis moi aussi un dominicain appelé à la contemplation. Vous avez partagé ouvertement avec moi vos espoirs de renouveau pour la vie contemplative au cœur de l’Ordre, et les défis que vous devez relever. Aussi par la présente lettre aimerais-je partager avec toutes les moniales le fruit de nos conversations. S’il devait s’avérer que je n’ai pas compris votre vocation, je vous en demande pardon. L’Ordre ne s’épanouira que si nous osons dire ce que nous avons au fond du cœur, avec l’assurance d’être pardonnés.
Cette lettre s’adresse en premier lieu aux moniales, car c’est de votre vie qu’il s’agit, chères sœurs moniales. Je veux rendre grâces à Dieu pour votre présence au cœur de l’Ordre. Souvent, au milieu de visites canoniques menées tambour battant, mon passage dans les monastères a été un moment de joie, de rire et de fraîcheur. Je ne suis pas moniale, alors qu’ai-je à dire de votre vie ? Comme vous, je suis moi aussi un dominicain appelé à la contemplation. Vous avez partagé ouvertement avec moi vos espoirs de renouveau pour la vie contemplative au cœur de l’Ordre, et les défis que vous devez relever. Aussi par la présente lettre aimerais-je partager avec toutes les moniales le fruit de nos conversations. S’il devait s’avérer que je n’ai pas compris votre vocation, je vous en demande pardon. L’Ordre ne s’épanouira que si nous osons dire ce que nous avons au fond du cœur, avec l’assurance d’être pardonnés.
Je voudrais aussi partager cela avec toute la Famille dominicaine. Avant de mourir, saint Dominique « confia les moniales, membres du même Ordre, au soin fraternel de ses fils » (LCM 1 § I). La première communauté dominicaine qu’il fonda fut celle des moniales de Prouilhe, et l’un de ses derniers soucis fut de construire le monastère de Bologne : « Il est absolument nécessaire, mes frères, de construire une maison de moniales, même si cela implique de délaisser quelques temps le travail de notre propre maison » . Les monastères nous sont donc confiés à tous. De même que nous-mêmes sommes confiés à la prière et au soin des moniales. Cette réciprocité est au cœur de l’Ordre. Aussi, quoique je m’adresse directement aux moniales, j’espère que tous les dominicains sont à l’écoute.
1. Une vie contemplative
Les monastères ne sont pas la branche contemplative de l’Ordre. Nous ne saurions laisser la contemplation aux seules moniales. Nous sommes tous appelés à la contemplation, et le renouveau de la vie contemplative est l’un des plus grands défis que l’Ordre doive relever. J’hésite à donner une définition de « contemplation »… mais, un peu d’audace ! Par contemplation j’entends notre quête de Dieu, qui nous conduit à la rencontre de Dieu qui vient à nous. Nous recherchons Dieu dans le silence et la prière, dans l’étude et dans la discussion, dans la solitude et dans l’amour. Avec tous nos dons de cœur et d’esprit, nous suivons les traces de Dieu. Mais c’est Dieu qui nous trouve au moment où nous nous y attendions le moins. Marie Madeleine, première sainte patronne de l’Ordre, est l’authentique contemplative, qui cherche le corps de Jésus pour finalement rester stupéfiée lorsqu’elle entend le Seigneur Ressuscité l’appeler par son nom. Notre prière jaillit de ce désir profond. Comme l’a dit Catherine, « Le désir même est prière ».Le fr. Vincent de Couesnongle parlait de « la contemplation de la rue » . Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, chez le plus petit de nos frères, la plus petite de nos sœurs (Mt 25), dans nos familles, là où nous travaillons, chez nos amis et nos ennemis, dans la joie et dans la tristesse. Le Verbe est là, si seulement nous voulons bien ouvrir les yeux pour le voir. Eric Borgman, un laïc dominicain néerlandais, a écrit : « Les dominicains sont convaincus que le monde dans lequel nous vivons, tumultueux et en ébullition, souvent violent et terrifiant, est en même temps le lieu où naît le sacré, le lieu où nous nous rencontrons et nous écoutons pour -‘contempler’- Dieu » . Aussi chaque dominicain est appelé à la contemplation, que nous soyons laïcs dominicains, sœurs, frères ou moniales. Notre plus grande figure contemplative, sainte Catherine de Sienne, était une laïque.
Prêcher est un acte de contemplation. Don Goergen a écrit : « Dans la prédication s’unissent le chercheur et le cherché, celui qui est perdu et celui qui est trouvé. Dieu nous découvre au cœur même de notre parole qui tente de le révéler. Dieu ne nous laisse jamais tomber » . Prêcher n’est pas juste ouvrir la bouche pour parler. Cela commence par une attention silencieuse à l’Évangile, une lutte pour comprendre, la prière pour être illuminé, et cela s’achève par les réactions de ceux qui nous écoutent. Je me souviens, jeune frère, de la visite d’un évêque attendu pour prêcher, et qui se tourna vers l’un des frères une minute avant la messe : « Si tu es un bon dominicain, tu devrais pouvoir prêcher maintenant sans préparation ». Le frère répondit : « C’est justement parce que je suis dominicain que je ne crois pas que la prédication consiste juste à dire la première chose qui me vient à l’esprit ».
Si tous les dominicains sont appelés à la contemplation, qu’y a-t-il donc de si particulier dans votre vie ? Votre vie est tout entière façonnée par la recherche de Dieu. La vocation d’une moniale est « un rappel pour tout le peuple chrétien de la vocation fondamentale de chacun à la rencontre avec Dieu » (Verbi Sponsa 4). Comme l’écrivit le fr. Marie-Dominique Chenu, « la vie mystique n’est foncièrement pas autre chose que la vie chrétienne » . Vous n’échappez pas aux drames et aux crises de la vie humaine ordinaire. Vous les vivez plus à nu, plus intensément, connaissant la joie et le désespoir de toute vie humaine, sans avoir l’abri qu’offrent tant des choses qui donnent du sens à la plupart des vies humaines : un mariage, des enfants, une carrière. Le monastère est cet endroit où l’on ne peut se cacher nulle part de la question fondamentale de toute vie humaine. Une moniale écrivait : « Je suis entrée au monastère, non pour fuir le monde ou l’oublier, pas même pour ignorer son existence, mais pour être présente au monde d’une manière plus profonde, pour vivre au cœur du monde, d’une façon secrète mais que je crois plus réelle. Je ne suis pas venue chercher ici une vie tranquille ou la sécurité, mais partager, prendre avec moi les souffrances, la douleur, les espoirs de toute l’humanité » .
Votre vie n’a de sens que si la quête de Dieu mène bien à cette rencontre dans le jardin, à entendre prononcer son nom. Votre vie n’a aucun objectif intermédiaire auquel vous accrocher au fil des jours et des années. Le monastère est comme un petit groupe à l’arrêt de bus, un signe d’espoir que le bus va arriver. Cela est vrai de tous ceux qui vivent la vie monastique cloîtrée. Dans une conférence au congrès des abbés bénédictins , je disais que Dieu se montre souvent dans l’absence, dans le vide : l’espace libre entre les ailes des chérubins dans le Temple, et finalement dans le tombeau vide au jardin. La vie d’une moniale et d’un moine est creusée par un vide. Votre vie est vide de but, sinon celui d’être là pour Dieu. Vous ne faites rien de particulièrement utile. Mais ce vide est un espace libre dans lequel Dieu vient habiter et où nous entrevoyons sa gloire.
Vous faites cela en moniales de l’Ordre des Prêcheurs. L’Église appelle les contemplatifs de différentes familles religieuses à vivre de la richesse de leurs traditions et charismes respectifs -bénédictin, carmélite, franciscain ou dominicain- qui « constituent un splendide éventail » . Que signifie pour un monastère être dominicain ? Je veux partager ce que j’ai appris de vous en regardant votre vie marquée par la mission de l’Ordre, par la vie commune dominicaine, par la recherche de la Vérité, et par l’appartenance à tout l’Ordre. Il y a maints autres aspects de votre vie que je n’aborderai pas, je m’en tiens à ceux-ci qui sont au cœur de votre identité dominicaine.
2. La mission
Que signifie être moniale d’un Ordre missionnaire ? Comment est-il possible d’être à la fois une contemplative cloîtrée et une missionnaire ?
Être envoyés
Être missionnaires, c’est littéralement être envoyés. Les frères et les sœurs peuvent être envoyés en mission aux confins de la terre, comme Jésus envoya ses disciples. Certes on peut vous envoyer fonder un nouveau monastère, ou renforcer un monastère fragile, mais en général vous restez sur place. Alors en quel sens êtes-vous envoyées ? Pour Jésus, être envoyé par le Père ne consistait pas à quitter un lieu pour un autre. Il ne partit pas en voyage. Son existence même venait du Père. Vous êtes tout aussi missionnaires que les frères, non par un départ, mais parce que vous vivez votre vie venant de Dieu et pour Dieu. Comme le dit Jourdain à Diane : « Ta permanence dans le calme du couvent et mes nombreuses errances de par le monde sont pareillement faites pour l’amour de Lui » . Vous êtes une Parole prêchée par votre être même.
La septième manière de prier de Dominique consistait à étirer « son corps tout entier vers le ciel en une prière semblable à la flèche tirée haut de l’arc tendu » . Vous pointez droit vers Dieu comme une flèche, juste par votre présence sans autre objet. Vous êtes par votre vie même une parole pour vos frères, vos sœurs, et les laïcs dominicains, et une parole pour le lieu où se trouve votre monastère. Je l’ai bien vu dans des pays qui souffrent, comme l’Angola, le Nicaragua, dans les taudis des grandes villes comme Karachi, ou dans le Bronx à New York, ou dans certaines banlieues de Paris. Dans des endroits comme ceux-là, un monastère est une Parole qui se fait chair et sang, « pleine de grâce et de vérité » (Jn 1, 18).
Marie Madeleine va trouver les apôtres et leur dit : « J’ai vu le Seigneur ». Certaines d’entre vous seront peut-être appelées à prêcher par l’écrit. Beaucoup des plus grands théologiens étaient des moines ou des moniales, et cela serait particulièrement approprié à une moniale dominicaine. LCM 106 § II affirme explicitement que le travail des moniales peut également être intellectuel.
Vous pouvez aussi être envoyées créer de nouvelles fondations. Olmedo est une inspiration, avec ses huit fondations dans quatre continents. L’Ordre se développe dans de nombreux pays, en particulier en Asie, et sans vous nous sommes incomplets. Il arrive que vous soyez là avant nous. Il faut parfois un grand courage pour envoyer des moniales fonder un nouveau monastère, en particulier parce que ce sont celles qui donnent le plus à leur communauté qui seront capables d’une telle aventure. Rappelez-vous le courage de Dominique qui dispersa les frères à peine l’Ordre était-il fondé, afin que le grain portât des fruits.
La compassion
La compassion fait partie de votre mission, cette part du don de Dominique pour « conduire les pécheurs, les opprimés et les désespérés dans le sanctuaire intime de sa compassion » (LCM 35, § I). Le Dieu de Dominique est un Dieu de miséricorde. La compassion suppose que nous désapprenions cette dureté de cœur qui fait le procès des autres, que nous nous dépouillions de cette carapace qui tient les autres à l’écart, que nous apprenions à être vulnérable à la souffrance et au désarroi des autres, que nous entendions leurs appels à l’aide. Cela nous l’apprenons avant tout dans nos communautés. Osons-nous nous laisser toucher par les souffrances de notre sœur de la chambre voisine ? Osons-nous prendre le risque d’écouter ses appels à l’aide à demi formulés ? Dans le cas contraire, comment pourrions-nous incarner la compassion de Dominique pour le monde ?
La compassion est plus qu’un sentiment, c’est ouvrir les yeux pour voir le Christ parmi nous, le Christ qui souffre encore, comme Las Casas vit le Christ crucifié dans les Indigènes d’Hispaniola. Il y faut une éducation du cœur et de l’œil, qui nous rende attentifs au Seigneur présent parmi nous dans l’opprimé et le blessé. La compassion est donc authentiquement contemplative, clairvoyante. Comme le dit Borgman, « Être touché, ému, par ce qui arrive aux gens et par ce qui les atteint, c’est une manière de percevoir la présence de Dieu. La compassion est contemplation au sens dominicain » . La compassion contemplative est l’apprentissage d’un regard désintéressé sur les autres. Comme tel, elle est profondément liée à la soif d’un monde juste. L’engagement de l’Ordre au service de la justice devient aisément une question d’idéologie s’il ne naît pas d’une compassion contemplative. « Une société qui ne comprend pas la contemplation ne comprendra pas la justice, parce qu’elle aura oublié comment regarder de manière désintéressée qui est l’autre. Elle se réfugiera dans des généralités, des préjugés, des clichés calculateurs. »
La compassion nous porte au-delà des divisions internes. Le monastère de Rweza au Burundi est cerné par la guerre. Les sœurs viennent elles-mêmes des différents groupes ethniques qui se combattent, elles ont souvent perdu des membres de leur famille. Quand on leur demande ce qui les a maintenues unies, elles répondent que l’union est un don de Dieu, pour lequel elles ne rendront jamais assez grâces. Elles disent aussi qu’elles écoutent ensemble les nouvelles à la radio, même si c’est très douloureux. Partager cette peine les unit.
La compassion implique donc une connaissance des besoins de l’Ordre et du monde. Dans les monastères florissants, j’ai souvent constaté un désir d’en savoir davantage sur l’Ordre et ses besoins, tout comme Diane réclamait sans cesse à Jourdain des nouvelles de ses missions. « Pour quoi voulez-vous que nous priions ? » Il y a une soif de comprendre ce qui se passe dans les pays en guerre, comme l’Algérie et le Rwanda. Aussi les monastères doivent-ils avoir accès à l’information et aux véritables éléments d’analyse, plutôt qu’à des nouvelles comme simples passe-temps, pour pouvoir soumettre à Dieu les besoins de notre monde.
La prière
La compassion déborde en prière. Les premiers frères demandaient toujours aux moniales de prier pour eux parce qu’ils manquaient de temps pour le faire eux-mêmes. Raymond de Penyafort se plaignit un jour à la Prieure de Bologne d’être trop occupé par les affaires de la cour papale : « Je ne peux quasiment jamais atteindre ou, pour être tout à fait honnête, ne serait-ce qu’apercevoir le début du calme de la contemplation… Aussi est-ce une grande joie et un immense réconfort de me savoir soutenu par tes prières » . Jourdain écrivit à Diane : « Prie pour moi souventes fois et avec ardeur dans le Seigneur ; j’ai grand besoin de tes prières en raison de mes fautes, et ne prie que rarement moi-même » .
Voilà qui pourrait donner l’impression que frères et moniales ont des types d’activités bien différents, les frères prêchant et les moniales priant, exactement comme un ménage où la femme préparerait le repas et laisserait à son mari le soin de laver la vaisselle -avec un peu de chance ! Mais dans la prédication nous partageons la parole qui nous est donnée. Prier pour cette parole fait donc partie de l’événement prédication. La prière ne vient pas seulement avant la prédication comme la cuisine précède la vaisselle. La prière participe de la venue du Verbe, et les moniales sont par conséquent intimement impliquées dans l’acte de prédication. « Les moniales cherchent, méditent et invoquent Dieu dans la solitude afin que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne Lui revienne pas vide mais accomplisse ce pour quoi elle a été envoyée » (LCM 1 § II). Pour Jourdain, ce sont les prières de Diane et sa communauté qui donnent force à sa prédication et apportent le flot des vocations.
Les formes de prière les plus typiques de saint Thomas d’Aquin étaient l’intercession et l’action de grâces. Nous demandons à Dieu ce dont nous avons besoin, et remercions lorsque cela nous est accordé. Cela évoque peut-être une manière infantile de se situer dans le monde, comme si nous étions incapables de faire quoi que ce soit par nous mêmes. Mais en fait, il y faut la maturité de qui réalise que toute chose est donnée. Dans la société de consommation, où tout a un prix, demander est considéré comme un échec. Mais si nous vivons dans le monde réel, créé par Dieu, alors demander ce dont nous avons besoin c’est être vrai, et reconnaître en Dieu « l’auteur de nos biens » . Mais plus encore, la réponse à nos prières est parfois la manière dont Dieu agit sur le monde. Dieu désire que nous priions, pour qu’il puisse donner, en réponse. Prier n’est pas contraindre Dieu à changer d’avis. C’est par amitié que Dieu nous accorde ce que nous demandons. Aussi vos prières sont-elles une participation à l’action de Dieu sur le monde.
Célébrer la liturgie
Une autre de vos manières de prêcher c’est par la beauté de votre célébration publique de la liturgie, comme le recommande instamment Venite Seorsum. Il y a dans notre société une soif de Dieu, souvent contrariée par le soupçon qui pèse sur tout enseignement. L’expérience m’a appris qu’au moment où l’on commence à prêcher, plus d’un visage se détourne. Mais la beauté sait toucher les sources les plus intimes de notre désir de Dieu. La beauté nous saisit sans nous forcer. Elle a sa propre autorité, plus profonde que n’importe quel argument.
La liturgie dominicaine doit être pleine de joie . Dominique chantait joyeusement. Jourdain raconte l’histoire d’un vaudois maussade, du nom de Pierre, qui tenait les dominicains en piètre estime parce que « les frères étaient trop gais et démonstratifs » . Il croyait qu’un religieux doit être grave et triste. Et puis une nuit il rêva d’une grande prairie. « Il y voyait une assemblée de Frères Prêcheurs, faisant cercle, leurs visages rieurs tournés vers le ciel. L’un d’eux tenait le Corps du Christ dans ses mains tendues. » Il s’éveilla « le cœur empli de joie » et entra dans l’Ordre. La joie de la liturgie fait partie de notre prédication de la Bonne Nouvelle. Je n’oublierai jamais la joie des moniales de Nairobi dansant au pied de l’autel aux paroles de l’Évangile. La joie de la bonne nouvelle était visible dans leur mouvement. Je n’ai pu m’empêcher de danser moi-même !
3. La communauté
Toute communauté monastique devrait être un lieu d’amour mutuel où Dieu vient faire sa place. « Grâce à l’amour mutuel, la vie fraternelle est un espace théologal dans lequel on fait l’expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité » (Verbi Sponsa 6). Mais la tradition dominicaine a une compréhension particulière de la vie commune. Vous tenez vous aussi vos vœux de la Règle de saint Augustin, qui rappelle que la fin à laquelle nous sommes appelés « est vivre unis dans la maison et n’être qu’un seul esprit et un seul cœur en Dieu ». Jésus appela les apôtres à vivre avec lui avant de les envoyer prêcher. Pour vous aussi, la vie commune fait partie de la prédication.
La communauté et l’amitié
La tradition dominicaine de la communauté est profondément marquée par la manière dont nous concevons notre relation avec Dieu. Il y a dans l’Église deux grandes traditions. L’une considère notre relation avec Dieu en termes de mariage, comme l’amour entre les époux. L’autre l’envisage en terme d’amitié. On trouve les deux dans l’Ordre, mais nous avons tout particulièrement cultivé la théologie johannique de l’amitié, souvent négligée. Pour saint Thomas d’Aquin, le cœur de la vie de Dieu est l’amitié du Père et du Fils : l’Esprit Saint. Prier est donc parler à Dieu comme à un ami. Selon Carranza, un dominicain espagnol du seizième siècle, prier c’est « converser intimement avec Dieu… discuter de tout ce qui vous touche avec Dieu, des intérêts les plus élevés aux détails sans prétention, que cela concerne le ciel ou la terre, ait trait à l’âme ou au corps, les grandes et les petites choses ; c’est lui ouvrir votre cœur et vous découvrir entièrement à lui, ne laissant rien dans l’ombre ; c’est lui raconter vos peines, vos péchés, vos désirs et tout le reste, tout ce que vous avez dans l’âme, et vous abandonner à lui comme un ami s’abandonne à un autre » .
On trouve aussi la conception ‘nuptiale’ dans l’Ordre, par exemple chez Jourdain de Saxe, Catherine de Sienne, Agnès de Langeac. Mais, cet amour n’est pas à leurs yeux une relation individuelle avec Dieu, il s’incarne dans l’amour des frères et des sœurs. « Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas » (1 Jn 4, 20). Jourdain écrit à Diane : « Christ est le lien qui nous unit ; en lui mon esprit est fermement soudé à ton esprit ; en lui tu es toujours présente, sans cesse avec moi, où que me porte mon errance » . « Aimons-nous les uns les autres en lui et à travers lui et pour lui » . Catherine dit sans ambiguïté que son amour du Christ Époux est le même que celui qu’elle porte à ses amis. Le Seigneur lui dit : « L’amour que l’on a pour moi et pour le prochain est une seule et même chose » . Cela signifie que notre vie contemplative doit nous faire ouvrir les yeux sur nos frères et nos sœurs. Dans le Rosaire, nous suivons les mystères de la vie du Christ, ses moments de joie, de souffrance et de gloire. Sommes-nous attentifs aux « mystères » de la vie des membres de notre communauté, qui ne sont pas toujours joyeux et glorieux ?
Notre amitié avec Dieu se fait chair et sang dans le tissu de la vie communautaire. J’en ai vu le fruit dans la joie de nombreux moments de détente partagés avec vous. Sr Barbara, de Herne, a écrit : « C’est là, dans les moments de détente, que les moniales expriment leur joie d’être ensemble, elles rient beaucoup, au point que les retraitants de la maison d’accueil s’étonnent parfois des éclats de rire qui retentissent près d’une demi-heure tous les soirs ». Ces moniales sont les héritières d’une longue tradition. Un soir que Dominique rentrait tard à St-Sixte, il réveilla les moniales pour enseigner puis se détendit avec elles autour d’un verre de vin. Il les encourageait sans cesse à boire davantage, « bibite satis » . J’ai plutôt l’expérience que ce sont les moniales qui encouragent ainsi les frères ! Cette joie fait tellement partie de notre tradition que Jourdain interprète même la phrase « entrez dans la joie du Seigneur » au sens d’entrer dans l’Ordre où « tous vos chagrins deviendront joie et votre joie, nul ne pourra vous l’ôter » .
Cette amitié avec les frères et les sœurs est l’une des plus grande joies de ma vie, mais elle est parfois bien dure aussi. Joie et dureté doivent être encore plus intenses pour vous qui vivrez probablement toute votre vie avec les mêmes sœurs. Si un frère me trouve impossible, il lui reste au moins l’espoir qu’on m’assigne ailleurs un jour. Il n’aura pas à me supporter jusqu’à la mort. Le Cardinal Hume m’a raconté que lorsqu’il était jeune, son Abbé lui dit un jour : « Basil, rappelle-toi que quand tu mourras, il se trouvera toujours au moins un moine pour être soulagé ». Aussi pour vous la vie commune est-elle une joie particulière et en même temps un défi impossible à relever sans miséricorde et générosité. Tauler dit que lorsqu’un frère est insupportable, il faut se dire à soi-même : « Il a sûrement la migraine aujourd’hui ». Certaines sœurs vous semblent peut-être avoir très souvent la migraine !
Quand nous faisons profession dans l’Ordre, nous demandons « la miséricorde de Dieu et la vôtre ». Être dominicain et dominicaine, c’est promettre de donner et de recevoir cette miséricorde. Chaque jour nous en appelons à Dieu pour qu’il « pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Chaque sœur reçoit le pouvoir libérateur de pardonner, une part de la capacité divine à faire toutes choses nouvelles. C’est la liberté d’ouvrir les portes des prisons que chacun de nous construit, de nous appeler les uns les autres à sortir du tombeau pour entrer dans la vie nouvelle. Chacune de vous a un ministère de réconciliation dans la communauté. Chacune de vous peut dire une parole qui guérit.
La clôture
Cette idée de l’amitié peut nous aider pour une compréhension dominicaine de la clôture. Il y a dans certains monastères des discussions animées sur la clôture : combien de fois les moniales doivent-elles être autorisées à quitter le monastère, et pour quelles raisons ? Je n’entrerai pas dans ces débats. Tout d’abord cela risquerait de générer des divisions quand le Maître de l’Ordre doit par-dessus tout se soucier de l’unité. Et puis on ne peut trouver de consensus sur ces questions pratiques qu’après avoir clarifié la nature de la clôture. Verbi Sponsa en parle comme d’une « manière particulière d’être avec le Seigneur » (3). Elle a trait à la construction d’une demeure avec Dieu, plutôt qu’à un règlement. C’est une question d’amour plus que de droit. Ce n’est pas tant une fuite à l’écart d’un monde mauvais, que la construction d’un espace au sein duquel apprendre justement à ne pas fuir l’amitié de Dieu, les autres, et nous-mêmes. Ce qui compte n’est pas la clôture comme exclusion du monde, mais ce qu’elle contient, une vie avec Dieu, comme un verre rempli de vin.
Au début les monastères étaient de véritables foyers pour les frères. Prouilhe et plus tard St-Sixte était les maisons des frères, d’où ils partaient prêcher. Avec l’augmentation du nombre de frères, cela est devenu impossible. Sans aucun doute les frères menaçaient la paix du monastère en rentrant tard la nuit et demandant à manger, se disputant alors que les sœurs aspiraient au silence ! Il fallait que nous ayons des maisons séparées. Mais les monastères sont restés des foyers pour les frères dans un sens plus profond. Pour Jourdain de Saxe, le monastère de Bologne était la demeure de son cœur, même s’il y passait peu de temps. Il écrit à Diane : « Ne suis-je pas à toi, ne suis-je pas avec toi ? À toi dans le travail, à toi dans le repos ; tien quand je suis avec toi, tien quand je suis loin » . Le monastère est foyer en ce qu’il est un lieu où les moniales vivent avec Dieu (LCM 36), et c’est donc là que les autres peuvent entrevoir le véritable foyer que nous cherchons tous, où nous demeurerons en Dieu, notre Sabbat éternel. C’est pourquoi les monastères sont si souvent au cœur de la Famille dominicaine. La Famille dominicaine gravite fréquemment autour du monastère, lieu où nous sommes tous chez nous. C’est pourquoi accueillir des hôtes dans un monastère, certes avec bon sens de façon à ne pas déranger le rythme de votre vie, peut être une manière de partager le fruit de votre clôture.
« Oh ! chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant ! » (Hé 10, 31). Il est parfois dur de vivre avec Dieu. Nous nous retrouvons dans le désert, veillant à Gethsémani et témoins au Golgotha. Une contemplative doit parfois vivre dans les ténèbres mais, comme le dit ‘le Nuage de la Connaissance’, « Apprenez à vous sentir chez vous dans ces ténèbres ». La tentation est de fuir loin de Dieu, et se réfugier dans de modestes consolations, de minuscules désirs. On peut être tenté de remplir sa vie de petits projets, de passe-temps, de bavardage, juste histoire de combler le vide. Mais il faut laisser ce vide tel quel pour que Dieu le remplisse. Le monastère est notre maison non parce que vous y avez fui le monde mais parce que vous avez la hardiesse de ne pas fuir Dieu. Osez habiter les ténèbres et être chez vous dans la nuit, sans crainte. Comme le poète anglais D. H. Lawrence l’a écrit : « Chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant, certes, mais combien plus effroyable leur échapper ! ».
Nous sommes aussi parfois tentés de fuir nos frères et sœurs, d’échapper au défi de construire une maison pleine d’amour où Dieu puisse venir habiter. Surtout, nous pouvons être tentés de nous fuir nous-mêmes. Dans le monastère, il n’y a nulle part où se cacher. Là, nous apprenons, selon les mots de Catherine, à « habiter la cellule de la connaissance de soi » (Dialogues 73), en nous regardant en face sans crainte « dans le charitable miroir » de Dieu, nous sachant aimés. À l’aise avec nous-mêmes, nous le serons avec Dieu.
La clôture doit être réglée par des normes claires mais si celles-ci deviennent source de conflit et de division, elles mineront l’objectif fondamental de la clôture, qui est de trouver une demeure dans l’amour infini et la miséricorde infinie de Dieu. Il est essentiel que la discussion sur la clôture soit menée dans la charité et en vue d’une compréhension mutuelle. Si cette discussion génère colère et intolérance, nous abattrons la clôture plus sûrement que si les moniales « faisaient le mur » tous les jours.
Quelque étroite que puisse sembler la clôture, habiter avec Dieu ouvre un espace immense, « de l’ampleur, et de la hauteur, et de la profondeur de l’amour de Dieu » (cf. LCM 36). Sr Margaret Ebner raconte : parfois, en recevant l’Eucharistie, « mon cœur se gonflait tant que je ne pouvais le contenir. Il me semblait qu’il devait être aussi grand que l’univers entier » . Cette « expansion du cœur » (latitudinem cordis), dont parle Thomas, nous ouvre à l’immensité de Dieu. Si nous habitons avec le Seigneur, Il nous conduira à des espaces infinis, même dans l’enceinte d’une petite clôture. Si la clôture est bien vécue, elle a pour fruit une magnanimité, une grandeur d’âme et de cœur, où toute petitesse est transcendée.
Le gouvernement
La spiritualité dominicaine de l’amitié trouve sa principale expression dans notre système de gouvernement, qui se fonde sur la dignité de chaque sœur et sur l’égalité de toutes. Le gouvernement n’est pas la tâche de quelques unes mais la manière dont toutes partagent la responsabilité de la vie de la communauté.
Au cœur d’un bon gouvernement, il y a l’obéissance, « non comme des esclaves de la loi, mais en femmes libres dans la grâce » (cf. LCM 1§ VI). Comme l’écrivait Damian Byrne dans une lettre à la Fédération mexicaine, « Le mot obéissance signifie écouter. Selon la tradition dominicaine, dans le monastère on doit écouter la Prieure, le Conseil et le Chapitre. Chacun a son autorité spécifique qui doit tenir compte des autres autorités légitimes. Aucune autorité ne domine seule » . Aussi les monastères seront-ils florissants et heureux si les moniales s’écoutent les unes les autres. Plus que tout autre, le chapitre est le lieu de cette écoute mutuelle. « Pour que leur vie contemplative et leur communion fraternelle donnent des fruits plus abondants, la participation de toutes à l’organisation de la vie du monastère est d’une grande importance : ‘Le bien qui recueille une approbation générale est aisément et rapidement accompli.’ (Humbert de Romans) » (LCM 7).
D’après mon expérience des frères, les chapitres sont porteurs de vie quand nous avons la confiance de parler et la confiance d’écouter. On peut avoir peur de parler à un chapitre. Il m’a fallu près d’un an pour ouvrir la bouche et j’écrivais d’abord ce que je voulais dire sur un bout de papier, que je relisais attentivement plusieurs fois avant d’oser dire un seul mot. En général, quand je me sentais prêt il était déjà trop tard ! La supérieure a pour tâche de construire la communauté en engageant toutes les sœurs à parler, en particulier celles qui hésitent ou ne sont pas d’accord avec la majorité. Désaccord ne signifie pas déloyauté ou désunion.
Il nous faut aussi la confiance d’écouter sans crainte. Écouter est le fruit du silence dans lequel nous tendons l’oreille à Dieu. La vie contemplative sera une formation à l’écoute. Une moniale polonaise m’a dit un jour : « Tout le monde parle aujourd’hui mais personne n’écoute. Nous, les moniales, sommes là pour écouter ». Le résultat de l’écoute de Dieu dans le silence devrait être l’attention à ce que nos sœurs ont vraiment à dire, et non ce que l’on redoute ou que l’on attend qu’elles disent. Une écoute authentique n’est possible que si l’on est en paix. Souvent, une sœur qui essaie d’exprimer un doute ou une question ne trouve pas le mot juste. Elle cherche ses mots, elle a l’air perdue ou énervée, et il serait facile de la faire taire ou de l’écarter. Mais si nous écoutons attentivement et intelligemment, nous pourrons saisir le grain de vérité qu’elle a à partager. Cela suppose de toujours donner la meilleure interprétation possible de ce qu’elle dit, l’écouter d’une oreille charitable. Toute la Summa Theologica se fonde sur le principe de prendre à cœur les objections. La recherche du consensus peut prendre du temps. Même si la communauté ne parvient pas à un consensus, les minorités accepteront plus facilement la décision finale si elle savent avoir été entendues.
On a parfois peur d’aborder les vrais problèmes. Parce qu’on n’est pas sûr d’où la discussion nous emmènera. Mais la peur est la plus grande ennemie de la vie religieuse. Si nous avons confiance dans le Seigneur, les flots du chaos ne nous enseveliront pas. Si nous laissons la peur prendre le dessus, c’est que la communauté n’a pas fait sa demeure en Dieu, solide comme un roc. C’est surtout à la supérieure de conduire la communauté au-delà de la peur.
Les communautés sont généralement sans crainte lorsque les institutions de gouvernement -le chapitre, le conseil et la prieure- se soutiennent réciproquement au lieu d’être en compétition. La prieure est la gardienne de la dignité et de la voix de chaque membre de la communauté. Mais la prieure doit aussi recevoir le soutien de toute la communauté. Comme l’écrivait Damian, avec sa sagesse coutumière, « Il faut bien admettre qu’il y a dans les communautés des membres qui se plaignent constamment et des perturbatrices professionnelles. Une prieure doit être soutenue par sa communauté pour permettre à ces sœurs de se voir telles qu’elles sont et ne pas leur laisser faire du mal à la communauté. Et je lance un appel, car la miséricorde et la considération que nous nous devons les uns aux autres ne devraient-elles pas à plus forte raison être accordées aussi à nos supérieurs ? » . Discuter librement ce n’est pas être dans l’opposition. Si nous sommes véritablement une communauté, même si je n’ai pas voté pour le supérieur, nous avons voté pour le supérieur. Si je suis bien un frère ou une sœur de la communauté, je dois accepter ce vote comme le mien.
Un monastère dominicain n’a pas d’abbesse mais une prieure, qui est prima inter pares. Cela exprime l’amitié entre pairs qui est notre vie même. Si la communauté est solide, le passage à une nouvelle prieure devrait se faire sans drame. Les postulations devraient être rares. Mais si une prieure a réuni autour d’elle un groupe de moniales qui pensent comme elle, qui dominent la communauté, soit l’élection sera la continuation de la ‘dynastie’, soit il y aura un ‘coup d’état’ ! Une supérieure doit avoir le courage de prendre les décisions qui sont vraiment de son ressort, tout en fortifiant toute la communauté afin que le passage de la succession se fasse sans douleur.
4. La recherche de la vérité
Vous êtes moniales de l’Ordre qui a Veritas pour devise. Les dominicains sont réputés depuis toujours pour leur passion de l’étude. Certaines moniales m’ont fait part de leur sentiment d’être fort éloignées de cet élément de la vie dominicaine, soit qu’elles n’aient jamais pu étudier soit qu’elles ne s’en sentent pas capables. Et il est tentant de penser que ce sont les frères qui étudient et les moniales qui prient ; les frères qui parlent et les moniales qui écoutent. Ce serait se méprendre sur la nature de notre engagement au service de la Vérité. Il s’agit d’une manière d’être au monde selon la vérité. Chacun et chacune de nous y est appelé, que nous soyons doués pour les études intellectuelles ou pas.
Vivre dans la vérité
Veritas c’est l’appel à être des hommes et des femmes qui vivent dans la vérité, parlent selon la vérité, et écoutent attentivement. Souvent la communication dans les communautés religieuses finit par être distordue. Insinuations, allusions, soupçons brouillent la clarté de nos conversations. Par peur ou par manque de confiance on a recours à l’allusion, au coup de coude, au clin d’œil. Cela participe de notre vie dominicaine que d’oser parler en vérité, avec discrétion et sensibilité et respect. Cela n’a rien à voir avec l’érudition. C’est essayer de vivre avec la clarté de Dominique. « Celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu » (Jn 3, 21). Manifesté signifie que l’on voit clairement ce qui est fondamental et essentiel et que l’on ne se laisse pas distraire par des détails.
Le fr. Simon Tugwell OP a écrit qu’ »il est, en effet, tout à fait typique de la spiritualité dominicaine de concevoir Dieu, non d’abord comme l’objet de notre attention, mais plutôt comme le sujet essentiel, à qui nous sommes unis, en co-sujets, coopérateurs (1 Co 3, 9) de son œuvre de rédemption » . C’est dire que comme amis de Dieu, nous ne regardons pas tant Dieu que nous ne regardons avec lui. Nous sommes invités à voir le monde à travers les yeux de Dieu, donc à voir combien le monde est bon. Eckhart écrit : « Dieu se complaît en lui-même. Sa délectation intime est telle qu’elle rejaillit en délectation de toutes ses créatures. » . Voir à travers les yeux de Dieu, c’est partager sa joie de toutes les choses qu’il a faites, dont nos frères et nos sœurs ! Thomas Merton raconte comment, après sept ans de vie monastique, il alla un jour chez le dentiste et vit le monde différemment. « Je me demandais comment j’allais réagir en me trouvant à nouveau face à face avec le monde mauvais. Mes raisons d’en vouloir au monde quand je l’avais quitté étaient peut-être mes propres défauts, que j’y avais projetés. À présent, au contraire, je découvrais que toute chose m’émouvait d’un sentiment profond et muet de compassion… Je traversai la ville, réalisant pour la première fois de ma vie à quel point les gens du monde sont bons, et combien ils ont de valeur aux yeux de Dieu. » À force de regarder avec Dieu, nous partageons l’amour de Dieu. Si nous apprenons cette manière d’être au monde selon la vérité, nous pourrons faire face à n’importe quoi avec joie : nos échecs, le fait que nous soyons mortels, la vérité sur la situation de notre monastère, nos peurs et nos espoirs. Nous pouvons être joyeux et joyeuses jusque dans les ténèbres.
L’étude de la Parole de Dieu
Le LCM 101 § II dit que les moniales doivent tout particulièrement étudier la Parole de Dieu. Ce n’est pas une activité aride. Jourdain dit à Diane : « Relis cette Parole en ton cœur, retourne-la dans ton esprit, fais-la devenir aussi douce que le miel sur tes lèvres, médite-la, habite-la, afin qu’elle habite avec toi et en toi à jamais » . Pour que la Parole puisse toucher et changer tout ce que nous sommes, nous devons y ramener chaque aspect de notre humanité : notre intelligence, nos émotions, notre sens de la beauté, notre expérience, nos difficultés et nos espoirs.
Une fois par semaine, au Conseil généralice, nous nous réunissons pour lire en commun la Parole de Dieu. Certains apportent une analyse de la langue d’origine, d’autres nous font partager comment la Parole les touche, comment elle illumine une expérience récente, ou les provoque, ou les intrigue. Ce sont toutes de bonnes manières de lire la Parole, et il nous les faut toutes. C’est pourquoi il est bon de la méditer ensemble et de la laisser transformer notre vie commune. Toutes les moniales peuvent avoir des intuitions personnelles à offrir. Le Seigneur dit à Catherine : « J’aurais bien pu doter chacun de tout ce qui lui était nécessaire spirituellement et matériellement, mais j’ai voulu qu’ils eussent besoin les uns des autres » . Ceci vaut tout particulièrement pour la compréhension de la Parole de Dieu.
L’étude exégétique des Écritures est parfois ardue au démarrage. On craint de lire ce que dit l’érudit, de peur que nos convictions les plus intimes n’en soient ébranlées. Quand on commence à étudier, il faut passer par l’angoissante découverte que nous n’avions jamais compris le texte. Mais c’est là notre humilité devant la Parole que nous ne détenons pas et qui nous invite à nous mettre en route, on ne sait pour où. Osons être comme Marie qui à l’écoute du message de l’ange « fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation » (Luc 1, 29). Apprenons à nous laisser surprendre par la Parole, qui dit toujours plus que nous ne l’aurions imaginé. Voilà pourquoi il est bon que toute communauté ait des moniales qui étudient activement les Écritures, si possible dans les langues originales. J’avoue pour ma part que mes tentatives répétées d’apprendre l’hébreu ont été un désastre !
Dans toutes les communautés cloîtrées rôde la menace de l’ennui : vivre toujours au même endroit, toujours avec les mêmes gens, entendre répéter les mêmes plaisanteries et manger toujours la même chose. Mais la Parole est toujours nouvelle, fraîche de l’éternelle jeunesse de Dieu. Régulièrement, nous avons besoin de ressaisir la passion des disciples au retour d’Emmaüs, « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? » (Luc 24, 32). L’étude de la Bible renouvelle notre capacité d’émerveillement.
L’étude de la théologie
Dans mes visites aux monastères, je demande souvent aux moniales quelle théologie elles aiment étudier. En général, il y a un silence, et on change vite de sujet. La théologie est généralement considérée comme intellectuelle et incompréhensible. Le LCM 101 § III exhorte les moniales à étudier saint Thomas, mais je soupçonne que souvent la Summa prend la poussière sur les rayons des bibliothèques. On pourrait être tenté de penser que les frères étudient la théologie tandis que les moniales étudient la spiritualité. Cette opposition moderne aurait semblé totalement incompréhensible à Dominique et Catherine. La théologie n’est pas simplement une discipline intellectuelle. Elle fait partie de notre recherche du Seigneur dans le jardin, de notre soif de sens, de notre entrée dans le mystère de l’amour. Par la connaissance nous approchons de celui que sainte Catherine appelait prima dolce verità, la première douce vérité. L’une des manières de prier de Dominique était l’étude d’un livre, et il disputait avec l’ouvrage, niant tout haut, hochant la tête, s’exclamant. Quand saint Thomas écrivit la Summa, il renvoyait parfois les secrétaires et se jetait à terre pour prier jusqu’à recevoir la compréhension. Théologie et spiritualité sont inséparables.
Quantité d’écrits théologiques sont profondément ennuyeux, mais c’est peut-être de la mauvaise théologie. Nous avons besoin qu’on nous présente la Summa pour ce qu’elle est, une œuvre contemplative qui parle de notre chemin vers Dieu et vers le bonheur. Son enseignement nous libère des pièges qui pourraient nous écarter du pèlerinage. Tant de gens se laissent prendre à des conceptions idolâtres de Dieu comme personne puissante et invisible qui contrôle tout ce qui nous arrive, et nous maintient dans une perpétuelle immaturité. Beaucoup du ressentiment des communautés religieuses vient de la colère contre cette image de Dieu, qui est une idole. Mais Thomas fait exploser cette idée dans la Prima Pars, il ouvre la porte de cette prison spirituelle, et nous pousse sur la voie du mystère de Dieu, éternelle source de liberté au cœur même de notre être. Trop de gens sont prisonniers d’une vision étroite de la sainteté comme obéissance aux règles. Alors que dans la Secunda Pars, Thomas nous montre que croître en vertu, ce qui nous rend fort et nous fait partager la liberté même de Dieu, c’est la voie de la sainteté. Tant de gens sont piégés dans une vision magique de la religion. Au contraire dans la Tertia Pars, Thomas nous montre comment dans l’Incarnation et les sacrements, Dieu embrasse toute notre humanité et la transforme. L’indice de la bonne théologie est qu’elle se répand en prière et adoration et bonheur et en une authentique liberté intérieure. Il existe peu d’aussi bonne théologie. Peut-être des moniales sont-elles appelées à l’écrire. « Dans le domaine de la réflexion théologique, culturelle et spirituelle, on attend beaucoup du génie de la femme non seulement pour la spécificité de la vie consacrée féminine, mais encore pour l’intelligence de la foi dans toutes ses expressions. » (Vita consecrata 58).
Se former à la Veritas
Il s’ensuit qu’une partie essentielle de la formation d’une moniale dominicaine réside dans l’étude des Écritures et de la théologie. Ce n’est pas un banal addendum, comme apprendre à coudre ou à cuisiner. Cette étude fait partie de notre progression dans l’amour, « Car l’amour suit la connaissance et, en aimant, l’âme s’efforce de suivre la vérité et de s’en revêtir » .
Étudier la théologie doit donner du bonheur. Nous apprenons les grandes choses que Dieu a faites pour nous. Thomas disait : « Ceux qui se consacrent à la contemplation de la vérité sont les plus heureux qui soient dans cette vie » . Et pour lui, la contemplation signifiait en grande partie étudier. Nous apprenons à aimer la Parole de Dieu et sommes « nourris de sa douceur (dulcedo) » , comme l’a dit Albert. Comme l’initiation à tout bonheur profond plutôt qu’à un simple divertissement, ce chemin amène ses moments d’ennuis où nous nous sentons incapables de rester dans notre cellule. Nous devons apprendre la confiance, pour penser, interroger, chercher. Selon Thomas, l’enseignant doit avant tout apprendre à l’élève à penser par lui-même, à réaliser son potentiel de connaissance. Cela veut dire qu’en apprenant à étudier, nous n’avons pas à redouter de faire des erreurs. Les formateurs ne doivent pas surveiller leurs étudiants avec crainte. Osons lancer les idées, sans nous inquiéter de nous tromper au début. Bien sûr, l’orthodoxie est chère aux dominicains, mais si nous croyons l’enseignement de l’Église selon lequel l’Esprit Saint a été répandu en nous, nous ne nous enferrerons pas aisément dans l’erreur.
Les moniales ont besoin d’outils pour étudier : une bonne bibliothèque, des revues et du temps. Beaucoup de monastères sont pauvres et acheter des livres est un véritable sacrifice. Mais nous ne pouvons pas plus priver les moniales de livres que de nourriture. Internet offre des possibilités de suivre une formation théologique sans même quitter le monastère. La communauté doit ménager des temps d’étude à l’intérieur de son rythme de vie. Le calendrier annuel de Chalais, en France, inclut des périodes d’étude intensive, de silence, et de détente. Les frères aussi doivent répondre aux besoins de formation des sœurs. Quand saint Dominique rentrait à St-Sixte épuisé par une journée de prédication, il enseignait pourtant encore aux moniales, « parce qu’elles n’avaient pas d’autre maître pour le faire » . La vitalité des monastères dominicains du Rhin au quatorzième siècle est en partie due au fait que Herman de Minden, provincial de Teutonie, avait envoyé ses meilleurs théologiens enseigner aux moniales.
Les monastères ont besoin de sœurs dotées d’une solide formation théologique et biblique, de sorte qu’elles puissent enseigner aux jeunes. Cela vaut tout spécialement aujourd’hui où beaucoup de moniales nous arrivent de l’université. Elles ont besoin d’une formation théologique qui dilate leur esprit et réponde à leurs questions. L’idéal serait que chaque monastère puisse proposer une formation complète, mais si tel n’est pas le cas, la coopération entre monastères, en particulier là où existe une fédération, n’est que plus vitale. Parfois, on trouve cette peur qu’en allant étudier dans un autre monastère, les jeunes perdent leur attachement à leur communauté d’origine et demandent leur transfiliation. Cela arrive rarement, et ne saurait être une excuse pour ne pas donner à une sœur sa pleine et authentique formation dominicaine. Si les jeunes sont bien formées, c’est la communauté tout entière qui s’en trouvera renouvelée. La maison de formation des monastères du Mexique est un merveilleux exemple de la manière dont une fédération peut aider chacun des monastères à se consolider.
5. L’unité de l’Ordre
Vous êtes moniales de l’Ordre des Prêcheurs et faites partie de la grande Famille de Dominique. Chaque monastère est porteur de vie en soi, tout en étant en contact avec d’autres monastères, souvent même au sein d’une fédération. Vous êtes souvent un centre de vie pour la Famille dominicaine. Vous faites vos vœux au Maître de l’Ordre. Que signifie pour un monastère veiller à sa vie propre et en même temps appartenir à l’Ordre ?
Servir l’unité
Dominique voulut que son Ordre soit un. Et l’Ordre s’est toujours battu pour préserver son unité. Quand d’autres Ordres se sont divisés, nous nous sommes cramponnés à notre unité, parfois de justesse ! C’est que notre unité fait partie de notre prédication de l’Évangile. Nous prêchons le Royaume de Dieu, où l’humanité entière sera réconciliée dans le Christ. Nos paroles n’ont d’autorité que si nous sommes unis nous-mêmes. L’Ordre a un rôle particulièrement important à jouer dans une Église souvent partagée entre différentes idéologies concurrentes. Et puis des conflits politiques, des tensions ethniques, des guerres même déchirent parfois nos pays. Nous devons incarner la paix que nous prêchons.
Chaque monastère incarne cette unité en lui-même, mais l’unité « transcende les limites du monastère et atteint sa plénitude dans la communion avec l’Ordre et toute l’Église du Christ » (LCM 2 § I). Aussi avez-vous soin, en tant que moniales dominicaines, de l’unité de l’Ordre entier. Dans vos prières et dans tout ce que vous dites et faites, vous êtes aussi responsables de promouvoir cette unité, et la paix. Et les contemplatifs sont tout particulièrement qualifiés pour le faire parce que la proximité du mystère de Dieu emporte au-delà de toute division, fait dépasser toute prétention partisane à proclamer la sagesse ou la connaissance absolue.
La nature de l’autonomie
Chaque monastère est autonome. Cette autonomie participe de la nature même de votre vie de communautés monastiques. Vous vous en réjouissez à juste titre. Que signifie-t-elle ? Littéralement, elle signifie que chaque communauté se gouverne elle-même et assume la responsabilité de sa propre vie. Chaque monastère est responsable de construire une communauté qui soit un signe du Royaume de Dieu, où règne l’amour mutuel et où l’on demeure avec le Seigneur. Votre autonomie est la libre responsabilité de votre vie contemplative, plutôt qu’un isolement.
Dans la culture occidentale contemporaine, on a tendance à concevoir l’autonomie comme synonyme de séparation. On considère qu’un individu est libre pour autant qu’il ou elle est libre de toute ingérence extérieure. Mais la compréhension catholique de ce que signifie être humain propose un autre modèle, selon lequel c’est dans la communion avec les autres que nous trouvons la véritable liberté et l’authentique autonomie. Autonomie ne veut pas dire autarcie. C’est pourquoi l’Église apprécie les fédérations de monastères, parce que le soutien mutuel des fédérations peut aider individuellement les monastères à « garder et promouvoir les valeurs de la vie contemplative » (Verbi Sponsa 27). La coopération peut aider le monastère à être libre et prendre la responsabilité de sa vie. J’ai souvent visité des monastères aux moniales débordées par le soin des malades, la cuisine, le souci de faire entrer un revenu, l’entretien des bâtiments. Pas de temps pour prier. Ce genre de communauté est peut-être totalement indépendante, mais elle a perdu sa véritable autonomie, sa liberté et la responsabilité de sa vie. Des monastères qui s’aident réciproquement pour la formation, le soin aux malades comme à Dax, en France, ou la gestion financière, ne perdent pas leur autonomie, mais l’acquièrent d’une manière bien plus profonde. Souvent cette aide mutuelle a un prix élevé, et c’est un sacrifice. Car ce sont justement les moniales dont le monastère a le plus besoin qui pourraient apporter de l’aide à une autre communauté.
Le moment peut venir pour un monastère d’envisager sa fermeture . Le cas échéant, les moniales n’ont absolument pas à culpabiliser. Peut-être le monastère a-t-il accompli la mission pour laquelle il avait été fondé. Comme dominicains, il est bon que nous puissions considérer avec honnêteté la perspective d’une fermeture. On me dit quelquefois que si seulement une ou deux vocations arrivaient, le monastère pourrait peut-être survivre ; ne serait-il donc pas possible de chercher des vocations dans d’autres pays ? La volonté de survivre à tout prix peut pousser à accepter des vocations en fait inadéquates. Mais pour nous qui prêchons la mort et la résurrection du Christ, la survie n’est pas une valeur absolue. Si nous croyons en notre Père qui a réveillé Jésus d’entre les morts, nous pouvons affronter la mort, la nôtre et celle de notre communauté, avec espoir et avec joie. Quand j’étais provincial d’Angleterre, j’ai dû aller à Carisbrooke pour en conduire les quatre dernières moniales à leur nouvelle maison. La plus âgée, quatre-vingt-dix ans et quelques, avait apparemment changé d’avis au dernier moment, et puis finalement nous partîmes tous. Les gens des alentours, venus dire au revoir, faisaient des signes, chantaient et pleuraient. Ce départ était peut-être la prédication la plus éloquente de l’Évangile que les moniales eussent jamais faite. Si le monastère est véritablement un lieu où vous demeurez en Dieu, quitter le monastère ne vous prive pas de foyer.
Dans une région ou une fédération qui a beaucoup de monastères et peu de vocations, c’est merveilleux que les moniales aient le courage de réfléchir ensemble à l’avenir. Faut-il que tous les monastères cherchent des vocations, ou ne devrions-nous envoyer les candidates à l’Ordre que là où il y a une possibilité de se développer ? Non pas pour retirer au monastère son droit de prendre les décisions qui concernent sa vie et d’accepter des vocations ; mais plutôt pour l’inviter, dans les temps difficiles, à poursuivre ce qui compte plus que la survie d’un monastère pris individuellement : l’épanouissement de la vie contemplative dominicaine dans la région.
Les visites canoniques sont essentielles dans notre tradition. Elles sont parfois regardées avec appréhension par les monastères parce qu’on peut les voir comme des ingérences du dehors. Le bienheureux Hyacinthe Cormier disait que le but d’une visite est d’encourager, et encourager, et encourager. Son souci est avant tout « le gouvernement interne du monastère » (LCM 227 § III cf. 228 § III), et par conséquent d’aider le monastère à être réellement responsable de sa vie, et libre de relever ses défis. Une visite canonique devrait donc aider le monastère à devenir autonome au vrai sens du terme. Le LCM suggère une visite « au moins tous les deux ans » (227 § III).
Certains monastères expriment encore une certaine inquiétude à propos de la Commission internationale des moniales, établie par le chapitre général d’Oakland en 1989. Il ne s’agit pas d’une entité juridique doté d’un quelconque pouvoir décisionnel ou s’interposant entre le Maître de l’Ordre et les monastères. C’est un groupe de réflexion qui conseille le Maître de l’Ordre, au même titre que les autres commissions de l’Ordre, pour la vie intellectuelle, pour Justice et Paix, pour la mission de l’Ordre. Elle est là pour encourager la vie monastique et tout particulièrement soutenir les monastères isolés. Ce qu’elle fait bien. Son mandat s’achève les mois prochains, et j’apprécierais beaucoup que vous écriviez à mon successeur ou au chapitre général toute suggestion pour l’avenir. Comment cette commission peut-elle aider le Maître de l’Ordre à promouvoir une authentique vie dominicaine, avec toute sa beauté et son importance ?
Les relations avec les frères
Les frères et les moniales partagent une longue histoire. Notre amitié est au cœur de la vie de l’Ordre depuis près de huit cents ans. Cela n’as pas toujours été facile. Au début, les frères avaient souvent envie de fuir toute responsabilité vis-à-vis des monastères, et aujourd’hui encore ils ne prennent pas toujours cette responsabilité au sérieux. Les moniales ont sûrement dû souhaiter quelquefois échapper aux ingérences des frères ! Mais comme un vieux couple, qui en a déjà tant vu, nous pouvons être sûrs que rien ne détruira notre lien. Comme dominicains et dominicaines, l’honnêteté et la transparence doivent marquer notre relation. Surtout, nous devons avoir confiance les uns dans les autres, une relation sans méfiance aucune. Jourdain écrivit au provincial de Lombardie qu’il avait été « alarmé et effrayé par un simple bruissement de feuilles » au moment où il s’inquiétait de rumeurs rapportant que le chapitre général avait pris des décisions contre le monastère de Bologne. Il y a encore de temps en temps quelques moments de paniques déclenchés par « de simples bruissements de feuilles », des soupçons sur le rôle de la Commission internationale, des rumeurs sur les intentions du chapitre général, etc. Confiance, n’ayons pas peur ! Dans le doute, ne soyez pas méfiants, donnez la meilleure interprétation de ce que vous entendez, et demandez un éclaircissement. Avec la transparence et la confiance nous pouvons construire l’unité de l’Ordre.
La vie des monastères peut se compliquer du fait des nombreux hommes qui revendiquent une quelconque autorité sur vous. Certains monastères ont des aumôniers, des assistants, des vicaires, des provinciaux et des évêques ; et puis il y a le Maître de l’Ordre et le Saint-Siège. Tous sont supposés vous conforter et non s’immiscer dans votre vie ou vous contrôler. Par-dessus tout, vos relations avec les frères visent un réconfort mutuel. Le service des frères doit consister à vous soutenir dans la responsabilité que vous avez de votre vie. Tant de frères sortent affermis de leur contact avec les monastères, car nous nous y renouvelons dans le silence d’où jaillit la parole prêchée.
Conclusion
« Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d’un mont » (Mt 5, 14). Cette phrase évoque tellement de monastères perchés sur des montagnes : Chalais, Orbey, Los Teques près de Caracas, Rweza, Drogheda, Vilnius, Pérouse, Santorini, et bien d’autres. Mais que le monastère soit au sommet d’un mont ou dans la plaine, au cœur d’une jungle ou d’une ville, si vous vivez votre vie avec joie, sa lumière ne se pourra cacher. Comme l’a écrit le pape Jean Paul II, notre vie consacrée existe « pour que ce monde ne soit pas privé d’un rayon de la beauté divine qui illumine la route de l’existence humaine » . Faites confiance à votre mode de vie monastique. C’est un don de Dieu.
À Noël 1229, Jourdain écrivit à Diane pour fêter la naissance « d’une toute petite parole », née pour nous. Il lui envoie aussi un autre mot, « court et bref, mon amour ». La présente lettre n’est hélas ni courte ni brève, mais elle exprime mon amour et ma gratitude pour votre place au cœur de l’Ordre. Priez pour toute la Famille dominicaine, confiée à votre soin. Priez pour le fr. Viktor Hosftetter, précédent promoteur général des moniales, que vous êtes tant à aimer, et pour son successeur, fr. Manuel Merten, que vous allez aimer. Priez pour moi et pour mon successeur. ![]()
Remis à Ste-Sabine en la fête de sainte Catherine de Sienne, 2001.
Votre frère en saint Dominique,
fr. Timothy Radcliffe OP
Maître de l’Ordre
La mission dans un monde en fuite: les futurs citoyens du Royaume de Dieu
Conférence du Maître de l’Ordre à l’assemblée annuelle de Sedos, le 5 décembre 2000
fr. Timothy Radcliffe, o.p.
On m’a demandé de réfléchir à une spiritualité de la mission à l’ère de la mondialisation. Que signifie être missionnaire à Disneyland ? Ravi que l’on me demande cette conférence dont le sujet est passionnant, j’hésitais pourtant parce que je n’ai  jamais été missionnaire au sens usuel du mot. Au chapitre général électif de l’Ordre à Mexico, il y huit ans, les frères ont défini les critères de sélection d’un Maître de l’Ordre : il était essentiel que le candidat ait une expérience pastorale hors de son propre pays. Et puis il m’ont élu, moi qui n’avais jamais travaillé que comme universitaire en Angleterre. Je ne sais pas si toutes les congrégations se conduisent de manière aussi excentrique, mais cela montre combien je me sens mal placé pour présenter cette conférence.
jamais été missionnaire au sens usuel du mot. Au chapitre général électif de l’Ordre à Mexico, il y huit ans, les frères ont défini les critères de sélection d’un Maître de l’Ordre : il était essentiel que le candidat ait une expérience pastorale hors de son propre pays. Et puis il m’ont élu, moi qui n’avais jamais travaillé que comme universitaire en Angleterre. Je ne sais pas si toutes les congrégations se conduisent de manière aussi excentrique, mais cela montre combien je me sens mal placé pour présenter cette conférence.
Qu’y a-t-il de si neuf dans notre monde, que nous devions chercher une nouvelle spiritualité de la mission ? En quoi est-il si différent du monde où les générations précédentes de missionnaires étaient envoyées ? On pourrait répondre de manière automatique que la nouveauté, c’est la mondialisation. Les e-mails du monde entier affluent dans nos bureaux. Des milliards de dollars font chaque jour le tour des marchés du monde -mais pas le tour de l’Ordre dominicain ! Comme on dit souvent, nous vivons dans un « village global ». Les missionnaires ne sont plus dispersés sur les navires partant pour des pays inconnus ; à peu près aucun point de la planète n’est à plus d’un jour de voyage. Mais je me demande si la « mondialisation » définit vraiment le nouveau contexte de la mission. Le village global est le fruit d’une évolution historique qui court au moins sur les cinq cents, sinon cinq mille dernières années. Des experts soutiennent qu’à plus d’un titre, la société était il y a un siècle tout aussi mondialisée qu’aujourd’hui.
Peut-être ce qui caractérise véritablement notre monde est-il un fruit particulier de la mondialisation, à savoir que nous ne savons pas où va le monde. Nous n’avons aucun sentiment commun de la direction que prend notre histoire. Le gourou de Tony Blair, Anthony Giddens, appelle cela « le monde en fuite ». L’histoire s’avère hors de notre contrôle et nous ne savons pas où nous nous dirigeons. C’est pour ce monde en fuite que nous devons trouver une vision et une spiritualité de la mission.
Les premières grandes missions de l’Église hors d’Europe furent liées au colonialisme du seizième au dix-septième siècle. Espagnols et Portugais emmenaient leurs frères mendiants avec eux tout comme les Hollandais et les Anglais emmenaient leurs missionnaires protestants. Que ces missionnaires aient soutenu ou critiqué les conquérants, il y avait en tous cas un sentiment commun de la direction que prenait l’histoire : elle allait vers la domination occidentale du monde. C’est ce qui donnait son contexte à la mission. Dans la seconde moitié de ce siècle, la mission s’est déroulée dans un nouveau contexte, celui du conflit entre les deux grands blocs de pouvoir de l’Est et de l’Ouest, du communisme et du capitalisme. Certains missionnaires ont peut-être prié pour le triomphe du prolétariat, d’autres pour la défaite du communisme impie; ce conflit était en tous cas le contexte de la mission.
À présent, avec la chute du Mur de Berlin, nous ne savons pas où nous allons. Allons-nous vers le bien-être universel, ou notre système économique est-il sur le point de s’effondrer ? Verrons-nous un Grand Boom ou un Big Bang ? Les Américains vont-ils dominer l’économie mondiale durant des siècles, ou touchons-nous à la fin d’une brève période où l’Occident était au centre du monde ? La communauté mondiale va-t-elle s’étendre et englober tout le monde, y compris le continent oublié, l’Afrique ? Ou bien le village global va-t-il se rétrécir et laisser une majorité de gens à l’écart ? Est-ce un village global ou un pillage mondial ? Nous ne le savons pas.
Nous ne le savons pas parce que la mondialisation a abordé une nouvelle phase avec l’introduction de technologies dont nul ne saurait prévoir les conséquences. Nous ne le savons pas parce que, d’après Giddens, nous avons inventé un nouveau type de risque. Les êtres humains ont toujours eu affaire au risque, le risque des épidémies, des mauvaises récoles, des tempêtes, des sécheresses, et une fois ou l’autre des invasions barbares. Mais ces risques étaient en grande partie extérieurs, incontrôlables. On ne pouvait jamais savoir quand une météorite tomberait sur la planète, ou si un rat plein de puces n’allait pas apporter la peste bubonique. Alors que maintenant, nous sommes principalement menacés par ce que nous avons nous-mêmes créé, ce que Giddens appelle « le risque fabriqué » : réchauffement de la planète, surpopulation, pollution, instabilité des marchés, conséquences imprévisibles de la manipulation génétique. Nous ne connaissons pas les effets de ce que nous sommes en train de faire. Nous vivons dans un monde en fuite. Cela génère une angoisse profonde. Nous, chrétiens, ne détenons aucune connaissance particulière concernant l’avenir. Nous ne savons pas davantage que les autres si nous sommes sur le chemin de la guerre ou de la paix, de la prospérité ou de la pauvreté. Nous aussi sommes souvent hantés par l’angoisse de nos contemporains. Pour ma part il se trouve que je suis profondément optimiste sur l’avenir de l’humanité, mais est-ce pour avoir hérité la confiance de saint Thomas dans la bonté profonde de l’humanité ou bien les gênes optimistes de ma mère ?
Dans un monde en fuite, ce qu’offrent les chrétiens n’est pas connaissance mais sagesse, la sagesse de la dernière destination de l’humanité, le Royaume de Dieu. Nous n’avons peut-être aucune idée de la manière dont viendra son Règne, mais nous croyons en son triomphe. La mondialisation est riche en connaissances. En fait, l’un des défis de la vie dans ce monde cybernétique est justement que nous sommes submergés d’informations, mais il y a bien peu de sagesse. Il n’y a guère de sentiment du destin ultime de l’humanité. Et même, l’angoisse que nous éprouvons face à l’avenir est telle qu’il est plus facile de ne pas y penser du tout. Saisissons le moment présent. Mangeons, buvons et soyons heureux car demain nous serons peut-être morts. Aussi notre spiritualité missionnaire doit-elle être sapientielle, sagesse de la fin à laquelle nous sommes appelés, une sagesse qui nous libère de l’angoisse.
Dans cette conférence, mon idée est que le missionnaire peut être porteur de cette sagesse de trois manières, par sa présence, par l’épiphanie et par la proclamation. Il y a des endroits où tout ce que nous pouvons faire c’est être présents, mais il est naturel d’éprouver le désir de rendre visible notre espoir, de manifester notre sagesse. Le Parole s’est faite chair et aujourd’hui dans notre mission la chair se fait parole.
La présence
Un missionnaire est envoyé. C’est le sens de ce mot. Mais à qui les missionnaires sont-ils envoyés dans notre monde en fuite ? Quand j’étais à l’école chez les bénédictins, des missionnaires sont venus de loin nous rendre visite : d’Afrique, d’Amazonie. Nous économisions notre argent pour que des enfants puissent être baptisés de nos noms. Il devrait y avoir dans le monde des centaines de Timothy quadragénaires. Ainsi les missionnaires étaient-ils envoyés de l’Occident dans d’autres pays. Mais d’où les missionnaires sont-ils envoyés aujourd’hui ? Ils venaient autrefois d’Irlande, d’Espagne, de Grande Bretagne, de Belgique et du Québec. Mais aujourd’hui bien peu de missionnaires proviennent de ces pays. Le missionnaire moderne vient d’Inde ou d’Indonésie. Je me rappelle l’excitation de la presse britannique à l’arrivée en Écosse du premier missionnaire de Jamaïque. Ainsi dans notre village global, il n’y a pas de centre d’où les missionnaires soient dispersés. Dans la géographie du World Wide Web, il n’y a pas de centre, du moins en théorie. Dans la pratique, nous savons qu’il y a plus de lignes téléphoniques à Manhattan que dans toute l’Afrique subsaharienne.
Comme début de réponse, je dirais que dans ce nouveau monde, les missionnaires sont envoyés à ceux qui sont autres, distants de nous par leur culture, leur religion ou leur histoire. Loin de nous mais pas forcément physiquement, ils sont étrangers mais peuvent être nos voisins. L’expression « village global » sonne accueillante et intime, comme si nous appartenions tous à une seule, immense, heureuse famille humaine. Mais notre ère de la mondialisation est traversée de divisions et fractures qui font de nous des étrangers aux yeux des autres, nous rendant incompréhensibles et parfois ennemis. Le missionnaire est envoyé sur ces lieux. Pierre Claverie, évêque dominicain d’Oran en Algérie, a été assassiné par l’explosion d’une bombe en 1996. Peu avant sa mort il écrivait : « L’Église accomplit sa vocation quand elle est présente aux ruptures qui crucifient l’humanité dans sa chair et son unité. Jésus est mort écartelé entre ciel et terre, bras étendus pour rassembler les enfants de Dieu dispersés par le péché qui les sépare, les isole et les dresse les uns contre les autres et contre Dieu lui-même. Il s’est mis sur les lignes de fracture nées de ce péché. En Algérie, nous sommes sur l’une de ces lignes sismiques qui traversent le monde : Islam/Occident, Nord/Sud, riches/pauvres. Nous y sommes bien à notre place car c’est en ce lieu là que peut s’entrevoir la lumière de la Résurrection ».
Ces lignes de fracture ne courent pas uniquement entre différentes parties du monde : le Nord et le Sud, le monde développé et celui que l’on dit en développement. Ces lignes traversent chaque pays et chaque ville : New York et Rome, Nairobi et Sao Paulo, Delhi et Tokyo. Elles divisent qui a l’eau potable et qui non, qui a accès à l’Internet et qui non, le lettré et l’illettré, la droite et la gauche, qui a une religion différente, les blancs et les noirs. Le missionnaire doit être porteur d’une sagesse, du « dessin bienveillant qu’Il avait formé (dans le Christ) par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis : ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres » (Ép 1,10). Et cette sagesse, nous la représentons par notre présence à ceux que séparent de nous les murailles de la division.
Mais nous devons aller plus loin. Être missionnaire n’est pas ce que l’on fait ; c’est ce que l’on est. Tout comme Jésus est l’envoyé (Hé 3,1). Être présent à l’autre, vivre sur les lignes de fracture, implique une transformation de ce que l’on est. C’est en étant avec cette autre personne et en étant là pour elle, que je découvre une nouvelle identité. Je pense à un vieux missionnaire espagnol que j’ai connu à Taiwan, qui avait travaillé en Chine de nombreuses années et y avait été emprisonné. Maintenant qu’il était vieux et malade, sa famille souhaitait qu’il retourne en Espagne. Mais il disait : « Je ne peux pas retourner là-bas. Je suis Chinois. Je serais un étranger en Espagne. » Rencontrant un groupe de leaders juifs américains en 1960, Jean XXIII les sidéra quand il entra en disant « Je suis Joseph votre frère ». Voilà qui je suis et je ne peux être moi-même sans vous. Ainsi être envoyé implique-t-il de mourir à ce que l’on était. On abandonne une petite identité. Quelqu’un demanda un jour à Chrys McVey, un de mes frères américains qui vit au Pakistan, combien de temps il y resterait et il répondit : « jusqu’à ce que je sois fatigué de mourir ». Être présent pour les autres et avec eux est une sorte de mort de notre ancienne identité pour devenir un signe du Royaume où nous ne ferons qu’un.
Nicholas Boyle a écrit que « la seule réponse défendable du point de vue moral et consistante du point de vue conceptuel à la question « qui sommes-nous ? » est celle-ci : « les futurs citoyens du monde ». Nous ne sommes pas simplement des gens qui travaillent pour un nouvel ordre du monde, tentant de dépasser la guerre et la division. Nous sommes aujourd’hui les futurs citoyens du monde. On pourrait adapter les mots de Boyle et dire que nous sommes aujourd’hui les futurs citoyens du Royaume de Dieu. Son Règne est mon pays. Je découvre maintenant qui je serai alors par la proximité de ceux qui me sont le plus éloignés. C’est précisément notre catholicisme qui nous pousse au-delà de toutes les identités réduites, sectaires, tous les petits sentiments étriqués de nous-mêmes, vers ce que pour le moment nous ne pouvons qu’entrevoir. Voilà l’incarnation de notre sagesse.
Ce n’est pas facile, et exige par-dessus tout d’être fidèle. Le missionnaire n’est pas un touriste. Le touriste peut se rendre dans des sites exotiques, les photographier, profiter de la nourriture et des paysages, puis rentrer chez lui arborer fièrement ses T-shirts souvenirs. En restant là, le missionnaire n’est qu’un signe du Royaume de Dieu. Comme le disait un de mes frères, « tu ne te contentes pas de défaire tes bagages, tu les jettes, tes bagages ».
Je ne veux pas dire par là que tous les missionnaires doivent rester jusqu’à la mort. Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour s’en aller : un nouveau défi à relever ailleurs, la maladie ou l’épuisement, etc. Mais ce que je veux dire, c’est que la mission implique la fidélité. La fidélité de ce missionnaire espagnol, rencontré dans la jungle péruvienne, qui reste simplement là, année après année, rendant visite aux mêmes gens, refaisant les mêmes voyages dans les mêmes petits campements, fidèle au poste même s’il n’a pas l’air de se passer grand-chose. Souvent, la souffrance du missionnaire est la découverte que sa présence n’est pas souhaitée. Les populations locales ou même les vocations locales de sa propre congrégation, de son ordre, attendent peut-être qu’il s’en aille. Sa force intérieure c’est de rester là quand même, parfois sans être apprécié. L’héroïsme du missionnaire consiste à oser découvrir qui il est avec et pour les autres, même lorsque ces autres, eux, ne souhaitent pas découvrir qui ils sont avec et pour lui. Rester là, fidèlement, même si cela peut vous coûter la vie, comme l’ont fait Pierre Claverie et les moines trappistes en Algérie.
J’ai quitté Rome juste avant la Journée Mondiale de la Jeunesse. Mais dans mes rencontres ici et là avec de jeunes laïcs dominicains, j’ai été frappé par leur joie à se trouver en présence de qui est différent d’eux, ne leur ressemble pas. Allemands et Français, Polonais et Pakistanais, il y a une ouverture surprenante qui déborde les barrières de la race et de la culture et de la génération et de la religion. C’est un don des jeunes à la mission de l’Église, et un signe du Royaume de Dieu. Peut-être le défi pour les jeunes missionnaires consiste-t-il à apprendre cette force intérieure, cette fidélité durable à l’autre, face à notre propre fragilité et angoisse. Nos maisons de formation devaient être des écoles de fidélité, où nous apprenions à nous accrocher, tenir bon, même lorsque nous échouons, même lorsqu’il y a des incompréhensions, des crises relationnelles, même lorsque nous pensons que nos frères ou nos sœurs ne nous sont pas fidèles, eux. La réponse n’est pas de nous enfuir, de recommencer, d’entrer dans un autre Ordre ou de nous marier. Nous devons défaire nos bagages et les jeter. La présence ce n’est pas juste être là. C’est rester là. Elle prend la forme d’une vie vécue à travers l’histoire, d’une vie qui tend vers le Royaume de Dieu. La présence durable du missionnaire est bien un signe de la Présence réelle du Seigneur qui nous a donné son corps à jamais.
L’Épiphanie
Dans bien des endroits du monde, tout ce que les missionnaires peuvent faire c’est être là. Dans certains pays communistes et islamiques, rien d’autre n’est possible que d’être un signe implicite du Royaume. Parfois dans les quartiers défavorisés de nos grandes villes ou quand on travaille avec les jeunes ou les fous, la mission doit commencer de manière anonyme. Le prêtre ouvrier est simplement là, à l’usine. Mais notre foi brûle d’assumer une forme visible, d’être vue. Cette année Neil Mac Gregor, Directeur de la National Gallery à Londres, a organisé une exposition intitulée « Voir le Salut ». Durant la plus grande partie de l’histoire européenne, notre religion a été visible à travers les vitraux, la peinture et la sculpture. La célébration de la naissance du Christ commençait autrefois avec l’Épiphanie, la révélation de la gloire de Dieu parmi nous. Quand Syméon reçoit dans ses bras l’enfant Jésus dans le temple, il se réjouit : « car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples » (Lc 2, 30 et suiv.). Comme le dit saint Jean, nous proclamons « ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché » (1 Jn 1,1 et suiv). La mission passe de la présence à l’épiphanie.
Dès la controverse iconoclaste au neuvième siècle, le christianisme a cherché à montrer le visage de Dieu. Dans l’Europe du Moyen-Âge, les gens voyaient rarement des portraits, à part celui du Christ et des saints, mais dans notre monde, nous sommes bombardés de visages. Nous avons de nouvelles icônes sur nos murs : Madonna, la Princesse Diana, Tiger Woods, les Spice Girls. Être important aujourd’hui, c’est atteindre le statut d’icône !
Il ne suffirait pas d’ajouter simplement le visage du Christ à cette foule. Ce serait bien, mais pas suffisant, que Walt Disney fasse un dessin animé sur l’Évangile. Mettre le visage de Jésus sur l’écran à côté de Mickey et Donald n’accomplirait toujours pas l’épiphanie. Devant beaucoup d’églises protestantes de Grande Bretagne des enseignes affichant des paroles de l’Évangile rivalisent avec les publicités de la rue. C’est peut-être admirable, mais je trouve toujours cela un peu gênant. Je me souviens de nos fous rires d’enfants lorsque nous passions devant l’enseigne d’une église locale qui demandait si nous « veillions avec les vierges sages ou dormions avec les vierges imprudentes ».
Le défi est celui-ci : comment révéler la gloire de Dieu, la Beauté de Dieu ? Dans ce monde comble d’images, comment manifester la beauté de Dieu ? Balthasar parle de « l’évidence » de la beauté, de son « autorité intrinsèque ». Nous reconnaissons dans la beauté un appel difficile à ignorer. C. S. Lewis disait que la beauté réveille en nous le désir de « notre lointaine patrie », le foyer auquel nous aspirons et que nous n’avons jamais vu. La beauté révèle notre fin dernière, celle pour laquelle nous sommes faits, notre sagesse. Dans ce monde en fuite, avec son avenir incertain, le missionnaire est le porteur de sagesse, la sagesse de la destinée finale de l’humanité. C’est cette destinée finale qu’on entrevoit dans la beauté du visage de Dieu. Comment la montrer aujourd’hui ?
Plus facile de poser la question que d’y répondre. J’espère que vous me proposerez des réponses plus stimulantes que les miennes ! Mon idée est que nous devons présenter des images, des visages qui soient d’un type différent de ce que nous voyons dans nos rues. En premier lieu, la beauté ne se révèle pas dans le visage des gens riches et célèbres, mais dans celui des pauvres et démunis. En second lieu, les images du village global proposent divertissement et distraction, alors que la beauté de Dieu réside dans la transformation.
Les images du village global montrent la beauté du pouvoir et de la richesse. C’est la beauté de la jeunesse et de la santé qui a tout pour elle. C’est la beauté de la société de consommation. Et n’allez pas croire que je suis jaloux des jeunes et bien portants, quelque nostalgie que j’en aie, mais l’Évangile place la beauté ailleurs. La révélation de la gloire de Dieu est la croix, un homme mourant et abandonné. L’idée est tellement choquante qu’il a apparemment fallu quatre cents ans pour qu’on arrive à la représenter. La première représentation du Christ crucifié est peut-être celles des portes de Ste-Sabine, où j’habite, qui furent sculptées en 432, après la destruction de Rome par les barbares. L’irrésistible beauté de Dieu rayonne à travers la pauvreté la plus totale.
L’idée peut sembler absurde, jusqu’à ce que l’on songe à l’un des saints les plus beaux et les plus fascinants, François d’Assise. J’ai fait cet été un petit pèlerinage à Assise. La basilique était envahie par la foule des gens qu’y attire la beauté de sa vie. Les fresques de Giotto sont très belles, mais la beauté la plus profonde est celle du poverello. Sa vie est creusée d’un vide, un manque, qui ne peut être comblé que par Dieu. Le Cardinal Suhard a écrit qu’être missionnaire « ne consiste pas à se lancer dans la propagande ni à soulever les foules, mais à être un mystère vivant. Cela signifie vivre de manière telle que la vie n’aurait vraiment aucun sens si Dieu n’existait pas ». Nous voyons la beauté de Dieu en François parce que sa vie n’aurait aucun sens si Dieu n’est pas.
Tout aussi important, François a découvert une nouvelle image de la pauvreté même de Dieu (je me demande bien pourquoi je fais toute cette publicité aux franciscains!). Pour Neil MacGregor, c’est François qui a inventé la crèche, le signe de Dieu embrassant notre pauvreté. En 1223 il écrivit au Seigneur de Greccio, « Je voudrais représenter la naissance du Christ exactement comme elle a eu lieu à Bethléem, pour que les gens voient de leurs propres yeux les épreuves qu’Il a subies enfant, comment il était couché sur la paille dans une mangeoire avec le bœuf et l’âne à ses côtés ». Dans le monde de la Renaissance du treizième siècle, avec ses nouvelles fresques, ses nouveaux biens de consommation exotiques, sa nouvelle civilisation urbaine, sa mini-mondialisation, François a révélé la beauté de Dieu par une nouvelle image de la pauvreté.
Voilà notre défi dans le village global, montrer la beauté du Dieu pauvre et faible. C’est particulièrement difficile parce que notre mission se trouve souvent là où la pauvreté est la plus terrible, en Afrique, en Amérique Latine et dans certains pays d’Asie, où la pauvreté est de toute évidence atroce. Les missionnaires construisent des écoles, des universités et des hôpitaux. Nous dirigeons des institutions solides et absolument essentielles. On nous considère riches. Mais dans bien des pays, les systèmes sanitaire et éducatif s’effondreraient sans l’Église. Comment, dans ces conditions, montrer la beauté de la gloire de Dieu, visible dans la pauvreté ? Comment offrir ces services irremplaçables tout en continuant à mener des vies qui soient mystères, et qui n’auraient aucun sens sans Dieu ?
J’évoquerai maintenant brièvement une seconde manière de manifester la beauté de Dieu, par des actes de transformation. J’ai commencé cette conférence en disant que ce qui est unique dans notre société n’est peut-être pas tant la mondialisation que notre ignorance d’où va le monde. Nous n’avons aucune idée du genre d’avenir que nous sommes en train de nous préparer. Même le pôle nord a commencé à fondre et faire des flaques. Et après ? Cette incertitude provoque une angoisse profonde. Nous osons à peine contempler l’avenir, et il est plus facile dans ces conditions de ne vivre que pour le présent. C’est la culture de la gratification immédiate. Comme l’écrit Kessler, « La plupart des gens vivent bien moins aujourd’hui dans une perspective lointaine, de grands espoirs à long terme, qu’avec des intentions à court terme et des objectifs tangibles. ‘Vivez votre vie – tout de suite’ est l’impératif de la culture secondaire qui couvre le globe aujourd’hui. Il suffit de vivre la vie comme elle est, au présent – sans but ».
Quand j’arrive à Londres en avion, je vois souvent la grande roue du millénaire, l’orgueilleuse célébration de la ville pour les des deux mille ans de la naissance du Christ. Mais tout ce qu’elle fait, c’est de tourner et tourner -et encore, les bons jours ! Elle ne va nulle part. Elle nous donne la chance d’être spectateurs, d’observer le monde sans nous engager. Elle nous entraîne, et permet d’échapper un moment au rythme frénétique de la ville. Cela symbolise assez bien comment nous tentons de survivre, souvent, dans ce monde en fuite. Contents de nous distraire, de nous échapper un moment. Et c’est bien ce que nous proposent tant de nos images, la distraction qui permet d’oublier. Les jeux vidéo, les soap operas, les films nous offrent l’amnésie face à un avenir inconnu. Ceci dit, j’attends toujours qu’une de mes nièces veuille bien m’emmener sur la grande roue du millénaire !
Cette tendance à l’échappatoire s’exprime principalement dans un phénomène typique de la fin du vingtième siècle, le « happening ». On utilise ce mot même en français, « le happening ». Quand la France a célébré le millénaire par un gigantesque pique-nique de 1.000 kilomètres, c’était « un incroyable happening » ! Un happening, ça peut être une boîte de nuit, un match de foot, un concert, une soirée, une fête, les Jeux Olympiques. Un happening est un moment d’exubérance, d’extase, qui nous transporte hors de ce monde sombre et inflexible, pour oublier. La nouvelle ville que Disneyland a construite en Floride pour permettre aux gens de fuir les angoisses de l’Amérique moderne s’appelle Célébration.
Mais le christianisme aussi trouve son cœur dans « un incroyable happening », la Résurrection. C’est un genre de happening totalement différent, toutefois. Qui n’offre pas d’échappatoire, mais une transformation. Qui n’invite pas à oublier demain, mais est demain même débordant sur le présent. Face à toutes nos angoisses dans ce monde en fuite où nous ignorons dans quelle direction nous allons, les chrétiens ne répondent ni par l’amnésie ni par d’optimistes prédictions. Nous découvrons les signes de la Résurrection surgissant dans des gestes de transformation et de libération. Nos célébrations ne sont pas une fuite mais un avant-goût de l’avenir. Elles n’offrent pas d’opium, comme le pensait Marx, mais une promesse.
Cornelius Ernst, un dominicain anglais, a décrit l’expérience de Dieu comme « le moment génétique ». Le moment génétique est transformation, nouveauté, créativité, quand Dieu fait irruption dans notre vie. Il écrit : « Chaque moment génétique est un mystère. C’est l’aube, la découverte, le printemps, une nouvelle naissance, venir au monde, s’éveiller, la transcendance, la libération, l’extase, le consentement nuptial, le don, le pardon, la réconciliation, la révolution, la foi, l’espérance, l’amour. On peut dire que le christianisme est la consécration du moment génétique, le centre vivant d’où il regarde les perspectives infiniment variées et changeantes de l’expérience humaine dans l’histoire. C’est à cela, du moins, qu’il prétend ou devrait prétendre : au pouvoir de transformer et de renouveler toutes choses : ‘Voici, je fais l’univers nouveau’ (Ap 21,5) ».
Le défi pour notre mission est donc de trouver comment rendre Dieu visible par des gestes de liberté, de libération, de transformation, de petits « happenings » qui soient des signes de la fin. Nous avons besoin de petites irruptions de l’irrépressible liberté de Dieu et de sa victoire sur la mort. Assez curieusement, j’en ai trouvé plus facilement des images séculières très évidentes que des images religieuses : la petite silhouette devant le tank, Place Tienanmen, la chute du Mur de Berlin.
Quelles pourraient être ces images explicitement religieuses ? Peut-être une communauté de moniales dominicaines du Nord Burundi, Tutsis et Hutus vivant et priant ensemble, dans la paix, sur une terre de mort. Leur petit monastère, entouré de verdure – car là, au milieu de ce paysage brûlé et dévasté, des champs sont cultivés – est un signe de Dieu qui ne laisse pas la mort avoir le dernier mot. Une communauté œcuménique que j’ai visitée à Belfast en Irlande du Nord, pourrait être un autre exemple. Catholiques et Protestants y vivaient ensemble et chaque fois que les luttes sectaires faisaient une victime, un membre protestant et un membre catholique de la communauté allaient rencontrer les parents du défunt et prier avec eux. Cette communauté incarnait notre sagesse, elle était un signe que nous ne sommes pas condamnés à la violence, elle était une petite épiphanie du Royaume. Nous ne savons pas si la paix est à portée de la main ou si la violence va encore empirer, mais il y avait là une parole faite chair qui parlait de l’intention ultime de Dieu.
La proclamation
Nous sommes passés de la mission comme présence à la mission comme épiphanie. Nos yeux ont vu le salut du Seigneur. Mais nous devons encore franchir un dernier pas, jusqu’à la proclamation. Notre évangile doit trouver la parole. À la fin de l’Évangile de Matthieu, les disciples sont envoyés faire d’autres disciples dans toutes les nations et enseigner au monde ce que Jésus a commandé. La Parole se fait chair mais la chair aussi se fait parole.
Nous nous trouvons là devant ce qui est peut-être la crise la plus intime de notre mission aujourd’hui. Quiconque prétend enseigner déclenche une suspicion intense à moins de venir de l’Orient ou d’apporter quelque bizarre doctrine New Age. Les missionnaires qui enseignent sont soupçonnés d’endoctrinement, d’impérialisme culturel, d’arrogance. Qui sommes-nous pour oser dire à d’autres ce qu’ils doivent croire ? Enseigner que Jésus est Dieu est considéré comme un endoctrinement, mais enseigner que Dieu est un champignon sacré fait partie de la riche tapisserie de la tradition humaine ! En tous cas notre société est profondément sceptique devant toute prétention à la vérité. Nous vivons à Disneyland, le pays où la vérité peut être réinventée à loisir. À l’ère du virtuel, la vérité est ce que l’on fait apparaître sur un écran d’ordinateur. J’ai lu l’histoire d’un pilote qui s’est aperçu après le décollage d’un aéroport au Pérou que tous ses radars étaient devenus fous. Quand il tournait à gauche, les écrans de contrôle disaient qu’il allait à droite, et quand il montait, ils indiquaient qu’il descendait. Ses derniers mots ont été : « tout est fictif ». Malheureusement la montagne qu’il a heurtée ne l’était pas.
Dans Christianity Rediscovered (le christianisme redécouvert), Vincent Donovan décrit son travail de nombreuses années comme missionnaire auprès des Maasai, à construire des écoles et des hôpitaux, mais sans jamais proclamer sa foi. Il n’était pas encouragé à le faire par ses supérieurs. À la fin, ne pouvant se contenir davantage, il réunit tout le monde pour annoncer sa foi en Jésus. Alors (si je me souviens bien, car j’ai perdu mon exemplaire du livre), les anciens lui dirent : « Nous nous sommes toujours demandé ce que tu faisais là. Au moins, maintenant, nous savons. Pourquoi ne l’as-tu pas dit plus tôt ? » C’est pour cela que nous sommes envoyés, pour parler de notre foi aux gens. Nous ne sommes pas toujours libres de parler, et nous devons choisir soigneusement le moment, mais en fin de compte il serait paternaliste et condescendant de notre part de ne pas proclamer ce que nous croyons vrai. Cela fait même partie de la bonne nouvelle, que les êtres humains sont faits pour la vérité et peuvent l’atteindre. Comme le dit Fides et Ratio, « On peut définir l’être humain… comme celui qui cherche la vérité (§ 28), et cette recherche n’est pas vaine. Nous avons, comme le disent les Constitutions dominicaines, une « propensio ad veritatem » (LCO 77, 2), une inclination vers la vérité. Une spiritualité de la mission doit comporter la passion de la vérité.
En même temps il y a dans l’enseignement catholique traditionnel l’idée centrale que nous nous tenons à l’extrême frontière du langage, entrevoyant à peine la bordure du mystère. Saint Thomas dit que l’objet de la foi est hors de la portée et du pouvoir de nos mots. Nous ne possédons ni ne maîtrisons la vérité. Face aux croyances et aux affirmations des autres, nous devons avoir une profonde humilité. Comme l’écrivit Claverie « je ne possède pas la vérité, j’ai besoin de la vérité des autres », je suis un mendiant de vérité.
Au cœur d’une spiritualité de la mission se trouve certainement la compréhension du bon rapport entre notre confiance en la révélation de la vérité et notre humilité devant le mystère. Le missionnaire doit chercher ce juste équilibre entre confiance et humilité. C’est là une source de grande tension au sein de l’Église, entre la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et plusieurs théologiens asiatiques, et même avec beaucoup d’Ordres religieux. Elle peut être une tension féconde au cœur de notre proclamation du mystère. Je me souviens qu’à un chapitre général des dominicains une discussion acharnée éclata entre ceux qui jouaient leur vie entière et leur vocation sur la proclamation de la vérité et ceux qui soulignaient le peu que nous pouvons connaître de Dieu selon Thomas d’Aquin. Cela s’est terminé au bar, par un séminaire sur un texte de la Summa contra Gentiles, avec force bière et cognac ! Pour bien vivre cette tension entre la proclamation et le dialogue, je crois que le missionnaire a besoin d’une spiritualité de l’honnêteté et d’une vie de contemplation.
Cela peut paraître curieux de parler d’une spiritualité de l’honnêteté. Évidemment le prêcheur ne doit dire que le vrai. Mais je crois qu’on ne saura quand parler et quand se taire, qu’on ne trouvera cet équilibre entre confiance et humilité que si l’on a été formé à l’exigeante discipline de l’honnêteté. C’est un ascétisme lent et douloureux, une attention portée à l’usage que l’on fait des mots, dans l’écoute de ce que disent les autres, en ayant conscience de toutes les manières dont nous nous servons des mots pour dominer, subvertir, manipuler au lieu de révéler, dévoiler.
Nicholas Lash écrivait : « Envoyés comme ministres de la Parole rédemptrice de Dieu, il nous faut, en politique et dans la vie privée, au travail et dans les loisirs, dans le commerce et dans la recherche, pratiquer et favoriser cette philologie, cette attention au mot, ce souci méticuleux et consciencieux de la qualité du débat et de l’honnêteté de la mémoire, qui est la première causalité du péché. Par conséquent l’Église est ou devrait être une école de philologie, une académie du soin des mots ». L’idée du théologien comme philologue paraît bien aride est poussiéreuse. Comment un missionnaire trouvera-t-il le temps pour cette sorte de choses ? Mais être un prêcheur c’est apprendre l’ascétisme de l’honnêteté dans tous les mots que nous prononçons, dans la façon dont nous parlons des autres, nos amis comme nos ennemis, de ceux qui viennent de quitter la pièce, du Vatican, de nous-mêmes. Ce n’est qu’en apprenant cette vérité du fond du cœur que nous pourrons dire la différence entre une bonne confiance dans la proclamation de la vérité et l’arrogance de ceux qui prétendent en savoir plus qu’il n’est possible ; entre l’humilité devant le mystère et un relativisme mou qui n’ose même plus parler du tout. La discipline fait partie de notre assimilation à celui qui est la Vérité et dont la Parole est « vivante (…) efficace et plus incisive qu’aucun glaive à deux tranchants, elle pénètre jusqu’au point de division de l’âme et de l’esprit, des articulations et des moelles, elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur » (Hé 4,12).
Ensuite, nous ne serons d’humbles et confiants prêcheurs qu’en devenant contemplatifs. Chrys McVey dit que « la mission commence dans l’humilité et s’achève dans le mystère ». Ce n’est qu’en apprenant à demeurer dans le silence de Dieu que nous pouvons découvrir les mots qu’il faut, des mots qui ne soient ni arrogants ni vides, des mots qui soient à la fois confiants et humbles. Si le centre de notre vie est le silence même de Dieu, alors seulement nous saurons où finit le langage et commence le silence, quand proclamer et quand nous taire. Rowan Williams écrit : « ce que nous devons redécouvrir, c’est la discipline du silence – pas un silence absolu, ininterrompu, inarticulé, mais la discipline de lâcher nos bavardages faciles sur l’Évangile afin que nos paroles puissent rejaillir d’une profondeur ou d’une force nouvelle et différente, de quelque chose qui dépasse notre imagination ». C’est cette dimension contemplative qui détruit les fausses images de Dieu que nous pourrions être tentés de vénérer, c’est elle qui nous libère des pièges de l’idéologie et de l’arrogance.
Les futurs citoyens du Royaume de Dieu
Je dois maintenant conclure en tressant tous ces brins. J’ai dit qu’au démarrage de toute mission il y a la présence ; être là comme un signe du Royaume de Dieu auprès de ceux qui sont les plus différents, dont nous séparent l’histoire, la culture ou la religion. Mais ceci n’est qu’un début. Notre mission nous pousse vers l’épiphanie et enfin à la proclamation. La Parole se fait chair, et la chair se fait parole. Chaque étape du développement de notre mission exige du missionnaire des qualités différentes : la fidélité, la pauvreté, la liberté, l’honnêteté et le silence. Ai-je tracé là le tableau d’un impossible saint missionnaire, semblable à nul missionnaire réel ? Cela constitue-t-il une « spiritualité de la mission » cohérente ?
J’ai indiqué qu’à cette phase de l’histoire de la mission de l’Église, la meilleure façon de considérer le missionnaire est comme un futur citoyen du Royaume de Dieu. Notre monde en fuite est incontrôlable. Nous ignorons où il va, vers le bonheur ou la misère, la prospérité ou la pauvreté. Les chrétiens n’ont pas d’information privilégiée. Mais nous croyons vraiment qu’à la fin viendra Son Règne. Telle est notre sagesse et c’est une sagesse que les missionnaires incarnent dans leur vie même.
Saint Paul écrit aux Philippiens : « oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l’avant, tendu de tout mon être et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus » (Ph 3, 13 et suiv). C’est une image extraordinairement dynamique. Saint Paul est tendu, étendu, courant comme un athlète olympique à Sydney, droit à la médaille d’or ! Être un futur citoyen du Royaume c’est vivre ce dynamisme. C’est être tendu de tout son être, étiré vers le but, courir droit de l’avant. Le missionnaire souffre d’incomplétude ; il ou elle n’est fait/e qu’à demi jusqu’à ce que le Règne arrive, quand tous ne feront qu’un. Nous nous tendons vers les autres, vers les plus éloignés, incomplets jusqu’au moment où nous ne ferons qu’un avec eux dans le Royaume de Dieu. Nous tendons la main vers une plénitude de vérité, que pour le moment nous ne faisons qu’entrevoir vaguement ; tout ce que nous proclamons est hanté par le silence. Nous sommes creusés d’une soif de Dieu dont la beauté se devine dans notre pauvreté. Être un futur citoyen de Son Royaume c’est être dynamiquement, radieusement, joyeusement incomplet.
Eckhart écrivait que « dans l’exacte mesure où tu laisses toutes choses, exactement dans cette mesure, ni plus ni moins, Dieu arrive apportant tout ce qui est Sien – si vraiment tu quittes tout ce que tu possèdes ». Ce qui est beau avec Eckhart, c’est que moins on sait de quoi il parle, plus ça a l’air merveilleux ! Peut-être nous invite-t-il à cet exode absolu de nous-mêmes, qui creuse un vide où Dieu entrera. Nous nous tendons vers Dieu en notre prochain, Dieu qui est l’autre le plus autre, pour découvrir Dieu au cœur même de notre être, Dieu au plus intime. Car Dieu est totalement autre et totalement intime. Et c’est pourquoi pour aimer Dieu nous devons à la fois aimer notre prochain et nous-mêmes. Mais ça, c’est une autre conférence !
Cet amour est très risqué. Giddens dit que dans notre monde dangereux qui se précipite vers un avenir inconnu, la seule solution est de prendre des risques. Le risque est la caractéristique d’une société qui regarde vers l’avenir. Il dit qu’ « assumer les risques de manière positive est la véritable source de cette énergie qui crée la richesse dans une économie moderne… Le risque est la dynamique mobilisatrice d’une société résolue au changement, qui veut déterminer son propre avenir plutôt que de l’abandonner aux mains de la religion, de la tradition, ou des errements de la nature ». Il considère clairement la religion comme un refuge à l’abri du risque, mais notre mission nous invite à prendre des risques qui dépassent son imagination. Le risque de l’amour. Le risque de vivre pour les autres, qui ne veulent peut-être pas de moi ; le risque de vivre pour la plénitude de la vérité, que je ne peux saisir ; le risque de me laisser creuser par la soif de Dieu dont le Règne viendra. Voilà qui est fort risqué et cependant tout à fait sûr. ![]()
Notes:
Runaway World: How globalisation is reshaping our lives, Londres, 1999.
2 Sur les deux premières phases de la mission, cf. Robert J Schreiter, The New Catholicity. Theology between the global and the local, New York, 1997.
3Runaway World. How globalisation is reshaping our lives, Londres, 1999.
4 Je suis sûr de citer quelqu’un, mais ne me souviens pas qui!
5 Lettres et Messages d’Algérie, Paris, 1996.
6 Who are we now? Christian humanism and the global market from Hegel to Heaney, Edinburgh, 1998, p. 120.
7 Aidan Nichols o.p., The Word has been abroad, Edinburgh, 1998, p.1.
8 Cité par R. Harries, Art and the Beauty of God: A Christian understanding, Londres, 1993, p. 4.
9 Cité par S. Hauerwas, Santify them in the truth, Edinburgh, 1998, p.38.
10 Neil MacGregor, Seeing Salvation, BBC, Londres, 2000, p.49.
11 Hans Kessler, « Fulfilment – Experienced for a moment yet Painfully Lacking? », Concilium, Septembre 1999, p. 103.
12 Cf. Alberto Moreira « The dangerous Memory of Jesus Christ in a post-Traditional society » et Ferdinand D Dagmang, « Gratification and Instantaneous Liberation » both in Concilium, Septembre 1999.
13 The Theology of Grace, Dublin, 1974, p. 74 et suiv.
14 Ibid., p. 166.
15 Open to Judgment, Londres 1996, p. 268 et suiv.
16 Meister Eckhart, Sermons and Treatises, vol. IV, Londres, p. 14.
17 Ibid., p. 23 et suiv.
Damian Byrne 1984-1993
750e anniversaire de la canonisation de saint Dominique (1984)
Lettre du Maître de l’Ordre. Septembre 1984
fr. Damian Byrne, O.P.
 Cette année marque le 750e anniversaire de la canonisation de saint Dominique. Dans, la bulle de canonisation, le pape Grégoire IX parle de la sainteté apostolique de saint Dominique et de la fécondité de sa famille spirituelle. Sans doute, la meilleure manière de célébrer cet anniversaire ne serait-elle pas de réfléchir sur ces aspects de la vie de saint Dominique en rapport avec notre façon de vivre aujourd’hui son idéal ?
Cette année marque le 750e anniversaire de la canonisation de saint Dominique. Dans, la bulle de canonisation, le pape Grégoire IX parle de la sainteté apostolique de saint Dominique et de la fécondité de sa famille spirituelle. Sans doute, la meilleure manière de célébrer cet anniversaire ne serait-elle pas de réfléchir sur ces aspects de la vie de saint Dominique en rapport avec notre façon de vivre aujourd’hui son idéal ?
Comme saint Dominique, nous sommes appelés, par le baptême, à devenir des saints. L’évangile du Mercredi des Cendres, en nous invitant à la conversion, nous rappelle trois éléments essentiels de la vie chrétienne : la prière, l’aumône, le jeûne. Le procès de canonisation de saint Dominique nous montre avec clarté comment notre bienheureux père a vécu ces réalités avec une remarquable intensité.
1. La prière
Jean d’Espagne témoigne que : « Dominique était certainement très fervent et très persévérant dans la prière, plus que n’importe quel homme qu’il ait jamais connu ». Nous remarquons que saint Dominique, tout en étant fidèle à l’obligation de la prière chorales avait son rythme de prière privée profondément personnel : « Il priait plus que les autres frères qui vivaient avec lui:, se réservant des veilles plus longues ». (Jean d’Espagne).
Nous devons être des hommes et des femmes d’oraison en orientant nos vies entières vers Dieu et en étant fidèles à la prière communautaire et privée, si nous voulons connaître la volonté de Dieu sur nous et la mettre en pratique. Le rythme de la prière sera différent pour chaque branche de notre Famille : la moniales le prêcheur la religieuse de vie apostolique, le laïc dominicain et, évidemment, le rythme sera différent pour chaque personne à l’intérieur de chaque groupe l’essentiel est que chaque individu, chaque groupe prenne conscience de la nécessité de la prière, en fixe le rythme qui convient et y demeure fidèle.
2. Le jeûne
Saint Dominique était aussi frugal dans la façon de se nourrir mais surtout lorsqu’il s’agissait de quelque mets particulier.
Chacun de nous doit examiner son style de vie : nos repas, nos vacances, nos voyages. Nous devons aussi élargir notre manière d’envisager la pénitence comme le faisait Jean XXIII quand il disait que nous devions nous laisser mortifier par les autres et nous mortifier aussi un peu nous-mêmes.
Il y a place dans nos vies pour des jeûnes et des pénitences personnels mais ce sont les moindres. La pénitence la plus importante est celle qui nous vient du dehors et qui consiste à accepter les organisations des autres, les difficultés de la vie quotidienne, la souffrance causée far l’envies la jalousie, les commérages, l’égoïsme, l’intolérance et les refus de pardon.
Saint Dominique nous enseigne à nous occuper des autres, de nos compagnons (« il était toujours prêt à accorder des dispenses » aux autres), des pécheurs. Nous devons faire attention à nos propres réponses et ne pas juger celles d’autrui. « Jamais on n’entendit sur les lèvres de frère Dominique une parole méchante, blessante ou oiseuse ».
3. L’aumône
» Emu de compassion et plein de miséricorde, frère Dominique vendit ses livrés, que lui-même avait annotés, et d’autres biens qu’il possédait pour en donner le prix aux pauvres « .
Notre Seigneur nous dit (Mt. 25) que les actions ordinaires de chaque jour sont importantes pour être son disciple… « vous m’avez donné à manger, vous êtes venu me voir ». Nous servons réellement les autres quand nous les rendons capables d’attaquer les causes radicales de l’injustice ou de l’oppression. Il est nécessaire que nous nous consacrions à la cause de la justice et de la paix selon les meilleures traditions de l’Ordre, mais aucun de nous ne peut se sentir délié de l’obligation du service personnel aux autres à l’intérieur et à l’extérieur de nos communautés.
Dans ce contexte aussi il est important crue chaque communauté consacre un pourcentage de ses revenus a aider les pauvres comme une utilisation normale de ses ressources. Nous devons également accueillir avec beaucoup plus de sérieux les ordinations de nos constitutions en ce qui concerne la répartition des biens entre nous et la taxe provinciale et générale doit être envisagée clairement comme faisant partie de cette répartition des biens entre nous.
Notre engagement, en tant que chrétiens, se vit dans la Famille dominicaine. Nous sommes invités à suivre l’exemple de la vie évangélique de saint Dominique et à nous inspirer aussi de son zèle apostolique.
Selon le témoignage de Jean d’Espagne, »frère Dominique était plus zélé pour le salut des âmes que n’importe quel autre homme qu’il ait jamais connu » et cela se manifestait surtout « dans la prédication et l’écoute des confessions » auxquelles il se consacrait avec persévérance.
Notre Famille ne doit jamais perdre ces spécificités de notre dimension apostolique. Saint Dominique fonda son Ordre pour être appelé et être réellement celui des Prêcheurs. Il y aura d’autres nécessités, et d’autres priorités seront définies, mais pour nous tout sera oriente vers le salut des aines, la nôtre et celle des autres par le moyen de la prédication.
Les derniers chapitres généraux ont été très clairs en proposant à notre activité apostolique les quatre priorités suivantes : enseignement-recherche, justice et paix, moyens de communication sociale, contacts avec ceux qui sont hors de l’Église.
Nous ne sommes pas tous appelés de la mime façon à consacrer nos énergies à l’une ou l’autre des quatre priorités, il ne nous est pas demandé non plus d’abandonner nos apostolats traditionnels mais il est demandé à chacun de nous d’apporter quelque chose à chacune de ces priorités dans tout ce que nous avons à faire et d’examiner notre action individuelle ou commune (couvents, congrégations, provinces) à la lumière de ces priorités bien définies. Cela exige pour chacun une grande capacité d’écoute, une bonne volonté constante pour apprendre et s’adapter, une disponibilité pour profiter des talents et de la science des autres.
Par conséquent, dans notre Famille, on attache une grande importance à la communauté. Le système de gouvernement de saint Dominique et l’exemple qu’il donna d’accepter la volonté de ses frères sont les lignes directrices que nous devons vivre pour réaliser ce type de vie communautaire. Normalement, cela veut dire qu’un groupe de frères ou aussi de soeurs vivent ensemble
Cependant, j’ai assisté à d’inutiles discussions au cours desquelles les frères ont essayé de définir « l’idéal », le nombre minimum de frères pour composer une communauté dominicaine et j’ai été plus qu’édifie par l’adhésion aux idéaux communautaires de quelques frères qui vivent seuls par obéissance pour des motifs d’apostolat.
Mais il semble que s’accroît le nombre de frères et de soeurs qui vivent en dehors d’une communauté. Cela doit les faire réfléchir sur la manière dont ils vivent leur engagement dans la communauté et, nous autres, sur la qualité de notre vie communautaire.
La difficulté que quelques maisons et provinces rencontrent pour trouver des frères qui acceptent des charges administratives comme un service pour l’Ordre entier et pour l’Eglise est à souligner et exige une réflexion de notre part sur la valeur apostolique de la vie administrative.
Pour finir, le pape Grégoire IX parle de la fécondité de la Famille de saint Dominique. La liste de nos saints et de nos bienheureux (religieux et laïcs, hommes et femmes, personnes mariées et célibataires) est variée et impressionnante. Elle nous montre comment des personnes différemment douées et appartenant à divers pays, à toutes les époques, ont trouvé des manières de se réaliser et des moyens pour se sanctifier dans notre Famille dominicaine. Cela n’est pas différent aujourd’hui.
Cependant, il y a deux choses que les derniers chapitres et congrès ont exprimé et que nous ne devons pas négliger : la première est la collaboration, à l’intérieur de la Famille dominicaine, dans les activités apostoliques. Cela entraîne la promotion des femmes et des lacs et l’accession à leur véritable place. Les chapitres de Walberberg et de Rome ont donné, dans ce sens, de nombreuses et excellentes directives.
La seconde est que nous devons être fidèles à la mission si profondément incarnée dans la vie de saint Dominique. Le congrès de Madrid de 1973 marque un grand pas en avant sur le concept de Mission et j’espère que le Chapitre d’Avila, en 1986, date du IVe centenaire de notre Province missionnaire, développera encore davantage notre concept de la Mission, fera grandir la conscience de la dimension missionnaire de notre Famille.
Avec la bénédiction de notre bienheureux père saint Dominique et le désir que cet anniversaire approfondisse en chacun de nous l’engagement chrétien et dominicain. (Septembre 1984)
Le Rosaire(1985)
Lettre du Maître de l’Ordre. Septembre 1985
fr. Damian Byrne, O.P.
 Une tradition qui remonte à nos origines, nous assure que la Mère de Dieu a suscité, diffusé et défendu notre Ordre, selon le dessein de la providence qui l’avait inspiré. Je suis donc heureux de pouvoir m’exprimer avec confiance sur ce thème, sur l’aspect de l’action prophétique que Marie développe dans notre Famille, coopérant à la régénération des hommes. (LG 65)
Une tradition qui remonte à nos origines, nous assure que la Mère de Dieu a suscité, diffusé et défendu notre Ordre, selon le dessein de la providence qui l’avait inspiré. Je suis donc heureux de pouvoir m’exprimer avec confiance sur ce thème, sur l’aspect de l’action prophétique que Marie développe dans notre Famille, coopérant à la régénération des hommes. (LG 65)
Maintenant, penser au rôle actif et éminent que la Mère de Dieu et notre Mère joue dans l’Eglise; proclamer les merveilles que le Seigneur a accomplies par Elle; coopérer au plan de Dieu à travers notre confiance en Marie, signifie, pour nous Dominicains, parler en même temps et de la Vierge et du Rosaire. Non toutefois comme de deux réalités diverses et non plus comme d’un sujet accessoire à la vie apostolique et par conséquence spirituelle, formative, communautaire.
Il s’agit, au contraire, d’aborder avec un langage nouveau la redécouverte spécifique de notre prédication apostolique et de notre relation de prière et de vie avec la Vierge de Nazareth. Et, encore, de suivre l’action personnelle qu’Elle mène, sous la motion du St Esprit, dans l’Ordre et dans l’Eglise, en sa qualité de Mère.
Avec cette lettre, que je vous adresse en la fête du 7 octobre, il me semble opportun de me tourner vers l’entière Famille Dominicaine, attentive à se situer dans l’Eglise avec une profonde exigence de fidélité à sa mission propre. Ceci juste au moment où va se célébrer le XXe anniversaire du Concile Vatican II, par un Synode de vérification sur le chemin de l’évangélisation, dans le contexte des mutations vastes et profondes de la société actuelle.
Il est urgent aussi pour nous de nous renouveler selon l’évolution du charisme apostolique. Et de nous renouveler aussi à travers cet « abrégé de tout l’Evangile » qu’est le Rosaire.
L’urgence naît de deux attitudes de l’esprit, qui peuvent se retrouver aussi parmi nous : d’une part l’attention se centre sur les plus graves problèmes sociaux du moment, et la dimension mariale devient un fait de vie privée, d’autre part on insiste toujours plus dans la prière sur l’engagement avec la Mère de l’Eglise remettant toute initiative à ses soins.
Je considère les deux positions complémentaires et non alternatives, me basant en cela sur mon expérience missionnaire.
L’action prophétique de Marie et notre charisme
La mission actuelle de la Mère du Sauveur trouve son interprétation dans l’Évangile. « Suprêmement aimée de Dieu » Marie est porteuse de joie, (Lc. 1, 44) solidaire avec nous dans la souffrance, (Lc. 2, 35) modèle d’itinéraire apostolique, connexe au rôle de la maternité divine.
La « bénie entre les femmes » (Lc. 1, 42) aide à faire croître le charisme prophétique que l’Eglise nous a confié, nous rendant hommes de foi et animateurs d’espérance, dans la fidélité à l’Évangile. Dans son attitude d’écoute de la Parole de Dieu (MC. ‘I7), dans son rôle de priante (MC. 18). Elle nous indique les sources authentiques de toute mission évangélisatrice » associée à la sienne (MC. 19). Dans le Cénacle encore, Mère de grâce et de miséricorde, Elle nous aide à être pasteurs et guides des âmes dans le sacrement de Réconciliation.
A Toulouse, le musée des Augustins conserve une statue en bois du XVe siècle, provenant du Couvent dominicain des Jacobins. La Vierge, assise, tient d’un côté l’Enfant Jésus et de l’autre le livre des Évangiles. Marie conçoit la Vérité, engendre la Vérité, proclame la Vérité. « Elle est le Livre, dit Sainte Catherine de Sienne, où est écrit notre salut ». Image et modèle de l’Église. Elle l’est au même titre de notre Famille, appelée à la participation au charisme prophétique.
Il est donc exact de penser que dans sa mission prophétique nous retrouvons la nôtre propre. Par son action maternelle nous engendrons le Corps du Christ, par son intercession nous réalisons les engagements apostoliques, parfois entravés par de nombreuses difficultés. C’est Marie elle-même alors qui, à travers nous, actualise sa présence agissante. Ceci est la raison pour laquelle, aux origines de~l’Ordre, la prédication était déjà imprégnée d’une particulière saveur mariale.
Quand je me souviens des actes héroïques de nos missionnaires, vécus sous le signe du Rosaire; quand je pense à la hardiesse des oeuvres de charité que Saint Martin de Porrès et Saint Jean Macias surent faire surgir de leur piété pour le Rosaire, quand j’observe la gigantesque impulsion apostolique d’un Saint Louis Grignon de Montfort d’abord et d’un Frank Duff ensuite; si, en esprit, je parcours les grands itinéraires internationaux de la Croisade du Rosaire, alors, toujours plus, je suis convaincu par le jugement que les Evêques exprimèrent à Puebla : Marie est la plus haute réalisation de l’évangélisation (P. 282, 333), et sans Elle il n’est pas possible de parler d’Eglise (P. 291); sans Elle l’Évangile se désincarne, se défigure, et se transforme en idéologie, en rationalisme spiritualiste (P. 301).
Donc, l’Ordre, par tradition, se sent privilégié d’une manière particulière de la présence de Marie. Mais il est bon d’en prendre toujours plus conscience. Les Constitutions, à ce sujet, sont explicites : « Les Frères …se fortifient aussi avec l’amour et la dévotion envers la Bienheureuse Marie, Mère de Dieu » (LCO. 28,I)
Leur Profession religieuse se distingue par un rapport spécial d’obéissance filiale à Marie. Et pour que ce ne soit pas une simple expression pieuse le législateur l’éclaire en ajoutant : « en tant que Mère très aimante de notre Ordre » (LCO 189, III). Et encore, la Reine des Apôtres s’unit particulièrement à nous par la pensée, la parole et l’action apostolique à travers le Rosaire (LCO. 129) .
Le Bienheureux Angelico, dans la fresque du « Christ dérisoire » du couvent de St Marc a Florence, représente merveilleusement la Vierge et St Dominique : l’une en attitude de contemplation, et l’autre méditant profondément la Passion du Verbe incarné. Ceci est emblématique du rôle prophétique de Marie dans l’Ordre, qui nous incite à réaliser la contemplation dans l’action le « Contemplata aliis tradere ».
Problèmes de notre temps
Réfléchissant sur l’action déterminante de Marie dans la vocation dominicaine, j’aimerais considérer maintenant quelques uns des problèmes majeurs de notre engagement apostolique. Et ce sont : l’attention au monde des pauvres; le rôle de la femme aujourd’hui, dans la société et dans l’Église; l’unité des chrétiens.
Jamais comme de nos jours on n’a vu combien objectif et clairvoyant est le jugement de Vatican II sur les déséquilibres du monde contemporain : « Les contrastes entre les races et les divers groupes de la société surgissent; entre les nations riches, les moins riches et les pauvres » (GS. 8). Une collaboration humaine devient urgente pour appliquer l’Évangile au plan social, utilisant tous les remèdes pour aller à la rencontre des misères de notre temps » (UR.12).
Ayant devant elle cet énorme programme, l’Eglise nous demande aussi à nous, Dominicains, une authentique maturité évangélique, dans le but de vivre les exigences de la justice et de la charité, avant tout entre nous, et envers les autres et ensuite les prêcher.
La Vierge a toujours été proposée par l’Eglise comme modèle pour les fidèles, non pour le type de vie qu’Elle mena, encore moins pour le milieu socio-culturel dans lequel Elle a évolué, de nos jours presque partout dépassé; mais parce que, dans sa condition concrète de vie, Elle a adhéré totalement et de façon responsable à la volonté de Dieu (cf. Lc. I, 38) ; parce qu’Elle a accueilli la Parole et l’a mise en pratique; parce que son comportement fut animé par la charité et l’esprit de service; parce que finalement Elle fut la première et la plus parfaite disciple du Christ : ceci ayant une valeur exemplaire, universelle et permanente (MC. 35).
Oui, être attentif à la justice et à la charité envers les hommes, mais avec une vision purifiée par l’adhésion journalière à Celui qui est la Justice et l’Amour : en cela Marie est notre guide. Dans ces principes pratiques universaux prend alors racine ce que nous recommande le Chapitre de Rome regardant les problèmes sociaux de notre temps (n. 70). Marie est, en fait, pour nous aussi le modèle de notre vie personnelle et communautaire et un point de référence concret dans notre prédication aux riches comme aux pauvres de notre temps.
Mais nous voici à la seconde question : la femme aujourd’hui. Un féminisme, parfois exagéré, demande le droit d’accéder à toutes les professions, sans exclusion. Il pose l’accent sur la liberté et l’autonomie de la personne plus que sur la différence de caractère naturel et de service entre femme et homme. Il ne se rend pas compte du péril des manipulations des valeurs biologiques, éthiques, interpersonnelles. Il ne pose pas de barrières à l’avortement et au divorce.
Dans cette transformation profonde sociale et morale la femme a besoin de se retrouver plus complètement elle-même et d’embrasser de nouveau avec foi et courage sa mission dans la famille et pour la vie. Mais que peut lui dire à ce sujet la Femme de Nazareth ?
« Dans son dialogue avec Dieu (Marie) donne son consentement actif et responsable non à la solution d’un problème contingent mais à l’oeuvre des siècles, comme a été justement appelée l’Incarnation du Verbe. Elle fut tout autre qu’une femme passivement soumise ou d’une religiosité aliénante, mais la femme qui n’a pas hésité à proclamer que Dieu est défenseur des faibles et des opprimés et qu’Il renverse de leur trône les puissants du monde; une femme forte qui a connu la pauvreté et la souffrance, la fuite et l’exil : situations qui ne peuvent échapper à l’attention de qui veut embrasser avec un esprit évangélique les énergies libératrices de l’homme et de la société (MC. 37).
Dans sa juste aspiration à participer avec pouvoir de décision aux choix de la Communauté, la femme d’aujourd’hui ne trouvera-t-elle pas alors, dans la figure de Marie, le prototype à considérer ? Certainement. Mais elle pourra le faire seulement grâce à ce regard lumineux qui sait voir dans le profond de la réalité humaine de Marie, une humanité équilibrée par le rapport de foi avec son Dieu.
Enfin un troisième problème. Le culte de la Vierge Marie, typiquement ecclésial, reflète les préoccupations de l’Eglise; parmi elles, prédominante, le rétablissement de l’unité des chrétiens.
La dévotion à la mère de Dieu reçoit, à ce propos, les attentes du mouvement oecuménique parce qu’elle en exprime quelques caractères importants : « avant tout parce que les fidèles catholiques s’unissent aux frères des Eglises orthodoxes, chez lesquels la dévotion à Marie revêt à la fois une forme poétique et une profonde doctrine, dans… vénérer la Theotocos et l’acclamer « Espérance des chrétiens »; ils s’unissent aux Anglicans, dont les théologies classiques mirent en lumière les solides bases du culte à la Mère du Seigneur, et de qui les théologiens contemporains soulignent encore plus l’importance de la place que Marie occupe dans la vie chrétienne; ils s’unissent aux frères des Eglises de la Réforme, dans lesquelles fleurit vigoureusement l’amour pour les Ecritures, glorifiant Dieu avec les paroles mêmes de la Vierge » (MC. 32).
L’unité des chrétiens doit être pour nous un motif de plus intense supplication, parce que le testament du Rédempteur, exprimé au Cénacle et confié à Marie avant de mourir, se réalise grâce à son intervention particulière. En fait, la condition essentielle à l’aboutissement heureux du mouvement oecuménique reste toujours la « conversion » dans l’humilité et la charité (UR. 4,7,8,) et pour cela il a besoin de l’intervention et de la grâce de Marie. Pouvons-nous douter que la Mère de l’Eglise naissante soit encore aujourd’hui un « signe efficace », un « Sacrement d’unité » ?
Le Rosaire et la Famille Dominicaine
A la lumière de ces graves problèmes de l’Eglise, sont encore plus nettes la fonction prophétique de Marie et la beauté intrinsèque du Rosaire, à travers lequel nous nous unissons à Elle avec un esprit et un coeur de fils.
Pour nous Religieux et Laïques dominicains, le Rosaire est un don charismatique, prophétique, venu de la tradition de l’Ordre, de l’enseignement des Pontifes, du témoignage des Saints qui l’ont vécu avec une grande conscience de « service » à la Reine du ciel. C’est la contemplation de l’expérience vécue par Marie et son Fils, en union avec Eux; c’est la prédication typique dominicaine. (LCO n. 129).
A ce propos cependant on ne doit pas sous-évaluer l’activité créatrice que le Rosaire sait susciter sous une forme authentique (MC. 24), quand les circonstances le demandent, dans la ligne de la tradition d’Alain de la Roche et de Jacques Sprenger.
Quand la récitation du Rosaire s’oriente vers la profession de foi en la Divinité et en l’Humanité du Christ, avec Marie; quand le mystère de la Passion et de la mort du Sauveur sont rappelés comme l’Opus Justitiae de la réconciliation de l’homme avec Dieu quand la nouvelle vie de l’Eglise dans le monde est regardée a la lumière glorieuse du Christ et de sa Mère, alors le caractère christocentrique (MC. 46) et en même temps marial du Rosaire demeure entier. Et le Pater, l’Ave et le Gloria expriment oralement et accompagnent les réalités humano-divines que l’esprit a méditées et auxquelles s’est uni le coeur.
Le Rosaire est cependant une réalité vivante et, pour ainsi dire, au-delà de l’histoire. La prière mentale et orale qu’il offre aux simples comme aux savants est « fondée sur le rocher » de la Parole, puissance de Dieu pour « tous ceux qui l’écoutent et la mettent en pratique » (cf. Mt. -124 – MC. 48). Or, selon la nouvelle sensibilité de notre temps, l’Ecriture devrait trouver plus d’attention et de place dans la présentation des Mystères, pour ensuite proposer une pratique de vie (MC. 44).
Puis, afin de prolonger la contemplation des différents Mystères mêmes, leur contenu pourrait être rappelé à chaque Ave, avec l’ajout d’une petite phrase après le mot « Jésus ». Méthode fréquemment employée au XVe siècle et proposée par la « Marialis Cultus » (46). On peut encore mettre en relief que les quinze Mystères classiques ne sont pas contraires en eux-mêmes à une extension à d’autres épisodes évangéliques. Ceci en préservant toujours les trois cycles originaux, qui sont la sage intuition d’Alain de la Roche.
Une fois redécouvert dans ses éléments essentiels, le Rosaire sera naturellement vécu et adapté aux exigences de notre vie apostolique, spécialement en regard de la sensibilité religieuse des Jeunes, assoiffés de méditation et de vie évangélique, dans une expérience de groupe. Dans cette perspective le mois de mai et celui d’octobre et chaque fête mariale, offrent à notre prédication itinérante ou à une pastorale plus suivie l’occasion de renouveler nos mouvements mariaux ou d’en créer de nouveaux.
Un exemple dans ce sens peut nous venir de l’expérience des « Equipes du Rosaire » en France. En fait une sincère spiritualité mariale, centrée sur le Rosaire peut interpréter encore aujourd’hui comme par le passé les profondes instances apostoliques et missionnaires de l’Ordre. Et avec certitude d’en recueillir les fruits car Marie s’en porte garante.
Après le Ve Congrès International des Promoteurs dominicains du Rosaire, peut-être serait-il bon de penser à une rencontre périodique, selon les diverses langues. Ainsi pourraient être évaluées les situations ecclésiales concrètes et les expériences de notre ministère : dans les familles, les paroisses, parmi les Jeunes etc… Il serait aussi nécessaire de réorganiser dans les Provinces, où il est faible ou manquant, ainsi qu’à la Curie Généralice, le service de la Promotion du Rosaire.
Je suis sûr que la re-découverte, le re-départ ou la croissance du Rosaire sont des aspects de notre mission qui peuvent concerner toutes les branches de : la Famille Dominicaine : Frères, Moniales, Soeurs et Laïques. Chacun selon son état (cf. LCO. n. 141) mais tous fortement unis par un idéal commun : tout remettre à Marie, à Marie tout confier. Que St Dominique, qui y croyait tellement, continue à bénir sa Famille (Septembre 1985).
La formation dans le pré-noviciat (1987)
Lettre du Maître de l’Ordre. Septembre 1987
fr. Damian Byrne, O.P.
 L’introduction à l’Instruction sur la rénovation de la vie religieuse, « Renovationis Causam », nous rappelle la nécessité de « mener à bonne fin une meilleure adaptation du cycle complet de formation en conformité avec la mentalité des jeunes générations, les conditions de la vie moderne et les exigences actuelles de l’apostolat », reconnaissant le « rôle insubstituable et privilégié » du noviciat « comme la première initiation à la vie religieuse ». Elle dit que ces objectifs ne pourront s’obtenir que » si le futur novice possède un minimum de préparation humaine et spirituelle qui doit être vérifiée et aussi, bien des fois, complétée ». « La majorité des difficultés rencontrées au cours de la formation des novices vient généralement du fait qu’ils n’ont pas une maturité suffisante lors de leur admission… Tous les Instituts… doivent donner une grande importance à cette préparation au noviciat (RC, 4).
L’introduction à l’Instruction sur la rénovation de la vie religieuse, « Renovationis Causam », nous rappelle la nécessité de « mener à bonne fin une meilleure adaptation du cycle complet de formation en conformité avec la mentalité des jeunes générations, les conditions de la vie moderne et les exigences actuelles de l’apostolat », reconnaissant le « rôle insubstituable et privilégié » du noviciat « comme la première initiation à la vie religieuse ». Elle dit que ces objectifs ne pourront s’obtenir que » si le futur novice possède un minimum de préparation humaine et spirituelle qui doit être vérifiée et aussi, bien des fois, complétée ». « La majorité des difficultés rencontrées au cours de la formation des novices vient généralement du fait qu’ils n’ont pas une maturité suffisante lors de leur admission… Tous les Instituts… doivent donner une grande importance à cette préparation au noviciat (RC, 4).
Dans un document très récent de la CRIS, la Congrégation réitère la fonction importante du pré-noviciat. « La formation ne s’acquiert pas subitement. Le chemin entre la première réponse donnée et l’ultime engagement se divise en cinq étapes: le pré-noviciat, dans lequel est reconnu, autant qu’il se peut, l’authenticité de l’appel » (Les éléments essentiels de l’enseignement de l’Eglise sur la vie religieuse appliques aux Instituts consacrés aux Oeuvres d’Apostolat. CRIS. Rome 1983. n 48.). Le pré-noviciat est ici reconnu comme partie intégrale de la formation.
Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur cette période initiale de formation, après avoir discuté de ce sujet avec le Conseil Général, durant la réunion plénière du 11 au 13 novembre 1986.
L’expérience prouve qu’un bon nombre de ceux qui entrent dans nos noviciats ne sont pas assez préparés pour en bénéficier comme il se devrait. Le noviciat devrait commencer au moment où le candidat « est arrivé au degré de maturité humaine et spirituelle qui lui permet de répondre à cet appel avec une responsabilité et une liberté conscientes » (RC, 4). Ceci demande une attentive réflexion. Dans ce contexte le conseil du P. Vincent de Couesnongle est révélateur : « Il vaut mieux repousser l’entrée au noviciat s’il existe des doutes sur la maturité du candidat; dans le cas contraire les Frères abandonneront l’Ordre en plus ou moins grand nombre durant les premières années de formation, et ceci, inévitablement, n’est pas bon pour la ferveur du noviciat et du studentat ».
Nous voulons ordinairement que les autres aient les mêmes critères de pensée que nous-mêmes. Alors qu’ il est souvent vrai que les jeunes ont des connaissances plus grandes que ceux du même âge d’il y a 10 ou 15 ans, et ces connaissances ne sont pas toujours accompagnées par une formation chrétienne équivalente. Leur vie de foi est fréquemment basée sur une connaissance élémentaire de la doctrine, qui contraste avec leurs connaissances en matière profane.
Ceci n’est pas seulement une préoccupation pour les jeunes qui entrent dans la vie religieuse. C’est une préoccupation pour toute l’Eglise et doit l’être aussi pour les dominicains en tant que prédicateurs.
Apporter une formation chrétienne et la connaissance de la doctrine doit être un des principaux objectifs du pré-noviciat. « Enseignons la bonté, la connaissance et à être disciples ».
« Perfectae Caritatis » nous rappelle que « la norme fondamentale de la vie religieuse est de suivre le Christ, comme il est dit dans l’Evangile ». Rencontrer le Christ de l’Évangile est la base de toute formation qui veut se dire chrétienne. La Parole de l’Évangile conditionne la pensée, la conduite et l’action des candidats et les initie à suivre le Christ. Elle les initie également à la spiritualité de l’Ordre à la suite de Jésus.
Rythme de la vie moderne
Le rythme de la vie religieuse, pour adapté qu’il soit, et le rythme de la vie séculière sont différents. Le passage à la vie religieuse nécessite une certaine délicatesse et une compréhension des jeunes et de leur monde.
Le pré-noviciat permet un passage progressif de la vie civile à la vie religieuse, donnant le temps pour une progressive adaptation spirituelle et psychologique, et prépare les candidats aux changements nécessaires qu’ils devront assumer lors de leur entrée dans la vie religieuse. En même temps il leur donne une période d’indépendance vis-à-vis de leur famille et de l’Ordre.
Développement des valeurs humaines
Un des avantages importants du pré-noviciat est l’occasion donnée aux candidats de développer les valeurs humaines, de façon à ce qu’ils commencent à assumer leurs propres responsabilités, à être conscients de leurs points forts et de leurs déficiences.
Ceci me porte à réfléchir sur la politique qui vise à recruter les candidats au noviciat immédiatement à la fin de leurs études ou directement depuis les écoles apostoliques ou les séminaires mineurs. « Renovationis Causam » s’est interrogé sur la sagesse d’une telle politique. Ne devrait-on pas conseiller une période d’attente « de façon à assurer une meilleure préparation au noviciat par une nécessaire période de probation employée à développer la maturité émotive du candidat » ? (RC, 4).
Avant d’entrer au noviciat les jeunes doivent développer une certaine indépendance dans l’usage responsable de leurs biens matériels. En second lieu un certain temps est nécessaire pour développer la capacité de prendre des décisions. Il faut également un temps pour développer les relations normales avec les autres, hommes et femmes. Il resterait une équivoque si les candidats entraient au noviciat avant que ces qualités ne soient convenablement maturées. Le danger existe, que lors d’un recrutement prématuré, les questions de la propriété, de l’autonomie personnelle et de l’acceptation de sa propre sexualité, ne soient pas résolues. L’année de pré-noviciat devrait aider à clarifier ces problèmes. D’autre part, vivre avec les autres, devrait aider aussi les candidats à développer les relations permanentes, comme préparation à la vie communautaire, aider à apprécier le don de l’amitié humaine et au choix du célibat.
Pour que les candidats puissent développer ces qualités le climat du pré-noviciat devrait leur apporter une liberté suffisante pour les obtenir. Une super-structure du pré-noviciat le convertirait en mini-noviciat ou empêcherait d’atteindre les objectifs du pré-noviciat.
Lieu et durée du pré-noviciat
La durée, la forme et, le lieu du pré-noviciat doivent être déterminés par le Chapitre Provincial ou par le Provincial et son Conseil (LCO, 167).
Pour ma part, je suis d’accord avec la recommandation de RC, il ne doit pas être dans la maison où est le noviciat, où se vit complètement la vie régulière de l’Ordre, mais dans une maison distincte de celle-ci, afin que le mode de vie puisse s’ajuster mieux à la croissance des candidats et aux nécessités de cette période de transition.
Les 33 réponses que nous avons reçues des diverses entités de l’Ordre indiquent clairement qu’il existe une grande variété de programmes de pré-noviciat. Quelques uns insistent sur le développement de la maturité humaine et spirituelle, en même temps que compléter l’éducation formelle du candidat, études de langues et inclure la philosophie. D’autres mettent l’accent sur la récitation chorale de l’Office et sur l’initiation à la vie dominicaine. Tous ces éléments peuvent être valides dans un programme particulier mais l’accent doit être mis sur le développement humain et chrétien du candidat, en donnant à chacun la possibilité d’une certaine indépendance (comme il est expliqué au paragraphe sur les valeurs humaines), dans l’espoir qu’une salutaire indépendance conduira à une non moins salutaire interdépendance. J’espère que tout ce qui est dit antérieurement puisse clarifier quelques unes des équivoques qui existent en regard de la formation dans le pré-noviciat. Ce n’est pas la vie religieuse mais une préparation à cette vie.
Je ne vois pas comment le pré-noviciat pourrait atteindre ses objectifs en moins d’un an. En même temps je crois qu’un certain mode de vie en commun est désirable. Pour beaucoup de candidats ce sera la première expérience de vivre et de se plier à une vie partagée avec d’autres en communauté.
Entrée en communauté
Le travail du pré-noviciat est complété par la procédure qui conduit à l’entrée au noviciat. Cette procédure est déterminée dans LCO, 170. Beaucoup de demandes de dispense des voeux temporaires auraient pu être évitées s’il y avait eu plus d’attention à ce moment. Il serait souhaitable que tous ceux qui entrent au noviciat persévèrent, mais il devrait y avoir des signes positifs et un espoir fondé sur leur persévérance. Nous devons reconnaître, ici même, que la croissance de la vie religieuse est un processus graduel. Aucun de nous n’a été religieux subitement.
Certains Provinciaux s’adressent à des psychologues au cours de la procédure. Ceci est une matière très délicate et on doit respecter soigneusement les droits des individus (cf. Can.646, 220). Cette aide peut être très utile pour guider les candidats dans leur croissance future comme êtres humains et religieux, en même temps qu’elle sert à la commission d’admission à prendre sa décision. Cependant il doit être clairement dit que cette évaluation ne substitue pas la fonction du comité d’admission. Le droit d’admettre le candidat appartient toujours à la Province. (LCO, 171)
Les Constitutions, au no. 155 marquent bien le désir de l’Ordre au cours de la procédure d’admission quand elles disent : « Pour recevoir une formation fructueuse il est requis, de la part du candidat, la santé physique, la maturité psychologique proportionnée à l’âge, l’aptitude à la vie sociale, une réelle fermeté dans la vie chrétienne, l’intention droite et la volonté libre de se consacrer à Dieu et à l’Église dans la vie dominicaine. »
Vocations
Le travail de l’éclosion des vocations incombe à chaque membre le l’Ordre. Et non pas exclusivement aux promoteurs des vocations. Si nous croyons en nous-mêmes nous devons promouvoir des vocations.
La fidélité à l’oraison, le témoignage de nos vies et le témoignage de notre prédication contribueront à attirer des vocations. Mais nous devons les chercher activement. Dominique n’attendait pas que les jeunes viennent à lui. Il allait à leur rencontre, les visitant chez eux et les invitant à s’unir à l’Ordre. Dans se lettres à Diane, Jourdain de Saxe lui demande souvent des prières « pour que d’autres nous rejoignent »… et pour que « nous puissions convertir l’espérance en réalité ». Pouvons-nous faire moins ?
Etre indifférents aux vocations est refuser la vie. Frère Vincent nous rappelait que « comme des parents qui ne veulent pas d’enfants, ainsi sont les communautés religieuses qui repoussent les jeunes par peur d’avoir à changer leur style de vie ». Je fais mienne sa parole.
Les vocations augmentent peau à peu dans certaines parties de l’Europe et continuent à croître en Afrique, Asie, Amérique Centrale et Amérique du Sud et dans le Pacifique. Les vocations indigènes doivent être stimulées et être l’objet de sollicitude en tout lieu. Écrivant au roi d’Espagne en 1525, Rodrigo de Albornoz disait qu’une vocation indigène serait plus efficace que 50 missionaires. Une exagération ? Peut-être. De toute façon, personne en comprend mieux la mentalité, le coeur et le mode d’être et de penser que ceux qui appartiennent à un même groupe. Toute communauté a besoin de ses propres religieux et de ses propres prêtres. Dans les pays où existent différents groupes de culture, langue etc… nous devons avoir le courage de prendre l’initiative de provoquer des vocations dans ces différents groupes.
L’Ordre espère se réimplanter dans des pays où il fleurissait jadis et s’établir dans d’autres où rien n’a encore existé. C’est un travail qui exige des sacrifices, mais il n’y a pas de vie qui mérite ce nom qui n’exige des sacrifices.
En conclusion, beaucoup de Provinces sont arrivées à des réalisations, ont fait de gros sacrifices d’argent, de personnel et autres pour arriver aux meilleures formes de formation initiale dans le pré-noviciat, le noviciat et les années d’études. L’expérience des années passées nous enseigne que ces Provinces qui ont développé avec soin de sérieux programmes de formation, jouissent de la stabilité dans leurs maisons et peuvent envisager le futur avec confiance.
Quand fréquemment nous parlons de notre survivance avons-nous le courage de nous interroger : survivance pourquoi ? Notre réponse à cette question déterminera l’importance que nous donnerons à la formation dans toutes ses phases. La qualité de la prochaine génération de dominicains dépendra de l’exemple et de la formation que nous donnons à ceux qui entrent aujourd’hui dans l’Ordre. Dans ce processus la formation du pré-noviciat joue un rôle fondamental (Septembre 1987).
Les laïcs et la mission de l'Ordre (1987)
Lettere du Maître de l’Ordre. Novembre 1987
fr. Damian Byrne, O.P.
 Le Chapitre Général d’Avila a institué une commission spéciale pour étudier le rôle des laïques dans notre apostolat. Ainsi le Chapitre rappelle l’importance croissante que le laïcat est en train d’acquérir dans l’Église, particulièrement depuis Vatican II. Cette commission capitulaire a demandé au maître Général de l’Ordre « d’écrire aux frères et à toute la Famille Dominicaine sur les laïques dans notre apostolat et sur les laïques dominicains dans le monde actuel » (no. 95) .
Le Chapitre Général d’Avila a institué une commission spéciale pour étudier le rôle des laïques dans notre apostolat. Ainsi le Chapitre rappelle l’importance croissante que le laïcat est en train d’acquérir dans l’Église, particulièrement depuis Vatican II. Cette commission capitulaire a demandé au maître Général de l’Ordre « d’écrire aux frères et à toute la Famille Dominicaine sur les laïques dans notre apostolat et sur les laïques dominicains dans le monde actuel » (no. 95) .
Cette lettre veut donner une réponse opportune à cette commission du Chapitre. C’est un hommage à toute la Famille Dominicaine pour le succès remporté dans cette importante sphère ecclésiale et, en même temps » une fraternelle interpellation à tous les membres de la Famille Dominicaine pour qu’ils intensifient leur dévouement et leur travail dans ce nouveau défi ecclésial.
1. Le réveil des laïques, un nouveau signe ecclésial
Le Concile Vatican II s’est fait l’écho d’un nouveau signe ecclésial: le réveil des laïques pour une nouvelle étape ecclésiale de co-responsabilité et le sens de la communion. Les paroles du Concile furent une reconnaissance et un accueil favorable de cette nouvelle étape, et, à la fois, une invitation à toute l’Église de suivre ce chemin. Le récent Synode extraordinaire des Evêques a entendu la voix autorisée du Concile et a donné de nouvelles directives et de nouveaux objectifs comme complément des la vocation et de la mission des laïques dans l’Église.
Le réveil des laïques à la ministérialité et à la co-responsabilité ecclésiale est un signe des temps avec une signification théologique profonde. Les déclarations conciliaires ou synodales sont seulement le reflet d’un fait historique qui se produit de partout et dans toutes les églises locales, et également dans l’Église universelle.
Je vous invite à revoir avec moi quelques faits présents dans l’actuelle conjoncture de l’Église:
a) Les églises locales, beaucoup d’entre elles sont de jeunes églises, sont en train d’acquérir une spéciale vitalité grâce à l’active coresponsabilité des laïques, hommes et femmes, conscients de leur vocation chrétienne et de leur mission et responsabilité apostoliques… les efforts de revitalisation, réorganisation, inculturation… rénovation missionnaire.. sont fréquemment soulevés et menés à bien par les laïques en dialogue et collaboration avec leurs pasteurs.
b) Le fait d’une progressive diversification des ministères assumés par les laïques à l’intérieur de la communauté a acquis une singulière importance. Chaque jour s’accroît le nombre des laïques qui découvrent et réalisent des ministères spécifiques dans l’Eglise. Dans la majorité des cas se sont des ministères reconnus et approuvés par leurs pasteurs. S’accroît également le nombre des laïques qui se dédient à la catéchèse et à l’évangélisation, à la réflexion et à l’enseignement théologique, à la guide et à l’animation de la communauté, à l’administration et aux services sociaux, à la lutte pour la justice et la paix dans le monde. Ces ministères ne sont pas exercés sans autre préparation que la bonne volonté; ceux qui les exercent se sentent obligés d’avoir une formation et une préparation spécifiques.
Du point de vue théologique, ecclésial et pastoral, il est très significatif que le « leadership » assumé par les laïques soit en croissance. Ce n’est pas un simple leadership qui supplée au manque de prêtres ou qui les supplante. C’est le leadership de beaucoup de laïques qui, par vocation ou par un charisme spécial, se sentent appelés à devenir animateurs de la communauté chrétienne dans la prière, le partage de la Parole, dans les engagements sociaux ou politiques, dans les oeuvres de charité et de justice. Ces leaders laïques inaugurent une nouvelle étape non seulement pour la conception mais aussi pour lé fonctionnement de l’autorité dans la communauté chrétienne.
d) Dans le réveil du laïcat, la présence de la femme acquiert une singulière importance après trois siècles de silence et de marginalisation. Les dons naturels et les charismes spéciaux de la femme injectent une vitalité neuve dans la communauté chrétienne et révèlent une nouvelle face de l’expérience chrétienne. Son sens du pratique, la spéciale sensibilité féminine, sa maternité, sa constance dans les épreuves révèlent des aspects cachés de la Parole de Dieu, de la communion chrétienne, de l’expérience du Règne.
Ces phénomènes présents ,dans l’Eglise actuelle ont provoqué une collaboration qui va croissant, entre laïques, religieux, prêtres, dans les différentes sphères de la vie ecclésiale. Chaque fois un peu plus, dominicains et dominicaines partagent leur vie et leurs projets avec d’autres religieux et laïques, hommes et femmes, mariés ou célibataires. Les laïques ne sont pas seulement l’Objet de notre mission; ils partagent avec nous – et nous avec eux – une même responsabilité dans la communauté chrétienne.
En face de ce fait ecclésial il est normal que les dominicains se posent quelques questions: Comment sentons-nous et réagissons-nous au réveil des laïques dans l’Eglise ? Acceptons-nous ce fait de bon gré ? L’ignorons-nous par autosuffisance ? Le rejetons-nous par fausse peur ? Quelles sont nos attitudes et nos réactions en face des laïques ? Quelle place les laïques tiennent-ils dans notre ministère, dans l’élaboration et la réalisation de nos projets apostoliques ? Etre en harmonie avec l’Eglise signifie aujourd’hui, entre autre chose, assumer ces interrogations et y répondre avec sincérité.
2. Clés pour une réflexion chrétienne
La réflexion théologique aujourd’hui porte son regard vers les signes des temps pour lire, interpréter et discerner les exigences de la Parole de Dieu et de l’expérience chrétienne. Faire de la théologie ou prêcher est mettre en contact la Parole de Dieu avec les situations historiques des hommes. La fidélité à notre riche tradition théologique exige de nous une écoute attentive et un discernement théologique de ce nouveau signe ecclésial des temps. Nous ne pouvons oublier que ce furent précisément nos frères théologiens de Vatican II qui développèrent la nouvelle théologie du laïcat et de la ministérialisation de la communauté chrétienne.
La première clé pour réfléchir sur le laïcat et sa mission dans l’Eglise nous est proposée par l’ecclésiologie de Vatican II. Celui-ci a changé la définition juridico-institutionnelle de l’Eglise en une conception ou définition spécifiquement théologique. Le critère majeur de cette nouvelle définition est « Le Peuple de Dieu »: l’Eglise est le nouveau Peuple de Dieu; rassemblé par la foi dans le Ressuscité, et scellé par le Baptême en Jésus-Christ. Il existe aujourd’hui une certaine tendance à affirmer que la « communion » exprime la nature de l’Eglise mieux que « Le Peuple de Dieu ». Cependant, tant Vatican II qu’une tradition gaélique très antique sont en faveur de la définition « Peuple de Dieu ». Tous les baptisés participent de plein droit à cette vocation et à cette mission. Tous sont Peuple de Dieu, membres actifs et responsables de l’Église dans sa mission.
b) Cette conception ecclésiologique du Concile nous conduit à une nouvelle conception de la ministérialité et des ministères dans l’Église. Tous les ministères et charismes sont des dons de Dieu au travers de la communauté. Et là est la seconde clé importante pour notre réflexion théologique. Le sujet de la ministérialité est la communauté chrétienne. Tout baptisé partage radicalement cette dimension de la ministérialité. La diversification des ministères est l’expression de la dimension ministérielle dans la communauté.
Une troisième clé de réflexion théologique nous oblige à réviser notre traditionnelle théologie du ministère. Je me réfère à leurs critères de valorisation et de hiérarchisation. Le caractère sacré des actes liturgiques et le lien étroit entre ministère sacerdotal et autorité dans l’Eglise nous ont acçoutumé à un point de vue sacré et liturgique, donnant la préférence à ce ministère. Dans cette forme, les fonctions et les ministères associés au culte occupent le premier poste dans notre échelle des valeurs, tandis que le ministère plus « laïque » est relégué au second poste. Ceci doit changer. Se rappelant le conseil de St Paul aux Corinthiens, il est nécessaire de retrouver les critères communautaires pour valoriser et donner la préférence au charisme et au ministère. Le charisme et le ministère auront une plus grande importance pour le chrétien dans la mesure où ils serviront à la construction de la communauté chrétienne.
Cette troisième clé théologique nous aide à surmonter le traditionnel dualisme, et dans beaucoup de cas, la fausse opposition, entre le sacerdoce et le laïcat. Il vaut la peine de rappeler les paroles du P. Congar à ce propos :
« L’Église ne se construit pas seulement avec les actions des ministres officiels du sacerdoce, mais aussi avec beaucoup d’autres services, plus ou moins fixes ou occasionnels, plus ou moins spontanés ou reconnus, quelques-uns consacrés par l’ordination sacramentale. De tels services existent, ils existent même si on ne les appelle pas par leur nom : ministères qui n’ont pas leur vraie place et status dans l’ecclésiologie… On voit alors que le double élément décisif n’est pas « sacerdoce-laïcat », mais « ministères (ou services) et communauté ».
Ceci aide à comprendre la diversification et la répartition des charismes et des ministères entre tous les membres de la communauté, ordonnés ou laïques, hommes ou femmes. Finalement, ce qui est très important, ceci aide à reconnaître la profonde signification chrétienne qu’ont les ministères exercés par les baptisés dans la recherche d’une société plus humaine, plus fraternelle, plus juste: promotion, assistance, défense des droits de l’homme etc…
Ces clés théologiques doivent stimuler notre réflexion et notre discernement dans la pratique de notre activité pastorale et ecclésiale. La théologie nous offre aujourd’hui des points solides et des points discutés autour des ministères. C’est une mission des dominicains d’offrir à la communauté chrétienne le ministère et le charisme du discernement théologique, si nous entendons rester fidèles à notre tradition. Cependant notre réflexion théologique ne sera pas féconde si elle s’éloigne de notre action chrétienne, ecclésiale et apostolique.
3. Défis et engagements pour la famille dominicaine
Le centre du charisme dominicain doit se trouver dans la prédication, dans l’annonce kérygmatique de la Parole de Dieu. Etre dominicain c’est être prêcheur. Ceci est le plus important du projet dominicain. Cependant cette annonce est plus qu’un simple discours verbal qui passe à travers la catéchèse, l’homélie ou l’enseignement religieux. Il se manifeste dans n’importe quelle parole, ou pratique historique qui proclame l’événement salvifique au centre de l’Histoire humaine.
Le lieu spécifique de rencontre entre les dominicains et les laïques est exactement le charisme et le ministère de la prédication. La Famille Dominicaine est appelée à être une communauté de prédication dans laquelle frères, religieux, laïques sont membres actifs et coresponsables avec des charismes et des ministères différenciés.
L’Ordre naquit dans un moment historique de crise ecclésiale, mais aussi d’extraordinaire vitalité. Ce fut un temps de réveil des mouvements laïques, ce qui a influé grandement sur la naissance et le projet des Ordres Mendiants et a créé une nouvelle conception de l’Église au-delà des limites paroissiales ou diocésaines. Au long de son histoire l’Ordre a eu des expériences significatives qui peuvent nous aider à comprendre et à assumer les nouveaux temps du laïcat: l’incorporation du Tiers-Ordre au projet dominicain, l’évolution des fonctions et des ministères des frères coopérateurs, l’incorporation de nombreuses congrégations féminines à la mission de l’Ordre. Le souvenir de ces faits est un défi pour les temps nouveaux.
Aujourd’hui je pense que nos communautés sont appelées à inaugurer et à potentialiser de nouvelles pratiques ecclésiales qui mèneront le laïcat vers la collaboration dans le ministère de l’Église.
La pratique de la prière partagée avec les laïques leur offre la richesse d’une prière cautionnée par les siècles qui, en même temps, reçoit d’eux la nouveauté et la fraîcheur de nouvelles expériences chrétiennes. Quelques-unes de nos communautés dominicaines seraient revitalisées dans, leur prière si elles la partageaient avec les laïques. Les exemples ne manquent pas.
Il faut de même inaugurer et potentialiser de nouveaux modèles de formation partagés avec les laïques. Ceci ne peut s’orienter vers une seule direction, comme si nous étions les maîtres et eux les disciples. Il faut une formation partagée et mutuelle. La Parole de Dieu n’est pas enchaînée: elle est ouverte à l’intelligence de tout croyant qui en est à l’écoute. Nous autres pouvons apporter la richesse de notre formation théologique, mais nous devons apprendre à écouter afin de nous enrichir par le dialogue avec ces mêmes croyants.
Notre travail apostolique doit être révisé et réorienté dans la perspective des nouveaux ministères laïques, pour répondre adéquatement à la nouvelle relation ecclésiale avec les laïques. Ces travaux sont appelés à potentialiser une nouvelle forme plus collégiale d’exercer l’autorité et le leadership. Nous devons trouver de nouvelles formes de partager les projets apostoliques, de diversifier les fonctions et ministères dans notre activité apostolique. La cause de l’Évangile doit s’opposer à nos routines, commodités et peurs. Une communauté dominicaine en état de mission et d’itinérance est une communauté ouverte au présent et au futur de l’Église et de la société.
Le Chapitre d’Avila (no. 85 A) s’est rendu compte du malaise qui existe dans le laïcat dominicain. On rencontre fréquemment aujourd’hui un problème particulier: l’absence quasi totale de jeunes, avec pour conséquence une perte de vitalité. Ne serait-ce pas, en partie, à cause de la méconnaissance des enseignements de l’Église à partir du Concile Vatican II ? Le même problème fut pris en considération par le Congrès du laïcat dominicain célébré à Montréal en 1985. Devant cette situation il faut repenser et réorienter les groupes du laïcat dominicain en harmonie avec les nouvelles pratiques ecclésiales et les nouvelles clés théologiques concernant la place et la mission dés laïques dans l’Eglise et le monde.
4. En regardant vers le futur
Nos frères et soeurs se façonnent progressivement à ce nouveau style de vie et de mission dominicaine pour une Eglise neuve qui est en train de naître. Beaucoup ont déjà commencé et sont un stimulant pour toute la Famille Dominicaine. Leur nouveau style rend plus crédible notre vocation. C’est une opportunité de renouveler l’Ordre. Ce réveil des, laïques nous offre une nouvelle frontière. Pour la traverser il faut du courage.
Le futur de l’Eglise et de la Famille Dominicaine nous demande beaucoup. Les raisons qui nous empêchent de nous rénover nous donnent une fausse sécurité, mais comme nous le rappelle Saint Jean Baptiste, le premier prédicateur de Jésus-Christ : « Il faut que je diminue pour que Lui grandisse » (J. 3, 30). Comme Jésus, la grâce divine qui vit dans chaque fidèle, croît quand ils la proclament jusqu’aux confins de la terre. Que le souvenir de saint Dominique nous donne le courage pour nous engager sous ce nouveau signe ecclésial. (23 novembre 1987).
Le défi de l'évangélisation aujourd'hui (1988)
Lettre aux Provinciaux, Vice-provinciaux et Vicaires provinciaux en date du 25 mai 1988
fr. Damian Byrne, O.P.
 Comme quelques-unes de nos Congrégations et Provinces décroissent en nombre, il existe le péril que nous nous concentrions sur nos propres problèmes et que l’impulsion de l’évangélisation s’affaiblisse en nous. Si cela existe il est important de mettre devant nos yeux – et les yeux de ceux qui sont en formation – le défi de l’évangélisation.
Comme quelques-unes de nos Congrégations et Provinces décroissent en nombre, il existe le péril que nous nous concentrions sur nos propres problèmes et que l’impulsion de l’évangélisation s’affaiblisse en nous. Si cela existe il est important de mettre devant nos yeux – et les yeux de ceux qui sont en formation – le défi de l’évangélisation.
Parlant des premiers dominicains, Honorius III disait: « Les membres de cet ordre sont entièrement consacrés à l’évangélisation ». Affirmation surprenante. Celle de Paul VI en 1970 ne l’est pas moins quand il nous rappelle: « L’Ordre dominicain restera fidèle à sa tradition s’il ne s’éloigne pas de son devoir missionnaire », ou l’affirmation du P. Vicaire, qui dit que l’Ordre fut « le premier Institut réellement missionnaire dans l’Eglise ». Actuellement notre perception de l’évangélisation a été transformée par les intuitions de Vatican II, par Evangelii Nuntiandi et par la réflexion intense de ces dernières années.
Avant Vatican II, les efforts d’évangélisation se concentraient pour porter l’Évangile aux non-chrétiens, un mouvement allant du centre vers la périphérie. Aujourd’hui ce mouvement s’est enrichi d’autres mouvements: de la périphérie vers le centre, en ce sens que les « nouvelles Églises » donnent leur propre témoignage et aident à leur tour à l’évangélisation des « anciennes Églises ». L’Europe est en train d’apprendre à son tour de l’Amérique Latine, de l’Afrique et des Églises d’Asie. Nous sommes entrés dans une période d’écoute mutuelle et de coresponsabilité. Conscients de ce mouvement et du défi qu’il nous présente, nous sentons de nouveau la. richesse de la vision originelle de Dominique et son enthousiasme pour l’évangélisation.
Vision progressive de Dominique
L’ardente passion de Dominique pour le salut de tous a impressionné fortement ses compagnons intimes. Le Jeune Guillaume de Monferrat nous dit que « Dominique avait par-dessus tout le zèle pour le salut des âmes ». « Ainsi nous deux nous, nous promettions que, lorsque frère Dominique aurait organisé son Ordre et que moi j’aurais étudié deux ans la théologie, nous marcherions avec lui et ferions tout notre possible pour convertir les païens en Prusse et dans les autres pays du Nord ».
Des affirmations comme celle-ci se rencontrent dans beaucoup des témoins du procès de canonisation. Jourdain de Saxe dit la même chose quand il affirme:… »avec toute son énergie et son zèle passionné, il (Dominique) se consacrait à gagner au Christ toutes les âmes qu’il pouvait. Son coeur était plein d’un extraordinaire, d’un incroyable désir du salut de tous ». Jourdain nous dit aussi: « Il élevait fréquemment au ciel sa prière pour que Dieu lui donne la véritable charité, qu’elle soit effective pour obtenir le salut de tous; il pensait qu’il serait réellement un membre du Christ seulement quand il aurait usé toutes ses forces pour la conquête des âmes… »
Dominique ne réalisa jamais son rêve d’être missionnaire dans le monde non-chrétien, mais il lança son ordre sur ce chemin. Au Chapitre de 1221, il était décidé d’envoyer des groupes de dominicains dans trois territoires bien au-delà des frontières du christianisme. Ceux qui furent envoyés avec Paul de Hongrie demandèrent d’aller vers les Cumans pour que soit réalisé le rêve de Dominique. Le Chapitre prit la décision mais l’inspiration venait de Dominique.
Sa méthode d’évangélisation
Guillaume de Monferrat nous dit: « Bien des fois j’ai parlé avec lui des moyens de salut pour nous et pour les autres ». Dominique mit en pratique ses fermes convictions sur la manière de réaliser l’évangélisation. Comme dans beaucoup d’autres champs, celles-ci étaient fréquemment en contradiction ,avec les idées de ce temps-là sur l’évangélisation.
1.Prédication dans la pauvreté selon le modèle évangélique.
Nous connaissons le moment exact où cette conviction s’est manifestée pour la première fois et où il adopta sa façon personnelle de prêcher la Parole de Dieu. Ce fut en juin 1206, quand Diego et Dominique rencontrèrent les légats cisterciens à Montpellier. Découragés par l’échec apparent de .leur prédication, ils demandèrent conseil à l’évêque. Sa réponse fut: « Je ne crois pas que vous agissiez en cela selon la voie juste. Je ne pense pas que vous puissiez jamais faire revenir les gens vers la foi en leur parlant, car ils sont très enclins à douter en raison des exemples qu’ils voient ». Pour les hérétiques, les prédicateurs de l’Évangile devaient vivre selon le modèle apostolique. Diego et Dominique firent de ce modèle leur propre manière de prêcher et Dominique a continué à la pratiquer après la mort de Diego. Il eut l’intuition de la connexion qui existe entre la mission et la forme de vie menée pour le Christ. L’engagement principal de Dominique était de prêcher l’Évangile. « Sa vocation personnelle était cependant très précise: porter l’Évangile aux peuples lointains qui ne l’avaient pas encore reçu ».
2. Mobilité apostolique et itinérante.
La mobilité apostolique fut un élément clé dans la méthode d’évangélisation de Dominique. Il voulait qu’en cela aussi sa vie ressemble à celle du Christ. Dans les maisons de l’Ordre il n’y avait aucune cellule que l’on puisse dire sienne. Cette mobilité fut une arme apostolique qui lui permit de rester avec et au milieu du peuple. Le P. Vicaire s’empresse de dire que « si son ministère était universel pour les personnes, pour ceux qu’il dirigeait et pour le succès immédiat, son plan d’action était concret: le contact par la prédication et non par un engagement dans une activité pastorale locale ».
3. L’importance de la communion avec l’Église.
Quand Diego et Dominique arrivèrent à Rome en 1206, ils demandèrent au Pape de leur permettre de se consacrer à la mission pour les peuples de l’Europe du Nord. Le Pape ne le leur permit pas. Ce fut une obéissance douloureuse, car elle s’opposait à leur inspiration apostolique. Et cependant sans cet acte d’obéissance l’Ordre n’aurait jamais existé. Probablement, s’ils avaient obtenu la permission, ils auraient fait partie du mouvement missionnaire du Nord de l’Europe de ce temps, une méthode basée sur la conquête. Ceci n’était pas le modèle d’évangélisation demandé par Dominique aux premiers missionnaires dominicains, ils ne demandaient l’appui d’aucune armée. Dominique et l’Ordre auraient pu se convertir facilement en partie au mouvement missionnaire qui unissait l’évangélisation et la conquête. L’obéissance les a libérés de cela. Ils abandonnèrent cette forme d’évangélisation en faveur d’une méthode basée sur celle des apôtres: prédication dans ha pauvreté, indépendance vis-à-vis du pouvoir civil.
Dans une lettre à l’Ordre en 1970, le cardinal Villot décrivait Dominique comme « libre d’une façon surprenante ». Pour Dominique la liberté de l’esprit n’était pas accidentelle mais un libre propos délibéré.
Ces convictions sur l’évangélisation se reflètent sur ce que dit Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, nos 40-48.
Mission à travers le monde
Avec les successeurs de Dominique, les frontières de la prédication se sont étendues au monde entier. Ceci s’est réalisé en deux phases: celle qui suivit la mort du Fondateur et celle qui coïncida avec les grandes découvertes maritimes des XVème et XVIème siècles.
A la mort de Dominique, Jourdain de Saxe a établi des missions en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Raymond de Penyafort ouvrit des écoles pour l’étude des langues orientales et de l’Islam. Une série de Papes confièrent à l’Ordre de nouveaux champs d’évangélisation.
La seconde phase a commencé avec la découverte des Amériques et de la route de la mer vers l’Asie. C’est une belle histoire, mais tout n’est pas beau en elle. Le 15 juillet 1582, Paul Constabile, Maître de l’Ordre, écrivait que les dominicains étaient en décadence dans leurs activités missionnaires. En réponse à sa lettre, la Province du Rosaire commençait à travailler en Asie. De ces premiers missionnaires ont surgi les martyrs japonais et vietnamiens.
Les Martyrs japonais et vietnamiens
Le 18 octobre 1987, le Pape Jean-Paul II a canonisé Lorenzo Ruiz, laïque philippin, et ses 15 compagnons. Le décret de béatification de 1980 disait: « D »une façon ou d’une autre tous faisaient partie de l’Ordre des Prêcheurs ». Le groupe comprenait deux catéchistes, deux membres de la branche féminine du laïcat dominicain, deux frères laïques et neuf prêtres, ensemble avec Lorenzo Ruiz, qui était membre de la Fraternité du Rosaire. Neuf étaient japonais, quatre espagnols, un philippin, un italien et un français, reflétant ainsi le caractère international des missionnaires.
Au moment où j’écris cette lettre, la canonisation des martyrs du Vietnam est proche. Il s’agit de dix laïques dominicains, trois prêtres tertiaires, six évêques dominicains et seize prêtres.
Ces événements coïncident avec le quatrième centenaire de la Province du Rosaire en Orient. Trente deux des nouveaux saints étaient membres de cette Province.
Quand Humbert de Romans demanda des volontaires pour les missions en 1255, il se rendit compte qu’il y avait deux choses qui retenaient les frères pour s’offrir comme volontaires pour le travail de l’évangélisation. « Une est l’ignorance des langues, il y a à peine un frère qui entreprend l’étude des langues, puis la majorité préfère exercer son intelligence dans des nouveautés plutôt que dans l’étude de ce qui serait vraiment utile… L’autre obstacle est l’amour de sa propre patrie… »
Un aspect digne de mention chez les canonisés de cette année est l’importance qu’ils donnaient à l’apprentissage des langues. On donnait six mois aux missionnaires pour apprendre la langue; s’ils n’y arrivaient pas ils étaient renvoyés dans leur patrie.
Les autres caractéristiques importances étaient l’usage de la musique et du théâtre, la seule dépendance autochtone envers la Parole de Dieu et le refus d’être identifiés au pouvoir colonial.
On doit également noter leur opposition à l’esclavage et à toute forme d’injustice et d’avidité, ainsi que l’insistance d’hommes comme Domingo de Salazar, pour que la liberté soit rendue aux esclaves.
La proximité avec les gens qu’ils évangélisaient était surprenante ainsi que leur mutuelle aide et fidélité durant l’emprisonnement et le procès. Ils formaient une véritable communauté. Quand Madeleine de Nagasaki vit que Jordan Esteban avait été emprisonné, immédiatement elle se présenta aux autorités pour partager son martyre. Son unique crime était d’avoir donné l’hospitalité aux chrétiens. Nous honorons ces hommes et ces femmes et nous reconnaissons dans leur canonisation un message pour les hommes d’aujourd’hui.
Nous reconnaissons en même temps que nous ne pouvons pas travailler de la façon dont ils le firent, car les méthodes d’évangélisation changent avec les époques.
Avant Vatican II, l’évangélisation tendait à avoir une signification géographique et juridique. Le premier congrès missionnaire des frères et soeurs, qui a eu lieu à Madrid en 1973, a pris diverses résolutions à cet égard qui sont maintenant reprises dans LC0112.
Modèles géographiques et juridiques
Ces modèles identifient l’évangélisation avec le travail dans les nations non-chrétiennes et quelques nations étaient identifiées comme territoires de mission. Mais l’extension de la sécularisation qui nie à Dieu une place dans la vie de l’homme a créé la nécessité d’une seconde évangélisation dans beaucoup de nations chrétiennes. L’indifférence religieuse et l’expansion de l’incrédulité parmi les baptisés demande une urgente évangélisation de ceux-ci. Intimement lié à ce fait, on trouve le défi d’une société de consommation qui tend à faire du plaisir la suprême valeur de la vie humaine (cfEvangelii Nuntiandi, no. 55).
Une autre erreur est que ceux qui travaillaient en territoire de mission, indépendamment du travail qu’ils réalisaient, étaient appelés missionnaires. Evangelii Nuntiandi a corrigé ceci en affirmant que « il n’y a pas de véritable évangélisation si le nom, l’enseignement, la vie, les promesses, le Règne et le mystère de Jésus de Nazareth ne sont pas proclamés » (Evangelii Nuntiandi no.22). Ceci est le critère qui nous permet de savoir si nous sommes évangélisateurs ou non.
Conscients des déficiences de ces modèles nous reconnaissons l’urgente nécessité de proclamer la Bonne Nouvelle à ceux qui ne l’ont pas reçue. Fidèles au souvenir de saint Dominique, nous dominicains, nous devons continuer le travail dans les nations qui sont au-delà des frontières de lai culture occidentale. Il nous vient immédiatement à l’esprit les populations d’Asie qui représentent 60% de la population mondiale, ainsi que l’Afrique et quelques parties des Amériques.
Nouveaux modèles d’évangélisation
Evangelii Nuntiandi nous a rappelé que « les méthodes d’évangélisation changent selon les temps » (Evangelii Nuntiandi no. 40). En réponse à ceci, de nouveaux modèles d’évangélisation surgissent.
Nous pouvons constater qu’à mesure que nous nous approchons de la fin du second millénaire du christianisme, le progrès de l’évangélisation durant deux mille ans a été très limité. Les catholiques ne constituent en réalité que 18% de la population mondiale. Malgré des structures d’Eglise qui existent à peu près partout, le message salvifique de Jésus n’a pas été universellement accepté. L’évangélisation est aujourd’hui une tâche aussi urgente qu’à l’époque de saint Dominique.
Construire le Règne implique une lutte contre tout ce qui empêche sa croissance: le péché sous toutes ses formes. Dans une société, l’implantation du Règne peut se caractériser par la lutte contre les structures injustes qui oppriment le peuple. Dans une autre, cela peut consister dans une lutte contre l’influence corrosive du matérialisme qui envahit tout et la mentalité de consommation. En conséquence, l’évangélisation peut revêtir des facettes diverses selon les circonstances où elle se réalise. Le message de Jésus, la promesse de salut et le Règne seront les mêmes, mais le message sera incarné pour qu’il corresponde au défi présenté par telle ou telle situation. Ce discernement demande aux évangélisateurs une observation attentive de la réalité.
La complexité de la société moderne oblige ceux qui se consacrent à la mission d’évangélisation de demander la collaboration de spécialistes en sciences sociales pour pouvoir travailler de manière efficace. Tous les Vicariats, Provinces ou Congrégations ne disposent pas de personnel préparé. Si nous n’avons pas ce personnel parmi nous, nous avons l’obligation de le chercher chez les autres, soit dans l’Eglise soit dans le monde séculier. Notre histoire nous pousse vers cette nouvelle orientation. Le Chapitre de 1232 interdisait aux dominicains l’étude des philosophes païens et des sciences profanes. Vingt ans après, Thomas et Albert virent la nécessité de telles études et un autre Chapitre a révoqué la décision. Aujourd’hui nous avons besoin de personnes préparées en psychologie sociale, anthropologie culturelle, religions comparées pour pouvoir élaborer de nouvelles méthodes d’évangélisation. Si nous ne cherchons pas l’aide de tels instruments, notre travail en sera appauvri.
A ce propos, je veux souligner la nécessité de la formation permanente et celle d’une année sabbatique pour les missionnaires. Il existe une différence marquée entre les Provinces et Vicariats qui ont compris la nécessité d’une telle formation et qui ont réalisé les sacrifices nécessaires pour implanter cette politique, et celles qui ne l’ont pas fait.
Dans son oeuvre Offices de l’Ordre, Humbert de Romans remarque que c’est une obligation du Maître d’avoir « un zèle fervent et un soin spécial » pour promouvoir l’évangélisation. A ce propos il ajoute qu’il est aussi le devoir du Maître de l’Ordre de vérifier s’il existe des écrits sur les croyances des autres peuples. Si je voulais signaler un lieu où l’Ordre serait resté en arrière dans l’évangélisation, ce serait un manque de réflexion théologique globale sur le problème de la mission dans l’Église et l’absence d’une contribution dominicaine, avec peu d’exception, à la recherche de nouvelles méthodes d’évangélisation que Jean-Paul II a exigé de l’Église. Le document du Chapitre d’Avila sur la mission a bénéficié de la présence de nombreux théologiens engagés dans l’évangélisation.
Inculturation
La question de la culture est intimement liée avec la recherche de nouvelles méthodes d’évangélisation. Durant l’ère de la colonisation, l’évangélisation s’identifiait avec la culture du colonisateur. Le succès de l’évangélisation paraissait se mesurer au degré de pénétration et de transformation que la culture du colonisateur apportait à celle du colonisé.
Où ce processus obtenait un succès, l’évangélisation avait un succès parallèle. Mais quand l’implantation de la culture du colonisateur était superficielle, l’accroissement numérique des chrétiens était aussi limité. La rapide christianisation des Amériques au XVIème siècle présente un contraste marqué avec le
progrès de celle des pays d’Asie, mais tandis que la relation entre évangélisation et culture du colonisateur donnait des fruits, il n’y a eu que peu de réflexion sur les effets collatéraux, en particulier sur la séparation des communautés chrétiennes de leurs racines et l’identification du christianisme avec une culture étrangère.
Aujourd’hui la relation entre Evangile et culture est l’objet d’une intense réflexion, qui considère non seulement le contenu de l’évangélisation, mais encore le mode par lequel il se communique (cf. Evangelii Nuntiandi, no 20).
Tandis qu’il est facile de spéculer sur l’inculturation, il est extrêmement difficile de prendre des décisions concrètes. En réalité, il n’existe pas de christianisme désincarné. Partout où il existe, le christianisme est incarné dans une culture, soit celle du peuple qui vit avec la communauté chrétienne, ou celle de l’évangélisateur. Ceci exige fine grande sensibilité de la part de ceux qui évangélisent dans aine culture différente de la leur.
Ce qui est certain, c’est que le progrès de l’évangélisation a été empêché par le manque d’appréciation des autres cultures. « Notre premier soin pour approcher d’autres peuples, d’autres cultures, d’autres religions », dit Kenneth Cragg, « est de quitter nos chaussures parce que le sol que nous foulons est saint. Nous pouvions nous trouver en train de fouler aux pieds l’idéal d’un peuple. Mais encore plus grave, nous pouvons oublier que Dieu était déjà là avant que nous arrivions ».
L’inculturation est un défi lancé avec insistance par le Saint Père. Si nous ne comprenons pas encore complètement ces implications, nous devrions néanmoins prendre part à cette mission de recherche de l’Eglise .
Certaines Provinces qui, avant, envoyaient beaucoup de religieux pour évangéliser dans d’autres nations, n’ont pas pu le faire. Ceci a amené la réduction parfois critique de personnes-clé dans beaucoup de Vicariats missionnaires et de Provinces. Dans certains cas il suffirait de deux ou trois religieux pour relever la situation.
La gêne grave où l’Ordre se trouve dans certains Vicariats et Provinces, m’oblige à lancer un appel à l’ensemble de l’Ordre. Je vous prie instamment de voir, de discuter en communauté qui, parmi les frères, seraient capables et accepteraient de s’engager dans un pays étranger pour une évangélisation qui respecte la culture autochtone, afin que nous puissions, comme Ordre, témoigner de l’universalité de l’Eglise. Le caractère international des martyrs du Japon, provenant de cinq nations différentes, est une leçon pour nous. Il existe aujourd’hui la même nécessité qu’alors d’une collaboration internationale dans la tâche d’évangélisation.
Il est temps maintenant que nous examinions la possibilité d’une plus grande collaboration au sein des entités qui ont un petit nombre de frères.
Si une petite Province/Vicariat veut avoir ses propres instances de formation, elle doit se poser les questions suivantes:
1. A-t-elle des formateurs suffisants et préparés?
2. Met-elle les besoins de la formation en premier lieu?
3. Peut-elle offrir la qualité d’enseignement nécessaire pour obtenir des étudiants bien préparés et des prédicateurs prophétiques, ouverts aux nécessités de notre temps?
4. Valorise-t-elle suffisamment le caractère international de l’Ordre?
Je demande que ceux qui travaillent dans les pays développés du Nord deviennent communautés évangélisatrices. Les derniers Actes du Chapitre de la Province d’Angleterre affirment: « Nous considérons toutes les maisons comme postes de mission d’où nous pouvons exercer notre vocation de hérauts de l’Evangile du Christ ».
Collaboration avec les Soeurs et le Laïcat
En 1968 le Père Aniceto Fernandez écrivit à toutes les religieuses dominicaines du monde, répondant à leurs questions sur leur place dans l’Ordre il leur dit: « Le temps est venu d’examiner attentivement nos relations dans ce monde moderne au sein duquel nous vivons, notre Sauveur nous a placés ensemble pour poursuivre son oeuvre de salut. Nous sommes appelés, frères et soeurs, à embrasser l’esprit et la tradition qui nous ont été légués par saint Dominique pour poursuivre et construire ensemble nos communautés de frères et de soeurs pour le service de l’Eglise ». Le P. Aniceto parle des soeurs comme des égales et les invite à rechercher avec les frères le meilleur mode de réaliser leur apostolat.
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis ces dernières années: collaboration dans la formation, ministère pastoral, enseignement universitaire, prédication, direction conjointe de centres de conférences et de retraites. Une soeur est présidente d’une de nos meilleures facultés de théologie. Là où, malgré les difficultés de tout commencement, cette collaboration a été réalisée, il y a eu un mutuel enrichissement. Et nous sommes seulement au début.
Les chapitres et congrès missionnaires successifs depuis 1968 ont montré l’urgente nécessité de la coopération dans la formation, la préparation conjointe des futurs missionnaires, dans le ministère de la Parole, retraites, promotion des vocations, dans le travail pour la Justice et la Paix, pour la prière commune, l’enseignement.
Je demande aussi que vous collaboriez avec le Laïcat dans le travail d’évangélisation. De nouveau notre histoire est instructive. Les premiers efforts de Bartolomé de las Casas pour évangéliser le peuple du Venezuela se sont terminés par un échec. Plus tard, au Guatemala, dans une zone appelée « le pays de la guerre » à cause de la férocité de ses habitants, il développa une méthode complètement nouvelle d’évangélisation. Lui et ses compagnons commencèrent par apprendre la langue pour composer ensuite des vers dans leur dialecte sur la création, la chute et la rédemption et ils les enseignèrent aussi aux commerçants chrétiens qui pénétraient dans les montages. Ceux-ci les chantaient et excitaient la curiosité du peuple qui voulait en savoir plus. Le laïcat fut ainsi la clé de la première évangélisation du Guatemala.
Jusqu’à nos jours, il est intéressant de visiter le Sanctuaire de Notre-Dame-de-Guadeloupe au Mexique pendant la fête de décembre et de voir le peuple représenter, avec des chants et des mimes, l’histoire de la création et de la rédemption.
En conclusion, permettez-moi de répéter une fois encore ce qui s’est dit à Quezon City: « Nous nous rencontrons aujourd’hui avec le défi de réaliser ce que saint Dominique a commencé: une famille en unité de vie et d’engagement de service à l’Eglise et au monde ». Ceci est d’une particulière application dans la mission évangélique.
De la vie commune (1988)
Lettre du Maître de l’Ordre. Novembre 1988
fr. Damian Byrne, O.P.
 À travers mes visites à l’Ordre dans le monde entier, m’est apparu que notre plus grande nécessité en ce temps est d’intensifier notre compréhension et notre pratique des éléments essentiels de notre vie communautaire.
À travers mes visites à l’Ordre dans le monde entier, m’est apparu que notre plus grande nécessité en ce temps est d’intensifier notre compréhension et notre pratique des éléments essentiels de notre vie communautaire.
Notre vie de communauté, comme notre vie d’étude, n’est pas une fin en soi. La Constitution fondamentale (II) nous rappelle que l’Ordre « specialiter ob praedicationem et animarum salutem ab initio noscitur institutus fuisse ». Elle nous rappelle de même que nous embrassons la vie des apôtres comme moyen pour obtenir le salut des âmes, insistant sur le fait que notre prédication et notre enseignement doivent jaillir « ex abundantia contemplationis » (LCO, n° 1, IV).
Je désire signaler deux causes de la situation présente de notre vie communautaire:
I. Dans le sillage des orientations du Concile et des derniers Chapitres généraux de l’Ordre, quelques structures de l’Eglise et de l’Ordre ont été mises en question. Cela a entraîné un examen des structures de notre vie communautaire.
Comme conséquence, quelques-unes d’entre elles ont été abolies ou ignorées, parce qu’elles n’avaient plus, dit-on, aucun sens pour nous. De ce fait, quelquefois, nous avons oublié les valeurs sous-jacentes de l’Evangile et de la vie régulière que ces structures renfermaient et mettaient en valeur dans le passé. Il ne s’agit pas aujourd’hui de retourner aux vieilles structures, mais de réaffirmer clairement les valeurs essentielles de notre vie telles qu’on les trouve dans nos Constitutions, nos traditions et l’enseignement de l’Eglise.
Il sera opportun, aussi bien au niveau personnel que communautaire, et à l’échelle des provinces comme de l’Ordre tout entier, d’en arriver aux structures qui nous permettront de nous maintenir et d’être en harmonie avec les valeurs de la vie communautaire.
II. Un deuxième facteur qui joue contre notre vie communautaire est la grande nécessité de l’Eglise dans le champs de la pastorale et les nombreuses demandes qui nous arrivent comme individus ou comme communautés.
Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes pastoraux de l’Eglise, et, si nous tentions de le faire, ce serait avec une grave détérioration de notre appartenance à la communauté. Notre meilleur service à l’Eglise en tant que religieux est précisément de continuer en étant fidèles à notre charisme de prédication, qui dérive de la vie communautaire. Nous ne sommes pas des moines, et nos derniers Chapitres généraux ont insisté plus sur les observances régulières que sur les observances monastiques, ce qu’écrit le P. Congar étant cependant vrai: « Il existe une forte empreinte de l’esprit monastique dans la vocation dominicaine ». (Appelés à la liberté, p. 3). Nous ignorons cette empreinte, pour notre préjudice.
Nous sommes pélerins de la foi. Nul d’entre nous n’est arrivé à la fin de sa pérégrination. Tous nous pouvons nous aider dans le voyage que nous faisons ensemble… Pour cela, en communion avec le Conseil généralice, je propose six aspects de la vie communautaire dominicaine sur lesquels nous pourrons réfléchir en vue de les mettre en oeuvre.
1. Oraison
La rénovation de la vie de communauté signifie que, par-dessus tout, nos communautés doivent être des communautés de prière. La vie de prière était une partie essentielle de la vie de Dominique et la source de sa passion pour la prédicaion et l’évangélisation. Jean-Paul II parlant aux religieux disait: « La prière a une valeur et un fruit spirituel plus grand que la plus intense activité, même l’activité apostolique. La prière est le défi le plus urgent que le religieux doit lancer à une société dans laquelle l’efficience a été convertie en idole sur les autels de laquelle est sacrifiée toute la dignité humaine… Vos maisons doivent être avant tout des centres de prière ».
Dans la célébration quotidienne de l’Eucharistie, est rendu présent et se réalise le mystère du salut. La prière liturgique et personnelle et l’évangélisation permanente de nos vies sont une conséquence de la contemplation de la Parole de Dieu. Nous sommes fortement conscients de la vérité contenue dans ces mots: « Sans moi vous ne pouvez rien faire, avec moi vous pouvez tout ». Seule une vie de prière peut nous préparer en vue de prêcher à un monde sécularisé pour qui l’Evangile est une folie.
Le rythme frénétique de la vie dans beaucoup de parties du monde s’infiltre dans nos vies et rend difficile la possibilité de trouver du temps pour la prière. Quelques-uns arrivent à imprégner leur travail de prière; les autres, par tempérament, ont besoin d’un certain climat pour prier.
Le P. Congar dit que l’étude de la théologie doit être inséparable de la célébration de la liturgie: « Pour moi, les deux sont une même chose ». Notre fidélité à la liturgie se manifestera dans la fidélité que nous aurons à la célébration ou à l’assistance journalière à l’Eucharistie et à l’Office divin. « L’Office liturgique est composé essentiellement de psaumes. Ils jouent un rôle important dans ma vie… Ils sont une prière, en même temps qu’ils nous enseignent à prier ». (Appelés à la liberté, p. 3).
En plus de la prière commune, il nous faut nécessairement trouver un moment pour créer le silence intérieur et rester seuls avec Dieu, ce qui nous permet de dire chaque jour: « Je veux rester avec Toi ». Saint Dominique, souvent, s’adressait à ses compagnons et leur disait: « Allons de l’avant et pensons au Seigneur ». Nous devrions chercher un temps analogue dans nos vies pour rester seul avec Dieu. Cela est plus important que toute activité apostolique.
II est de plus en plus fréquent que les communautés célèbrent la prière commune unies aux fidèles. Célébrée ainsi elle est certainement une prière d’Eglise. Chaque communauté doit adapter sa prière aux coutumes du lieu.
2. Vie commune et partage de foi
Le Christ est le centre de notre vie communautaire. Cependant, cela n’apparaft pas clairement parmi nous. Parfois nous sommes capables de partager nos idées, les choses de l’intelligence, mais nous ne le sommes pas pour les choses de la foi, les choses du coeur. Aujourd’hui, étant affrontés à tant de défis, il ne suffit pas simplement de laisser entendre que nous avons la foi. Nous devons proclamer le Christ d’une manière explicite.
Pour surmonter certains blocages et partager la foi en communauté, il est important de se rappeler que nul d’entre nous ne possède le monopole de la vérité. Nous devons apprendre les uns des autres, (LCO n° 100) et nous prêcher les uns aux autres. Nos Constitutions signalent l’obligation pour les prieurs de prêcher à la communauté, mais ne devrions-nous pas avoir tous le courage de prêcher en communauté? Ne devrions-nous pas profiter des occasions de parler en communauté? Même les jeunes devraient partager leur foi durant la liturgie des Heures ou durant les célébrations spéciales de nos fêtes dominicaines.
Nous devrions nous réunir pour préparer l’homélie du dimanche, étudier un thème d’actualité ou pour informer la communauté de notre activité apostolique et ainsi partager la foi. Ce dernier point – partager nos expériences apostoliques – est toutefois très difficile, car beaucoup d’entre nous travaillent hors du couvent. C’est une oeuvre de charité de communiquer sa propre foi, mais ne devrions-nous pas commencer par nous-mêmes?
Je ne pourrais trop insister pour qu’on prenne au sérieux cet aspect de la vie communautaire. Beaucoup de religieux, spécialement les jeunes, désirent ce mode de partager de la foi. Ne sommes-nous pas entrés dans l’Ordre pour vivre avec des hommes de foi ? Il est urgent de nous communiquer les uns aux autres les richesses de la foi.
Un des grands avantages de nos maisons d’étude est qu’elles offrent aux professeurs et aux étudiants de partager la vie commune dans le contexte des études. A travers des contacts formels et informels, il est possible de questionner et d’éclairer certains aspects de la foi. Pour beaucoup, c’est ainsi au cours des études, qu’ils arrivent à l’unité.
Cela est toujours très évident dans la formation pastorale des étudiants: le ministère les rapproche de la vie du peuple de Dieu. Dans notre processus actuel de formation, cette activité pastorale, non seulement est recommandée, mais elle est exigée; non pas pour se reposer des études, mais pour apprendre à vivre conjointement l’étude et le ministère.
La réflexion méthodique, comme processus intégral du ministère n’est pas une chose qui s’apprend facilement. Il devrait exister un processus graduel dans l’engagement au ministère, accompagné d’une formation théologique solide. Tout ministère devrait comporter une planification et une évaluation comme faisant partie de son progrès.
Il est triste de constater que la perception de la relation qui devrait exister entre l’étude, le ministère et la communauté se soit perdue chez beaucoup de religieux responsables de nos çommunutés. Nous ne pouvons réduire notre formation permanente à des études ou à des lectures privées; ces études doivent avoir, par naturel un caractère communautaire.
Nous réunir en communauté pour partager des expériences apostoliques et réfléchir ensemble sur leur signification dans la foi pourrait être une priorité. Des lectures sur un thème commun, discutées en communauté, pourraient être un bon moyen de réaliser cet objectif.
Les bibliothèques conventuelles sont une source de rénovation de la vie commune à travers l’étude. Une bibliothèque bien fournie est une chose nécessaire dans toute communauté. Il est triste de visiter les bibliothèques de quelques communautés et de constater qu’elles contiennent peu de livres récents.
3. Correction fraternelle
Notre législation a toujours accordé une grande importance àla correction fraternelle qui, autrefois faisait partie du chapitre régulier de la maison. Bien que la forme du chapitre conventuel soit modifiée, les Constitutions ont maintenu la nécessité de la correction fraternelle.
Le Chapitre de Bogota a pris l’option de demander une « causerie/dialogue », qui pourrait stimuler notre vie communautaire et notre vie apostolique. Les Constitutions de 1968 confirment cette orientation (LCO, n° 7, I), et ajoutent: « Aliquoties in anno pariter habeatur capitulum regulare in quo fratres, modo a capitulo conventuali determinato, examinent fidelitatem suam erga missionem apostolicam conventus et vitam regularem, atque aliquam paenitentiam faciant. Hac occasione superior exhortationem circa vitam spiritualem et religiosam necnon opportunas admonitiones et correctiones facere potest » (LCO N° 7, II). Dans certains lieux, le « colloque » mensuel, prescrit par LCO n° 7, I, n’est pas tenu. Cependant l’expérience des dernières années montre la nécessité de fortifier la pratique du dialogue fraternel en vue de la fidélité de la communauté à ses engagements apostoliques et aux observances communes.
Il est nécessaire que les réunions communautaires retrouvent les valeurs qu’elles ont perdues. Nos réunions communautaires devraient être une occasion pour examiner les valeurs de nitre vie religieuse et de notre travail apostolique dans une atmosphère de dialogue sincère, de façon que chacun puisse partager ses problèmes et ses expériences à la lumière de la foi et ainsi s’aider mutuellement par des conseils et des encouragements. Pour que cela puisse se réaliser, il est nécessaire que ces réunions aient un authentique caractère religieux et ne tombent pas dans la routine et le formalisme. La réflexion sur la Parole de Dieu et l’oraison peuvent nous aider à comprendre que Dieu est au milieu de nous. Nous devrions aussi respecter la « créativité » des autres communautés, mais sans jamais laisser ces réunions à l’improvisation. L’Ordre, en tant que tel, pourrait considérer l’opportunité de publier des NORMES qui aideraient à la célébration de ces réunions.
Pour beaucoup, la correction fraternelle peut sembler un relent de l’ancien chapitre des coulpes. Il faut une grande délicatesse. Il est dit de saint Dominique que, lorsqu’il parlait avec quelqu’un, « ses paroles étaient si douces » que ce qu’il disait était accepté « avec patience et avidité ».
Si nous vivons ensemble en communauté, nous sommes responsables les uns des autres. Combien de problèmes arrivent à un point critique parce que nous avons négligé l’aide fraternelle ou parce que nous l’avons apportée quand il était trop tard! Mais pouvons-nous négliger d’offrir notre aide à un frère ou à une soeur qui a un besoin urgent d’une assistance particulière?
Un autre aspect: la nécessité des visites canoniques. Dans beaucoup de Provinces elles sont devenues une pure formalité. Cependant, ne pas les faire convenablement nuit à la qualité de notre vie. C’est une erreur de les omettre. Les ordonnances de nos Constitutions sur ce point renferment une grande sagesse. Les Provinces où les visites canoniques se sont faites avec sérieux trouvent un bénéfice pour la vie de leurs religieux.
4. Le témoignage de nos vies. Les voeux
Nous voulons que nos vies soient un témoignage du Règne et que nos voeux soient des actes publics de consécration. S’il en est ainsi notre conduite doit témoigner d’une telle consécration. C’est ce que les fidèles attendent de nous. Cependant, ne décevons-nous pas leurs espérances par la façon dont nous vivons l’obéissance, la pauvreté et la chasteté? Permettez-moi les réflexions suivantes sur quelques aspects particuliers de nos voeux.
Obéissance.
L’obéissance consiste à écouter Dieu qui nous parle directement ou à travers les autres. Obéissance signifie aussi écoute de la communauté et fidélité aux chemins communautaires vers la sainteté. Cela est d’une particulière application aujourd’hui. Quand l’un de nous prêche, c’est la communauté qui prêche. Ainsi, par exemple, quand nous adoptons une attitude en matière de justice ou de moralité, cette attitude devrait être examinée devant la communauté. Combien de dommages – et de scandales – pourraient être évités aux fidèles si nous soumettions à l’examen de la communauté nos idées sur des problèmes conflictuels. Nous, les dominicains, nous louons nos prophètes. Les plus grands d’entre eux furent ceux dont la prédication et le travail naquirent en communauté et furent appuyés par la communauté. Je me réfère à Antonio de Montesinos et à Las Casas. Les prophètes aussi doivent se soumettre à l’obéissance.
Un autre aspect de l’obéissance qui appelle notre réflexion actuelle est notre attitude devant les observances de la communauté. Combien facilement nous mettons-nous à part et nous dispensons-nous des exercices de la communauté, de telle façon qu’imperceptiblement nous devenons des marginaux dans la communauté. Dans certains cas, quelle volonté suivons-nous, celle de Dieu ou la nôtre?
Pauvreté.
Nous avons fait profession de pauvreté, mais paradoxalement, nous jouissons d’une sécurité que n’a pas la grande majorité des gens. La préoccupation de notre sécurité pourrait facilement nous éloigner du travail apostolique. Je le constate en plusieurs endroits. Je pense que l’insistance de Dominique pour vivre en dépendance était intimement liée à son désir de liberté apostolique. Pour nous, dominicains, il existe une connexion entre les voeux et la prédication. Les voeux nous donnent la liberté de prêcher; ils authentifient notre prédication.
Dans son discours au Conseil généralice extraordinaire de mai 1970, le P. Aniceto Fernandez disait: « La pauvreté est un thème dont on parle beaucoup, mais, dans la pratique, même dans la vie privée, il n’existe pas de signes de pauvreté, ni dans les vêtements, ni dans la nourriture, ni dans le logement ou dans l’usage des transports, ou dans les voyages ou autres choses complètement superflues ». S’est-il produit un changement dans les années suivantes?
Aujourd’hui nous pouvons être facilement victimes du phénomène universel, qui est lié à la société de consommation. Cela nous impose à tous l’obligation d’être responsables.
Il faut nous demander constamment comment nous usons des choses matérielles: quel témoignage donnons-nous dans nos édifices, notre table, nos vêtements, nos loisirs, nos vacances? Il est aussi nécessaire d’aider ceux qui administrent les biens de la communauté, et eux, de leur côté, doivent être conscients que l’argent qu’ils administrent n’est pas le leur, sinon celui de tous, devant lesquels ils doivent en répondre.
Chasteté.
Pour beaucoup, c’est le témoignage le plus important de notre vie religieuse. Une fois de plus, notre conduite doit être en consonnance avec notre consécration. Tout ce qui est licite n’est pas toujours opportun.
Un aspect de cette consécration que je voudrais aborder est le suivant. Tandis que le sanctuaire le plus intime de nos coeurs est voué à Dieu, nous expérimentons d’autres nécessités. Dieu nous a faits de telle façon qu’une partie importante de notre vie est accessible aux autres et nécessaire aux autres. Tous nous avons besoin d’expérimenter l’intérêt authentique des autres membres de la communauté, leur affection, leur estime et leur amitié. Quelqu’un pourra dire que Dieu suffit, mais, avec raison il a été dit que Dieu nous a faits de telle façon que nous avons aussi besoin d’autre chose, en plus de la prière et du renoncement. Nous avons besoin d’air, d’aliments, de sommeil, d’éducation; mais par dessus tout d’amour. A quel moment de notre pérégrination terrestre cessons-nous d’être humains? La vie ensemble signifie partager ensemble le pain de nos esprits et de nos coeurs* Quand le religieux ne trouve pas tout cela en communauté, il va le chercher autre part.
5. Prise de décision
Notre responsabilité mutuelle nous mène à accepter la responsabilité de notre communauté. Tous nous sommes responsables de la marche harmonieuse de la communauté et ce sentiment de responsabilité sera d’autant plus profond que nous nous engagerons à fond dans les prises de décisions.
Les Constitutions nous offrent un certain nombre de structures pour faciliter la prise de décision: les Chapitres généraux et provinciaux, le conseil et le chapitre de la maison. Mais aucun d’eux n’arrivera à un projet ou à une mission commune s’il n’est employé d’une façon adaptée.
On n’insistera jamais assez sur la nécessité de célébrer les rencontres régulières de la communauté, qui contribuent à créer la conscience collective d’une communauté et qui conduisent au « consensus ». Dans ce processus collectif, le prieur est le premier parmi des égaux. Nous devons toujours tenir présente la différence entre la démocratie civile et la nôtre. Dans les démocraties civiles, le pouvoir émane du vote de la majorité absolue et un vote peut déterminer une décision. Dans le système démocratique dominicain, notre but est d’obtenir un seul esprit et un seul coeur, afin d’atteindre un consensus le plus ample possible, ce qui est un témoignage de beaucoup plus de poids que la majorité absolue. « Nous efforcer pour l’unanimité », disait le P. de Couesnongle, « quoiqu’on n’y réussisse pas toujours, c’est une garantie sûre de la présence de l’Esprit Saint et, en conséquence, c’est un chemin plus sûr pour découvrir la volonté de Dieu ». En même temps, il m’a dit que « les frères qui ont atteint une maturité religieuse expérimentent la communauté comme unique – et parfois comme contradictoire – centre de jugement et de décisions ». Dominique avait la capacité de ne pas être d’accord avec les autres et de permettre aux autres de ne pas être d’accord avec lui.
Nos chapitres conventuels seraient inutiles si nous les considérions comme de simples réunions légalistes ou comme un lieu de discussion. Nous pouvons dépasser cela si nous commençons ces rencontres comme une prière, en esprit de réflexion et d’ouverture à l’Esprit. En second lieu, comme faisant partie de cette réflexion silencieuse et de la prière, nous pouvons prendre le temps de reconnaître nos défauts en face de la vie de communauté.
Beaucoup de choses peuvent militer contre ce processus: l’individualisme exagéré, l’apathie et la crainte qui peut accompagner la prise de décision. D’autre part, nous devons préparer ces réunions avec les informations voulues; également donnons-nous le temps suffisant pour les terminer. En dernier lieu, nous devons avoir la force d’accepter l’obéissance que nous imposent les décisions communautaires.
Autre point: la disponibilité pour accepter des responsabilités à l’intérieur de la communauté. Existe presque partout le refus d’accepter des postes de responsabilité. L’élection à un office particulier ne doit jamais être refusé, à moins de très graves raisons. De notre côté, quand nous élisons quelqu’un, nous devons l’aider.
6. Construction de la communauté
Chaque communauté doit trouver un rythme d’observance qui tienne compte des changements de nos besoins et de nos ministères, en n’oubliant jamais que nous sommes voués aux nécessités des autres.
L’unité du coeur nous pousse à vivre unis, même si nous avons des opinions et des attitudes diverses. Une communauté où tous sont d’accord n’existe pas. Il est nécessaire d’avoir une compréhension mutuelle, une tolérance et disposition pour nous supporter mutuellement. Il y en a qui sont disposés à vivre seulement avec leurs amis; il y a des communautés qui excluent des personnes de mentalité ou d’attitudes différentes. Que resterait-il de la vie religieuse si nous choisissions avec qui vivre? Cela n’est même pas chrétien.
Ensuite il y a le problème de la récréation, personnelle et communautaire. Parlant au monde du travail Jean-Paul il disait: « La Sainte Ecriture, comme elle enseigne la nécessité du travail, enseigne aussi la nécessité du repos ». Et dans une lettre aux membres de sa Province, un Provincial demande: « Dans quelle mesure la télévision affecte-t-elle la qualité du temps que nous passons ensemble et comment se vivrait la fraternité sans elle? N’avons-nous pas perdu, peut-être, quelque chose de très important durant la période de rénovation? Concrètement, pourquoi beaucoup d’entre nous rencontrent leurs expériences de fraternité hors et non dans la communauté? Insistons-nous trop sur le côté apostolique de nos vies au détriment de notre vie fraternelle, et à quel prix pour l’apostolat? »
Enfin, nous devons nous efforcer de construire des communautés d’espérance. Si nous prêchons la miséricorde, nous devons pouvoir recevoir la miséricorde et nous manifester une miséricorde mutuelle et donner un témoignage de l’espérance qui nous habite. Les paroles de Paul VI dans Evangelica Testificatio sont toujours source d’inspiration pour nos vies: « Imparfaits, certes, comme tout chrétien, vous entendez pourtant constituer un milieu qui contribue au progrès spirituel de chacun de ses membres. Comment y parvenir sinon en approfondissant dans le Seigneur vos rapports, même les plus ordinaires, avec chacun de vos frères? La charité, ne l’oublions pas, doit être comme une espérance active de ce que les autres peuvent devenir avec l’aide de notre soutien fraternel. Le signe de sa vérité se trouve dans la simplicité heureuse avec laquelle tous s’efforcent de comprendre ce qui tient à coeur à chacun. Si certains religieux paraissent comme éteints par leur vie de communauté, qui devrait au contraire les épanouir, n’est-ce pas faute d’y trouver cette sympathie compréhensive qui nourrit l’espérance? Nul doute que l’esprit d’équipe, les rapports d’amitié et d’entr’aide fraternelle dans un même apostolat, ainsi que le soutien mutuel d’une communauté de vie choisie pour un meilleur service du Christ, ne soient dans ce cheminement quotidien de précieux adjuvants ». (n° 39). (Roma, 25.11.88).
Le ministère de la prédication (1989)
Lettre du Maître de l’Ordre. Septembre 1989
fr. Damian Byrne, O.P.
 Saint Dominique a voulu que son Ordre s’appelle et soit réellement un Ordre de Prédicateurs. Tel est le titre qu’il a choisi pour lui et pour ses compagnons, le titre accordé par l’Église. Cette appellation a déterminé non seulement sa mission, mais tout son style de vie. Même si les appels à la prédication sont nombreux, un Ordre de Prêcheurs est nécessaire pour rappeler à l’Église sa mission dans ce domaine. Certains Ordres sont dédiés à la prière, à la mission ou au service des pauvres, et tous nous sommes appelés à ces choses sous une forme ou une autre. Nous autres, nous sommes un rappel constant pour toute l’Église de l’importance de la prédication. Nous devrions donc y exceller.
Saint Dominique a voulu que son Ordre s’appelle et soit réellement un Ordre de Prédicateurs. Tel est le titre qu’il a choisi pour lui et pour ses compagnons, le titre accordé par l’Église. Cette appellation a déterminé non seulement sa mission, mais tout son style de vie. Même si les appels à la prédication sont nombreux, un Ordre de Prêcheurs est nécessaire pour rappeler à l’Église sa mission dans ce domaine. Certains Ordres sont dédiés à la prière, à la mission ou au service des pauvres, et tous nous sommes appelés à ces choses sous une forme ou une autre. Nous autres, nous sommes un rappel constant pour toute l’Église de l’importance de la prédication. Nous devrions donc y exceller.
Comment devons-nous vivre et que devons-nous faire pour remplir notre vocation d’hommes et de femmes qui proclament le message de salut du Christ; pour qu’il devienne une réalité ardente dans nos vies et dans la vies de ceux vers lesquels nous sommes envoyés?
Vie et Témoignage
Une des clés du succès de Dominique comme prédicateur fut sa façon de vivre. En toute sécurité, il aurait partagé les sentiments de Evangelii Nuntiandi : « L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou, s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont témoins » (E.N. 41).
Ce qui attire les gens n’est pas tellement ce que nous disons mais ce que nous sommes. Notre Seigneur a converti des pécheurs comme Mathieu avec une parole, Pierre avec un simple regard. Il a mangé avec les pécheurs. Il a contrecarré les préjugés sociaux bavardant et mangeant avec les samaritains, les receveurs d’impôts et les, prostituées. Par l’action et la parole, Jésus a proclamé l’amour miséricordieux de Dieu.
Dans Octogesima Adveniens, (n. 51) Paul VI nous rappelle :
« Aujourd’hui plus que jamais, la Parole de Dieu ne pourra être annoncée et entendue que si elle s’accompagne du témoignage de la puissance de l’Esprit-Saint, opérant dans l’action des chrétiens au service de leurs frères, aux points où se jouent leur existence et leur avenir ». Nos paroles tombent dans le vide si elles ne sont pas accompagnées du témoignage de vie, tant individuel que communautaire. La vie commune est inséparablement unie à notre mission de prêcher. « Missio et communion sont les deux faces de la même monnaie, tant dans l’Eglise que dans l’Ordre, et nous ne pouvons les séparer. Précisément pour cela, par le témoignage de leurs vies, nos soeurs contemplatives sont au coeur de notre famille de prédicateurs. Mais le témoignage de vie fleurit au dedans d’un témoignage plus profond.
Nous voulons voir Jésus
Dans l’Evangile Notre Seigneur dit aux apôtres : « Vous serez mes témoins ». La phrase ‘nous sommes des témoins’ signifie littéralement que nous offrons l’expérience d’un Christ qui est vivant, qu’il est possible de rencontrer et à qui on peut parler. La requête de ceux qui se sont approchés de Philippe en lui demandant : « Nous voulons voir Jésus », est aujourd’hui le cri d’un grand nombre dans le monde. Mais combien de fois le découvrent-ils dans la parole que nous leur disons? Avec une certaine angoisse, Paul VI écrivait :
« Tacitement ou à grands cris, toujours avec force, l’on nous demande : Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez? Vivez-vous ce que vous croyez? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez? » (EN. 76).
Ce que le monde cherche c’est un témoignage digne d’être cru. Les gens sont rassasiés de fictions. Ils demandent de voir Jésus, comme Mère Térésa de Calcutta nous l’a rappelé avec clarté : « Les gens devraient pouvoir reconnaître Jésus en nous ».
Si nous sommes des prédicateurs, nous devons être des hommes et des femmes qui lisent, étudient et vivent les Ecritures. Cette rencontre étudiée et méditée avec le Jésus des Évangiles se transforme en source de vie pour chacun de nous. A la table de la Parole et à la table de l’Eucharistie, notre vie de prédicateurs reçoit son aliment. Nous devons cependant renouveler notre foi en la Parole de Dieu. « La Parole de Dieu est vivante, elle est vie… » (Héb, 4, 12). Quand on prêche, Dieu est présent (cf. Mysterium Fidei, n’36). Mais la parole doit être méditée en ce moment historique.
Application
Notre prédication ne sera pas complète tant qu’elle ne mettra pas l’Évangile en relation avec la vie des gens. De même que Jésus a prêché son message dans une forme adaptée aux gens de son époque, ainsi nous devons présenter son message d’une manière adaptée pour les gens de notre temps. Conforme à l’Évangile, notre prédication doit répondre aux demandes que nous recevons. Ceci nous impose l’obligation d’écouter et d’être en alerte sur les divers mouvements qui se succèdent avec rapidité dans notre société changeante. Comment pouvons-nous parler des nécessités des, gens si nous ne partageons pas leurs peines et leurs joies? Comme nous le rappelle Gaudium et Spes (n. 1) :
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’y a rien de vraiment humain qui ne trouve un écho dans leur coeur ».
Avant de parler nous devons écouter, non seulement la voix du peuple, mais aussi ses yeux et son coeur. Alors, notre parole prononcée chaque jour depuis l’autel, en classe, dans les salles d’hôpital…, sera une parole d’espérance : la qualité de la prédication sur laquelle Paul VI insiste le plus.
Prophétique et doctrinale
Quand notre parole est prophétique elle est dans la meilleure tradition de l’Ordre. La prédication purement théorique et abstraite ne répond ni à l’esprit de saint Dominique, ni aux coeurs des fidèles. La prédication prophétique n’est pas purement le partage de la science, mais une proclamation joyeuse de la Parole de Dieu vivante et vivifiante. Il est donc nécessaire d’annoncer le message complet de l’Evangile.
Dans son commentaire des Constitutions, Humbert de Romans écrit : « L’étude n’est pas la fin de l’Ordre, mais elle est au plus haut point nécessaire aux fins de l’Ordre, c’est à dire à la prédication et au salut des âmes, car sans l’étude nous ne pourrons obtenir ni l’une ni l’autre de ces fins » (Opera II, p. 41). Si nous sommes des prédicateurs nous sommes aussi des étudiants. Le jour où nous laisserons la lecture et la réflexion, nous cesserons d’être des prédicateurs efficients. Pour être toujours de bons prédicateurs il faut être toujours étudiants. Lisons-nous ? Lisons-nous suffisamment ? L’écoute réelle des joies, des peines, des espérances et des préoccupations de la famille humaine demande une étude sérieuse et des analyses sociales. Elle demande d’apprendre d’autres langues et un respect délicat des différences culturelles, pour que l’Evangile soit réellement incarné dans les nouvelles cultures. Plus que jamais, elle demande temps et présence parmi ceux auxquels nous devrons prêcher, parce qu’il est certain qu’à partir die leur expérience nous entendrons l’Evangile sous des formes nouvelles. Nous autres nous sommes appelés à recevoir et à embrasser la Parole de Dieu partout où nous l’entendrons. Dominique a passé la nuit avec son hôte; l’attention de Las Casas aux différences entre l’Espagne et le « Nouveau Monde » a exigé une nouvelle forme de prédication prophétique. L’attention de Catherine aux signes de son temps l’a poussée à prêcher la compassion aux victimes de la peste noire, mais aussi de proclamer la vérité comme elle la voyait, non seulement aux politiciens mais aussi aux cardinaux et aux papes.
L’évêque Diego et Dominique ont vu l’incapacité de l’Eglise de leur temps pour répondre avec efficacité au mouvement albigeois. Vivant au milieu d’eux, apprenant d’eux et les écoutant, ils développèrent une nouvelle catéchèse. L’Eglise devait admettre les valeurs authentiques qui se rencontraient dans le mouvement albigeois et dans le même proclamer les valeurs authentiques que les albigeois préféraient ignorer. C’est ce que nous entendons par prédication doctrinale, la prédication de la « vérité complète » de l’Evangile. Le défi des albigeois fit naître une réponse créative en Dominique et en Diego. Quels sont les défis qui invitent notre prédication d’aujourd’hui à un réponse créatrice ?
Pour être fils et filles de saint Dominique, nous devons nous insérer dans les champs de débats, spécialement dans ceux où l’Eglise rencontre des difficultés pour répondre. Nous nous y insérons d’abord pour écouter et pour apprendre. Ensuite nous nous engageons dans une réflexion théologique et dans le discernement de notre réponse, aussi bien par les faits et les paroles que par notre forme de vie. Si nous ne sommes pas au milieu des nécessités des gens, nous nous exposons à être désorientés et nous courons le risque d’être inefficaces. Suivre Dominique signifie être pour cette période historique de l’Ordre, d’Eglise et de la société, ce que fut Dominique pour la sienne. Lui, Dominique est toujours notre point de départ pour examiner et renouveler nos vies. Fidèles à Dominique et à notre tradition, notre propre identité et spiritualité doivent avoir leurs racines dans notre mission de prêcher. Déjà en 1968, le P. Congar faisait cette surprenante observation : « Je pourrais citer toute une série de textes anciens, dans lesquels il est affirmé – plus ou moins – que, si dans une nation la messe est célébrée pendant trente ans sans prédication, et que dans une autre on prêche pendant trente ans sans la célébration de la messe, les gens seront plus chrétiens dans la nation où on aura eu lieu la prédication » (article dans Concilium, n. 33).
Que signifie pour nous être prêcheurs, non au commencement du XIIIème siècle mais à la fin du XXème siècle? Notre préoccupation de « proclamer la vérité » a été une préoccupation spécifiquement dominicaine à l’intérieur de la mission de l’Eglise universelle de prêcher l’Evangile. Où est aujourd’hui la vérité non désirée ou en péril dans notre nation, dans notre vie personnelle, communautaire et dans notre prédication?
De la même façon que dans le monde où vivait Dominique, le nôtre a ses propres formes de dualisme auxquelles nous sommes confrontés : les divisions profondes entre nations riches et pauvres, entre les races, les religions et les groupes ethniques, entre hommes et femmes, entre nations d’idéologies politiques différentes.
Quatorze ans après Evangelii Nuntiandi, nous pouvons nous poser les trois mêmes questions cruciales que Paul VI posait a toute l’ Eglise :
1. Qu’est devenue, de nos jours, cette énergie cachée de la Bonne Nouvelle, capable de frapper profondément la conscience de l’homme?
2. Jusqu’à quel point et comment cette force évangélique est-elle en mesure de transformer réellement l’homme de ce siècle?
3. Suivant quelles méthodes faut-il proclamer l’Evangile pour que sa puissance soit efficace?
Parole et Sacrement
La priorité des priorités pour tous les Dominicains est la prédication, et l’amour pour la prédication devrait être notre signe distinctif. Je crois que, selon l’esprit de Evangelii Nuntiandi, il faudrait prêcher tous les jours aux messes publiques. Paul VI signale aussi l’importance de la prédication dans l’administration des sacrements et dans les cérémonies para-liturgiques. Au Chapitre général de 1983, Jean-Paul II, en s’adressant à nous disait : « Vous, Dominicains, vous avez la mission de proclamer que Dieu est vivant, qu’Il est le Dieu de la vie et qu’en Lui existe la racine de la dignité de l’homme appelé à la vie… Vos Constitutions donnent la priorité au ministère de la parole sous toutes ses formes orales ou écrites, et le lien entre le ministère de la parole et celui des sacrements est son couronnement ». La prédication vient en premier, mais si elle ne conduit pas aux sacrements elle est incomplète.
Il est important de vérifier le pouvoir évangélisateur que notre prédication peut avoir dans le contexte de l’Eucharistie journalière ou hebdomadaire. Nous pouvons dire que beaucoup de gens aujourd’hui sont sacramentalisés mais non évangélisés. Cette dimension sacramentale peut non seulement offrir une occasion de proclamation évangélique, mais les sacrements sont eux-mêmes paroles d’évangélisation par le moyen des symboles. Comme nous le rappelle saint Augustin,la parole est un sacrement audible et le sacrement est une parole visible. Tandis qu’il existe beaucoup d’occasions pour prêcher la Parole hors des sacrements, ce serait une erreur d’ignorer l’opportunité que la célébration des sacrements nous offre pour célébrer la Parole.
Donc nous ne devrions pas laisser passer une occasion de prêcher. Non seulement pour le bien de celui qui nous écoute : je crois que personne ne peut prêcher continuellement la Parole sans être transformé lui-même par la Parole qu’il prêche.
Aussi bien Paul VI que Jean-Paul II insistent sur la Parole dite durant les célébrations de l’Eglise, mais aussi sur celle dite à travers des contacts individuels. « A l’imitation de saint Dominique qui était plein de sollicitude pour le salut des individus et de tous les peuples, que les frères sachent qu’ils sont envoyés à tous les hommes, croyants et non-croyants, et en particulier aux pauvres… » (LCO, n. 98) .
La prédication journalière de chacun de nous correspond-elle à notre vision de l’Eglise et de l’Ordre? Paul VI au cours d’une audience générale, le 3 décembre 1975, disait à des aspirants et novices dominicains : « On dit des Dominicains qu’ils sont des prêcheurs. Mais il est rare d’entendre la prédication d’un dominicain ». Le sérieux avec lequel nous devrions nous attacher à notre ministère de prédication se reflète dans la nouvelle Ratio Formationis, qui indique « l’aptitude à la prédication doit être un des éléments à considérer pour l’admission aux ordres ».
Dans une récente visite au Japon, on m’a parlé du grand témoignage donné par les artistes dominicains et je me suis rappelé des paroles de Lorenzo de Rippafratta à Fra Angelico et à son frère en un moment de doute : « Vous ne seriez en aucun moment des frères prédicateurs moins authentiques parce que vous cultivez la peinture, parce que le peuple se conquiert non seulement avec la prédication, mais aussi par les arts, en particulier par la musique et la peinture. Beaucoup qui se montrent sourds à la prédication seront attirés par vos tableaux, qui continueront à prêcher à travers les siècles ». C’est vrai, ils prêchent toujours, de même que ceux qui écrivent et publient ou ceux qui sont engagés dans les diverses formes des media.
Collaboration
J’aimerais me référer à deux formes de collaboration, une qui a ses racines dans notre tradition, l’autre comme une forme récente de cette même tradition.
Le dimanche avant la Nativité de 1511, dans une chapelle au toit de paille de l’île de l’Espagnole, Antonio de Montesinos fit un sermon sur le texte : « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Sa condamnation de l’injustice entraîne une avalanche de protestations. Les gens se précipitèrent pour se plaindre au Prieur, Pedro de Cordoba, qui expliqua à l’étonnement et la surprise générale : « Ce n’est pas Antonio de Montesinos qui a prêché, mais toute la communauté ». La communauté avait décidé dé prendre une position : ils ont décidé ce qui fallait dire et Montesinos l’a exprimé.
Comme notre prédication serait enrichie si nous trouvions une méthode pour préparer communautairement l’homélie du dimanche et pour réfléchir sur les thèmes clés qui concernent aujourd’hui les diverses couches de la société et qui doivent être abordés dans notre prédication : Ce serait encore mieux si cette préparation pouvait inclure les laïques.
Une seconde forme de collaboration aujourd’hui serait de s’adresser à la Famille dominicaine, partageant le charisme commun de la prédication : Ce ne sont pas que les femmes et les laïques qui sont appelés à vivre :La vie évangélique et les prêtres qui sont appelés à proclamer la Parole. Déjà au XIIIème siècle Thomas d’Aquin soutenait que le charisme, appelé « du discours de sagesse et de science », avait été donné sans différence de sexe (Cf. II-II, q. 177, a.2, 2m). Dans cette ligne, je demande expressément aux soeurs dominicaines, moniales ou de vie apostolique, de profiter de toutes les occasions qui peuvent se présenter pour prêcher, et cela en conformité avec le témoignage de leur vie. Il n’y a personne qui ne puisse prêcher par sa vie et par des contacts « de personne a personne, transmission qui reste valide et importante » (EN 46).
Il ne peut être mis en doute que l’Ordre a été appelé depuis toujours à proclamer l’Evangile et à le pratiquer comme une seule famille. Nos diversités et nos efforts pour croître comme famille, pour collaborer à la mission évangélique, sont des aspects réels de notre prédication dans un monde qui n’a pas encore découvert comment des femmes et des hommes, des laïques et des clercs, peuvent être unis en communautés où ils sont égaux, respectueux des différences mais unis par la foi.
Conclusion
Dans mes visites aux diverses parties du monde, j’ai constaté que ceux qui se trouvent parmi des difficultés sont ceux qui proclament l’Evangile avec le plus de force et ceux qui vivent une vie évangélique plus engagée. A cause de leur situation, leur prédication a une résonnance et un impact beaucoup plus grands que ceux qui prêchent dans un milieu de commodité et de sécurité. Il est peut-être difficile de trouver de bons prédicateurs dans un peuple qui ne souffre pas et n’est pas opprimé. Nous devons nous trouver affrontés à des problèmes importants pour que l’Evangile soit proclamé avec vigueur. Le monde riche a des problèmes graves avec qui lutter, mais une certaine auto-suffisance et une fausse sécurité peuvent aveugler le prédicateur parce qu’il ne voit pas leur urgence. L’Evangile est la Bonne Nouvelle aux pauvres. Quand nous engageons notre vie avec les pauvres et les opprimés nous devenons destinataires de leur Evangile; la prédication naît alors d’un profond accord avec le peuple, une communion qui demande une réponse à ses nécessités. Notre mission est de proclamer à tous prix l’espérance de l’Evangile et le prêcher au-delà des limites de notre vision, même quand nous n’incarnons pas complètement cette vision. Comme Dominique, nous ne sommes pas des prophètes de perdition ou de disgrâce. Dominique, comme Jésus, n’annonce pas de mauvaises nouvelles mais la. Bonne Nouvelle, étant un prophète de l’espérance. Il ne fut pas non plus un moraliste annonçant des châtiments ou suscitant des sentiments de culpabilité. Il fut – et il est – le maître spirituel qui rend l’espérance à ceux qui se sentent opprimés par la peine et le sentiment de culpabilité.
Saint Dominique ne nourrit aucun doute sur sa mission. Il savait qu’il était prêcheur. Nous ne pouvons que renouveler en nous ce sentiment de Dominique, ne nous reconnaissant pas tellement comme « Dominicains » mais comme « Prêcheurs ».
Dans quelque temps commencera le Chapitre général d’Oakland, en Californie. Comme préparation au Chapitre je voudrais formuler les questions suivantes :
1. Ma vie est-elle où sont mes paroles?
2. Les Dominicains sont-ils reconnus dans le monde entier comme l’Ordre des Prêcheurs?
Faisant partie de notre formation continue, ne devrions-nous pas nous considérer davantage comme « prêcheurs », titre que nous ont donné le Pape Honorius et saint Dominique?
4. Quelles sont les expériences humaines qui me modèlent, moi et mes paroles? Par quels moyens ai-je permis que le cri des pauvres, de ceux qui :,ont sans catégorie sociale, éducation ou pouvoir, influe sur ma compréhension de l’Evangile et mon annonce de celui-ci?
5. Quelle est ma prédication? Se base-t-elle sur la prière et l’étude? Suis-je un familier de la Parole de Dieu? Est-ce que je me prêche moi-même ? mes idées ? ou JésusChrist? Est-ce que je m’accepte comme je suis, permettant aux autres de m’enseigner? Comment ai-je continué ma formation de prédicateur? Est-ce que je cherche la collaboration de mes frères, de mes soeurs et du laïcat dans mon ministère de prédication?
6. De quelle façon notre manière particulière de vivre ensemble peut-elle promouvoir directement la prière, l’étude et l’annonce – éléments essentiels de la prédication – pour que nous soyons reconnus publiquement comme « les Prêcheurs ».
Nous sommes Prêcheurs : Réjouissons-nous de notre vocation, hommes et femmes à qui a été confiée la Parole et la vision de Dieu pour notre monde. (Septembre 1989)
Les premières assignations (1990)
Lettre du Maître de l’Ordre. Mai 1990
fr. Damian Byrne, O.P.
 Les rapports des différents Provinciaux signalent régulièrement une de leurs préoccupations : la difficulté qu’on éprouve à procurer une assignation convenable aux frères dans les premières années de ministère.
Les rapports des différents Provinciaux signalent régulièrement une de leurs préoccupations : la difficulté qu’on éprouve à procurer une assignation convenable aux frères dans les premières années de ministère.
Il me semble que le problème fondamental est double. D’abord, à cause d’un manque de vision, de prévision et de volonté de la part des Chapitres provinciaux, les Prieurs provinciaux se voient trop souvent réduits à remplir des vides, au préjudice des jeunes religieux. En second lieu, on constate souvent que, malheureusement, seules quelques rares communautés dans les Provinces peuvent affronter le défi des valeurs que représentent de jeunes religieux, en particulier sous le rapport de la vie et de l’apostolat communautaires souhaités par notre législation.
Planification
À mesure que les Provinces diminuent en effectifs, deviennent progressivement restreintes leurs possibilités de maintenir leurs engagements apostoliques. Ici, les Provinces qui peuvent résoudre ce problème en réorganisant leurs engagements manifestent une santé bien supérieure à celles des Provinces qui s’en abstiennent. Face à une réorganisation nécessaire, le sursis ne fait que compliquer les problèmes qui, de toute façon, devront être un jour attaqués de front. Comme exemples de réorganisation heureuse, je citerais les Provinces du Mexique et d’Angleterre. D’un Chapitre provincial à l’autre, on a décidé de fermer des maisons, ce qui leur permettait de distribuer leurs personnels et d’assumer de nouveaux apostolats. Rien de facile, c’est certain ; mais les Provinces et les Vicariats y regagnent en vitalité.
Nos Constitutions -et les récents Chapitres généraux insistent sur la nécessité de la planification. Ce travail constitue la responsabilité de tous, et non pas uniquement des Supérieurs. Il doit s’opérer dans nos maisons aussi bien que dans nos Provinces et Vicariats (cf. Walberberg, nn. 17c, 78, 201).
Il semble facile de considérer nos engagements et d’identifier nos besoins d’une façon uniquement abstraite. Cependant, lorsqu’il s’agit de fermer une maison ou de se retirer d’un apostolat donné, il nous arrive souvenu: de ne pas nous en sentir capables. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à jeter un coup d’oeil sur une communauté qui doit, par exemple, réviser l’horaire des messes. Que de fois, dans de telles circonstances, les préférences individuelles des frères prennent le pas sur les réels besoins des fidèles ou sur les exigences de la liturgie sous le rapport de la participation ou de la prédication.
Lorsqu’il s’agit de renoncer à des endroits qui nous sont chers, on pourrait se rappeler ce que Donald Nicholl écrit sur la recherche de la vérité et de la science, sur la douleur qu’on éprouve en renonçant à de vieilles formules et images, à des symboles familiers
» C’est en vain que j’ai essayé, durant de longues années, de saisir le sens de notre soif de vérité. Jusqu’au jour où je reçus la lumière de… Thomas d’Aquin, dans son commentaire sur la béatitude » Bienheureux ceux qui pleurent « . Saint Thomas y affirme que cette béatitude vise particulièrement ceux dont la vocation consiste à repousser les frontières de la science. Une telle assertion se révèle pour le moins surprenante et nous oblige à la considérer de plus près. Voici l’explication de Thomas : chaque fois que nos esprits s’éprennent d’une nouvelle vérité, nous souffrons parce que tout notre être désire protéger le contrepoids d’inertie et de confort qu’il s’est construit. La perte de ces cadres nous apparaît comme une menace personnelle, et notre peine constitue le symptôme de la douleur ressentie devant le dérangement. Bien plus, nous éprouvons comme une sorte d’ affliction. Les formules, les images et les symboles ne sont-ils pas devenus au long des ans une partie de nous-mêmes ? Leur perte constitue la perte d’une part de nous-mêmes. Et nous pleurons leur perte comme nous pleurions la perte d’un membre » (Sedos, février 1990).
Il nous faut mourir afin de vivre. Et les exigences de l’Évangile ne s’appliquent pas uniquement à nos vies, mais aussi aux maisons et aux ministères. Souvent nous sommes beaucoup trop attachés à des édifices qui sont devenus de vrais musées. Il arrive que l’État nous rende service en s’appropriant certains de nos édifices et en les mettant à la disposition du public, ainsi appelé à partager notre héritage matériel. Par exemple, croyez-vous que nous poumons conserver des chefs-d’oeuvre comme San Marco à Florence ou Santo Domingo à Oaxaca aussi bien que l’État le fait ? Et à supposer que nous en aurions les moyens, à quoi servirait un tel engagement ? De jeunes religieux ne peuvent être assignés dans des communautés habitant des édifices délabrés.
De plus, certaines Provinces affrontent le défi de maintenir des lieux qui ne constituent plus des centres populeux ; également des secteurs négligés par d’autres missionnaires. En centrant notre projet apostolique sur de telles fondations, resterons-nous fidèles à notre vocation » d’être présents à Dieu et au monde » de notre temps ? Dans l’esprit de l’Évangile, nous devrions avoir le courage de » plonger en profondeur » et de nous déplacer vers les nouveaux centres urbains. Jésus attache plus d’importance aux personnes qu’aux choses. Ce qui ne signifie pas que tout ce qui est ancien doit disparaître. Le maintien de certaines fondations anciennes peut devenir le tremplin de nouveaux apostolats. On a déjà affirmé que » les conditions de l’espérance et celles du désespoir se recoupent souvent de façon parfaite « . Je l’ai constaté fréquemment. Une telle situation s’explique par notre attitude et notre initiative ou bien par leurs contraires. Nous devons préparer l’avenir ensemble, sous la conduite de l’Esprit, dans nos chapitres et au niveau de nos communautés locales. Les ministères traditionnels doivent être examinés attentivement et évalués en fonction de nouveaux modes de prédication à instaurer.
En particulier, le nombre et la qualité de nos paroisses doivent retenir notre attention. Le Chapitre d’Avila recommandait que toute demande de charge d’une nouvelle paroisse tienne compte des exigences de notre vie religieuse et des conditions de notre ministère itinérant. On doit aussi se rappeler que nous ne devons pas accepter facilement des paroisses et que les Chapitres provinciaux doivent examiner périodiquement nos engagements dans ce secteur. Ces principes s’appliquent à toutes les paroisses que nous assumons partout dans le monde. Pareille évaluation doit s’appliquer à nos universités, nos collèges, nos sanctuaires et nos aumôneries dans les hôpitaux.
Vie communautaire et insertion des jeunes religieux
Ma seconde préoccupation porte sur la première assignation dés jeunes Dominicains à la fin de leur formation initiale. Comme je l’ai déjà affirmé, peu de communautés dans les Provinces offrent aux jeunes religieux un lieu où ils peuvent vivre leur vie religieuse d’une façon conforme à l’actuel idéal de la vie communautaire et d’un apostolat spécifiquement dominicain. L’expérience de la vie communautaire de la Province doit se situer dans la ligne de la formation institutionnelle.
On doit accueillir les jeunes comme des adultes, et non comme des enfants. Nous ne devons pas non plus les considérer uniquement comme nos successeurs. Ils possèdent leurs propres vues et leurs propres espoirs. Comme nous avons nous-mêmes appris en commettant nos erreurs, ils doivent apprendre en commettant les leurs. Je me rappelle encore la remarque d’un prêtre assez âgé : » Les jeunes prêtres sont nos enfants ; ils doivent apprendre de nous, mais ils ne sont pas intéressés à le faire » . Je lui répondis: » Mon père, ils ne sont pas vos enfants. Ce sont des adultes qui arrivent dans une communauté adulte. Ils ont encore beaucoup à apprendre ; mais ils ont aussi beaucoup à donner, sans que ce soit pour autant à l’intérieur d’une relation entre enfant avec son père ou son grand-père. Nous sommes ici dans une relation entre différents adultes qui ont beaucoup à apprendre de l’un à l’autre » .
Je crois que la prudence s’impose particulièrement dans l’assignation de jeunes religieux. Ils aspirent à un lieu où non seulement ils seront bienvenus, mais où ils se trouveront vraiment chez eux et encouragés dans leur ministère. Dans ces circonstances, l’avis des responsables de formation pèse lourd. N’oublions pas que, pour plusieurs jeunes, la première assignation correspond au passage de la stabilité à l’instabilité. Ce qui cause problème, c’est la solitude ou le sentiment de se retrouver sans appui. On ne peut éviter toutes les misères, tous les inconvénients de la solitude, toutes les erreurs des premières années vécues dans une communauté et un ministère donné. Mais on peut demeurer attentif à ces réalités. Autant que faire se peut, laissons les jeunes frères s’incorporer à une équipe ou au moins se joindre à un autre frère dominicain.
Au début, il ne faudrait pas les laisser à leurs propres projets, même au sein d’une communauté. Non plus les assigner avec l’intention de remplir des vides dans d’anciens projets sans grande valeur actuelle. Les trois points du triangle se retrouvent dans une équipe apostolique, dans la qualité de vie à la maison d’assignation et dans une saine relation avec un ou plusieurs membres de la communauté.
Je n’arrive pas à comprendre comment on peut pousser de jeunes religieux à vivre et à travailler seuls ou dans des communautés où fait défaut la vie religieuse. Comment peuvent survivre nos jeunes dans de telles conditions ? De plus, je ne comprends pas l’idée de les faire étudier encore après leur formation initiale. Ils ont besoin d’une année ou deux pour s’habituer au rythme du ministère. Combien d’exemples pouvons-nous citer de jeunes religieux qui ont dû affronter la crise dans les années qui suivent immédiatement leur ordination ! Il n’existe aucune façon de prévoir les réactions d’un chacun dans les situations difficiles, mais nous connaissons la valeur effective d’une vie communautaire stimulante. Lequel d’entre nous peut se passer d’encouragement et d’appui dans son travail ? Qui a pu oublier ce que furent nos jeunes années ? Avons-nous complètement perdu la mémoire de nos premiers efforts de prédication, de nos angoisses, de nos erreurs, de nos espoirs et de nos craintes.
Nous devons examiner noire attitude envers les jeunes et leur monde. Est-ce que nous faisons un effort suffisant pour comprendre les sentiments de jeunes qui souvent viennent d’une culture et d’une expérience religieuse bien différentes des nôtre ? Sommes-nous capables d’entrer dans leur monde, alors que nous désirons les voir entrer dans le nôtre ? On entend souvent parler du » bon vieux temps » ; mais que dire des promesses et des espoirs de notre temps actuel ?
Le Chapitre d’Avila force notre réflexion lorsqu’il affirme : » .Si nous voulons vraiment un avenir ouvert, nous devons agir en conséquence. À ce propos, une exigence fondamentale est à remplir : apprendre à réellement faire confiance aux jeunes. Si nous le réussissons, nous serons alors des compagnons de route capables d’une patience soutenue, capables de compréhension et d’espérance, capables encore d’accueillir la nouveauté apportée par ces jeunes. En plus, nous saurons leur confier des responsabilités apostoliques signifiantes non seulement auprès des jeunes de leur âge (par exemple dans les collèges et les mouvements) mais au sein de communautés chrétiennes régulières ; nous saurons même, assez souvent, nous mettre à leur école de manière à promouvoir avec plus de pertinence l’évangélisation de notre monde… » (Avila, chap. IV, n. 67.3, pp. 43-44).
Les jeunes religieux et les quatre priorités
Un autre aspect des premières assignations consiste dans l’utilisation appropriée des talents. Il serait: naïf de penser qu’un jeune religieux peut tout faire ou encore faire les choses comme ses prédécesseurs. Une communauté peut offrir un milieu favorable au ministère, mais c’est le religieux lui-même qui le rend viable selon ses propres attitudes et talents. Il faut concéder aux autres, non le privilège, mais le droit de procéder à leur façon à eux ; leur laisser l’espace nécessaire à leurs propres essais lorsqu’il s’agit de tendance à la perfection dans la prédication, les études, l’enseignement ou les relations humaines… Il faut leur laisser la place de développer leur sens de l’initiative, de la créativité et de leur talent de l’organisation. En un mot, il faut favoriser un climat qui leur permette de grandir et de rester eux-mêmes.
D’après moi, ce travail se situe très bien à l’intérieur des quatre priorités, qui favorisent amplement le développement des talents de nos frères. Dans cette perspective, chaque Province devrait se poser la question suivante : notre mission s’étend-elle à ceux qui ne croient pas en Jésus ? Comptons-nous des jeunes qui se consacrent au travail intellectuel d’aujourd’hui ? En voyons-nous qui se dévouent auprès des pauvres et à la lutte pour la justice et la paix ? Combien en avons-nous qui se consacrent aux moyens de communication sociale ?
Notre Ordre peut se vanter d’une longue tradition de créativité. Les jeunes Dominicains n’en possèdent pas le monopole. Par exemple, je suis émerveillé par l’esprit d’invention d’un missionnaire allemand de Taiwan, pourtant assez âgé, face à la rapide mutation de la société où il travaille. Il faut aussi encourager la créativité chez les jeunes.
Durant plusieurs siècles, les artistes représentaient souvent les Dominicains avec un livre sous le bras. Il faut dire que deux cents ans avant la révolution de l’imprimerie, l’Ordre a joué un rôle prépondérant dans la diffusion du livre comme moyen courant de communication. Une liste incomplète d’auteurs dominicains de ces deux siècles comporte pas moins de 25,000 noms. Les régions de missions révèlent aussi beaucoup de créativité. Par exemple, les Dominicains missionnaires au Maroc obtenaient, en 1226, la permission du Pape Honorius III d’adapter leur habit à celui des gens, et ce pour ides raisons d’apostolat. Dans un autre domaine, on sait que saint Albert et saint Thomas ont su assimiler et adapter la pensée d’Aristote pour la mettre au service de l’Église. Par ailleurs, la bibliothèque Vaticane renferme une copie du XVe siècle du fameux jeu » moralisé » d’échecs (De Ludis Scacchorum) de Jacques de Cessole, religieux de notre couvent de Gênes vers 1290. La première illustration représente un Dominicain en chaire, où pend un échiquier. Ne trouve-t-on pas là une primitive expérience de communication directe ? Chacun de nous est pareillement appelé à écrire son propre chapitre de la vivante histoire de la famille dominicaine:.
L’Ordre a fait preuve de beaucoup de créativité et de puissance d’adaptation dans la chaire, dans les média, dans le développement de la pensée chrétienne et dans le travail de l’évangélisation. Nous-mêmes devons continuer dans cette ligne. Nos seuls ennemis se logent à l’enseigne de la suffisance et de la recherche de notre propre sécurité. Répétons de nouveau que les jeunes religieux doivent s’engager courageusement dans les apostolats de frontières. N’oublions pourtant pas que ce genre de ministère suppose la communauté et aussi une soigneuse préparation.
Prêcheurs avant tout
Nous sommes prêcheurs avant tout. Dans certaines Provinces, la préparation à la prédication durant les années de formation se révèle meilleure que jamais. Les jeunes prennent conscience de leurs talents en groupes ou au sein d’une communauté qui les encourage à prêcher. Je crois que nous devons multiplier des expériences communes de préparation de la prédication et aussi de partages de la foi. Je continue à recommander aux communautés de se réunir pour partager leurs réflexions, leurs idées et leurs expériences afin de préparer la prédication à venir. La présence à ces rencontres des laïcs, des soeurs et de tous les agents du ministère pastoral constitue un idéal. Ne s’agit-il pas là d’une structure de la formation permanente en prédication ?
L’Ordre compte actuellement au-delà de mille frères en formation, ce qui constitue un nombre impressionnant si l’on considère l’ensemble de nos effectifs. On peut penser que leur nombre augmentera encore dans un futur rapproché. Ce futur leur appartient.
Le rôle de l'étude dans l'Ordre (1991)
Lettre du Maître de l’Ordre. 25 mai 1991
fr. Damian Byrne, O.P.
 Quand Dominique a voulu former ses Frères comme prêcheurs, il les a envoyé étudier. L’importance de l’étude court comme un fil conducteur à travers le texte entier des Premières Constitutions, définissant la façon dont sont vécues les observances elles-mêmes.
Quand Dominique a voulu former ses Frères comme prêcheurs, il les a envoyé étudier. L’importance de l’étude court comme un fil conducteur à travers le texte entier des Premières Constitutions, définissant la façon dont sont vécues les observances elles-mêmes.
« Notre étude doit tendre principalement, ardemment, et avec nos plus grands efforts, vers le but de nous rendre utiles au salut des âmes ».
La loi de la dispense est introduite, spécialement pour ce qui paraîtrait être un obstacle à l’étude, à la prédication ou au bien des &mes ». Le chapitre quotidien peut être déplacé ou omis « de façon à ce que l’étude ne soit pas gênée ». L’office divin doit être récité « brièvement et ;succinctement pour que les Frères ne perdent pas la dévotion et quia leur étude ne soit gênée en aucune façon ». Le Maître des novices doit enseigner à ceux qui lui ont été confiés » combien ils doivent être assidus à l’étude… ». C’est cela que nous avons reçu de Dominique.
L’originalité de Dominique est de mettre l’étude au service de la prédication et de donner à l’étude une signification, une spécificité apostolique.
L’étude en fonction de la prédication
L’orientation de l’étude en vue de la prédication constitue une partie essentielle du ;plan que Dominique avait conçu pour son
Ordre. Dans son Expositio supra Constitutiones, Humbert de Romans souligne clairement l’attitude dominicaine face à l’étude. lorsqu’il écrit:
« L’étude n’est pas le but de l’Ordre, mais le moyen le plus important pour atteindre ce but, c’est-à-dire la prédication et la tâche du salut des âmes, ce que sans l’étude nous ne pourrions en rien atteindre. »
Humbert n’ignore pas le danger qui nous guette de faire de l’étude une fin en elle-même:
« Certains se consacrent aux saintes écritures. Mais si leur étude ne vise pas :la doctrine de la prédication, à quoi peut-elle leur être utile? »
Les constitutions Gillet donnaient l’impression que l’étude se limitait aux premières années de la vie dominicaine comme un nécessaire préambule à la prédication ou au ministère. Quelques générations de dominicains ont été marquées par cette optique. Les Constitutions de River Forest ont, restauré notre conception traditionnelle de l’étude et de la réflexion théologique comme partie intégrale de notre héritage religieux, bien que l’ancienne conception persiste chez plusieurs d’entre nous, qui considèrent l’étude comme l’apanage des spécialistes ou bien l’activité d’une période précise de notre vie dominicaine.
Scolaire ou pastoral
On a souvent affirmé qu’il faut considérer le passé pour comprendre le présent. Voici un événement passé qui confère une dimension pastorale additionnelle à l’étude dans l’Ordre. Le 4 février 1221, Honorius III recommande les dominicains comme confesseurs. Il attirait ainsi l’attention de l’Ordre sur le besoin de préparer les frères au ministère de la confession et de la direction spirituelle. Alors que l’éventail de l’étude dominicaine comprenait même la philosophie dans la Ratio studiorum de 1259, le Pape Honorius III, en nous confiant le ministère de la confession, orientait l’Ordre vers un système d’éducation à forte teinte pastorale.
Thomas d’Aquin eut la géniale idée de pousser davantage l’orientation fondamentale de Dominique et d’élargir la base de l’éducation théologique de l’Ordre en l’appuyant sur l’étude de la philosophie aristotélicienne. Ce qui lui permettait d’assurer une assise intellectuelle à la théologie de la bonté de la création, en rejetant toute forme de dualisme. En 1265, il commençait la rédaction de sa Summa theologique. Parlant de la vie des étudiants et du studium de Santa Sabina, de môme que des débuts de la summa, voici ce qu’en dit le Père Leonard Boyle:
» … Thomas élargissait maintenant la base de leur éducation théologique, faisant ainsi éclater la tradition de la théologie pratique qui avait jusque là caractérisé le système d’éducation dans l’Ordre. » Il « désirait assurer une base beaucoup plus théologique à la formation dominicaine régulière en théologie pratique ».
Dominique et Thomas partageaient le même idéal. L’application de Thomas à la vie intellectuelle n’impliquait nullement le mépris de la prédication. Il poursuivait, le môme but que Dominique: le salut des âmes par la prédication, enracinée dans une vie de prière, de contemplation, d’étude et de partage communautaire.
Étude et communauté
Le Chapitre d’Oakland nous rappelle l’intime relation qui existe entre étude et communauté. « Cette vie commune est en même temps le contexte de notre étude. Car, en premier lieu, nul ne peut parler de l’amour de Dieu, s’il n’en fait l’expérience dans le quotidien. De plus, nul ne peut faire oeuvre de théologien de façon isolée … Une théologie intégrale doit toujours être le fruit d’une entreprise collective ». L’étude dominicaine se présente comme communautaire. La première responsabilité face à l’étude revient à la communauté, tout comme la communauté détient la première responsabilité de la prédication. Dans la lettre au frère Jean, attribuée à saint Thomas d’Aquin, l’auteur répond à la question: comment étudier? De la même manière qu’on vit, écrit-il.
L’étude requiert une atmosphère particulière. L’auteur de la même lettre insiste sur l’importance du silence et sur la place de la prière. Et cela, pour préparer dans le coeur une place au Seigneur. Il rappelle encore la nécessité d’une curiosité modérée et le besoin de cultiver la charité fraternelle. Ceux qui vivent dans les centres d’études savent combien les relations humaines peuvent faciliter ou entraver l’étude. Un réel esprit de communauté aide grandement à créer l’atmosphère propice à l’étude.
Dans son commentaire sur la lettre précitée, Victor White signale qu’à la Secunda pars. de la Summa, saint Thomas réfléchit sur les problèmes émotifs des étudiants et sur leur besoin tout particulier de loisirs.
Les étudiants ont leurs propres exigences. Nous devons les encourager. Avons-nous déjà oublié notre expérience de la jeunesse et de ses difficultés? L’acquisition d’un savoir profond se fait selon un processus intérieur graduel. Après tout, nous ne sommes que des humains, pas des anges. Personne ne peut apprendre à notre place. Il n’existe aucun raccourci, et nous avons besoin de professeurs pour nous guider, tout en sachant bien qu’aucun professeur ne peut apprendre pour nous.
Les jeunes ont besoin d’une atmosphère favorable à l’étude et à la réflexion. Voilà qui fonde l’importance d’un studium, d’un maître ou de professeurs pour les orienter. Même lorsque les études se poursuivent ailleurs, on doit exiger un rythme de vie et de soutien qui favorise le meilleur rendement des études. Pour nous, l’étude constitue une observance rigoureuse. Elle exige une profonde dévotion personnelle, beaucoup de discipline et d’application. L’habitus de l’étude résulte de l’effort et de la persévérance de l’individu lui-même.
Les professeurs ont aussi leurs besoins propres. Leur tâche requiert une profonde application de l »esprit. Le travail de recherche et de réflexion sérieuse, on :le sait, ne produit guère de gratification immédiate ou de reconnaissance garantie. Il arrive parfois que les résultats paraissent tellement minces qu’ils ne peuvent justifier les efforts fournis. La vocation d’enseignant est plutôt rare, et ceux qui s’y adonnent éprouvent continuellement la tentation de l’abandonner.
vous ne pouvez ni enseigner tout aux étudiants, ni toujours compter sur leur gratitude. Le don le plus appréciable que vous pouvez leur apporter consiste peut-être dans les moyens de se livrer à une réflexion critique. Est-il besoin de rappeler à nouveau la recommandation des actes du Chapitre général de Walberberg:
« Nous n’avons qu’un seul conseil à donner aux frères: lisez saint Thomas. Répandez cette consigne parmi nos étudiants, afin qu’ils deviennent capables de lire eux-mêmes le texte de saint Thomas ».
Le Père Yves Congar décrivait en ces mots le travail de l’étude et de la recherche. L’étude scientifique de la philosophie et de la théologie, avec toutes ses exigences d’une documentation méticuleuse, de: la réflexion et de la publication, constitue une partie intégrale de la mission de l’Ordre. S’il lui arrivait jamais de la négliger, une telle grâce serait remise à d’autres … De nos jours, la science biblique, l’histoire ou la connaissance des sources nous offrent toutes les possibilités qu’aucun théologien ne peut ignorer ou négliger dans sa recherche.
Une vocation exigeante
Rappelons notre devise: vérité. Si nous allions en déduire que nous possédons la vérité, nous pécherions par ignorance. Si nous nous considérons comme des pèlerins en quête de la vérité, nous commençons à approfondir notre vocation.
Gilbert de Tournai écrivait:
« Nous ne découvrirons jamais la vérité si nous nous contentons de nos découvertes. Ceux qui ont écrit avant nous ne sont pas nos maîtres, mais nos guides. La vérité est à la portée de tous. Elle n’a jamais constitué la propriété exclusive de personne ».
A l’Office des lectures, un commentaire de saint Vincent de Lérins pose la question suivante:
« Ne peut-il y avoir, dans l’Eglise du Christ, aucun progrès de la religion? Oui, assurément, et un très grand. Car qui serait assez jaloux des hommes et ennemi de Dieu pour essayer d’empêcher ce progrès? »
L’étude dominicaine, c’est l’étude de la théologie. Si notre étude doit aboutir à la prédication et surtout la prédication doctrinale, elle doit nécessairement être théologique. Ce qui ne signifie pas qu’elle doive dédaigner les autres secteurs du savoir humain. Théologique signifie évidemment qu’elle soit inter-disciplinaire.
Pèlerins de la vérité
L’Ordre a toujours maintenu sa tradition de recherche et d’étude. Sommes-nous réellement fidèles à cet aspect de notre vocation? Il faut bien admettre que les frères sont plus engagés dans la pastorale que dans l’étude et la recherche. L’Eglise et notre époque ont encore besoin d’hommes et de femmes qui se consacrent à l’étude et à la recherche afin de bâtir une philosophie et une théologie qui parlent de Dieu aux hommes d’aujourd’hui. L’Ordre assure-t-il à ces gens les conditions qui leur permettent de continuer et qui leur fournissent aussi le soutien dont ils ont besoin? Parmi les sujets de thèses de doctorat, combien concernent les problèmes d’aujourd’hui?
Dans un message adressé au Chapitre général de 1983, le Pape Jean-Paul II nous rappelait:
« Comme dominicains, vous; avez reçu la mission de proclamer que Dieu est vivant … Le charisme. prophétique de votre ordre se signale par la note spécifique de la théologie … Soyez dans l’Ordre toujours fidèles à cette mission de théologie et de sagesse, quelle que soit la forme sous laquelle vous êtes appelés à l’exercer, à l’université ou sur le terrain de la pastorale ».
Cette mission qui est nôtre ne signifie pas qu’un dominicain soit plus savant que les autres; ni non plus que chaque dominicain soit un spécialiste en philosophie et en théologie. Bien plutôt, que la recherche de la vérité constitue une dimension fondamentale de la vie de tout dominicain.
La recherche de la vérité en vaut-elle encore la peine? Il en est qui se le demandent. Les mots et; le langage ont été tellement galvaudés qu’ils ne signifient plus ce qu’ils devaient exprimer à l’origine. D’autre part, le courant subjectiviste rétrécit la vérité à une impression. Un pluralisme populaire suggère encore que toute opinion est valable et que la vérité est toute relative. Par ailleurs, nous vivons à une époque tellement préoccupée par la solution de ses problèmes urgents et concrets, et également tellement soucieuse de sa survie que l’étude de la philosophie est considérée comme inutile. Mais la recherche de la vérité fonde encore notre vocation. Nous croyons au don de Dieu en chacune des créatures humaines: la capacité de découvrir, de vivre et de transmettre la vérité.
La fidélité à la tradition, l’application à la théologie aujourd’hui
Posons la question: comment peut-on s’adonner à la théologie. Le Chapitre d’Oakland nous rappelle que nous avons toujours été créatifs en théologie dans les moments où nous avons osé nous laisser interroger par les problèmes les plus accablants pour le peuple. Saint Thomas n’a pas agi autrement. Dans Questiones disputatae, il traite des problèmes de son temps comme devraient le faire tous les dominicains face aux problèmes de notre temps.
Si l’école théologique de Salamanque a connu des heures glorieuses, c’est précisément parce que Vitoria et ses collègues abordaient les problèmes de l’époque: à eux transmis par leurs frères des Amériques sur ces questions. Il s’agit là peut-être du plus bel exemple de collaboration entre missionnaires et professeurs.
La fidélité à notre passé n’est rendue possible que par l’étude des problèmes de notre temps. La fidélité au passé ne s’accommode pas d’attitudes défensives ou triomphalistes, pas plus que de répétitions ou. d’imitations des écrits de nos frères ou encore d’interprétation servile de textes anciens. L’étude de la tradition sans curiosité demeure stérile; l’étude de la tradition d’une façon défensive ou triomphaliste est nuisible. Il faut l’étudier de façon critique. Notre temps et les circonstances actuelles exigent des réponses aux questions d’aujourd’hui. C’est le défi exprimé dans nos quatre priorités. Elles constituent les points critiques de nos préoccupations actuelles, tout en étant profondément rattachés à notre tradition. Les réalisations les plus créatrices et les plus scientifiques de notre temps sont l’oeuvre d’hommes qui ont affronté les problèmes d’aujourd’hui: les pères Lagrange, Chenu, Lebret …
En nous proposant l’oeuvre de saint Thomas comme exemple pour notre époque, la Pape Paul VI écrivait:
» … il a su trouver des solutions toutes neuves aux questions de la foi avec la raison en harmonisant la sécularité du monde avec les exigences de l’Évangile ».
« Son enseignement et sa vie ont fait la preuve qu’il est possible d’harmoniser. la fidélité à la parole de Dieu avec une mentalité totalement ouverte au monde et ses vraies valeurs; qu’il est aussi possible de combiner le goût du renouveau et du progrès avec l’intention de construire un système de pensée sur les inattaquables fondements de la tradition. »
Le Pape nous rappelle encore que Thomas:
« …se maintenait au courant de nouveau savoir de son temps en abordant les nouveaux problèmes qui surgissaient et en étudiant les arguments de la raison humaine pour ou contre la foi … Il gardait un esprit ouvert à tout énoncé de la vértité, qu’elle qu’en soit la source ».
Paul VI nous met encore en garde contre un attachement servile à saint Thomas:
« Il ne suffit pas de présenter cette doctrine en la répétant mot à mot, avec les mêmes problèmes et avec la façon usuelle de traiter les questions ».
« On ne peut en rien douter que de nos jours saint Thomas chercherait passionnément à découvrir les causes des changements qui affectent le genre humain, ses conditions, sa mentalité, sa conduite. »
Nous sommes conviés à une semblable créativité. La fidélité à saint Thomas consiste dans une réflexion théologique sur les « questions disputées » de notre temps.
Dans un article intitulé: L’étude dans l’ordre des Prêcheurs, auquel je me réfère dans la présente lettre, le frère Felicisimo Martinez écrivait:
« Si l’on désire maintenir la réflexion théologique dans l’Ordre, la première tâche consiste à réconcilier missionnaires et professeurs, activité pastorale et activité intellectuelle, tradition missionnaire et tradition monastique. L’existence de ces deux traditions tout au long de notre histoire n’implique aucun appauvrissement, mais plutôt une richesse. c’est de leur opposition que naît plutôt l’appauvrissement. Le divorce entre la réflexion théologique et la prédication a représenté une des plus grandes tragédies dans l’histoire de l’Ordre, parce qu’en même temps on dévalue et: la théologie et la prédication. La séparation entre dominicains professeurs et prédicateurs rétrécit l’idéal d’étude et d’évangélisation, parce que pasteurs et prédicateurs se croient dispensés de l’étude,
considérée par eux commet le terrain des spécialistes et des professionnels; par ailleurs, les professeurs se croient dispensés de tout travail pastoral et de l’évangélisation ».
La tension entre pastorale et enseignement devrait devenir créative pour les deux. Sinon, elle sera néfaste.
Quelques problèmes au sujet des études
La plupart des Provinces et des Vicariats estiment que les étudiants devraient poursuivre leurs études dans leur propre pays. L’expérience a prouvé que le séjour des étudiants à l’étranger pour leur formation institutionnelle a entraîné de regrettables conséquences dans bien des cas. cependant, dans plusieurs entités, le petit nombre d’étudiants ne permet pas de maintenir un studium dominicain. Inévitablement, les étudiants doivent aller poursuivre leurs études ailleurs. Un petit nombre de frères requiert la présence et le soutien d’un plus grand nombre.
Dans bien des cas, la solution consiste à envoyer les étudiants dans une institution du pays, séminaire diocésain ou institut pour religieux. Il arrive qu’on puisse s’en réjouir, mais pas toujours.
Autant que possible, il faut compter sur des normes comparables à celles de la Ratio studiorum et sur une introduction graduelle à la philosophie et à la théologie. On ne peut nier, pour les étudiants, la valeur d’un ordre dosé de cours, plutôt que d’une approximative série de cours sans liens entre eux. Les Constitutions primitives présentent une forme de travaux pratiques à réaliser dans une assemblée où les étudiants pourraient démêler les problèmes les plus difficiles concernant leurs études. On peut suggérer un tel procédé qui permettrait aux étudiants d’assimiler la matière qu’ils absorbent dans leurs cours.
Dans certaines régions de l’Ordre, on constate peu d’intérêt pour les études et la formation intellectuelle. On n’attache pas suffisamment d’importance au niveau scolaire des candidats à l’Ordre; on ne s’applique pas assez à leur procurer l’instruction requise. Cette négligence face aux études se reflète ensuite dans l’indifférence intellectuelle des étudiants eux-mêmes.
La préoccupation des pauvres ne s’oppose pas à l’étude dans l’Ordre. Le problème consiste à pourvoir nos étudiants d’une solide formation sans pour autant en faire de bons petits bourgeois.
Certaines entités de l’Ordre ne s’arrêtent pas suffisamment à l’étude des problèmes réels qui concernent l’éducation de leurs étudiants.
Tout notre ministère sera marqué par notre formation supérieure. Pour réussir dans les média, il faut être bon théologien; de même, si nous voulons combattre pour la justice. Les premiers frères de l’Amérique Latine nous servent d’exemple sur ce point. Leurs succès en prédication dépendaient de leur réputation de bons théologiens. Eux-mêmes, conscients de leurs propres limites, ne manquaient pas de chercher la lumière auprès des professeurs de Salamanque.
Collaboration
Nous manquons de spécialistes en philosophie, en théologie et en sciences annexes. Dans certaines régions, la planification et l’échange de personnel pourront apporter une solution à cette carence. Dans les pays en voie de développement, l’économie constitue un des facteurs qui entravent un tel échange de professeurs. C’est dans cet esprit que nous avons constitué une fondation, afin de favoriser une meilleurs collaboration dans le domaine de la formation. Les Provinciaux ont déjà reçu toute information à ce sujet.
Même si une Province se voit contrainte d’envoyer ses étudiants à l’extérieur, pour une partie ou l’ensemble de leurs études, elle doit aussi former des spécialistes en philosophie, en théologie et en sciences annexes. On ne pourra jamais assurer adéquatement la vocation doctrinale de l’Ordre si chaque entité ne s’applique pas à former des gens qui travaillent ensemble, comme équipe, dans un centre d’études » et qui désirent aussi travailler aux frontières die la science.
Lorsque nos entités collaborent les unes avec les autres, chaque entité doit assurer l’accompagnement de ses étudiants sur place, que se soit par un professeur ou par un membre de l’équipe de formation.
Comme Prêcheurs, nous sommes aussi étudiants. L’étude représente une obligation liée à l’état du Frère Prêcheur.
Unis dans la collaboration : la famille dominicaine (1991)
Conférence du MO aux Supérieures générales tenue le 17 mai 1991 à Rome
fr. Damian Byrne, O.P.
 Nous autres, Dominicains, avons une identité bien précise. Nous sommes tous prédicateurs. C’est notre vocation. Tout dans nos vies y est orienté. Nous partageons cette vocation et je crois que nous devons, comme groupes (non seulement comme individus), essayer de réaliser notre vocation ensemble.
Nous autres, Dominicains, avons une identité bien précise. Nous sommes tous prédicateurs. C’est notre vocation. Tout dans nos vies y est orienté. Nous partageons cette vocation et je crois que nous devons, comme groupes (non seulement comme individus), essayer de réaliser notre vocation ensemble.
L’Ordre dominicain est né comme famille. Cela fut le dessein de Dominique. La première fondation à Prouilhe fut une fondation avec un prieur et une prieure!
Si, en effet, nous sommes une famille, nous devrions avoir beaucoup à partager; la compréhension, l’expérience, une espérance communes devraient nous inspirer mutuellement et nous faire rêver un peu ensemble. Ce serait un échange riche d’expérience et de compréhension, un échange mutuel qui est créatif. Plus que jamais je crois que nous devrions collaborer dans le ministère. Déjà nous avons commencé, mais seulement en surface.
Un peu d’histoire. Dans les temps modernes, un intérêt renouvelé pour la Famille dominicaine fut initié par le Père Cormier (1904 -1916) et par Buenaventura de Paredes (1926 -1929). Le Père Paredes a décrit l’Ordre comme « une famille particulière et unie de la grande famille chrétienne ». Il apporta un grand esprit de famille entre tous les Dominicains et a autorisé les soeurs à ajouter O.P. à leur nom. Il a aussi créé une commission pour promouvoir « tout ce qui pourrait contribuer aux relations dans la famille et établir une union intime entre les diverses branches ».
Un moment également important dans la réalisation de la Famille dominicaine a eu lieu en 1968. Le Père Aniceto Fernàndez a reçu de nombreuses demandes de la part des soeurs sur leur place dans l’ordre. Cela a fourni l’occasion de sa fameuse lettre où il écrivait: « Dans ce monde moderne où notre Sauveur nous a placés pour travailler à sa grande oeuvre de salut, nous sommes appelés à embrasser ensemble l’esprit et la tradition transmis par saint Dominique, pour chercher ensemble le meilleur moyen de réaliser notre apostolat et construire ensemble nos communautés en service d’Église. De nos jours les femmes revendiquent leur plein droit à avoir une place dans le travail de l’Église. A cause de cela, les soeurs doivent tenir leur place propre dans l’apostolat de l’Ordre ».
Égalité dans la collaboration
Le Père Fernandez a écrit aux soeurs comme à des égales, et, comme égales, les invite à chercher ensemble avec les frères les meilleurs moyens pour réaliser le ministère que nous avons en commun: la prédication sous toutes ses formes.
Je crois que seulement quand nous acceptons l’autre comme égal, nous pouvons collaborer effectivement ensemble dans le ministère. Voilà l’unique base pour la collaboration.
Mais, cependant, nous devons apprendre comment travailler avec l’autre, pour accepter l’autre comme femme ou comme homme, comme frère ou comme soeur. Cela exige un niveau de sensibilité et de compréhension qui ne se rencontrent pas dans tous.
Chapitres et Congrès récents
Depuis 1968, nous autres, hommes, nous avons essayé de faire tout ce qui est possible du point de vue législatif, pour affirmer cette égalité. Le Chapitre général de Tallaght (1971) a déclaré que la Famille dominicaine était égale dans tout l’Ordre des Prêcheurs. « L’appellation universelle Ordre des Prêcheurs, est la même que celui de Famille dominicaine et est formé de clercs, frères coopérateurs, moniales, soeurs, … » (no. 122).
Le premier congrès international d’hommes et de femmes dominicains de l’histoire de l’Ordre, fut le Congrès missionnaire de 1973 (Madrid). Il suscita des projets internationaux et l’établissement d’associations nationales de la Famille dominicaine. Ce Congrès a demandé au Maître de l’Ordre que soit nommée une soeur pour promouvoir la collaboration dans la Famille dominicaine. L’esprit du Congrès a influencé profondément les chapitres successifs.
Une autre réunion internationale significative fut celle de la Famille dominicaine à Bologne. Celle-ci a déterminé: « Notre vie apostolique se renouvelle constamment dans le dialogue avec nos frères et soeurs et est stimulée par les valeurs de l’Evangile. Dominique a associé des femmes à sa mission, affirmant ainsi leur place dans l’Eglise et sa mission. Comme héritiers de Dominique nous avons l’obligation de manifester l’égalité et la complémentarité de l’homme et de la femme » (No. 2.2).
Le Chapitre de Madonna dell’Arco (1974) a aboli les noms de « Premier, Second et Tiers » Ordre comme une terminologie hors d’usage dans la société moderne. Il n’existe pas des citoyens de première et deuxième classe. Tous sont égaux. Nous, nous sommes tous prédicateurs.
En 1977 nous avons eu un excellent document sur La Famille dominicaine, du Chapitre général de Quezon City. On y fait remarquer l’existence de deux grands mouvements dans l’Eglise et dans le monde: l’émergence du laïcat « comme un élément indispensable dans l’établissement du règne de Dieu, et la très récente et constante augmentation du mouvement de libération de la femme, ainsi que la reconnaissance de son égalité avec les hommes » (No. 64).
Saint Dominique a créé la Famille dominicaine, non pour elle-même, mais pour qu’elle soit au service de l’Eglise dans sa mission dans le monde. Elle est d’un grand secours pour l’évangélisation du monde, mais c’est un potentiel qui ne s’est pas développé totalement faute de collaboration. « Le développement d’un authentique esprit dominicain et de formation dominicaine a souffert de l’absence d’une plus grande inter-relation à l’intérieur de la Famille dominicaine… C’est maintenant le temps favorable pour que la Famille dominicaine arrive à une véritable égalité et complémentarité ». (No. 64) .
Le Chapitre affirme aussi que les membres non clercs de l’Ordre ne sont pas moins dominicains, ni participent plus faiblement à la vocation dominicaine.
Il a émit plusieurs suggestions pratiques: 1. Avoir des réunions régionales d’hommes de femmes dominicains; 2. Un cours commun de formation de base pour tous les membres de l’Ordre dans le but de créer une unité d’esprit et de compréhension dans notre vocation dominicaine.
Les Chapitres postérieurs firent des suggestions encore plus pressantes pour la collaboration dans: le ministère de la parole; la prédication de retraites, les engagements avec la jeunesse et la catéchèse; les programmes de formation; la promotion des vocations; le travail pour la justice et la paix.
Depuis 1968 nous nous somme, efforcés de surmonter les obstacles qui auraient pu nuire à la collaboration. Chapitres et congrès ont poussé à la collaboration. Il existe de beaux exemples de collaboration: création du noviciat de formation aux Îles Salomon, équipes de prédication aux U.S.A., formation permanente et collaboration sur le thème de la justice, création d’une nouvelle revue au Chili, collaboration dans des cours d’exercices spirituels et dans des centres de conférences.
Apprendre à travailler ensemble
Nous avons seulement commencé. La collaboration dans le ministère n’a pas connu une grande disponibilité de la part de beaucoup de frères. Vous êtes mieux armées pour parler aux soeurs.
La collaboration est un processus entièrement neuf que nous devons apprendre. Il exige un niveau d’adaptation et d’acceptation que beaucoup ne sont pas capables de réaliser.
Je rappelle la remarque de soeur Geraldine O’Driscoll. La première chose à considérer, entrant dans une équipe ministérielle, c’est l’importance du temps. Il faut du temps pour créer une équipe. Quand elle a commencé une équipe ministérielle elle a recherché des prêtres pour partager leur vision de la paroisse. Ils furent incapables de la réaliser, mais « après quatre ans nous sommes maintenant appelées pour nous réunir à eux et partager notre vision ».
Le second point, dit-elle, c’est seulement en travaillant ensemble, que nous seront affrontées avec le fait que « un homme et une femme abordent les choses différemment et que nous devons savoir l’accepter. Cela signifie aussi être sensibles aux résistances et faiblesses des frères et leur sensibilité envers ce qui est important pour nous ». « J’ai appris à apprécier la complémentarité du travail ensemble et à me méfier de la compétition ».
Un prêtre, qui travaille avec elle, disait: « Nous, prêtres, nous devons oublier que nous sommes Dieu et que Dieu est masculin; et les soeurs doivent oublier qu’elles étaient maîtresses d’école ».
Son commentaire final est particulièrement intéressant: « Les membres d’une équipe doivent développer leur faculté d’ écoute de l’ autre, et laisser à l’ autre son propre espace et son propre rythme. Partager des idées peut être facile. La façon dont chacun arrive à mettre ces idées en pratique peut être différente et même surprenante, nous devons respecter l’espace et le rythme de chacun ».
Je voudrais ajouter ce qui suit. Nous avons programmé une collaboration au niveau des congrès et des chapitres, mais nous n’avons presque rien fait en relation avec les problèmes humains et avec ce qui nous affronte comme hommes et femmes. Le commentaire de soeur Geraldine éclaire cela. Il ne suffit pas de vouloir travailler ensemble, il faut apprendre comment travailler ensemble.
Domaines qui demandent la collaboration
Je demande votre aide dans trois domaines où votre collaboration est nécessaire en ce moment: l’évangélisation, l’enseignement et l’administration centrale de l’ordre.
Evangélisation: Je crois que le travail d’évangélisation du monde est appauvri par l’absence de capacités entre les évangélisateurs, capacités qui sont essentielles dans l’évangélisation actuelle. Notre grande faiblesse dans l’évangélisation, est notre échec pour nous adapter aux temps qui sont changés par rapport à ce que nous vivons et l’absence d’adaptation et d’inculturation. Aujourd’hui nous avons besoin de ceux qui sont préparés en psychologie sociale, anthropologie culturelle, religions comparées… pour nous aider à inventer de nouvelles méthodes d’évangélisation pour notre temps. Je pense que nous avons besoin de soeurs préparées dans ces domaines pour faciliter l’évangélisation dans une terre nouvelle. Un échec pour trouver de telles capacités appauvrira le travail que nous faisons.
Enseignement: Le Chapitre général de Rome 1983, recommande: « Que la charge de l’enseignement dans les Institutions dominicaines d’études, soit exercée non seulement par les frères mais aussi par les membres d’autres groupes de la Famille dominicaine » (No. 278).
J’étendrais cela à la collaboration dans la formation. Pendant combien de temps les Dominicaines ont-elles reçu l’aide des frères ? Nous n’avons pas l’apport de soeurs dominicaines qui nous prêchent et nous aident dans les programmes de formation. Je pense que dans le passé une attitude négative en face de la sexualité a élevé des murs, physiques et psychologiques, dans nos noviciats et maisons d’étude, et cela a été un préjudice plus qu’une aide pour les personnes. Etre en contact avec des formateurs de l’autre sexe est un salutaire enrichissement dans la formation de vocations masculines.
Je renouvelle l’invitation du Symposium de Bologne, qui fut une réunion de frères, soeurs et laïques dominicains, de préparer ceux qui ont le désir et la capacité d’enseigner dans nos différentes institutions internationales. Je pense, en particulier, à l’Angelicum, ici à Rome, mais aussi à d’autres pays. Il y a nécessité urgente d’incoporer l’intelligence féminine dans l’enseignement de la théologie et des sciences similaires. Nous nous sentons appauvris par leur absence.
L’administration centrale de l’Ordre
En premier lieu je voudrais exprimer la gratitude de tout l’Ordre aux Congrégations qui, si généreusement, fournissent du personnel pour le Secrétariat à Sainte-Sabine depuis plus de vingt ans. Cela a été une immense aide. La générosité et le dévouement des différentes soeurs, pendant ces années, a été merveilleuse.
Le Congrès missionnaire de 1973 formula la demande suivante: « Nous demandons que les soeurs soient représentées au Secrétariat général des Missions, au Secrétariat général des Religieuses et auprès du Maître général par une soeur avec le titre de « Assistante du Maître général ». De cette façon la collaboration peut être établie à tous les niveaux de la vie de l’Ordre, par exemple, en relation avec les programmes de formation, échanges de lecteurs et dans la coopération pastorale ». Une proposition très surprenante, mais dans la juste direction.
Dans le numéro de janvier de IDI il y a une lettre de soeur Veronica Rafferty, d’Argentine. Elle émet une requête pour la création de l’Union mondiale des Dominicaines. Une telle organisation, dit-elle, pourrait faciliter les relations directes entre les soeurs et le Maître de l’Ordre, promouvoir la vie de la Famille dominicaine, faciliter les réunions pour planifier la formation initiale et permanente, ‘luné organisation qui corresponde à notre dignité, à nos aspirations et à nos nécessités ». Est-ce le moment de cheminer dans cette direction ?
La formation des frères (1992)
Lettre du maître de l’Ordre. Rome, 4 décembre 1992
fr. Damian Byrne, O.P.
 À chacun de ses niveaux, la formation revêt une importance capitale pour le bien-être de l’Ordre et de chaque religieux. Sa valeur même et sa complexité n’expliquent-elles pas la diversité de nos opinions à son sujet, probablement aussi nombreuses que les Dominicains eux-mêmes ?
À chacun de ses niveaux, la formation revêt une importance capitale pour le bien-être de l’Ordre et de chaque religieux. Sa valeur même et sa complexité n’expliquent-elles pas la diversité de nos opinions à son sujet, probablement aussi nombreuses que les Dominicains eux-mêmes ?Cependant, on peut s’arrêter à un certain nombre de vérités qu’on doit souligner à propos de la formation et sur lesquelles il faut réfléchir.
1. La formation doit se poursuivre tout le long de notre vie religieuse. Plusieurs pensent qu’elle se termine avec la profession solennelle ou bien l’ordination presbytérale. On a tendance à la confondre avec les études institutionnelles plutôt que de la concevoir comme un mode de vie.
2. Conséquemment, chaque étape de la formation doit retenir notre attention. La formation initiale ne présente qu’une partie de ce processus avec, bien sflr, son propre rôle unique et crucial.
3. Si nous voulons faire de la formation une réalité à chaque instant de notre vie, nous avons besoin de structures adéquates qui permettent aux frères dé vivre leur vie religieuse dans la présente conjoncture. Ce qui suppose la définition précise des différentes étapes de la formation ainsi que la volonté de « déterminer, selon les nécessités régionales et les forces disponibles, les objectifs prioritaires du ministère des frères » (LCO 106, 3).
Qu’est-ce que la formation ?
La formation vise quatre éléments de base: l’humain, le religieux, l’intellectuel et le pastoral. Ces éléments doivent se retrouver dans chaque étape de la formation, sans empêcher l’un ou l’autre de prédominer ici ou là. Puisque l’un ou l’autre des éléments de la formation peut éventuellement s’imposer au point d’éliminer les autres, nous devons en conclure que ce ne sont pas seulement les idées qui produisent le changement.
« On ne peut affirmer que seule l’expérience constitue la norme de vérité. Mais il est primordial de réaliser la valeur de nos expériences et aussi la place de nos sentiments et de nos émotions dans la recherche de la vérité sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu » (Rapport du Maître de l’Ordre au Chapitre général de Oakland, p. 112 du texte latin).
La formation permanente représente une démarche de tous les jours qui nous permet d’approfondir notre connaissance de nous-mêmes, des autres et de Dieu. Sommes-nous convaincus de la valeur d’une formation de tous les jours ? Les Chapitres généraux et provinciaux nous le rappellent souvent, et avec insistance. Pouvons-nous affirmer que les résultats correspondent à leurs préoccupations ?
La valeur de la formation institutionnelle
Lors de mes visites à l’Ordre, c’est de la formation institutionnelle ou initiale que j’ai le plus souvent traité. On oppose parfois les programmes actuels de formation à ceux d’autrefois. De façon positive ou négative. Mais, en réalité, il n’existe aucun modèle parfait pour chaque époque.
D’abord nous devons désirer des vocations et les accueillir. Nos maisons doivent être prêtes à recevoir des jeunes qui nous considèrent comme des hommes de foi, au service les uns des autres au long de notre pèlerinage, également au service de tous les humains. Ces jeunes doivent aussi constater que nous sommes des hommes d’espoir dans le futur de l’Ordre et dans son rôle à l’intérieur de l’Eglise. Nous répondrons à leurs aspirations seulement si nous respectons les orientations des récents Chapitres généraux. Les religieux que nous sommes doivent être perçus comme des gens qui croient au pouvoir de la grâce sur nos défauts humains et à la présence de l’Esprit dans notre vie de tous les jours.
En second lieu, il nous faut absolument assurer les conditions nécessaires à la formation institutionnelle. La tâche de la formation doit être considérée comme prioritaire et non comme découlant d’une autre responsabilité de la communauté. Les besoins des religieux en formation doivent prédominer sur ceux de la communauté dans la prière et le travail. De plus, les jeunes ont besoin d’accompagnateurs dans leurs expériences. On ne pourra jamais trop insister sur ce point lorsque nos Provinces vivent de profonds conflits de génération. Par ailleurs, il n’est pas bon de traiter les jeunes en formation comme des poissons en aquarium qu’on examine sous tous les angles. En fait, on doit encourager la création de maisons communes de formation dans un pays ou une région où les vocations se font rares. De même, « les structures de la communauté de formation, tout en étant suffisamment claires et fermes, laisseront une large place aux initiatives et aux décisions responsables » (Directives sur la formation dans les Instituts religieux, no. 15).
Enfin, nous devons respecter le cheminement des jeunes et ne pas exiger d’eux le degré de développement ou de conviction 0ù nous sommes nous-mêmes rendus. « La raison essentielle en est de ne pas multiplier les problèmes au cours d’une étape de formation où les équilibres fondamentaux de la personne doivent se mettre en place » (Directives, no. 47). Face à l’apostolat, aux pauvres, aux signes extérieurs, comme l’habit, par exemple, il nous arrive d’exiger des jeunes la même attitude que nous avons nous-mêmes après plusieurs années de vie religieuse. On doit traiter ces jeunes en toute liberté et discernement pour leur permettre de fleurir et de choisir. On doit aussi les écouter. Dans son encyclique Centesimus annus (ler mai 1991), le Pape Jean-Paul II fait remarquer:
« Le patrimoine des valeurs transmises et acquises est toujours soumis à la contestation par les jeunes. Contester, il est vrai, ne signifie pas nécessairement détruire ou refuser a priori, mais cela veut dire surtout, mettre à l’épreuve dans sa propre vie et, par une telle vérification essentielle, rendre ces valeurs plus vivantes, plus actuelles et plus personnelles, en distinguant dans la tradition ce qui est valable de ce qui est faux ou erroné, ou des formes vieillies qui peuvent être remplacées par d’autres plus appropriées à l’époque présente » (no. 50).
Notre rôle consiste à accompagner les jeûnes et à les soutenir dans leur volonté d’être des disciples de Jésus Christ et de saint Dominique. Il n’est pas indiqué de les dominer, non plus que d’essayer d’en faire nos disciples.
Nos Constitutions déterminent clairement que le Prieur provincial demeure l’autorité ultime dans l’admission des candidats à l’Ordre, dans leur acceptation à la profession ainsi que dans leur présentation aux Ordres sacrés. Dans cette tâche le Provincial est assisté par le comité d’examen des candidats, par les différents conseils de formation. Les pouvoirs confiés au comité d’examen, aux conseils et aux chapitres locaux, en ce qui concerne le refus de certains candidats, doivent s’exercer, rappelons-le, d’une façon très responsable. D’où, en particulier, il faut évaluer attentivement ce qui est le meilleur pour le candidat et pour l’Ordre; et aussi porter un jugement réaliste et non arbitraire.
Le personnage-clé de la formation est celui que nous appelons maître. L’Ordre reste infiniment reconnaissant à ceux qui acceptent de jouer ce rôle précieux et difficile. Leur tache se complique lorsque l’on ne comprend pas les exigences actuelles de l’Église et de l’Ordre face à la formation. A ce sujet une maîtresse des novices m’écrit:
« J’ai connu bien des jours pénibles, accompagnés de sublimes aperçus sur le suave travail de Dieu dans les âmes. J’ai beaucoup appris, spécialement à apprécier davantage le caractère unique de chaque personne ».
Puissions-nous apprécier le poids de la tache confiée à nos formateurs en même temps que le caractère unique de chacune des créatures de Dieu. Peut-être serions-nous alors moins négatifs les uns envers les autres.
Enfin, nous devons penser à l’influence de notre vie religieuse sur les jeunes. Par exemple, peuvent-ils voir une différence entre religieux et prêtres diocésains ? Vont-ils percevoir qu’un prêtre religieux se considère comme engagé d’abord dans sa profession religieuse et les exigences de la vie communautaire ?
Les exigences de la formation religieuse
J’aimerais vous soumettre quelques réflexions sur les quatre étapes de la formation: la période du pré-noviciat, le noviciat et la première profession religieuse, les années de studentat, enfin la formation permanente.
1. Le pré-noviciat
Plusieurs Provinces ont organisé cette étape de la formation. En 1990, les Directives affirmaient explicitement qu’il s’agissait là de la première étape de la formation et reprenaient ce qu’affirmait Renovationis causam:
» La plupart de difficultés rencontrées de nos jours dans la formation des novices proviennent du fait que ceux-ci ne possèdent pas, au moment de leur admission au noviciat, la maturité nécessaire » (nQ 42).
Les Directives continuent à rappeler les exigences de l’Eglise pour:
– un degré suffisant de maturité humaine et chrétienne;
– une base de culture générale qui corresponde au niveau « d’un jeune qui a achevé une scolarité normale dans le pays ». On y ajoute la nécessité de comprendre facilement « le langage en usage au cours du noviciat »;
– une affectivité équilibrée, spécialement sur le plan sexuel;
– la capacité de vivre en communauté sous l’autorité de supérieurs dans un institut donné.
Ce programme peut-il se réaliser en trois mois, en six mois ?
Même les candidats les plus équilibrés doivent expérimenter la vie chrétienne en communauté. Les directeurs de la formation affirment souvent que les candidats agés ont, plus que les jeunes, le besoin de faire l’expérience d’un pré-noviciat.
Le pré-noviciat peut poursuivre un autre but non négligeable: permettre au candidat de se situer par rapport aux diverses options qui s’offrent à lui et, pour celui qui considère l’option dominicaine, de bien se renseigner sur la priorité de notre mission de prêcheurs.
Il faut choisir attentivement le lieu du pré-noviciat.
Autant que faire se peut, on doit le situer dans un lieu qui aidera le directeur à orienter le candidat vers la vie religieuse. Conséquemment, le pré-noviciat ne devrait pas être, autant que possible, dans une maison religieuse. Il n’est pas la vie religieuse, et ce serait injuste et imprudent de contraindre les candidats à vivre une telle vie sans la formation requise et sans un engagement précis.
Dans un endroit à part, il pourra mieux comprendre la nature de la vie chrétienne du pré-noviciat; pendant que les candidats s’entraîneront à une nécessaire autonomie face à leurs deux familles: la naturelle et la religieuse.
S’il était permis d’appliquer à cette période du pré-noviciat les quatre caractères de la vie religieuse – humain, religieux, intellectuel, pastoral – j’insisterais ici sur les aspects humain et chrétien plus que sur l’aspect religieux. Également sur la nécessité d’atteindre le niveau culturel des jeunes du troisième palier de l’éducation, plus l’ouverture é l’ apostolat de l’Ordre . Enfin sur l’aide à apporter aux candidats dans une meilleure connaissance d’eux-mêmes, de leurs forces et de leurs faiblesses.
2. Le noviciat
Sous bien des aspects, voici la plus importante année de formation, celle où le candidat décide de sa vocation, autant qu’il est possible.
Les Directives du Saint-Siège sont claires sur la nature de cette année. C’est un temps de retraite, et non d’insertion, qui doit être vécu comme une expérience de solitude. Plusieurs jeunes sont intéressés à l’Ordre par le désir de prêcher l’Évangile et par l’amour de l’étude. Mais, à moins d’être enraciné dans une pratique soutenue de la prière, communautaire et personnelle, un tel idéal peut bien ne pas suffire à vaincre les difficultés de la vie religieuse. Nous devons développer cette passion de Dieu qui nous empêche de devenir de purs rhéteurs.
« Les novices ont en effet besoin de s’exercer à la pratique de l’oraison prolongée, de la solitude et du silence. Pour tout cela le facteur temps est un facteur déterminant. Ils peuvent éprouver un plus grand besoin de « revenir » du monde que « d’aller » au monde, et ce besoin n’est pas uniquement subjectif. C’est pourquoi le temps et le lieu du noviciat seront organisés de telle sorte que les novices puissent y trouver un climat propice à un enracinement en profondeur dans la vie avec le Christ. Ce qui ne s’obtient qu’à partir du détachement de soi, de tout ce qui dans le monde résiste à Dieu, et même de ces valeurs du monde « qui méritent indiscutablement l’estime ». En conséquence, il est tout à fait déconseillé d’accomplir le temps du noviciat en communautés insérées. Comme il est dit au no. 28, les exigences de la formation doivent prévaloir sur certains avantages apostoliques de l’insertion en milieu pauvre » ( Directives, no. 50).
Nous devons maintenant réfléchir sur un phénomène particulier, celui des religieux qui ont vécu un noviciat selon les Directives en question et qui ont quitté la vie religieuse peu après leur profession. Il est des frères qui croient en un excès de mystique dans la conception spirituelle du noviciat. On en arriverait à « porter » trop facilement le candidat au long de l’année et à le couper en quelque sorte de ses responsabilités, envers lui-même, envers la communauté, envers l’avenir. Ils suggèrent la nécessité d’une plus grande insertion dans le monde et ses problèmes, ainsi que la prise en charge par chacun, de ses responsabilités.
Personnellement, j’estime que c’est là la tâche du pré-noviciat, et non du noviciat. A moins de clarifier de façon définitive les différents rôles du noviciat et du pré-noviciat, la discussion va se poursuivre sans qu’on arrive jamais à une conclusion. Les frères en formation vont souffrir à court terme, et l’ordre va souffrir à long terme.
Nous devons rechercher l’unité dans notre conception de la formation, autant pour le bien des jeunes en formation que pour l’avenir de l’ordre.
La plupart des autres points mentionnés dans les Directives sont respectés dans nos noviciats. Mais on n’a pas suffisamment clarifié le rôle du noviciat dans l’aide à apporter au candidat pour vérifier sa capacité à vivre seul avec Dieu, unique source de notre espoir d’atteindre à l’intégrité et à la complétude. C’est pourquoi je pense qu’on doit insister pour présenter le noviciat comme une certaine expérience du désert. D’où l’élément religieux de la formation deviendra primordial. On ne négligera pas l’engagement dans l’apostolat, mais sans jamais lui laisser prendre le dessus.
Un autre point des Directives doit retenir notre attention (no. 47). Il s’agit de la « célébration de la liturgie selon l’esprit et le caractère de l’Institut ». J’ai visité des noviciats où l’office n’est pas récité en entier parce que la communauté ne peut le faire ou bien parce que ce n’est pas l’usage de la Province.
J’estime qu’un novice doit partager l’héritage de l’Eglise et de l’ordre dans l’office intégral et les dévotions telles que le rosaire. Ces prières sont centrées sur la personne du Christ et sur l’Ecriture.
3. Les années d’étude – Le studentat
L’élément intellectuel de la formation recevra un traitement privilégié durant les années que le candidat passera au studium. Etant donné que ma lettre à l’Ordre du mois de mai 1991 traite des études, il suffira ici de souligner quelques points particuliers.
1. Autant que possible, on doit poursuivre les études institutionnelles dans son propre milieu culturel.
2. Ce qui signifie parfois qu’on étudiera dans une institution non dominicaine. Auquel cas il est indiqué que des religieux plus expérimentés accompagnent les étudiants.
3. Par ailleurs, il faut envisager la possibilité de réunir certaines entités, au moins pour une partie des études.
4. Il faut insister sur le rôle de la communauté comme une active Sancta praedicatio, afin que les étudiants puissent saisir le lien réel qui doit exister entre étude et prédication. Ils doivent aussi comprendre le besoin, dans l’Eglise, de prédicateurs spécialisés, qui prêchent avec une autorité particulière et qui, dans un certain sens, jouent le même rôle que l’évêque pour déterminer la foi dans l’Eglise.
Le processus de maturité de l’étudiant s’accentuera dans la participation à l’Eucharistie avec prédication quotidienne et à travers les autres éléments de la formation.
On doit attirer l’attention sur l’engagement dans la fraternité et le célibat. Le religieux renonce à toute relation exclusive entre deux personnes et assure les exigences de la continence totale et du célibat. (cf. Canon 599).
Dans ma lettre sur la vie commune, je présentais des réflexions sur l’obéissance, la chasteté et la pauvreté, telles qu’elles se présentent de nos jours. Je me contenterai donc ici d’un mot sur le célibat. Il y a plusieurs années, un certain fr. Sellmair rappelait par écrit aux directeurs des étudiants l’obligation qu’ils ont de former leurs sujets à la vie de célibat:
« Quelle que soit l’honnêteté de ses intentions, et quelle que soit la rectitude de sa volonté, (l’étudiant) peut rencontrer, plus tard dans la vie, un être qui touche en lui des cordes jusque là muettes, met en branle des forces qu’il se sent incapable de contrôler et qui ne peuvent être maîtrisées que par les seuls moyens naturels. Celui qui est chargé de la formation du prêtre et qui ne signale pas ces dangers à ses candidats, encourt de graves responsabilités, â moins qu’il ne soit bien ignorant de la nature humaine ».
Une bonne sauvegarde du célibat repose sur la vie de communauté, où se nourrit la vie de prière, où l’amitié et la camaraderie permettent au frère d’apprendre que les difficultés font partie de la vie et qu’on ne doit pas se laisser abattre par elles. Si un frère ne peut trouver cette amitié à l’intérieur de la communauté, il la cherchera au dehors. Et, s’il la trouve au dehors, il s’isolera encore davantage de *la communauté et pourra ainsi se retrouver, dans la « spirale » de la solitude.
Les premières assignations et les frères figés
Il existe encore deux étapes dans notre vie sur lesquelles il faut réfléchir. Il s’agit des premières années de ministère et, plus tard, du moment « où le frère âgé ne peut plus prêcher » (RGF, nQ9). Autant les jeunes que les vieux doivent se trouver à l’aise dans nos communautés et se sentir encore utiles. Dans ma lettre de mai 1990, j’ai déjà traité des problèmes que les jeunes religieux affrontent lors de leurs premières assignations. De plus, j’ai l’intention de préparer, pour le prochain Chapitre général, une étude sur le soin de nos frères âgés.
4. La formation permanente
« Si l’on ne suit pas la marche du temps, on est en retard; et une personne en retard devient dépassée dans son travail, ce qui entraîne un inévitable mécontentement. »
Ces mots du Pape Jean-Paul II ne nous suggèrent-ils pas deux raisons en faveur de la formation permanente ? Le besoin de pouvoir remplir notre rôle dans l’Eglise, faute de quoi nous courons, non seulement vers l’incompétence, mais aussi vers la
tristesse et le mécontentement ?
Il en est peu parmi nous qui se rappellent encore tout ce qui nous restait à apprendre lors de nos premières assignations. Par ailleurs, plusieurs d’entre nous ont eu peur de se renouveler intellectuellement, spirituellement et psychologiquement. La vie communautaire constitue l’endroit où se continue la formation à la sortie du studentat. « La Parole de Dieu qui habite en nous, les études que nous poursuivons, les hommes et les femmes que nous rencontrons, les diverses mentalités qui nous interrogent, les lieux et les événements où nous sommes plongés nous invitent à poursuivre notre formation permanente » (RFG, no. 12). Plusieurs commentaires, que nous recevons de la Ratio Formationis Generalis, soulignent le besoin de normes précises à ce sujet. (cf. Oakland, p. 113 du texte latin).
« Tout au long de leur vie, les religieux doivent poursuivre soigneusement leur formation spirituelle, doctrinale et pratique. D’un autre côté, les supérieurs doivent leur assurer et les ressources et le temps nécessaire » (CIC; 661).
« Tous les Instituts religieux ont donc le devoir de programmer et de réaliser un plan approprié de formation permanente pour tous leurs membres. Un programme qui ne vise pas seulement à la formation de l’intelligence, mais à celle de la personne toute entière, en premier lieu dans sa dimension spirituelle, afin que tous les religieux et toutes les religieuses puissent vivre leur propre consécration à Dieu, dans la mission spécifique qui leur a été confiée par l’Eglise » Jean-Paul II aux religieux du Brésil, 1986, no. 6 « .
Il se peut que des normes précises soient ici moins nécessaires qu’une nouvelle approche. Bien sûr, les théologiens et les autres penseurs doivent éclairer la question. Mais plus importante encore est probablement notre propre contribution en la matière, celle de la discussion entre nous de nos expériences et de nos difficultés ainsi que ciel le de la volonté de partager notre foi les uns avec les autres.
Lorsque l’occasion s’en présente, nous devons nous regrouper – frères, soeurs et lacs – dans la même ville ou la même région, afin d’apprendre la véritable ouverture aux autres, les besoins des autres, leurs aspirations et leurs craintes.
Dans un document publié par le Comité des évêques américains, de la vie et du ministère du prêtre, voici ce qu’on déclare à propos de la morale des prêtres:
« En dépit de l’enseignement précis de l’ Eglise, il faut bien reconnaître que l’accablement de certains prêtres provient de l’absence de discussion sur les solutions à la crise du sacerdoce. Egalement du manque à explorer toutes les solutions et les options possibles. Leur tristesse procède donc de l’intense conviction, chez les prêtres, que certaines avenues possibles d’amélioration n’ont pas été considérées ni discutées. On cite souvent, par exemple, la possibilité d’ordonner des hommes mariés, de recourir de façon effective à des prêtres laïcisés, ainsi que de confier aux femmes des tâches accrues dans le ministère. »
On ne doit pas avoir peur d’aborder de telles questions. Si l’on ne pouvait en discutez entre nous, ce serait là signe de crainte plus que d’obéissance, puisque la véritable obéissance suppose l’écoute.
Des rencontres sur de: tels sujets devraient aussi nous amener à un renouvellement de la prédication et, dans le cas des prêtres, à un meilleur exercice du sacrement de pénitence. Dans une lettre à ses frères dominicains réunis en chapitre à Toulouse en 1303, le Pape Benoît XI insistait sur la pratique de l’étude, de la prédication et de l’écoute des confessions. Des centaines d’années plus tard, cette recommandation est toujours pertinente. Ensemble nous pouvons nous aider les uns les autres à être de meilleurs prêcheurs, de meilleurs confesseurs et de meilleurs étudiants.
La formation permanente ne doit pas être perçue uniquement comme l’acquisition d’un nouveau savoir, ou d’une compétence additionnelle dans l’exercice d’un apostolat personnel, mais comme la chance de participer d’une nouvelle manière à l’apostolat de la Province celui qui a terminé ses études institutionnelles depuis plusieurs années peut trouver pénible de retrouver l’habitude de l’étude. Aussi en voit-on souvent qui se découragent. Cependant le défi de la lutte avec de nouvelles idées sera plus facilement assumé si on le considère comme une plus sérieuse participation aux projets de l’Ordre. Nous devons faire confiance aux dons de tout un chacun. Et les supérieurs peuvent découvrir que certains frères ont à donner plus qu’eux-mêmes l’avaient imaginé.
Je renouvelle mon insistance sur l’année sabbatique. Sans hésitation je puis affirmer que les Provinces ou les Vicariats qui ont encouragé les frères à suivre des programmes dans ce sens, sont les plus vivants de l’Ordre. Dans cette ligne, les aspirations des frères sont différentes. Certains éprouvent des besoins plus spirituels que purement intellectuels. Beaucoup parmi nous redoutent les exigences du renouveau ainsi que leur capacité d’affronter une année sabbatique. Ayez confiance en vous-mêmes; vous ne voyagez pas seuls.
Lettre aux moniales de l'Ordre (1993)
fr. Damian Byrne, O.P.
 Dans ma Relatio au Chapitre général de Mexico, je parle de l’unité de la Famille dominicaine partout dans le monde. Cette unité repose sur une admiration et un amour commun de saint Dominique et de nos traditions. Elle s’est affirmée davantage depuis que le Concile Vatican II a exhorté les religieux au retour continu à leurs origines.
Dans ma Relatio au Chapitre général de Mexico, je parle de l’unité de la Famille dominicaine partout dans le monde. Cette unité repose sur une admiration et un amour commun de saint Dominique et de nos traditions. Elle s’est affirmée davantage depuis que le Concile Vatican II a exhorté les religieux au retour continu à leurs origines.
Dans le cas des moniales, cette unité se manifeste par l’appréciation et l’acceptation vraiment remarquables de vos nouvelles Constitutions. Les réponses au questionnaire de la Commission des moniales en témoignent explicitement. Cette unité est aussi fortement soulignée par la place que vos Constitutions réservent au Maître de l’Ordre.
Conséquemment, il me semble normal que je vous dédie, comme un de mes derniers actes en tant que Maître de l’Ordre, cette lettre depuis longtemps promise.
Trois raisons principales la justifient. D’abord, je désire exprimer la reconnaissance de l’Ordre envers nos moniales pour leur fidélité au projet de saint Dominique. Vous êtes vraiment au coeur de notre Famille de prêcheurs. De plus, il faut souligner le besoin général d’une formation adéquate à tous les échelons et d’une forme de participation de plus en plus responsable à la vie communautaire en accord avec notre tradition. Enfin, je voudrais répondre, si possible, à tant de questions et d’interrogations qui parviennent souvent ici, à la Curie généralice, concernant l’interprétation des Constitutions et des Directoires.
Durant la préparation du Chapitre d’Oakland (1989), le Conseil généralice a pensé que la meilleure façon de répondre à ces demandes ou autres semblables, serait de former une commission de moniales au Chapitre. La commission, qui comprenait quatre moniales, décida avec raison d’éviter ces questions, mais de souligner plutôt la place des moniales à l’intérieur de la Famille dominicaine et de proposer la nomination d’un promoteur et d’une commission selon certaines indications précises.
Le promoteur et la commission ont été désignés. Je comprends que quelques monastères auraient souhaité plus ample consultation avant la désignation des personnes en cause. Malheureusement, le temps ne l’a pas permis. D’abord, le P. Viktor Hofstetter ne pouvait être nommé promoteur avant la fin de son provincialat. Et ensuite la commission devait être établie le plus rapidement possible pour lui permettre de commencer ses travaux. Depuis, la commission, avec le promoteur, s’est réunie deux fois. Vous en avez reçu les rapports. De plus, à sa dernière réunion, tenue à Sainte-Sabine du 2 au 6 mars dernier (1992), elle a formulé une proposition visant à former une commission représentative en tenant compte des cultures, des langues et des mentalités.
Unité et renouveau
La rédaction et l’acceptation entière de vos nouvelles Constitutions marque une étape importante dans l’histoire de l’Ordre. Vos réponses à la consultation de la commission constituent un signe impressionnant de votre unité avec l’Ordre et entre vous. Cette unité garantit fortement un renouveau nécessaire. Ce qui nous réunit tout spécialement, c’est l’orientation communautaire et notre tradition de collégialité. Ce sont là des valeurs à protéger et à développer si nous voulons demeurer d’authentiques dominicains. Cette organisation collégiale et communautaire ainsi que le consensus à rechercher doivent constituer la base, non seulement de notre gouvernement, mais aussi de notre approche des problèmes concrets comme la formation, la solitude et l’indépendance, la clôture, etc.
Dans sa récente encyclique sur les questions sociales, le Pape Jean-Paul II affirme que la continuité et le renouveau font la preuve de la traditionnelle valeur de l’enseignement de l’Église. Le véritable renouveau ne peut exister sans la fidélité à la tradition. À propos de renouveau de l’Ordre, le Père Aniceto Ferndndez écrivait, dans une lettre qu’il vous adressait du Chapitre général de River Forest (1968):
« Le renouveau de toute l’Église suppose spécialement le renouveau des Ordres religieux, et en particulier des contemplatifs. Le décret Perfectae Caritatis de Vatican II l’affirmait clairement. Bien que notre programme de renouveau ne soit évidemment pas identique au vôtre en tout point, nous en partageons beaucoup d’éléments communs ».
Vie dominicaine contemplative
La vocation à la vie contemplative en est une bien particulière qui « tient une place de choix dans la mission de l’Église, si urgente que soit la nécessité d’un apostolat actif’ (Mut. Rel. 23; Per. Car. 7). Par ailleurs, s’adressant aux moniales à Guadalajara, le 30 janvier 1979, le Pape Jean-Paul II déclarait :
« Être contemplatif ne signifie passe désintéresser complètement du monde et de l’apostolat. La religieuse contemplative doit trouver sa manière propre de travailler à l’extension du Règne de Dieu, de collaborer à la construction de la cité terrestre, non seulement à l’aide de ses prières et de ses sacrifices, mais aussi par son témoignage silencieux, de façon telle que les personnes de bonne volonté avec qui elle est en contact puissent recevoir ce témoignage. C’est pourquoi vous devez trouver votre propre style de vie qui, à l intérieur dune perspective contemplative vous aidera à partager avec vos frères et soeurs le don gratuit de Dieu ».
Chaque Ordre contemplatif possède son identité propre ainsi que ses propres moyens de conduire ses membres à Dieu. L’identité dominicaine, tout comme les moyens dominicains, est profondément reliée à la lecture, à la méditation et à la prédication de la Parole de Dieu. Ce qui requiert de chaque Dominicain de se consacrer sérieusement à la lecture qui le conduise à Dieu, tout en constituant notre principale ascèse. Et puis, cette relation avec Dieu dans la prière et l’étude conduit à la proclamation du Verbe. Dans votre cas, vos Constitutions rappellent le projet de Dominique pour vous :
» Attentives à l’exemple des premières soeurs que saint Dominique établit au monastère de Prouilhe, au coeur de la « Sainte Prédication », les moniales, habitant ensemble animées d’un même esprit, suivent Jésus se retirant au désert pour prier. Elles offrent ainsi un signe de la Jérusalem céleste, cette Cité bienheureuse que les frères construisent par leur prédication. Le cloître, est en effet le lieu où les soeurs se dédient totalement à Dieu (..) perpétuant cette grâce singulière de notre bienheureux Père à l’égard des pécheurs, des opprimés et des affligés, qu’il portait dans le sanctuaire intime de sa compassion » (LCM 35, 1).
Il est certain que la vie contemplative dominicaine apparaît, sous cet angle, intimement liée à la mission de l’Ordre tout entier.
« Souligner la conscience de la vocation originale et de la tâche spéciale des moniales dans l’Ordre » (LCM 181), signifie qu’il faut approfondir notre perception du lien profond qui unit contemplation et mission de l’Ordre, comme l’ont rappelé les derniers Chapitres généraux. Lorsque cette conscience fait défaut, on « rétrécit la vision de Dominique et, conséquemment, on réduit de beaucoup l’importance et la contribution de l’Ordre dans le monde et l’Église » (Oakland 147, 2). Sur ce sujet, l’une d’entre vous écrivait récemment:
» Notre caractère proprement dominicain consiste dans notre relation à la mission de l’Ordre, prêcher l’Évangile de la miséricorde, mais il s’exprime par la qualité de la communion entre nous, la communion au Christ inspirée par l’Esprit. La place des moniales dans la mission de la prédication se situe exactement dans ce témoignage fondamental de la prédication: la communauté. Notre témoignage jaillit d’abord de notre vie communautaire. C’est dans la communauté que naît et vit le Verbe « .
Le Verbe de Dieu
Notre spiritualité repose sur le Verbe de Dieu, sur l’écoute du Verbe, la contemplation du Verbe et la prédication du Verbe. Ces trois fonctions sont intimement liées, ce qui fait que les Prêcheurs du Verbe les plus efficaces peuvent bien être les moniales. Les Actes du Chapitre de Oakland rappelaient aux frères:
« Nous n’avons pas toujours été assez sensibles à l’aspect contemplatif de la vie dominicaine, si manifestement illustré par la vie des moniales, et l’efficacité de notre prédication en a subi les conséquences » (147, 4).
Pour écouter le Verbe de Dieu, nous devons nous faire pauvres et humbles de bien des façons. Inspirons nous de chacun des troisièmes mystères du Rosaire: la naissance du Christ, son couronnement d’épines, la venue de l’Esprit Saint.
Pour écouter le Verbe de Dieu, il faut d’abord être vraiment pauvre. Dans le troisième mystère joyeux, nous apprenons que les témoins de la naissance de Jésus sont de pauvres bergers. Leurs coeurs étaient prêts et capables de recevoir le message.
Le 5 juillet 1986, le Pape Jean-Paul II parlait aux prêtres de Colombie du service des pauvres selon l’Évangile. Il disait:
» Vous ne pouvez aller vers les pauvres sans avoir le coeur de la pauvre personne qui sait écouter et recevoir le Verbe de Dieu tel qu’Il est. Il nous faut des apôtres qui suivent et imitent le, Christ dans sa vie de pauvreté « .
Le Saint Père poursuivait en affirmant que cette pauvreté comporte le renoncement à nos ambitions personnelles. C’est ce que nous enseigne le troisième mystère douloureux. Le Christ apparaît dépouillé de tout bien matériel y compris l’honneur. Nous devons apprendre à pouvoir renoncer à tout si nous voulons écouter le Verbe. Pensons aux personnes, aux places d’honneur, aux coutumes surannées, aux pratiques ostentatoires, au pouvoir…
Le troisième mystère glorieux nous rappelle que notre écoute est soutenue de différentes façons: par l’Église, par l’Ordre et par nos soeurs en communauté. Il nous enseigne aussi que l’Esprit habite en chacun de nous et que nous devons reconnaître la valeur de nos propres intuitions tout en acceptant qu’elles puissent être éprouvées. « N’ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils sont de Dieu. » (Un 4,1).
Quels défis particuliers voudrais-je que l’Ordre vous lance aujourd’hui, à l’écoute du Verbe ? En tout premier lieu je dirais qu’on doit lutter contre toute forme d’isolationnisme entre les monastères dominicains. Dans un article sur la vie dominicaine, le P. Thomas Raush, S.J., écrivait :
» Fondés comme une communauté apostolique, les Dominicains allient les éléments du passé monastique et canonial avec le mouvement évangélique de la fin du XII,’ siècle. La mission de la communauté détermine son style de vie et sa spiritualité. Mais le processus d’institutionnalisation que la communauté a vécu dans les nombreuses générations qui ont suivi celle de Dominique leur a conféré un caractère monastique de plus en plus accentué « .
C’est certainement vrai des frères et des soeurs. Mais c’est seulement dans les nouvelles Constitutions des frères qu’on a cessé de parler des observances monastiques on y parle plutôt d’observances régulières. La situation des moniales n’est pas tout à fait la même. Mais, même si vous appelez vos maisons « monastères », les supérieures sont des prieures et non des abbesses. Je ne désire; en rien changer de vocabulaire; je ne fais que signaler les différences. Elles signifient dans les mots votre notion de gouvernement interne et votre volonté de ne pas vous tenir à distance – à la manière d’un grand monastère ou d’une abbaye – des autres prieures et des autres monastères, selon notre tradition.
Déjà le Pape Pie XII déclarait :
« Bien qu’en règle générale on ne puisse imposer les Fédérations de monastères, on ne peut que les recommander instamment, non seulement pour abolir le dommage et les inconvénients que peut produire l’isolement total, niais aussi pour stimuler l’observance régulière et la vie contemplative » (Sponsa Christi, art. VI, no. 2-I).
Vous avez des Constitutions communes, vous avez aussi plusieurs Fédérations. Mais il reste encore parmi vous beaucoup d’isolationnisme. Passer d’une indépendance outrancière ou parfois d’un total isolement vers une situation d’interdépendance: voilà un de vos premiers défis.
Valeurs et structures
Il y a plusieurs années, à la suite de ma première visite canonique d’un monastère, j’avais l’impression qu’il y avait besoin de changement. Comme je n’étais pas très sûr de moi-même, je soumis à un autre vicaire de moniales, beaucoup plus expérimenté que moi, la liste des changements que j’entrevoyais. À chacun il me disait: » Oui, cela devrait aider les moniales à mieux prier « .
Depuis je n’ai cessé d’apprécier la sagesse de cette remarque. Il est probable qu’elle m’a servi, longtemps après, lorsque j’ai rédigé ma lettre sur la vie commune. Elle m’a permis d’exprimer une conviction: bien que nécessaires, les structures ne sont pas ce qu’il y a de plus important. Les valeurs sont beaucoup plus importantes, car elles demeurent dans la mesure où elles prennent racine dans l’Évangile.
Dans cette lettre, je soulignais six valeurs essentielles de la vie dominicaine: la prière, le partage de la foi, la correction fraternelle, les voeux, la prise de décision et la tâche de bâtir la communauté. Certainement nous avons besoin de réexaminer nos vies de temps en temps et de nous demander si nous vivons les valeurs que l’Évangile et nos Constitutions mettent de l’avant dans notre vie. Nous devons insister sur la vie commune et sur la vie contemplative, mais les structures de cette vie peuvent changer. Elles ne constituent pas une fin en soi. Vos Constitutions sont claires sur ce point :
» L’observance régulière, que saint Dominique a prise dans la tradition ou qu’il a lui-même instaurée, ordonne la manière de vivre des moniales en vue de favoriser leur propos de suivre plus étroitement le Christ et de permettre un meilleur accomplissement leur vie de contemplatives dans l’Ordre des Prêcheurs « .
Et plus loin :
» Relèvent de l’observance régulière tous les éléments qui constituent la vie dominicaine et l’organisent par la discipline commune. Parmi ceux-ci, dominent la vie commune, la célébration de la liturgie et la prière privée, l’accomplissement des voeux, l étude assidue de la vérité, dont la réalisation fidèle nous est facilitée par la clôture, le silence, l’habit religieux, le travail et les oeuvres de pénitence » (LCM :35, 1.2).
II existe un ordre bien précis de ces valeurs. L’observance régulière soutient les moniales dans leur détermination de suivre le Christ plus attentivement et leur pennes de vivre plus ef,ficacement leur vie contemplative dans l’Ordre des Prêcheurs. C’est le premier et le plus important niveau de la vie, la suite du Christ dans la vie contemplative de l’Ordre des Prêcheurs. L’observance régulière n’est pas un but en soi; elle aide les moniales et favorise plus sûrement la vie contemplative. Mais on trouve aussi un ordre parmi les éléments de l’observance régulière. Il en est qui sont plus importants, comme la vie commune, la célébration de la liturgie et la prière privée, l’observance des voeux et l’étude de la vérité sacrée, parce qu’ils constituent notre vie dominicaine et les organisent dans une discipline commune. Il en est encore qui nous aident à rester fidèles aux autres, comme la clôture, le silence, l’habit, le travail et les pratiques pénitentielles. Remarquez que les Constitutions ne disent pas qu’ils sont facultatifs, mais qu’ils favorisent tous la poursuite du but, la suite du Christ dans la vie contemplative dominicaine. Je crois que plusieurs des problèmes de nos communautés proviennent du manque d’attention à cette hiérarchie de valeurs.
Évidemment, il est des structures qui peuvent changer. Les Constitutions disent précisément que saint Dominique en a adopté certaines de la tradition et qu’il en a créé d’autres. De vraies valeurs et de bonnes structures nous assurent une vie équilibrée; de vraies valeurs sans bonnes structures aboutissent à une vie déséquilibrée. D’autre part, de piètres valeurs encadrées de bonnes structures aboutissent à un ensemble plutôt faux, tandis que de piètres valeurs reposant sur de pauvres structures conduisent à la dérive. Bien sûr, il ne s’agit pas de nier la nécessité des structures, bien au contraire. Mais nous avons d’abord besoin de valeurs authentiques, des valeurs religieuses et chrétiennes, et nous avons ensuite besoin de structures pour favoriser en nous une vie réellement équilibrée sur le plan humain, chrétien et religieux.
Le gouvernement dominicain
La question première et la plus importante question à considérer est celle du gouvernement interne du monastère. Lorsque vos Constitutions traitent du gouvernement, il faut se rendre compte qu’il s’agit d’une législation concernant d’une façon très particulière d’exercer l’autorité par la prieure, le chapitre et le conseil (dans cet ordre). Chaque palier d’autorité doit jouer son rôle propre. Et si, à l’intérieur de la communauté, l’une ou l’autre « autorité » ne le joue pas convenablement, à la fin ce sera la communauté elle-même qui ne jouera plus le sien.
À propos d’obéissance, voici ce que j’écrivais à la Fédération mexicaine à la suite de ma récente visite :
» Obéir signifie écouter. Selon la tradition dominicaine vous devez écouter, dans vos monastères, la prieure., le conseil et le chapitre. Chacune de ces instances possède son autorité qui doit respecter les autres autorités légitimes. Aucune d’entre elles ne doit prédominer. Voyez le bel exemple que saint Dominique nous a laissé en héritage: il soumettait son autorité aux frères. On ne doit pas exagérer, ni minimiser le rôle de la prieure, du conseil ou du chapitre; mais on doit se fier aux Constitutions, qui déterminent la compétence de chacun. La véritable obéissance dominicaine ne se trouve que dans la connaissance, le respect et l’observance de ces réalités. Ce qui suppose la discussion, vraie et ouverte, en chapitre, l’acceptation par le conseil de son rôle dans les questions juridiques, et enfin le « leadership » de la prieure dans l’observance des Constitutions et l’appréciation du consensus général de la communauté dans les matières qui le réclament. Cest seulement de cette façon que vous réaliserez ce que disent les Constitutions: « Pour demeurer fidèle à son esprit et à sa mission, la communauté a besoin de ce principe d’unité qui lui est assuré par l’obéissance. » (no. 17, 1) ».
Conformément à LCM 201, il revient au chapitre du monastère d’étudier et de régler les principales questions de la vie de la communauté. Est-ce si difficile à réaliser ? Lorsque j’étais Provincial, j’ai eu de temps en temps des prieurs qui ne tenaient pas le chapitre, i.e. avec discussions: je ne parle pas de conférences ou de chapitre des coulpes. Habituellement c’est qu’ils se trouvaient confrontés avec le problème de deux ou trois frères qui revenaient continuellement sur les mêmes questions. Je faisais les commentaires suivants :
1) Si vous ne tenez pas le chapitre régulièrement, il est inévitable que les frères reviennent souvent sur les mêmes questions.
2) Si vous tenez le chapitre régulièrement, les frères vont épuiser leurs rengaines puisqu’on aura déjè discuté peu avant de leurs questions.
3) Cest le prieur, après consultation de la communauté qui doit déterminer l’ordre du jour. Et donc il peut toujours refuser de discuter tel ou tel point.
Les Constitutions des frères déterminent ceci:
» Avant le chapitre, les capitulaires peuvent proposer au président des affaires à traiter; et si le tiers du chapitre a proposé une affaire, le président est tenu de la soumettre à discussion. Pendant le chapitre, aucune affaire ne doit être proposée à moins que le président n’y ait consenti ou n’ y ait invité » (LCO 312 III).
Ce texte contient plusieurs sages dispositions sur le droit à la discussion où les questions doivent être préparées à l’avance, et on ne peut déroger à ce programme sans le consentement du président. Peut-être devriez-vous à l’avenir introduire une disposition semblable à votre LCM. D’ici là, elle peut vous inspirer dans la préparation de vos chapitres de communauté.
L’exercice légitime de l’autorité d’une personne en charge ne règle pas tous les problèmes. Le prieur ou la prieure doit plutôt s’appliquer constamment à rechercher un consensus à l’intérieur de la communauté. Permettez que je cite ici le P. de Couesnongle au sujet de l’obéissance dominicaine :
» La loi fondamentale de la démocratie, c’est la loi de la majorité »‘. ll n’en est pas ainsi chez nous où pourtant les votes sont nombreux. Notre loi propre est la loi de l’unanimité. Au chapitre conventuel – et il en est de même aux chapitres provinciaux ou généraux – le prieur, loin de se satisfaire d’un vote précipité, doit permettre une large information, susciter une recherche commune et provoquer le débat de telle façon que l’on tende à un avis aussi unanime que possible. Cette recherche d’unanimité – même si on n’arrive pas – garantit la présence du Seigneur et de son Esprit et, par le fait même, oriente plus souvent vers la découverte de la volonté de Dieu. De même, à Vatican II, Paul VI a fait retarder certains votes pour favoriser une plus grande entente et éviter que des décisions soient prises seulement à la majorité.
Il est inutile d’insister sur ce qu’une telle recherche exige de chacun et de la communauté tout entière. Mais c’est le lieu où se vérifie par excellence la justesse de ce que le frère prêcheur veut vivre et annoncer. Faute de quoi, l’appareil complexe et si riche de virtualités risque de tourner à vide. Et les couvents au lieu d’être des fraternités d’hommes qui vivent de la foi, l’approfondissent et la prêchent, peuvent donner l’apparence de groupes uniformes à vague coloration religieuse » (Le courage du futur, pp. 110-111).
Peut-être est-il nécessaire d’ajouter qu’on ne peut pas toujours réaliser cette unanimité, malgré nos efforts. Mais si la minorité peut se faire entendre, l’expression de la majorité sera acceptée plus facilement, et ce procédé pourra parfois produire un changement de direction dans les affaires de la communauté.
L’élément important de la discussion en chapitre c’est d’écouter, essayer de comprendre le point de vue de l’autre sans le juger. Dans Ecclesiam suam, no. 26, le Pape Paul VI suggère quatre conditions de l’échange qu’il est bon de rappeler :
1) La clarté. Le dialogue présuppose et requiert l’intelligibilité, qui est comme l’échange des idées.
2) La bienveillance. Le dialogue ne doit pas être arrogant, il ne blesse pas, n’attaque pas… Il est paisible, il refuse les procédés violents, il est patient, généreux.
3) La confiance. D’après Paul VI, deux attitudes sont nécessaires à la confiance dans le dialogue: le choix judicieux des motifs et la disposition fondamentale de bonne volonté, qui permet d’écouter l’autre.
4) La prudence. Nous ne devons jamais oublier les dispositions psychologiques de nos interlocuteurs.
Lorsque la communauté est parvenue à un consensus, elle a nécessairement l’obligation d’accepter la décision et de l’appliquer. Le chapitre est responsable de cette application des décisions prises. Il ne s’agit pas que d’exercer un droit, mais plutôt de travailler au bien de la communauté entière.
» Pour que la vie contemplative et la communion fraternelle portent des fruits féconds, la participation unanime de toutes les soeurs est de la plus haute importance: en effet,toute décision approuvée en commun sera exécutée rapidement et sans difficultés (Humbert de Romans) » (LCM 7).
Alors que le rôle du chapitre est capital dans le mode dominicain de gouvernement, le conseil et la prieure ont aussi leur rôle à jouer et qui n’est pas moins important. On doit prendre des décisions et les mettre en pratique. Le conseil donne son avis à la prieure lorsqu’elle le demande. Sur certaines questions précises il doit jouer un rôle bien déterminé (LCM 210). Quant au rôle de la prieure il est d’abord pastoral dans sa relation avec les soeurs. En second lieu, la prieure doit s’assurer que la vie se déroule en accord avec les Constitutions (LCM 195). Elle représente la suprême autorité dans la communauté, mais cette autorité doit. s’exercer dans l’esprit de saint Dominique qui, selon les dépositions à son procès de canonisation, était » joyeux, agréable, patient, compatissant et bon, véritable réconfort des frères « . Mais le même Dominique pouvait s’avérer ferme et décidé à l’occasion. On n’a qu’à rappeler qu’il reprenait les frères avec autorité. Pensons aussi à sa décision personnelle d’envoyer les frères, le 15 août 1217, dans le monde entier.
Cet équilibre constitue un idéal presque impossible et de fait, comme certains le pensent, il est devenu encore plus difficile dans une société et une Église en mutation. Il faut bien s’y résigner, nos communautés auront toujours des religieux insatisfaits et contestataires. La prieure doit compter sur sa communauté pour neutraliser ces individus et les empêcher de nuire. Permettez que je demande si la considération et la miséricorde qu’on se doit les uns aux autres ne pourraient pas encore plus être accordées aux supérieurs ?
La seconde question que je voudrais considérer se rapporte à une « faiblesse » extérieure ou structurale due à la nature même d’une communauté monastique et aussi à l’apport (ou manque d’apport) de l’Ordre.
II est clair que la tradition monastique de l’importance de l’abbé ou de l’abbesse comme père ou mère de la communauté est très différente de la conception dominicaine du prieur ou de la prieure comme primus ou prima inter pares. Vos Constitutions reflètent parfaitement la tradition dominicaine et en conséquence l’autorité doit s’exercer selon cette tradition et les Constitutions. Au cours des siècles, la seule façon de former une nouvelle communauté (et ce fut vrai également des soeurs de vie active), était de la faire comme de nouvelles et indépendantes unités. Le rôle de la supérieure dans la fondation de l’établissement d’une nouvelle communauté était primordial. Il me semble qu’on avait exagéré le rôle d’une personne dans les communautés. De fait, on a connu dans certains monastères des dynasties de prieures et de maîtresses des novices. Et voilà que maintenant les Constitutions sont très claires sur cette question:
« La prieure demeure en charge trois ans; au ternie de ces trois ans elle peut être réélue pour un nouveau triennat, mais Ras immédiatement pour un troisième dans le même monastère » (LCM 196, 1).
Comment se fait-il que cette disposition des Constitutions est si facilement ignorée ?
Ce que j’ai déjà dit du détachement des choses, des personnes et des charges s’applique très bien aux ex-prieures. C’est durant leur terme d’office qu’elles doivent préparer les soeurs à assumer des responsabilités dans la communauté; elles doivent fuir toute tentation de fonder des dynasties de soeurs de la même mentalité. Et lorsqu’elles ont terminé leur mandat, peut-être feraient-elles mieux de passer quelque temps dans un autre monastère, ce qui serait bon et pour elles et pour celles qui leur succèdent.
Pas plus que l’autorité de la prieure est absolue dans notre tradition, je crois que l’Église et l’Ordre nous invitent aujourd’hui à admettre que l’autonomie des monastères ne peut pas être absolue. Chacun doit penser que toutes les tendances existent ailleurs et chercher à aider les autres et à en recevoir aussi de l’aide. Le document conciliaire sur le renouveau de la vie religieuse, paru en 1965, insistait sur l’entraide des monastères de moniales :
» Pour ce qui concerne la rénovation adaptée des monastères de moniales, on pourra recueillir également les voeux et les avis des assemblées des Fédérations ou d’autres réunions légitimement convoquées » (Ren. Causam, no. 4).
Lorsque vos Constitutions parlent de Fédérations (LCM 235-237), on y reconnaît l’autonomie du monastère tout autant que le droit d’appartenir à une Fédération. Je crois qu’il nous reste un long chemin à parcourir avant que les Fédérations (ou les Conférences) remplissent leur rôle dans le renouveau et l’aide mutuelle, spécialement en ce qui concerne la formation et l’échange éventuel de personnel qualifié. On sait que les lois de l’hérédité répugnent à l’autosuffisance. De même, une indépendance ou un isolement exagéré est toujours malsain du point de vue de la vie religieuse.
Dans l’esprit de liberté
» La liberté à laquelle les moniales ont droit pour le sacrement de pénitence et la direction de conscience doit être très exactement assurée » (LCM 85).
C’est là un seul des passages des Constitutions qui rappellent l’esprit de liberté que saint Dominique voulait maintenir dans ses communautés. Dans cette ligne je voudrais attirer votre attention sur quelques points en particulier.
Premièrement. On ne doit pas considérer les Constitutions comme une arme pour juger ou attaquer les autres ou bien pour nous investir du rôle de gardiens. La loi vise à protéger les droits des individus et des communautés, et non à nous permettre d’écraser les autres.
» Alors un des légistes dit à Jésus: Maître, en parlant de la sorte, c’est nous aussi que tu insultes: Il répondit: ‘vous aussi, légistes, vous êtes malheureux, vous qui chargez les hommes de fardeaux accablants et qui ne touchez pas vous-mêmes d’un seul de vos doigts à ces fardeaux « . (Lc 11, 45-46).
Il existe parmi nous beaucoup de légistes de cette sorte.
Deuxièmement. Chaque soeur a le droit d’écrire régulièrement à sa famille. Et pour les novices et les postulantes, pas moins d’une fois par mois. On doit aussi favoriser une grande liberté d’échanges épistolaires d’un monastère à l’autre. Je voudrais ici attirer votre attention sur un point du droit canon :
» Personne n’a le droit d’attaquer injustement la réputation de qui que ce soit, pas plus que de violer le droit à toute personne à protéger son intimité » (C.I.C. 220).
Aussi une directive exceptionnelle mentionnée dans le LCM 43 doit-elle être appliquée seulement dans des circonstances vraiment graves.
Troisièmement. On ne peut trop insister sur la valeur de la visite canonique. Le Maître de l’Ordre a le pouvoir de décréter une visite canonique. Mais en pratique, il ne le fait pas sans consulter l’évêque du lieu. Je demande aux prieures et leurs conseils de veiller à ce que chaque couvent soit visité au moins tous les deux ans (LCM 227 III, 3). Même dans les monastères sous la juridiction immédiate de l’évêque, rien n’empêche qu’on puisse rappeler à l’évêque le besoin d’une visite canonique non plus que de suggérer des noms de visiteurs (LCM 228 II, S). Je concède que des monastères ont vécu des expériences malheureuses dans des visites faites par des Dominicains ou non Dominicains; aussi que des communautés ont parfois été déçues des visites.
Peut-être serait-il bon d’ajouter quelques remarques :
1. Le but de la visite canonique n’est pas d’intervenir dans le gouvernement interne du monastère, mais plutôt d’aider la communauté à mieux fonctionner aux trois paliers d’autorité, prieure, chapitre, conseil.
2. Je crois que la première tâche d’un visiteur canonique consiste à écouter attentivement chaque personne. II ne trouvera pas la solution des problèmes, humains ou autres; mais l’important c’est que chaque membre de la communauté puisse s’exprimer en toute confiance une fois tous les deux ans.
3. Comme il est difficile de trouver des visiteurs et comme, par ailleurs, on ne possède pas de critères précis pour les choisir, serait-il possible de demander aux provinciaux ou groupes de provinciaux, de désigner tous les deux ans un visiteur pour tous les monastères de la province ou de la région.
Lors du travail de révision du droit canon, la commission préparatoire a énoncé les principes suivants :
» Dans la législation actuellement en vigueur (Le. celle de 1917) les monastères et les moniales sont en fait soumis à une tutelle, sur bien des points, du supérieur régulier ou de l’ordinaire du lieu. Cette situation ne favorise certainement pas la maturité des moniales, pas plus qu’elle ne développe leur sens de la responsabilité. Au contraire, il n’est pas rare qu’elle provoque des interventions indues dans l’administration de leur vie interne ou de leur propre gouvernement, ce qui trouble la discipline et la vie commune des moniales.
Le nouveau code ne doit plus favoriser de telles pratiques. En effet, la commission consultative désire éviter en principe toute discrimination entre les Instituts, spécialement entre les Instituts masculins et féminins. C’est pourquoi les Instituts et les monastères autonomes (sui iuris) des moniales ont droit à leur propre mode de vie et à leur propre législation conforme à leur droit particulier » (Communicationes vol. VI, no. I, 1974, p. 90).
Conformément à ce principe, l’actuelle législation de l’Église sur les monastères de moniales ne confère pas à l’ordinaire du lieu ou au supérieur régulier le droit de légiférer ou de gouverner. Ce sont les Constitutions du monastère qui déterminent les relations entre l’ordinaire du lieu ou le supérieur régulier en ce qui concerne la vie interne et le gouvernement du monastère.
Je sais que seuls quelques-uns de nos monastères ont encore des soeurs externes. Dans l’esprit du renouveau actuel, on doit reconnaître leur contribution à la vie dominicaine contemplative. Les Constitutions et aussi les Directoires particuliers fournissent les façons de le faire. Les soeurs externes ont le droit de participer à la vie de la communauté, et non uniquement pour les élections.
La formation
La formation représente un nouveau défi. Je rappelle fréquemment aux frères deux questions que posait le P. de Couesnongle:
a) Pourquoi désirez-vous des recrues ?
b) Comment allez-vous les former ?
La réponse qui vient spontanément à la première question: c’est parce que nous désirons des gens pour nous remplacer. Mais si nous devions nous recruter uniquement pour maintenir nos effectifs ou pour nous empêcher de fermer des monastères, tout en négligeant la formation, ce serait une erreur, si ce n’est une grave négligence. S’adressant aux Evêques du Japon, le Pape leur demandait comment ils allaient exploiter les talents de ceux qui se donnent au service de l’Église. Un diocèse a tellement de besoins et tellement de postes à remplir! Malgré tout, le Pape demande aux Évêques de s’occuper encore plus attentivement de l’utilisation des talents des jeunes à qui Dieu donne une vocation sacerdotale. En conséquence, nous ne pouvons pas oublier, dans notre recrutement, ce que ces jeunes portent avec eux de talents et d’expérience, et nous devons leur procurer une formation capable de leur assurer une vie saine, joyeuse et fructueuse.
Sous cet éclairage, la seconde question prend de l’importance. L’Église attire notre attention sur la formation des religieux. La formation ne doit pas être perçue comme un processus automatique où seule suffit la bonne volonté des formateurs et des personnes en formation. Dans son introduction à Renovationis Causam, en 1969, la Congrégation des Religieux reconnaît la nécessité « de mieux adapter le cycle entier de la formation à la mentalité des jeunes d’aujourd’hui ». Et le document insiste sur l’importance que l’on doit accorder à la période de préparation précédant l’entrée au noviciat.
Votre situation n’est pas la même que celle des communautés apostoliques auxquelles Renovationis Causam s’adressait. Mais elle comporte des points de ressemblance. Vous entrez en contact avec des jeunes d’une mentalité différente de la vôtre et qui viennent d’un monde bien différent du vôtre. Les Directives du Saint-Siège de janvier 1990 englobent explicitement ‘les moniales dans ce contexte. Au no. 44, parlant des formes de stages avant le noviciat, le texte déclare:
» Elles peuvent être diverses: accueil dans une communauté de l’institut, sans pour autant en partager toute la vie, sauf la communauté du noviciat qui est déconseillée, le cas des moniales étant mis à part sur ce point; périodes de contacts avec l’institut ou l’un de ses représentants, vie commune dans une maison d’accueil pour candidats « .
J’aimerais que nos moniales des diverses Fédérations se révèlent aussi créatives à cette étape de la formation qu’elles le sont pour le noviciat ou pour le juniorat. Le no. 43 des Directives énonce clairement les quatre conditions fixées par la loi générale de l’Église pour l’admission au noviciat :
a) la formation humaine et intellectuelle suffisante;
b) la formation chrétienne nécessaire;
c) l’équilibre de l’affectivité, et spécialement l’équilibre sexuel;
d) la capacité de vivre en communauté.
Voilà ce qu’on doit exiger d »une personne avant son entrée au noviciat. Concédons que très peu de jeunes femmes peuvent remplir ces quatre conditions lorsqu’elles entrent en contact pour la première fois avec la communauté. J’ai l’impression que la formation humaine et l’éducation chrétienne doivent mûrir en dehors du monastère. Lorsque de jeunes femmes se trouvent intéressées par la vie monastique on doit les encourager à poursuivre leurs études, au moins jusqu’au niveau secondaire, chez elles ou bien, en cas d’impossibilité, en participant aux sessions de nos soeurs actives. On sait d’expérience que le monastère n’est pas un endroit où l’on peut compléter son éducation.
Voici un extrait de la lettre que j’ai reçue d’une de nos moniales à la suite de ma lettre sur le pré-noviciat :
» Même ici, dans notre monastère, il est absolument certain que, nous aussi, nous aurions besoin d’un programme pour permettre à celles qui voudraient se joindre à nous de sonder sérieusement et plus longtemps leurs capacités avant d’entrer réellement à notre noviciat… La mère prieure le croit aussi fermement; mais nous ne voyons pas comment on pourrait y parvenir comme moniales… « .
Une fois convaincues de la nécessité d’une telle entreprise, le reste suivra. Surtout ne soyez pas pressées d’attirer des jeunes en clôture avant que vous et elles ayez rempli les quatre conditions énoncées par le Saint-Siège.
Aux deux questions du P. de Couesnongle, je crois que nous devons en ajouter une troisième :
c) Comment nous formons-nous nous-mêmes à accueillir des jeunes ?
Voilà un réel défi pour plusieurs de nos communautés. Si la formation initiale pose problème ici et là à cause du manque de formateurs nécessaires, comment pouvons-nous prétendre que nous sommes prêts à intégrer à la vie du monastère des jeunes qui viennent d’un monde si différent du nôtre ? Voici encore ce qu’en dit une d’entre vous :
» Je crois que nous, moniales, nous devons comme telles réfléchir sérieusement à l’avenir. J’ai l’impression qu’on pourra dire avoir de la chance si six ou sept de nos communautés peuvent survivre. Il nous faut prévoir entre temps beaucoup de besoins à court terme. Cependant, ne devons-nous pas faire des choix ? Privilégier certains monastères en fonction de l’avenir ? Par exemple, ne pourrait-on pas penser à désigner un monastère en particulier comme lieu de formation, deux ou trois autres comme maisons de soins pour les soeurs âgées, un autre comme centre de communication et de publication pour nos communautés ? «
Il me semble que si vous, nos moniales dominicaines, désirez « promouvoir la vie dominicaine contemplative selon les conditions de chaque époque » (LCM 181), vous ne pouvez éviter cette troisième question.
Noviciat et juniorat
Dans mon rapport au Chapitre de Oakland, je disais :
» Le noviciat est une période qui offre au novice le lieu et le temps nécessaire à l’acquisition d’une profonde expérience de Dieu. C’est là qu’on doit prendre conscience de l’amour de Dieu et recevoir cet amour ainsi que la fidélité qu’il commande. La séparation qui a toujours existé entre le noviciat et le reste de la maison n’est pas sans valeur. On doit bien faire attention à ce que les novices ne soient pas surchargés par les tâches de la maison « . (Acta p. 117)
Sur le même sujet, je posais aux provinces d’autres questions qui peuvent s’adresser à vous aussi. Par exemple :
1. Votre monastère a-t-il des formatrices en nombre et en qualité suffisantes
2. Les besoins des personnes en formation sont-ils pour vous de la première importance ?
3. Avez-vous un sérieux programme de formation ?
4. Avez-vous suffisamment confiance dans les autres monastères, pour ce que vous pourriez leur apporter ou ce que vous pourriez en recevoir ?
Alors que la plupart des monastères ont de la difficulté à surmonter les exigences dont on vient de parler, les fédérations ou les groupes de monastères peuvent le faire.
On ne peut pas considérer les jeunes uniquement comme celles qui nous permettent de maintenir le noviciat ou d’assurer le travail nécessaire au bon ordre de la communauté. Elles ont besoin de compagnes pour poursuivre avec elles la même expérience. Lorsque je vois qu’on tient à la séparation complète entre une ou quelques novices avec leur maîtresse des novices dans le noviciat, je me demande si nous comprenons vraiment les exigences de la formation aujourd’hui.
Dans son introduction au livre des Constitutions de 1930, le P. Martin Gillet, alors Maître de l’Ordre, soulignait l’importance de la formation et de l’étude comme prérequis à la vie contemplative dominicaine:
» Il ne s’agit pas de remplir les monastères d’ intellectuelles, pas plus que de soutenir que, dans la vie contemplative, la science l’emporte sur l’amour. Ce serait désastreux Non, on ne parle pas d’intellectuelles, mais de religieuses instruites qui désirent connaître Dieu le mieux possible, afin de l’aimer davantage; et de l’aimer davantage afin de Le connaître plus intimement « .
Combien de monastères pris individuellement peuvent offrir cette formation essentielle aujourd’hui ?
Prêcher l’espérance
Le Chapitre général de Oakland nous rappelle que « nous n’avons pas de raison valable d’intervenir par la parole si notre propos ne réveille pas l’espérance ou ne lui donne pas une nouvelle vigueur » (4 3,IV). L’immense variété des saints de l’Ordre de Prêcheurs démontre qu’il existe plusieurs façons de remplir notre mission de prêcheurs. Le Pape Paul VI écrivait dans Evangelii Nuntiandi :
» Pour l’Église, le témoignage dune vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une communion que rien ne doit interrompre mais également donnée au prochain avec un zèle sans limite, est le premier moyen d’évangélisation » (no. 41).
C’était là la vision de saint Dominique et de plusieurs de nos saints. La vie d’une moniale contemplative est d’abord une vie qui prêche par son témoignage.
Vous pouvez aussi prêcher en paroles lorsque vous partagez votre foi avec une autre ou avec la communauté et encore dans les contacts personnels de votre correspondance ou de vos rencontres. (cf. Evangelii Nuntiandi, dans la section consacrée aux moyens d’évangélisation). Le Père Chenu disait un jour:
» On peut entrer dans l’Ordre des Prêcheurs par deux portes différentes: celle de l’apostolat et celle de la contemplation. Je suis entré dans l’Ordre par la porte de la contemplation et au long des années j’ai découvert la dimension apostolique du charisme dominicain « .
Dans ses dernières années il posait la question: l’Ordre a-t-il encore sa chance ? Avec un optimisme remarquable il disait :
» La chance de l’Ordre, elle est en ceci que, là où l’Église doit courir sa chance, dans un monde en mutation si rapide et radicale, l’Ordre trouve sa raison d’être. La chance de l’Ordre c’est l’actualité même de l’Église. Nous sommes nés dune rencontre, d’un affrontement de l’Église et du monde – un monde déjà » moderne » – ; ce fut alors, en action, et plus encore en pensée, un défi. Nous lavons relevé joyeusement, par le mouvement même de notre nature. Soyons fidèles à notre nature « .
Je termine sur cette belle définition de votre vie par une moniale qui fut déjà membre d’une de nos Congrégations actives :
« C’est depuis que je vis dans un monastère que j’ai compris davantage, comme Dominicaine, le sens du service des autres. Je suis ici afin d’offrir ma vie de prière pour le monde, et en particulier pour mes soeurs et frères dominicains. Je ne suis plus une Dominicaine engagée dans un apostolat personnel; je participe plutôt à tout l’apostolat dominicain. Ainsi je perçois plus vivement le pouls de la souffrance et de la joie à l’intérieur de notre famille. »
Vincent de Couesnongle 1975-1984
Le courage du futur (1975)
Lettre envoyée aux Pères et Frères de l’Ordre des Prêcheurs, en la fête de l’Epiphanie, le 6 janvier 1975
fr. Vincent de Couesnongle, o.p.
 Dans cette lettre adressée à tous les Frères, je voudrais engager avec chacun de vous une réflexion que nous devrons poursuivre ensemble dans les années qui viennent. Rendre l’Ordre plus vivant, toujours plus capable de réaliser sa mission d’ » évangéliser de par le monde le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ » : telle doit être notre grande passion.
Dans cette lettre adressée à tous les Frères, je voudrais engager avec chacun de vous une réflexion que nous devrons poursuivre ensemble dans les années qui viennent. Rendre l’Ordre plus vivant, toujours plus capable de réaliser sa mission d’ » évangéliser de par le monde le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ » : telle doit être notre grande passion.
1. L’ORDRE AUJOURD’HUI
L’Ordre est un corps vivant. Le Chapitre de Madonna dell’Arco (1974) a mis en pleine lumière les forces vives qui continuent de l’habiter et de le travailler. A l’égal de toutes les institutions contemporaines, l’Ordre souffre d’une crise sérieuse. Il serait sot et contraire à la vérité de refuser de voir les choses en face : on ne peut construire sur le sable des illusions et de l’irréalisme.
Les chiffres sont connus. En 1964, il y a dix ans, nous étions plus de 10.000 ; aujourd’hui, nous sommes un peu moins de 8.000. Il y a dix ans, nous avions 367 novices clercs (et c’était déjà un recul sensible) ; aujourd’hui, nous en avons 167. Depuis dix ans, 700 Dominicains-prêtres ont quitté l’Ordre et le sacerdoce. Et l’on sait comment certains de nos Frères sont aujourd’hui » en recherche » comme on dit, ou se sentent » mal à l’aise « . Qui alors, parmi. nous, n’est pas parfois tenté de poser à ses Frères la question de Jésus après le départ de certains disciples : » Voulez-vous partir, vous aussi ? » Il vaut la peine d’évoquer un instant certaines sources de nos difficultés.
Tout concourt aujourd’hui à affecter nos convictions les plus profondes d’un coefficient de relativité. Le terrain sur lequel on a construit sa vie semble moins ferme. Avec le pluralisme qui naît de la diversité des situations et du changement qui affecte toutes choses, l’Ordre a perdu quelque chose de cette unité qui en faisait, il n’y a pas si longtemps, un milieu de vie solide, sûr de lui, et dans lequel on se sentait soutenu.
Et puis, surtout, il y a le sécularisme envahissant qui rend moins réelle – s’il ne l’estompe pas à certains moments – la relation vivante à Dieu sans laquelle il n’est pas possible de vivre la vie qui fut celle des apôtres. Avec ses images, son bruit, ses journaux, ses distractions, ses provocations de toute sorte, sa hantise de l’efficacité et du plus vite, le 20e siècle finissant rend difficile, sinon impossible à certains, une prière qui soit autre chose qu’un bruit de paroles : la rencontre de Dieu. » Qui est-ce qui prie vraiment parmi nous ? » A cette question entendue, il y a plus de vingt ans, que répondons-nous aujourd’hui ?
Evoquer ainsi certaines difficultés de l’heure, ce n’est pas indiscrétion, pessimisme ou complaisance devant ce que nous connaissons bien et qui nous fait souffrir. Il est bon de reprendre conscience ensemble de ce qui nous interpelle tous. C’est déjà, je le crois, un signe de santé ; ce doit être surtout source de renouveau commun. D’ailleurs, on aurait grand tort de noircir ces ombres. Elles ne doivent pas cacher tout le reste. Que de choses admirables dans l’Ordre en ces années que nous vivons ! Qu’il suffise de rappeler quelques faits qui me viennent à l’esprit.
Je pense aux réalisations de tant de nos provinces, au point de vue évangélisation, enseignement, vie intellectuelle, engagement missionnaire, etc. Et comment ne pas évoquer ces petits groupes de Frères qui travaillent et partagent avec les marginaux dans les quartiers pauvres des grandes villes du monde ou ailleurs, leur apprenant à lutter contre la faim et l’ignorance. Tant d’autres cas de ce genre… Je pense à ces possibilités que nous avons dans certains secteurs ou dans certaines régions. Et pour ne citer qu’un exemple, sait-on assez qu’en Amérique latine il y a plus de 1.200 Dominicains à l’oeuvre – 1.200 sur 8.000 dans le monde : n’est-ce pas un investissement précieux dans un continent en pleine croissance ? Et puis il y a ces germes nouveaux que j’aperçois en plus d’un endroit et qui ne demandent qu’à pousser. Je songe spécialement à ces jeunes qui viennent à nous dans des provinces où, ces toutes dernières années, les noviciats étaient vides ou presque. Ils impressionnent par leur sérieux et l’amour de tout ce qui fait l’essence de la vie dominicaine. Et comment oublier – mais c’est le secret de Dieu -ceux qui, dans un monde où tant de choses s’opposent – et peut-être à cause de cela même – vivent le primat de la prière dans une recherche incessante de Dieu ?
Quelle que soit notre situation à l’intérieur de l’Ordre et face à l’appel de Dieu sur nous, l’état de crise dans lequel se trouvent l’Eglise et toute institution religieuse nous oblige à y faire front. Notre vie ne peut être facile. Ce dont nous avons le plus besoin, c’est le courage. Il ne s’agit pas de n’importe quel courage, mais de celui qui a fait la vie de saint Dominique. C’est le courage du chanoine d’Osma qui quitte son Chapitre et, à la suite de son évêque, s’avance sur la route inconnue. C’est le courage de l’apôtre qui s’installe à Fanjeaux, en plein pays hérétique. C’est le courage du fondateur qui disperse à Toulouse, le 15 août 1217, sa poignée de Frères. C’est le courage du missionnaire qui, une fois établis les fondements de son Ordre, rêve d’aller chez les Cumans dépenser ce qui lui reste de force. En bref, c’est le courage d’un » homme évangélique » qui vit, dans la foi, l’élan d’un espoir sans limites.
Le courage de saint Dominique, c’est donc le courage de quelqu’un qui, loin de se cramponner à un certain passé parce que c’est le passé, s’appuie sur les valeurs essentielles et permanentes que contient celui-ci, pour regarder droit devant lui et aller de l’avant : le courage du futur. Ces mots, qui rejoignent la » force d’âme » dont nous parle notre Constitution fondamentale devant les renouveaux nécessaires (§ viii), me sont venus spontanément à l’esprit au début du Chapitre général. Je voudrais vous dire très simplement ce qu’ils évoquent à mon esprit au début d’une nouvelle étape que nous sommes appelés à vivre ensemble.
II. LE » COURAGE DU FUTUR «
On peut, semble-t-il, ramener au regard neuf et à la disposition au changement les traits caractéristiques du » courage du futur « , auxquels il faut ajouter, comme leur source, l’espérance en Dieu.
1. Un regard neuf
Avoir le courage du futur, c’est d’abord être capable de jeter sur toutes choses un regard neuf. On s’habitue si vite à voir les choses non pas comme elles sont, mais comme on les a cataloguées une fois pour toutes… On s’organise si vite son monde personnel, sa hiérarchie des valeurs… C’est par le regard qu’on jette autour de soi qu’on vieillit peut-être le plus vite. Et cette » cataracte » d’un nouveau genre atteint à tout âge.
Or, le Christ nous a appris à voir les choses, les gens, les événements avec des yeux neufs, c’est-à-dire tels qu’on ne les avait pas vus jusque-là. Il prêcha un royaume où les valeurs sont bouleversées, où les derniers deviennent les premiers, où la pécheresse est préférée au pharisien, où le brigand entre tout droit en paradis !
Le Christ révèle le vrai visage de toutes choses. Il faut pénétrer au-delà des apparences, des masques et des façades. Les hommes et tout ce qui les affecte : amours, espoirs, appels, joies, chagrins, souffrances, nous apparaissent rarement dans leur vérité immédiate, native, à l’état brut, pourrait-on dire.
Il faut aussi savoir aller au-delà de ce que nous sommes capables de voir avec nos yeux d’hommes. Les choses sont beaucoup plus que ce qu’elles sont. Elles sont aussi : signes des temps, chemins vers Dieu, présence de Dieu, paroles de Dieu. Il faut reconnaître la grâce de Dieu à l’oeuvre dans le » monde meilleur » qui essaie de se construire. Derrière toute réalité, il est donc une » vérité dernière » que nous avons beaucoup de peine à dégager, mais qui toujours, d’une manière ou d’une autre, nous renvoie à Dieu.
Regard neuf tout d’abord sur nous-même. J’ai dit oui au Seigneur, quand il m’a appelé au » service de sa Parole « . Qu’est-ce que je fais de ce oui au long des jours ? Regard neuf sur l’Ordre. Quels jugements je porte sur lui ? Et pourtant ! Regard neuf sur l’autre, mon prochain: si proche parfois qu’il me gêne, me bouscule, détruit le monde que je m’étais fait ; si loin aussi que je ne le rencontre plus, même quand il est mon voisin de table. Regard neuf sur le monde. La lettre du Chapitre de Madonna dell’Arco sur les problèmes contemporains a tenté de susciter un nouveau regard sur le monde. Qu’en a-t-il été pour chacun d’entre nous ?
Ce regard neuf, c’est celui du prophète. Les mêmes yeux, mais qui voient plus loin. Par vocation, ne sommes-nous pas prophètes d’un monde nouveau, celui qui est en train de se faire? Si nous avons ainsi ce regard-là, la parole que nous dirons ne tombera pas dans le vide, elle ne sera pas une parole toute faite – faite pour tout le monde, c’est-à-dire pour personne. Elle rencontrera des personnes, des communautés, des institutions réelles. Nous serons capables de rejoindre l’autre et de lui faire entendre quelque chose qui résonnera au plus secret de sa vie. Un vrai dialogue deviendra possible. Celui-ci n’est-il pas beaucoup plus un regard qu’une parole ? Avant d’être une parole, ne doit-il pas être un regard rendu plus perspicace par la charité ?
» C’est étonnant comme nos idées changent, quand on les prie « , a-t-on dit. Prier ses idées, c’est les reconsidérer dans la lumière de Dieu, sous son regard. Notre propre regard, oui comme il changerait et se rapprocherait davantage de la vérité de Dieu si nous savions prier ainsi toutes choses…
2. Disposition au changement
Le monde d’aujourd’hui est » créativité » . Ce n’est pas là seulement un mot à la mode, c’est l’un des mots clés de notre temps. Personne ne peut y échapper. Ce qui est vrai pour tout homme l’est à un titre spécial pour le Frère prêcheur qui, dans l’annonce de la Parole éternelle de Dieu, doit être » contemporain » de ceux auxquels il s’adresse. Comme tel, il doit donc se mettre au » tempo » d’évolution du monde. Et ainsi, sous peine de n’être pas fidèle à sa vocation, il doit faire preuve de » créativité » dans sa mission d’évangélisation.
Par nature, un Frère prêcheur doit d’ailleurs se sentir à l’aise dans ce grand mouvement qui affecte l’humanité, car l’Ordre est né en un temps où la vie culturelle et les structures sociales de l’Occident ont subi de profonds bouleversements. Toute notre histoire montre combien nous sommes restés marqués par cette attention à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui commence. Les plus grands Dominicains n’ont-ils pas tous été affrontés à des situations apparemment sans issue, où il fallait précisément faire preuve d’un esprit créateur ?
Créativité, disposition au changement, courage du futur tout cela va de pair. Pour affronter l’avenir, il faut savoir reconnaître lucidement les limites de ce que l’on fait ; il faut vivre dans l’inquiétude du plus et du mieux, savoir constater son impuissance – ce que nous faisons n’est-il pas dérisoire face à cette immensité de la tâche ? -, être également habité par un sentiment d’urgence – le temps presse pour ceux qui n’entendent pas la Parole du salut !
Ce n’est pas que le travail manque dans la plupart des couvents et des provinces. L’important, c’est que certaines questions demeurent toujours posées : n’y a-t-il pas mieux à faire ? Des besoins plus urgents ne nous appellent-ils pas ? Ne faudrait-il pas laisser tel ministère à d’autres qui feraient aussi bien – mieux peut-être – que moi, pour me. lancer dans tel autre apostolat dont personne n’est chargé et qui correspond peut-être mieux à la mission de l’Ordre.
Cette insatisfaction et cette impatience qui, à certains moments, peuvent devenir véritable angoisse, sont foncièrement bonnes. Cette crainte de laisser s’assoupir en nous le zèle apostolique, ce sentiment d’urgence, tout cela doit en effet être, en chacun de nous et dans nos communautés, comme une source d’énergies toujours renouvelées. Ne concluons pas que les désirs et les projets, suscités par cette insatisfaction, doivent être considérés comme des absolus et qu’il faut les réaliser coûte que coûte. Pour beaucoup de raisons qui touchent aux conditions concrètes de notre vocation dans l’Eglise, il n’est pas toujours possible, ni même souhaitable, de mettre en route et de réaliser ces projets. Il reste que cette inquiétude doit être, en nous comme chez nos frères – surtout quand on sait l’assumer -, une force qui entretient notre ardeur apostolique et nous aide à nous donner, plus pleinement, à l’euvre que l’obéissance attend de nous dans l’immédiat.
La place de l’Ordre des Prêcheurs, dans l’Eglise, est en première ligne, aux frontières, là où il faut savoir inventer, ouvrir des pistes, partir en reconnaissance, faire preuve d’audace. Des espaces humains importants et immenses, de véritables « nouveaux mondes » sont nés et se développent en dehors de tout contact avec l’Evangile. Y faire retentir la Parole de vie, n’est-ce pas notre vocation ?
Cette insatisfaction, cette recherche constante, cette hantise, nous la voyons dans la vie de saint Dominique. N’est-ce pas cette hantise qui le fait s’écrier pendant ses nuits sans sommeil au pied de l’autel: » Mon Dieu, ma miséricorde, que deviendront les pécheurs ? » Ne nous y trompons pas, ce cri n’est pas seulement prière d’intercession. C’est aussi une question, la question d’un apôtre toujours en recherche, qui interroge Dieu sur le meilleur chemin à prendre pour annoncer le salut.
3. Fortifiés dans l’espérance
Sommes-nous capables de ce regard neuf et de cette disposition au changement, sans lesquels il n’est pas de » courage du futur » Si nous sommes laissés à nos seules forces, sans autre soutien que des motivations très humaines – sûrement pas. Mais nous sommes forts de la force même de Dieu et de la puissance même du » Christ, notre espérance » . Spe roborati, fortifiés dans l’espérance.
De même que notre foi est communion à la foi de l’Église, ainsi notre espérance se nourrit-elle de l’espérance de l’Église. Avec Abraham, les prophètes et tous les envoyés de Dieu à son peuple, comme à travers les hauts faits qui jalonnent l’histoire du peuple élu, l’Ancien Testament proclame la présence du Dieu fidèle en sa miséricorde et tout puissant. Cette espérance culmine dans le Christ dont la puissance de résurrection est toujours à l’oeuvre : » Je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20.) Tel est le fondement de l’espérance de l’Eglise. Après son départ, Jésus a envoyé, comme il l’avait promis, l’Esprit qui renouvelle et recrée toutes choses. L’Esprit est toujours là qui nourrit et fortifie l’espérance de l’Eglise. La » petite fille espérance « , chère au poète, c’est l’Eglise, cette mère toujours jeune qui sans cesse enfante dans la douleur une humanité nouvelle unifiée dans la charité du Christ.
C’est dans ce grand mouvement d’Eglise que s’insère notre espérance personnelle et celle de l’Ordre, notre » espérance dominicaine « . Les premiers Frères de saint Dominique étaient des gens » comme les autres « . La dispersion du 15 août 1217 fut pour eux occasion de trouble et de crise. Ils sont partis cependant réconfortés par l’assurance et la parole de leur père. Celui-ci meurt très tôt. Mais nous savons tout ce qui a été accompli par l’Ordre, tout au long du 13e siècle. Ce sont nos ancêtres, nous sommes leurs héritiers. Ne sommes-nous pas persuadés de la vocation toujours actuelle, plus urgente que jamais peut-être, de l’Ordre dans l’Église ? Imitons saint Dominique, sa pureté de coeur, sa pauvreté, son regard vers Dieu, sa passion du salut. Il voulait tout sacrifier pour le bien des âmes. Même ses livres. Nous, qui sommes toujours si éloquents à évoquer tout cela et tant d’autres traits de sa vie, qu’en faisons-nous ? Moins que de paroles, le monde réclame aujourd’hui des hommes courageux qui se donnent totalement et osent parler de Dieu.
Imitons-les. Jetons loin de nous les béquilles et autres accessoires qui assurent notre confort et nous satisfont à peu de frais. Même à notre insu, nous voudrions tellement tenir entre nos mains un avenir que nous façonnerions à notre guise, mais qui immanquablement nous échapperait, parce qu’il ne serait pas celui de Dieu. Si souvent le » Maître de l’impossible » se joue de nos plans ! Une certaine obscurité est le lot commun des vrais serviteurs de Dieu. Ne cherchons pas tant à savoir exactement où Dieu nous mène. Ce qui doit compter avant tout, c’est la force de la foi, toujours à l’oeuvre en nous et qui laisse place à l’initiative divine.
Que, dans sa fermeté, notre confiance soit contagieuse. Communiquons-la aux autres. Le courage est toujours contagieux – comme la peur, le doute, le défaitisme, hélas ! Partageons avec les autres, et d’abord avec les membres de notre communauté, cette espérance qui nous habite. Que chacun d’entre nous soit conscient de sa grande responsabilité auprès de ses frères, en ce domaine. Parce que le monde est bruyant aujourd’hui, l’appel de Dieu se ferait-il moins pressant ? Parce que le péché abonde, cela empêcherait-il la grâce de surabonder ? L’Esprit Saint serait-il devenu soudain avare de ses dons ?
III. QUELQUES EXIGENCES PLUS URGENTES
Le » courage du futur « , dont témoigne saint Dominique et qu’il attend de nous, n’est pas une impulsion aveugle ; il ne vise pas n’importe quel futur. Je voudrais souligner quelques-unes de ses exigences à l’heure actuelle.
1. Communier au monde actuel
J’ai déjà parlé de la nécessité de porter un regard neuf sur toutes choses. Il faut y insister. Cette connaissance du monde a, aujourd’hui, des requêtes d’ordre technique : méthodes d’enquête, statistique, sociologie, anthropologie, etc. Un vrai Prêcheur n’a pas le droit de les ignorer, encore moins de les mépriser ; il a au contraire le devoir d’étudier ces disciplines nouvelles, afin de les appliquer avec discernement.
Si l’on pense que tout a été dit et qu’il suffit de répéter, c’est qu’on ne sent pas son temps. Connaître les espoirs et les épreuves des hommes, les partager, ce n’est pas un luxe ou une fantaisie condamnable. C’est une exigence de la vocation dominicaine. Exigence d’autant plus forte que le monde change vite. Et pour tous, cette » mise à jour » toujours à reprendre exige effort et persévérance.
Le danger de contamination est réel et nous en connaissons les méfaits. Il faut pourtant exorciser certains démons, je veux dire cette crainte quasi panique qui s’empare de certains à l’idée de devoir s’approcher davantage du monde. Pour sauver notre monde, Dieu ne s’est-il pas incarné et n’at-il pas communié avec le monde que nous voyons vivre dans l’Evangile ? Dans la mesure où nous nous identifions au Christ – et c’est dans cette identification-là que nous devons chercher notre véritable identité -, nous trouverons, comme par un sûr instinct, ce rapport de communion authentique avec le monde.
2. Pluralité dans l’unité
A Madonna dell’Arco, on a constaté tout particulièrement une prise de conscience beaucoup plus vive, par les diverses provinces de l’Ordre, de leur originalité. Un mois plus tard, au Synode des évêques [1974], une même constatation s’imposait quant à la diversité des problèmes des Eglises particulières selon leur implantation géographique.
Il y a là pour l’Ordre quelque chose de très positif: ce pluralisme de nos provinces témoigne de son souci de » coller partout au réel « , condition de sa présence et de son action. Mais au moment où s’affirme davantage le pluralisme de nos formes de vie et d’action, il est nécessaire de souligner plus fortement que jamais ce qui fait l’unité foncière de l’Ordre.
Notre type de gouvernement explique pour une bonne part l’unité que nous avons gardée durant des siècles. De même ces éléments constitutifs de notre vie qu’énumère le § IV de la Constitution fondamentale (mission apostolique, vie commune, conseils évangéliques, célébration commune de la liturgie, prière privée, étude, observance régulière) et qui composent comme le tissu de notre vie contribuent à former cet esprit qui nous réunit.
Ne faudrait-il pourtant pas aller plus loin et chercher le fondement de cette unité au niveau de l’intelligence ? Manière d’aborder les problèmes, sensibilité à la mesure de la vérité qui se trouve en tout homme, méthode de pensée, discernement et amour des sources, recours aux principes fondamentaux qui éclairent une question, etc. Et puis chez nous l’intelligence garde le spirituel et le nourrit ; notre spiritualité est théologique au premier chef. Non pas que tout Dominicain soit un grand intellectuel ou un génie, mais nous avons tous une manière à nous d’aborder les hommes et de leur annoncer Jésus-Christ.
Notre responsabilité dans le domaine de la formation intellectuelle – première et permanente – n’en est que plus grande à une époque où les convictions les plus solides de l’intelligence sont mises en cause. Les questions se pressent à l’esprit : Organisation des études – Rôle du promoteur provincial en ce domaine – Manière d’aborder saint Thomas – Ouverture à la pensée moderne – Et tant d’autres… Le fait que le dernier Chapitre ait décidé qu’un assistant général serait désormais totalement consacré à cette tâche manifeste que l’Ordre a la conviction de se trouver ici à un point névralgique qui engage son identité et son unité pour l’avenir. Si le » courage du futur » doit être une réalité de nos vies, c’est bien ici. Mais cela nous met en face d’une autre question.
3. Une tâche essentielle de l’Ordre
Dans l’allocution qu’il prononça lors de l’audience accordée aux Pères capitulaires, le Souverain Pontife a déclaré que » la fidélité à saint Thomas était une partie intégrante de la mission confiée par l’Eglise à l’Ordre « . Deux mois plus tard, dans la lettre qu’il envoyait à l’Ordre à l’occasion de l’anniversaire de la mort de saint Thomas, il reprenait ce thème avec plus d’insistance, soulignant avec quelle lucidité et quel courage l’Aquinate avait fait face à la crise que l’Eglise traversait de son temps.
Dans cette double exhortation, il y a plus qu’une invitation pressante à étudier saint Thomas. Je crois que nous devons y voir comme une mission explicitement donnée à l’Ordre de faire face, avec le zèle et le respect de l’enseignement de l’Église qui ont caractérisé le Docteur Angélique, à la profonde crise actuelle de la pensée humaine et chrétienne. Le solide travail de discernement qu’il a fait de la pensée grecque, arabe et juive qui déferlait alors sur le monde occidental, nous devons le faire, à son exemple et en discernant les éléments toujours valides de solution qu’il nous a légués, à l’endroit de tout ce que la pensée moderne, les découvertes scientifiques, l’évolution du monde nous disent de l’homme, de la vie, de l’univers avec toutes les incidences que cela peut avoir sur la foi et la morale.
Il faut souhaiter que se lèvent parmi nous des pionniers qui, avec des forces jeunes, se passionnent pour une confrontation entre la pensée de l’Aquinate et tout ce que contient de neuf la pensée moderne. Les célébrations du centenaire ont montré que, pour avoir sept siècles, sa pensée était toujours étudiée. Même des étudiants et chercheurs non catholiques y sont attentifs.
Dans sa session de 1973, la Commission permanente pour la promotion de l’étude s’est demandé comment susciter parmi nos plus jeunes frères des vocations de professeurs et de chercheurs. Cette question, nous devons tous nous la poser. Sommes-nous assez convaincus de l’importance de ce travail pour l’Eglise ? L’atmosphère générale de nos provinces et de nos couvents suscite-t-elle et soutient-elle de telles vocations ? Que faisons-nous pour préparer de tels hommes, les libérer d’autres travaux, répondre à leurs besoins ?
L’Ordre a toujours été très attentif à sauvegarder dans son sein, pour demeurer fidèle à lui-même, l’équilibre entre ceux qui, d’une part, annoncent directement la vérité qui sauve et ceux qui, d’autre part, l’approfondissent et préparent les Prêcheurs de demain. Il ne faudrait pas que cet équilibre qui est enrichissement pour les uns et pour les autres soit rompu au profit d’un apostolat de contacts plus directs. L’existence d’un assistant spécial pour l’apostolat, conjointement avec celui qui est consacré à la vie intellectuelle, est garant de cet équilibre.
4. Une conviction de foi
La crise de l’Eglise, aujourd’hui, est une crise de foi. Dans l’histoire, les Fils de saint Dominique se sont toujours efforcés d’en être des témoins et des prédicateurs privilégiés. La crise doit nous trouver vivants et lucides dans notre propre foi.
En ces temps de bouleversement culturel, technique, économique, politique, nous assistons à une réflexion critique particulièrement poussée de la foi. On s’interroge – avec raison – sur celle-ci pour mieux en saisir le sens, l’exprimer dans des » formules plus signifiantes « , en mieux discerner les exigences dans l’ordre moral. Mais autre chose poser des questions à la foi, et autre chose la mettre en question.
Or, aujourd’hui particulièrement, la tentation se fait plus forte de mettre les dogmes et la morale » au goût du jour » ; le relativisme et le sécularisme auxquels j’ai déjà fait allusion affaiblissent nos forces de résistance. Que nous portions le trésor de notre foi dans des » vases d’argile » est particulièrement vrai à notre époque. Y sommes-nous assez attentifs ? Avons-nous suffisamment conscience du caractère humainement vulnérable de la foi : la mienne, celle des autres ? Savons-nous toujours éviter une certaine légèreté face à des questions auxquelles nous ne pouvons répondre et qui risquent certes de corroder les convictions de ceux qui nous écoutent ? Cela dépend des personnes et des circonstances, sans doute. Mais ce sont des questions – et tant d’autres… – que nous devons nous poser.
C’est particulièrement dans la prière que la foi s’affermit et se développe. A condition que celle-ci soit une véritable rencontre du Christ. Qu’en est-il ? Quelle est la qualité de notre prière commune ? Pure obligation ? Véritable rencontre, en commun, du Seigneur ? Savons-nous à l’occasion y partager notre foi ? On sait pourtant tout ce que cela apporte lorsqu’il s’agit ensuite de parler de Jésus-Christ à ceux qui nous sont confiés. Un tel partage se fait-il spontanément chez nous ? Qu’en est-il de notre prière privée ? Depuis quelques années, un peu partout dans le monde, les jeunes nous étonnent par leur désir de prière. N’est-ce pas là un » signe des temps » ? Pouvons-nous parler de la prière, si nous ne savons pas prier, si nous prions peu ? Etonnons-nous de la faiblesse de notre foi…
5. Révisions nécessaires
Pour répondre à ce que l’Eglise et le monde attendent de l’Ordre au début de ce dernier quart de siècle, il nous faudra sans doute reconsidérer nos engagements apostoliques en plus d’un domaine. Nous ne sommes pas assez nombreux. Tenir ce que nous faisons pose déjà de redoutables problèmes en beaucoup d’endroits et nous devons prévoir l’avenir avant qu’il ne soit trop tard. Ailleurs de nouveaux champs d’apostolat plus urgents nous réclament déjà. Des décisions et des sacrifices seront nécessaires.
Cela ne doit pourtant pas nous décourager. L’histoire de l’Ordre montre que des forces réduites, mais bien préparées, peuvent faire de grandes choses quand les objectifs sont judicieusement choisis. Les Constitutions nous demandent de critiquer périodiquement nos activités apostoliques 3. S’y employer cette année dans un grand désir de renouveau, et pour manifester dynamisme et présence aux jeunes qui penseraient entrer dans l’Ordre, ne serait-ce pas l’une des premières manifestations de ce » courage du futur » dont je parle ? Que chaque province, chaque maison, chaque frère revoie toutes ses activités et s’interroge. Comment j’utilise mon temps ? Comment ces activités aident-elles les hommes à connaître Dieu et à chercher en lui le sens de leur vie ? Dois-je continuer dans la même ligne ? M’y engager davantage ? Que dois-je éliminer de ma vie ?
Il faudrait aussi s’interroger sur les nouveaux types de prédication à trouver, sur la manière d’atteindre certains milieux. Que faisons-nous pour les non-croyants, pour les chrétiens séparés, pour les membres des grandes religions ? Et puis, il y a tous les problèmes que posent la misère, l’injustice, l’incompréhension, les conflits et tensions de toute sorte, la guerre. Comment sommes-nous engagés dans ces secteurs sur lesquels l’Eglise insiste tant aujourd’hui, y voyant une exigence de la prédication de l’Evangile dans son intégralité ?
Mais ces révisions nécessaires que j’évoque exigent une révision de nos communautés elles-mêmes, car ces questions ne se posent pas seulement à chacun de nous individuellement, mais aux communautés dont nous faisons partie. La profondeur de nos échanges sur ces questions, comme sur tout ce qui fait notre vie, dépend de la qualité de notre vie communautaire. Qu’en est-il ? Que faisons-nous, à l’intérieur de nos couvents, pour nous aider les uns les autres à croître dans la plénitude du Christ ?
En commençant cette lettre, j’ai rappelé les ombres et les crises qui nous ont affectés, les difficultés que nous connaissons encore, la souffrance que nous en ressentons. Mais, le plus grave, ce n’est pas notre diminution en hommes. Le plus grave, ce serait que notre foi dans l’Ordre, notre confiance – en nous-mêmes et en nos frères, – notre dynamisme en soient atteints, si peu que ce soit.
Très chers frères, c’est à un renouvellement de courage et d’espérance que je convie chacun d’entre vous. Incarner le projet de saint Dominique dans le monde actuel, ce n’est pas se laisser abattre par la crise qui atteint le monde et l’Eglise. C’est leur être présent pour aider nos frères les hommes à surmonter cette crise et à découvrir ce que Dieu veut nous signifier pour aujourd’hui et pour demain.
Quelques aspects de notre vie dominicaine (1975)
Lettre envoyée à l’Ordre pour Noël 1975
fr. Vincent de Couesnongle, o.p.
 La fête de Noël nous rend plus proches du mystère de la manifestation de Dieu aux hommes. Elle nous rappelle aussi à notre vocation dominicaine : vivre ensemble la Parole de Dieu, la prier, l’étudier, la célébrer pour pouvoir l’annoncer de mille et une manières.
La fête de Noël nous rend plus proches du mystère de la manifestation de Dieu aux hommes. Elle nous rappelle aussi à notre vocation dominicaine : vivre ensemble la Parole de Dieu, la prier, l’étudier, la célébrer pour pouvoir l’annoncer de mille et une manières.
Au cours de cette première année de ma charge, j’ai visité plus de la moitié de nos 41 provinces et un certain nombre de vicariats d’Afrique et d’Amérique latine. Durant ce temps, la plupart des Assistants généraux ont, à l’invitation des Provinciaux, fait des séjours – plus ou moins longs – dans leurs régions respectives.
Durant ces visites, qui constituaient une première prise de contact avec les centres les plus importants de l’Ordre, j’ai surtout écouté les frères : leurs engagements apostoliques, leurs difficultés, leurs aspirations. J’ai beaucoup échangé avec les Frères, et aussi les Moniales et les Soeurs, sur mes trois préoccupations majeures face à la situation de l’Ordre, tel que je le vois maintenant. Ces trois points expriment d’ailleurs non pas une hiérarchie de valeurs, mais un ordre d’urgence pour aujourd’hui.
Première préoccupation : la vie intellectuelle
Actuellement, deux tiers de nos provinces n’ont pas leur propre maison d’études, leur studium : ce qui signifie que nos étudiants suivent des cours de philosophie et de théologie dans des facultés de niveaux bien divers. Il y aurait une solution immédiate : envoyer les étudiants dans d’autres pays qui ont un studium dominicain. Mais aujourd’hui on souligne combien il est important que les étudiants poursuivent leurs études dans leur pays, leur culture, leur milieu. Je sens que nos jeunes ont besoin d’une saine méthodologie pour pouvoir penser d’une manière critique.
Il y a un sérieux effort à faire pour confronter dans une fécondation mutuelle les conclusions des sciences et des philosophies modernes avec les intuitions de saint Thomas 1. Dans le passé, nous avions des hommes bien entraînés à la pensée moderne ainsi qu’à la perspective historique et la problématique de saint Thomas. Mais trop souvent la » confrontation » fut laissée aux étudiants – tâche difficile qu’ils pouvaient rarement accomplir. Il y a 9 ans, avant d’arriver à Rome, j’ai réalisé que je devais changer ma façon d’enseigner. Je suis convaincu que cette » confrontation » doit se faire, si notre héritage intellectuel veut survivre.
Il y a aussi un besoin urgent de formation continue des f’rères. Sous ce rapport, nous avons des provinces fortes, et ,les provinces faibles. Nous ne pouvons pas nous contenter te porter l’habit de saint Dominique et de chanter les hymnes de saint Thomas. Il nous est demandé bien plus dans le ronde d’aujourd’hui qui change si vite, qui se construit. `fous ne pouvons prendre un air de supériorité comme si nous avions toutes les réponses et agir comme si personne ‘avait rien à nous apprendre. En fait, nous avons beaucoup à apprendre des autres, spécialement dans les domaines de la pastorale et des spécialisations apostoliques.
Deuxième préoccupation : présence dominicaine dans le monde actuel
Nous accomplissons les tâches les plus variées, et en géréal, nous le faisons bien. Mais il me semble que nous faisons les mêmes choses, et de la même manière qu’il y a 5, 10 ou 20 ans ! Nous devons nous poser cette question et y réfléchir sérieusement.
Où est le monde de demain qui est en train de naître ? Que faisons-nous pour atteindre et marquer ces jeunes, ces professionnels, ces couples, ces étudiants, tel ou tel milieu ou coupe ? Quel rôle dynamique, exemplaire et actuel jouent , les paroisses, les écoles, les aumôneries ? N’y donnons-nous ras une réponse trop facile à nos aspirations apostoliques ? N’y cherchons-nous pas à évangéliser surtout un petit nombre choisi, » à sauver les sauvés » ? Sans considération pour que nous faisons, l’an 2000 aura un contenu tout nouveau. Où sera l’Ordre des Prêcheurs ?
Dans mes conversations avec les Frères, les Soeurs, les Moniales, j’ai exprimé mon étonnement devant la faible .présentation des frères dans le domaine de la justice sociale et des mass media, et j’ai insisté sur la nécessité de consacrer des religieux à ces domaines et de les former en conséquence.
Bon nombre de possibilités nous sont offertes de servir le pauvre et l’opprimé : 1. aide directe ; 2. enseignement des méthodes d’auto-assistance ; 3. recherche des causes de la misère et de l’injustice. Je crois fermement que, comme Dominicains, et sans écarter les deux autres, nous devons privilégier, la troisième possibilité qui réclame une compétence professionnelle en des champs très variés : économie, sociologie, politique, philosophie, théologie et bien d’autres disciplines. L’histoire nous offre un modèle dans les efforts, au 16e siècle, d’un Vittoria et d’un Las Casas pour défendre la cause des Indiens opprimés.
Troisième préoccupation: la prière
Depuis Vatican II, l’aspect quantitatif de notre prière a été réduit, et je crois que la qualité a progressé. Mais, qu’en est-il de l’intensité de notre prière privée ?
On note chez les jeunes une recherche croissante d’une vie de prière plus profonde. Pourrons-nous satisfaire ces aspirations ? De mes brefs contacts avec certaines maisons de formation, j’ai retenu que bon nombre de novices et de jeunes étudiants apprécient profondément la prière et la vie contemplative.
Dans certains groupes, j’ai entendu dire qu’il existait un antagonisme croissant entre les » charismatiques » et les » politiques » – un mot à prendre dans son sens large. Ces derniers accusent les autres de neutraliser le changement social – avons-nous suffisamment réfléchi à ce problème pour y apporter des réponses intelligentes ? II reste bien d’autres domaines de la prière à explorer.
Au cours des deux ou trois dernières années, j’ai constaté un changement dans le type d’hommes qui pensent àentrer chez nous. Et cette impression a été souvent confirmée lors de mes récents voyages. Ils possèdent le désir de l’étude à un niveau profond. Ils désirent aussi une solide vie de prière. Ils veulent vivre la vie commune dans un partage de la foi. Avec un certain humour, j’ai souvent parlé des jeunes comme de la » race nouvelle « .
Toutefois j’éprouve quelque crainte sur l’accueil qu’on leur fait. Pouvons-nous les recevoir, sans les décevoir ? Pouvons-nous leur offrir les richesses de cette vie spirituelle intérieure qu’ils cherchent ? Ils viennent à nous sans préjugés ni pour ni contre le passé qui a été si secoué immédiatement après Vatican II.
En assistant aux sessions du CIDAL, à Quito, cet été, j’ai été impressionné par le sérieux et l’intensité de l’approche, par les Pères et les Soeurs, du problème de l’évangélisation dans leur pays. Ce qui m’a touché tout spécialement, ce fut notre prière commune – deux heures chaque jour. Nous avions simplement Laudes, Vêpres et la Messe concélébrée, mais ce furent des moments de partage et de réflexion sur l’Ecriture, d’offrande des intentions, de silence – simple et profond. Je pense que nous avons eu une expérience aussi riche, en raison de la présence des soeurs, qu’il s’agisse de la vérité et de la ferveur de notre vie de prière comme aussi de la conscience qu’elles ont, du fait de leur sensibilité naturelle, des problèmes concrets quotidiens et de la condition du pauvre.
Je suis encouragé quand je constate la coopération et la collaboration entre les frères et les soeurs de l’Ordre. J’espère que nous continuerons dans cette perspective, car nous avons beaucoup à nous apporter les uns aux autres et, ensemble, nous pourrons constituer une force dans l’Eglise et dans le monde.
Mais jusqu’ici je n’ai que très peu rencontré une coopération profonde des Frères et des Soeurs avec les membres des Fraternités laïques de saint Dominique, lesquels devraient pourtant, face à un monde qui se fait, être une aide et une inspiration irremplaçable. Sans eux sommes-nous capables de donner au monde d’aujourd’hui la nouvelle âme dont il a besoin et qu’il ne peut trouver que dans l’Evangile du Christ ?
Et maintenant que j’ai partagé avec vous mes trois préoccupations, je demande à chaque frère, chaque soeur, chaque moniale, chaque couvent, chaque monastère, chaque province, chaque congrégation, chaque fraternité laïque en tous ses membres, de réfléchir et de rechercher comment, ensemble, vous et moi, dans un esprit de solidarité et dans la même espérance qui est d’abord prière, nous pourrons préparer ainsi aujourd’hui l’insertion et l’incarnation de l’Ordre des Prêcheurs, dans le monde de demain : le 21e siècle.
Accueil et formation des jeunes dans les communautés religieuses (1976)
Conférence donnée à Madrid lors de la 5e Semaine nationale des Religieux, le 23 avril 1976
fr. Vincent de Couesnongle, o.p.
 Un peu partout, on parle aujourd’hui d’une certaine reprise des vocations religieuses. On dit même parfois que c’est une » nouvelle race » de jeunes qui frappe à nos portes. Et tout de suite la question, angoissante après la crise récente, se pose aux responsables : Comment nos communautés vont-elles les recevoir ? Comment allons-nous les former ?
Un peu partout, on parle aujourd’hui d’une certaine reprise des vocations religieuses. On dit même parfois que c’est une » nouvelle race » de jeunes qui frappe à nos portes. Et tout de suite la question, angoissante après la crise récente, se pose aux responsables : Comment nos communautés vont-elles les recevoir ? Comment allons-nous les former ?
Jadis le problème était simple. J’entends encore le Père Prieur me dire lors de ma prise d’habit : « Durant cette année, vous pourrez voir si le genre de vie de l’Ordre vous plaît, et nous, si votre conduite nous plaît. Si l’épreuve est positive, nous vous recevrons à la profession ; en cas contraire, l’un et l’autre nous reprendrons notre liberté « .
De nos jours, les choses sont un peu plus compliquées. Sans doute la communauté accueille et forme, mais elle doit aussi accepter d’être mise en cause par les nouveaux venus. Les jeunes veulent bien passer sous les fourches caudines du noviciat, mais ils ont déjà sur les lèvres des questions insidieuses que la communauté devra écouter. Entre les uns et les autres, une espèce de dialogue s’établit donc dès le premier jour. Leurs points de vue ne seront pas toujours identiques, même s’ils se complètent. C’est pour cela que, comme dans un dialogue, cet exposé interrogera tour à tour les communautés et les jeunes, sur certains des problèmes que posent l’accueil et la formation de ces derniers. Le sujet est immense. J’insisterai surtout sur les conditions de l’accueil et, en ce qui regarde la formation, sur l’intégration des jeunes dans la communauté.
I. Nos communautés rebutent-elles les jeunes ?
Il y a un accueil antérieur à l’entrée dans une communauté religieuse. Les maisons dites de formation ne sont pas seules en cause. Les jeunes ne se contentent plus de prendre contact avec une seule communauté. Ils veulent savoir ce qui se passe dans les différentes maisons de la Province ou de l’Institut. Et c’est seulement après enquête, sérieuse et élargie, qu’ils feront leur choix.
Il y a bien sûr les communautés contre-témoignages. Dans une de nos missions depuis longtemps sans vocation, un jeune homme désire se faire dominicain. Il partage la vie des Pères, tout en commençant ses études ecclésiastiques. Après deux années, il nous quitte, juste une heure avant de prendre l’habit : « Je pars, dit-il au Père Maître, parce que la communauté ne vit rien de ce que vous m’avez enseigné, et qui me plaisait. »
De même qu’il y a des foyers qui ne veulent point d’enfants, il y a également des communautés qui écartent les jeunes, de crainte d’avoir à changer quelque chose à leur vie. D’autres désespèrent de la vie religieuse et, mettant en avant par exemple l’absence de vraie formation – du moins, à leur sens – dans leur congrégation, ils s’emploient malheureusement à décourager les vocations possibles. Malthusianisme d’un nouveau genre… Comment de telles communautés seraient-elles accueillantes à ceux qui passeraient outre au mur de leur hostilité ? Peut-on trop blâmer ces religieux et religieuses qui refusent la vie, et ne savent pas que le désir de vivre est source de santé ?
Et puis, il y a, à l’inverse, des communautés qui sont trop accueillantes. En ce sens qu’elles sont hantées par la quantité. Celle-ci n’est pas nécessairement source de qualité ; il est plus vrai de dire que » la qualité est la quantité à l’état naissant « . Communautés trop accueillantes encore parce qu’elles s’ouvrent à n’importe qui et à n’importe quoi, à condition que ce soit inédit, marginal, en création continuelle. Communautés toujours en recherche, qui changent leurs projets au premier mouvement d’humeur et dont la créativité, si nécessaire aujourd’hui, risque de tourner à l’anarchie. Ces communautés me font penser à ces moines gyrovagues de jadis. Mais ces nouveaux gyrovagues errent sur les grands chemins de l’imagination, de la déstructuration et de la liberté sans frein.
Sans doute peut-il y avoir quelque chose de sympathique chez ces » religieux en cavale » . Dans un passé encore récent, des jeunes ont pu se sentir attirés par ce type de vie. Je pense qu’aujourd’hui ils cherchent quelque chose de plus solide et de moins problématique. Ils répugnent à construire leur vie sur des sables mouvants. Ou si, après quelques années, sous couleur de présence au monde et de modernité, ils prennent ce style et cette mentalité à l’intérieur de leur Institut, c’est souvent par déception de ce qu’on leur a offert ou par manque de formation adéquate. Au fond, ce n’est pas ce qu’ils étaient venus chercher.
II. Que cherchent les jeunes qui pensent a la vie religieuse ?
Dans la vocation religieuse, ce que les jeunes d’aujourd’hui considèrent comme le plus précieux, c’est ce qui est commun à tous les chrétiens : la vie avec Jésus-Christ selon l’Evangile. Vatican II les confirme dans leur sentiment. Le Concile ne proclame-t-il pas que tous les chrétiens, quelle que soit leur condition, sont appelés à la perfection ? Ne rappelle-t-il pas aussi, et à l’occasion de la vie religieuse, que rien n’est supérieur à la consécration baptismale ? C’est en fait par rapport à cette vérité première – le Christ de l’Evangile – que les jeunes chrétiens orientent aujourd’hui leur vie. Quant à eux, les candidats à la vie religieuse pensent avoir découvert, dans le type de vie de tel ou tel Institut, un milieu sous le signe des conseils évangéliques où ils pourront normalement réaliser à l’extrême l’idéal de tout chrétien.
Dans le passé, nos aspirants étaient beaucoup plus sensibles aux institutions religieuses : régime de vie, observances, structures, oeuvres, tradition… On avait alors tendance à leur donner comme une valeur en soi : » Vivez cela, et tout le reste – le Christ lui-même – vous sera donné par surcroît. » On connaît le mot, de Pie XI paraît-il : » Présentez-moi un religieux qui suit parfaitement sa Règle et je le canoniserai. » De nos jours, ces considérations ne sont certes pas absentes, mais on les vit plus consciemment dans la lumière même du Christ, comme milieu de rencontre avec lui, et comme exigences de son amour. Et c’est par rapport à leur capacité de servir et d’annoncer effectivement l’Evangile que nos jeunes jugent l’essentiel et l’accessoire de la vie religieuse qui leur est proposée. Disons qu’hier l’appel à la vie religieuse était vécu d’une façon » plus institutionnelle » ; aujourd’hui il l’est d’une manière » plus kérygmatique « .
La Constitution fondamentale, par quoi débute la nouvelle législation dominicaine, organise toute notre propre vie autour de deux axes : communion, mission – ces deux mots prenant le sens très plein que leur donne le Nouveau Testament. Tout Institut religieux se reconnaît sans peine dans ce binôme. Mais, ce que je veux surtout souligner ici c’est que ces deux axes rejoignent les exigences fondamentales de toute vie chrétienne : aimer son prochain et annoncer le Sauveur.
Mais, et c’est ce qui la caractérise, la vie religieuse radicalise ces deux requêtes. Grâce aux conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance, elle les porte à l’extrême. En vie religieuse, dans la ligne de la première communauté de Jérusalem, l’amour du prochain se structure en vie de communauté. A la suite des premiers apôtres partant sans bâton, ni besace, ni pain, ni argent, les religieux se veulent libres, sans autre souci que celui du salut à annoncer. Suite du Christ, mission, communion : de ces trois composantes qui sont autant d’énergies vitales, nos futurs religieux ont déjà eu, avant leur entrée, une certaine expérience. La formation n’aura pas d’autre but que de les approfondir et de leur donner pleine dimension spirituelle et humaine.
Je ne crois pas me tromper en avançant que, de ces trois réalités, celle qui marque le plus les jeunes d’aujourd’hui, c’est la communion. Ces jeunes sont de leur temps. Et ils sentent d’autant plus le besoin de se rapprocher les uns des autres, d’échanger, de partager, de vivre ensemble, que le monde dans lequel ils vivent est plus dur, plus oublieux des personnes qu’il écrase pour ne voir en elles que des automates qui produisent et qui consomment. D’ailleurs s’ils ont découvert le Christ et appris à le rejoindre, n’est-ce pas le plus souvent dans des groupes de prière ou des partages d’Evangile ? Et n’est-ce pas » ensemble avec d’autres » qu’ils ont expérimenté la force de transformation, dans le monde, de la Parole de Dieu ? C’est dire ainsi que leur expérience du Christ et de la vie apostolique est passée de manière privilégiée par l’expérience de liens et d’un milieu communautaires. Nous comprenons mieux l’importance qu’ils donnent à la communauté dans la nouvelle vie qui se présente à eux.
On pourrait multiplier les exemples. Je pense à ces jeunes d’Amérique du Nord. Ils ont donné quelques mois à de petites communautés de religieux qui partagent leurs journées entre une intense vie de prière et l’aide accordée aux populations misérables du quartier. Ils veulent se consacrer totalement à cette vie qui leur plait… et entrent ainsi dans cette congrégation. En certains pays d’Amérique latine, il y a une dizaine d’années, ce sont les aumôniers d’étudiants ou d’Action catholique qui découvraient des vocations parmi les jeunes universitaires. Aujourd’hui c’est dans les barrios et les favellas qu’on rencontre les jeunes intellectuels animés des mêmes désirs. En Italie enfin, de nombreux jeunes découvrent leur vocation religieuse dans l’ambiance des focolarini, mouvement communautaire s’il en est.
III. A quelles conditions une communauté offre-t-elle aux jeunes un lieu favorable pour mener a bien leur recherche ?
Dans le passé, cette communauté, c’était le noviciat. Celui-ci n’avait que peu de relations avec le couvent ou la maison religieuse qui l’abritait : rares » fusions » (ou récréations communes), les jours de très grandes fêtes seulement ; permission spéciale nécessaire pour parler à un Père (on ne se confessait pas tous les jours) ; au début et à la fin du noviciat, comparution devant quelques Pères » graves » pour les examens canoniques, etc. A l’heure actuelle, le noviciat, bien que distinct de l’ensemble de la communauté, lui est profondément uni. C’est la communauté tout entière qui doit accueillir et former le nouvel arrivé. Le critère d’appartenance des Pères à une maison de formation n’est plus le même qu’autrefois. Alors que nos anciennes Constitutions, par exemple, n’acceptaient dans ces maisons que des religieux » de parfaite vie commune et de stricte observance » , les nouvelles parlent seulement de vie commune, à laquelle les jeunes religieux doivent activement et progressivement participer, activités apostoliques comprises. Et si, dans les deux cas, il s’agit de vie commune, on devine tout de suite que ce mot ne recouvre pas la même réalité. Jadis, c’était surtout » faire la même chose, au même moment, dans le même lieu « . Aujourd’hui, elle est échanges, partages, réciprocité de services, communion des personnes, etc. Le principe premier qui guide actuellement la formation c’est donc le désir de faire vivre, concrètement et progressivement, aux jeunes la vie même qui sera la leur demain, et cela par leur intégration graduelle dans une communauté adulte. A l’hétérogénéité d’hier a fait place une certaine homogénéité dans le temps et avec les personnes.
Perspective révolutionnaire, si nécessaire qu’elle soit, elle pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Quel formateur en effet peut se flatter d’éviter tous les récifs, de connaître parfaitement la manoeuvre et d’avoir trouvé une fois pour toute son rythme de croisière ?
Je ramènerai à trois les conditions qui font de la communauté, ainsi comprise, un lieu favorable où les religieux, dans leurs premières années de formation, peuvent mener à bien leur recherche. Comme chacun sait, ces premières années peuvent s’organiser de manières bien différentes. Je laisse de côté ces distinctions et les problèmes qu’elles posent pour m’en tenir aux généralités.
Un climat de renouvellement évangélique
» La vie religieuse, a-t-on dit récemment – mais cela vaut pour toute communauté, – n’est vraie, belle, agissante dans le monde et digne d’estime qu’à l’état naissant. » Que veut dire » à l’état naissant » ? Il s’agit sans doute des Instituts aux premières années de leur existence. A leurs débuts, en effet, une vitalité, un bouillonnement vraiment extraordinaires. C’est le dynamisme des commencements. Qu’on pense à saint Dominique, à saint Ignace de Loyola, à sainte Thérèse d’Avila, à saint Antoine-Marie Claret, pour ne citer que certains fondateurs.
Mais, dans la pensée de son auteur, » à l’état naissant « veut dire aussi – peut-être même surtout – que pour être vraiment elle-même, la vie religieuse doit être toujours à l’état naissant, c’est-à-dire en état de renouvellement continuel. N’est-ce pas là d’ailleurs ce que cherchent confusément les jeunes ? Ils veulent revivre eux-mêmes, dans l’Eglise et le monde présents, ce que les premiers frères ou les premières soeurs ont vécu en d’autres temps autour du fondateur ou de la fondatrice.
Un gouffre sépare bien sûr les désirs de leur réalisation. Si, pourtant, nous étions plus accessibles au sens que les fondateurs avaient de leur temps et au désir, souvent informulé, des jeunes au regard des débuts de leur congrégation, nous pourrions certainement beaucoup mieux les comprendre. Mais ce serait terriblement exigeant, et pour eux et pour nous.
Mais, que signifie exactement une communauté » à l’état naissant » ou » en état de renouvellement continuel » ? Rien d’autre, qu’une communauté » en état de conversion » incessante. Il ne faut pas seulement se reprendre et se reconvertir à cause de l’usure du temps et de la pesanteur des communautés. Dans un monde en perpétuelle évolution, un réajustage s’impose à chaque instant pour que nos actes, nos paroles, notre vie rejoignent les hommes dans la réalité de ce qu’ils sont. Si, dans certaines techniques, un ingénieur de trente-cinq ans est un vieil ingénieur, que dire du prédicateur ou de la catéchiste qui doivent parler de Dieu à des gens de tout âge et de toute condition, dont la mentalité et les problèmes évoluent aussi vite que le monde en lequel ils vivent ? La conversion au Christ et à l’Evangile ne va donc pas sans un regard nouveau. C’est par le regard qu’on porte autour de soi qu’on vieillit le plus vite. Nos yeux fatigués ne peuvent plus accommoder sur le monde nouveau. Et les jeunes s’aperçoivent rapidement de notre infirmité. Si nous ne prenons pas les moyens – une paire de lunettes ne suffit pas -, ils douteront de l’efficacité de nos engagements apostoliques et de notre capacité à les comprendre eux-mêmes.
Un véritable apôtre, c’est un homme inquiet du salut de ses contemporains, insatisfait de ce qu’il fait, animé d’un sentiment d’urgence devant l’immensité de la tâche à accomplir. Les brebis de l’Evangile ? Les chiffres ont changé. Et les jeunes s’étonnent de voir certaines communautés prendre tant de soin pour l’unique brebis sage et ne guère se soucier des 99 perdues. Ne les a-t-on pas oubliées ? Cherche-t-on, sérieusement, les chemins qui permettraient de les atteindre ?
Un climat de prière vraie
Ce dont la nouvelle génération a surtout besoin, c’est d’un lieu, d’un climat où leur quête de Dieu sera partagée et comprise. Un enseignement et même quelques exemples ne suffisent pas. Vraie prière : de quoi s’agit-il – Il me semble que le goût d’une prière, tour à tour intime et partagée, dont on parle un peu partout aujourd’hui, mérite d’être appelé » un signe de notre temps « . Les jeunes ne craignent plus de parler de prière, de méditation et de contemplation – ces mots que certains d’entre nous ne prononçaient qu’avec circonspection dans les années 60. C’est nouveau dans l’Eglise. Qui pouvait le prévoir ? Les groupes de prière prolifèrent. En parlant ainsi, je ne vise pas d’abord les groupes dits charismatiques. Ce ne sont, pour moi, que des manifestations plus spectaculaires, et parfois contestables, d’un mouvement spirituel plus général qui, à mes yeux, est beaucoup plus important. Seuls ce mouvement, cette aspiration et ce goût pour le retour à Dieu méritent d’être regardés comme un véritable signe de notre temps. Il est aisé de discourir à perte de vue sur les signes du temps. Les découvrir sur le vif et les prendre au sérieux le moment venu est beaucoup plus difficile. Soyons donc très attentifs aux nouveaux phénomènes que je viens d’évoquer. Une comparaison peut être instructive à ce sujet.
Les années 1930-1960 se sont caractérisées par un essor exceptionnel de l’Action catholique. On peut y voir comme la manifestation, en climat chrétien, du » militantisme » qui, sous divers vocables, animait alors nombre de mouvements politiques, sociaux ou syndicaux. Cette tendance est toujours vivante. Mais une autre tendance semble s’affirmer, également tributaire, en partie du moins, d’un aspect plus caractéristique du temps présent. En effet, contre un univers destructeur des personnes, nos contemporains cherchent à se retrouver eux-mêmes au plus profond de leur être. De plus en plus nombreux sont ceux qui, quelles que soient leur religion ou leur idéologie, font appel à des techniques d’intériorisation orientale : méditation transcendantale, Zen, Yoga, etc. Laissons de côté ces méthodes. Je pense que le désir de prière plus intérieure que l’on constate dans la nouvelle génération chrétienne n’est pas totalement étranger à ce fait plus général. Ce serait, dans l’Eglise et au niveau spirituel qui lui est propre, la manière privilégiée pour l’homme de redevenir lui-même. Comme quelqu’un l’a dit si magnifiquement: » Je ne suis que si Dieu me tutoie. » La prière est cherchée et vécue comme le lieu privilégié de cette interpellation. Elle permet en fait à l’homme moderne attaqué de toutes parts de s’ouvrir de manière décisive à l’existence, et même à l’existence en plénitude.
Pour la plupart des jeunes qui viennent à nous, l’oraison, la méditation, la prière personnelle ne sont pas des abstractions. Certains d’entre eux ont participé à des groupes de prière : une heure, deux heures et plus dans l’écoute silencieuse de la parole de Dieu, un partage d’idées sur le texte sacré ou à propos de la vie quotidienne, une rumination intérieure, une respiration commune dans le souffle de l’Esprit Saint.
Tout cela peut être malhabile, impur, durer autant qu’un feu de paille. La sensibilité et l’imagination peuvent y prendre trop de place ; ceux qui en jouissent se croient » arrivés « . Reste que c’est leur expérience. L’Esprit a fait son chemin, parmi ces broussailles et l’appel de Dieu a surpris ces jeunes dans cet état de veille. Ce qu’ils attendent alors de la communauté qui les reçoit, c’est d’être accueillis tels qu’ils sont, avec cette marque divine en eux.
Comment va-t-on écouter leurs confidences ? Avec un sourire entendu ? L’air distant et sceptique, au risque de blesser ce qu’ils considèrent comme le plus précieux en eux ? De fait, sommes-nous tentés de penser : les jeunes peuvent-ils découvrir quelque chose de solide dans un domaine si réservé ? Mais, ce ne sont pas des prêtres, des docteurs chevronnés en spiritualité qui ouvrirent ces nouveaux sentiers de prière. Ce sont le plus souvent des jeunes qui ne sont pas clercs et dont la plupart n’aspirent pas à le devenir. L’Esprit Saint souffle où il veut. Qu’avons-nous alors à leur offrir ?
Il y a l’Office, il y a la Messe. Avons-nous vraiment compris que la » Liturgie des Heures » n’est pas une édition revue et corrigée de l’ancien bréviaire. Mais, en rigueur de termes, une manière inédite de prier avec l’Eglise. Silence, partage des intentions… Savons-nous profiter de toutes les possibilités que nous offre la liturgie post-conciliaire ? Combien hélas ! n’arrivent pas à dépasser une fidélité trop uniquement matérielle dans une prière qui devrait être digne de la présence de Dieu et provoquer une union des coeurs à sa Gloire. Mais il est un autre aspect que je voudrais souligner.
Ecoute de la Parole, prière partagée : ce sont quelques-uns des nouveaux mots de notre vocabulaire chrétien. Les novices et postulants pensent retrouver chez nous quelque chose – beaucoup plus même – de ce qu’ils ont vécu, dans le monde. Que leur offrirons-nous ? Ne vont-ils pas recevoir… beaucoup moins, être fortement déçus ? Ou alors, ce sera en marge de la communauté, avec quelques initiés, dans un petit oratoire ou une cellule à l’écart.
Je vous dois une confidence. La première fois que j’ai participé à un » partage d’Évangile » – il y a plus de douze ans – c’était… avec des prêtres du clergé diocésain. Dans la suite, j’ai eu l’occasion de revivre un certain nombre de fois cette expérience, mais toujours avec des prêtres séculiers. Il m’a fallu attendre, j’ai honte de le dire, sept longues années avant de connaître de semblables échanges avec mes propres frères. C’était au cours d’une visite canonique, j’accompagnais le Père Aniceto Fernandez, alors Maître de l’Ordre. Ces dominicains étaient des prêtres-ouvriers. Faut-il penser que leur commun engagement au niveau des mêmes réalités – et quelles réalités ! – leur rendait vraiment plus spontanée une prière que je n’avais jamais vécue jusque-là à l’intérieur de l’Ordre ?
Je résume ces considérations :
· Non pas d’abord des prières, mais un vrai climat de relation à Dieu qui crée une atmosphère.
· Non pas uniquement des formules stéréotypées, mais des coeurs et des vies qui s’ouvrent et qui s’expriment.
· Non pas seulement des paroles, mais une rencontre avec lieu et avec ses frères dans le silence.
Une communauté à l’écoute des hommes d’aujourd’hui
Rien n’est étranger à l’Evangile. Il est lumière pour la vie personnelle et familiale, pour l’organisation d’une société plus juste, la défense de la personne, l’épanouissement de l’homme en relation avec ses semblables et avec l’univers. C’est par référence à cette dimension » mondaine » qu’on peut parler d’ » Évangile intégral « . Les jeunes sont particulièrement sensibles au rôle de l’Église en ce domaine. Leur vocation en est nécessairement marquée et personne ne songerait sérieusement à le leur reprocher.
Cette nécessaire présence des religieux et religieuses au monde actuel doit être l’une de nos préoccupations majeures. Qu’il s’agisse d’une communauté ou d’individus, la tentation est si grande de continuer à faire ce qu’on a toujours fait. Les choses étaient fort différentes il y a vingt, trente, cinquante ans et plus. Le monde ne changeait guère – en tout cas pas avec la rapidité que nous connaissons aujourd’hui – et la manière d’aborder les problèmes, qu’il n’avait pas été difficile de dénombrer une fois pour toutes, était toujours la même. Nous vivons aujourd’hui un moment où le péché d’omission, pour ne parler que de lui, augmente, chaque jour, en nombre et en gravité, l’homme tenant entre ses mains les moyens de changer beaucoup de choses dont il était hier la victime impuissante. Il est capable d’orienter le monde dans un autre sens : détruire l’homme ou le grandir, faire sauter la planète ou la rendre plus accueillante, augmenter ou réduire l’écart entre les démunis et les nantis. Devant une pareille situation, les professionnels de l’Évangile doivent être en un état d’alerte permanente.
Toutes ces questions, et combien d’autres ! qui devraient retentir continuellement à nos oreilles, et être objet de réflexions dans les communautés qui se veulent vivantes. Dans ce quartier, cette ville, ce village, cette région, où sont les hommes qui préparent le monde de demain ? Au 198 siècle, l’Eglise a perdu la classe ouvrière – ce sont les Papes qui l’ont dit. Ouel groupe d’hommes, quelle classe, quel secteur du monde sommes-nous aujourd’hui en train de perdre ? Les techniciens après les ouvriers ? Les femmes après tant d’hommes ? Les enfants après les adultes ?
Presque tous les grands fondateurs d’Instituts religieux se sont posé des questions semblables en leur temps. La découverte de tel ou tel secteur de misère – physique, intellectuelle, morale, religieuse – les a bouleversés. Ils ont voulu y répondre et sont devenus fondateurs. Ai-je besoin d’ajouter que nos jeunes scrutent nos faits et gestes en ce domaine. Ils nous attendent, avec quelle attention et quelle espérance aussi, au tournant de nos choix et de nos décisions. C’est pour eux comme un baromètre qui ne les trompe pas. Le recrutement en dépend en partie.
Il est un fait que nous constatons souvent. Il y a d’une part des congrégations qui recrutent et, même si les nouveaux ne sont pas en grand nombre, celles-ci augmentent progressivement. Il est des congrégations qui au contraire voient leurs vocations diminuer, et diminuer de plus en plus. On songe à la parole du Seigneur: » A celui qui a, on donnera ; et à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a » (Mc 4, 25). S’il en est ainsi, n’est-ce pas parce que, à l’encontre des secondes, les premières sont plus sensibles à des besoins actuellement ressentis ? La vie appelle alors la vie ; l’inadaptation au milieu, ici comme partout, produit la mort. Cette réflexion ne prétend pas éclairer définitivement le délicat problème du recrutement religieux. Du moins mérite-t-elle attention. La nécessité d’être à l’écoute des hommes pose une autre question. Etre à l’écoute du monde suppose qu’on lui soit présent dans la connaissance de ses problèmes, et dans la communion avec tous ceux qui se les posent et qui souffrent de leur situation :les plus pauvres, les chômeurs, les migrants, etc. Il est du devoir des chrétiens, et singulièrement des religieux, d’être proches de ces problèmes et de ces personnes. L’Evangile contient des enseignements et ouvre des perspectives que nous n’avons pas le droit d’ignorer. Nous devons les faire connaître et aider les hommes à traduire cette doctrine face aux situations concrètes qui sont les leurs.
Attention cependant au » pouvoir de récupération » du monde. Plongés dans ces milieux, en communion et en connivence avec eux, nous risquons de nous faire absorber et même de nous laisser engloutir. On ne vit plus la distance, les ruptures sans lesquelles la vie religieuse se dilue. Et cela, au nom de l’Evangile qui prêche la justice et la miséricorde, qui condamne le publicain voleur comme le pharisien satisfait, chasse les marchands du temple, défend la veuve et l’orphelin. Autant d’exigences évangéliques qui sont d’ordre proprement social. On peut parler tout le temps de l’Evangile, mais n’en voir que l’aspect sociologique. L’Évangile, comme comportement social, n’est qu’un aspect de l’Évangile intégral. Il en est un autre, premier celui-ci : l’Évangile comme attitude intérieure, comme relation à Dieu, à la prière, à la rupture avec le monde ; l’Évangile comme pauvreté, chasteté et obéissance.
II y a quelque temps un supérieur provincial me parlait de quelques-uns de ses religieux, engagés à fond dans un bas quartier, et qui aidaient des émigrants à trouver du travail et à améliorer leur situation misérable. Au bout de quelque temps, ces religieux se sont interrogés : » Nous n’avons ni femme, ni enfants. Mais, à part cela, qu’est-ce qui nous distingue de nos voisins ? » Et ils se sont remis à prier. Cas extrême sans doute et nous aurions tort de penser que le danger de récupération par le monde n’existe que dans les bas quartiers. Il est partout ; il imprègne – et imprégnera de plus en plus – le monde. Un rééquilibrage sera de plus en plus nécessaire. Ce qui est déjà difficile pour la génération présente, le sera encore plus pour celles qui suivront. Montrons aux jeunes des communautés à l’écoute èt du monde et de Dieu. Former les jeunes, ce n’est pas avant tout les protéger d’un monde difficile. C’est, avec la circonspection et les coupures nécessaires, leur apprendre à l’affronter. Ce sont des communautés vivantes, et non pas seulement des conseils et un enseignement abstrait, qui leur apprendront à aller vers le monde qui les attend, non pas les mains nues, mais avec la croix du Christ aimée et contemplée.
IV. Des jeunes qui s’intègrent dans une communauté
Climat de renouvellement évangélique et de prière vraie, communauté à l’écoute des hommes : je viens d’évoquer le lieu idéal que cherchent les candidats à la vie religieuse. Ils ne le trouveront pas… Dieu veuille qu’ils rencontrent beaucoup de communautés qui s’en approchent, ou au moins qui tendent à l’être. Ce serait déjà signe de vraie vie.
Comment la communauté, considérée en elle-même, est-elle formatrice ? Entre parenthèses, je parle du rôle formateur de la seule communauté et non de la fonction du Père Maître ou de la Mère Maîtresse. N’en concluez pas – comme on le fait assez souvent aujourd’hui : » Il n’y a pas besoin de Père Maître ou de Mère Maîtresse. C’est la communauté en son ensemble qui est responsable de la formation. » Non, car le Père Maître ou la Mère Maîtresse sont le chemin… Fermons la parenthèse. A ses tout débuts, la formation doit viser trois choses une première évaluation de la vocation, une initiation à ce qu’est la vie religieuse – l’une et l’autre exigeant une part d’enseignement et une part de dialogue, surtout avec le Maître des novices -, et troisièmement, une intégration dans la communauté. Intégration : voilà le rôle spécifique de la communauté dans la formation.
C’est sur le seuil de sa maison qu’on accueille quelqu’un – même si, dans la suite, on doit continuer à accueillir ce nouvel hôte, au fur et à mesure qu’on découvre les différents aspects de sa personnalité. Avec le temps, l’accueil se fera plus large, plus chaud. L’hôte se sent de plus en plus chez lui : » Faites comme chez vous. » Il est devenu membre de la famille – pour nous, de la communauté. Il s’y est intégré.
Il est difficile d’évoquer une opération qui, pour une bonne part, est inexplicable. Apprivoisement mutuel, dialogue le plus souvent sans paroles entre la communauté et le postulant qui désire de plus en plus se faire accepter – car ici le vécu l’emporte de beaucoup sur le dit. Peu à peu, la communauté découvre dans le nouveau venu une personnalité en qui elle croit se reconnaître. Le postulant ou le novice prend de plus en plus part à la vie de l’ensemble, aide les autres de son travail, de son attention et de ses prévenances. Ses bévues témoignent surtout de sa bonne volonté et de l’affection qu’il commence à ressentir pour les autres. Il épouse les peines et les préoccupations de la communauté, devient solidaire de ses projets. De plus en plus, il a conscience de faire partie de la maison ; et on le considère comme l’un de ses membres. Sans trop s’en rendre compte, lui-même parle moins de moi et de vous ; il emploie, de plus en plus, la première personne du pluriel : nous. Ceci nous amène à faire deux remarques.
Je n’insisterai pas sur le caractère progressif d’une véritable intégration. Il faut aller au pas de chacun : celui de l’intéressé bien sûr, le pas de la communauté, mais – par-dessus tout – le pas de Dieu.
La seconde remarque concerne les rapports entre le groupe des novices et le reste de la communauté. Il faut avouer qu’à ce sujet, on est passé d’un extrême – l’ancien noviciat juxtaposé à la communauté – à un autre extrême – le noviciat noyé dans la communauté. Dans ce dernier cas, faute d’être progressive, l’intégration ne peut jouer son rôle formateur.
S’il est sans cesse avec ses aînés, partage leur vie en tous leurs événements, communie à leurs projets et à leurs doutes, écoute leurs confidences, s’il est considéré par les autres religieux à l’égal d’eux-mêmes, le novice n’aura pas le recul nécessaire pour examiner s’il est à sa place et prendre conscience de la vérité de sa vocation. II risque de se passionner pour les problèmes des anciens, d’épouser leur mentalité ; il ne traitera de ses propres problèmes que de manière transitoire. Si une juxtaposition trop poussée des deux groupes a quelque chose d’infantilisant – les jeunes étant totalement coupés de la vie réelle, présente et future -, il y a quelque chose de dépersonnalisant dans l’autre cas. Il faut du temps pour apprendre à s’intégrer sans se fondre.
Bien menée, l’intégration est source et critère de maturation. Dans son déroulement comme dans ses motivations, elle provoque ou freine l’approfondissement d’une personnalité et manifeste son évolution réelle.
On rencontre des novices qui veulent tout de suite s’imposer. Du jour au lendemain, ils se considèrent comme membres, à part entière, de la communauté. Ces envahisseurs devront se faire pardonner leur indiscrétion ; la communauté sera longue à les accepter, si elle y consent. Il y a les timides, les complexés qui restent en marge et ne se réveillent que très lentement. Les deviner n’est pas toujours facile. Il ne faut pas les juger trop vite. Il y a ceux qui, par crainte d’être éliminés ou pour avoir la paix avec les supérieurs, » font » tout ce qu’il faut faire. L’intégration risque d’être superficielle. On s’apercevra plus tard – trop tard peut-être -qu’il n’y avait pas grand-chose derrière la façade. Il y a enfin – mais on pourrait continuer – les fortes personnalités, ceux qui ont du caractère. Et parfois, leur façon d’avoir du caractère, c’est de l’avoir mauvais, du moins au jugement des responsables qui pensent que la vertu cardinale du novice, c’est d’être en tout un modèle de passivité.
Sans doute, l’intégration du nouveau venu est loin de suivre la ligne rectiligne que j’ai tracée. Il y a des hauts et des bas, des crises et des éclats. Malgré cela et surtout à cause de cela, elle est indispensable à la formation. Mais ses difficultés mêmes posent un problème, dont je ne puis malheureusement parler: celui de la composition de la communauté qui reçoit.
V. Une communauté qui écoute le message des jeunes, en discerne le sens et accepte de se mettre en cause
Deux hommes de l’âge des cavernes, vêtus de peaux de bête, sont assis à l’entrée d’une grotte. Ils contemplent un assemblage d’objets, plus hétéroclites les uns que les autres, faits en pierre, en os ou de terre. L’un d’eux déclare d’un air désabusé : » La recherche, c’est fini comme métier. Tout a été inventé. » Cela me rappelle cette parole qui semble venir directement de l’Ecclésiaste : » Tout est dit et l’on vient trop tard. » Mais l’histoire nous apprend à corriger ces jugements. Il faudrait plutôt invertir cette phrase : » Rien n’est dit, et l’on vient trop tôt. » Trop tôt, parce que ceux qui entendent du neuf ne veulent pas l’accepter et brûlent le messager. Rien n’est dit, parce qu’il y a toujours du nouveau à découvrir. Si » rien n’est dit » , pourquoi les jeunes eux-mêmes n’auraient-ils pas quelque chose à nous apprendre, ou au moins, ne pourraient-ils pas nous alerter sur les nouveautés qu’ils » sentent » ?
N’en concluez pas que pour moi ils ont le privilège de l’Esprit Saint. Mais, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit, entre autres choses, sur le désir de prier et la nécessité d’une écoute du monde, comment ne pas prendre garde à ce qu’ils nous disent ? Sans doute le font-ils parfois avec maladresse, voulant que nous acceptions tout les yeux fermés et ne départageant pas le vrai du contestable. Du moins, nous invitent-ils à prendre conscience des nouveaux acquis, à ouvrir tout grands nos yeux et, ce qui n’est pas le moins important, à ne pas nous assoupir. C’est Nietzsche quia dit » Bienheureux les assoupis, car ils ne dormiront pas. » Il faut toujours craindre de s’endormir avant l’heure. Ce serait donc manquer à la vérité et pécher par anachronisme que de nous boucher les oreilles, par principe, à tout ce qu’avancent nos nouveaux venus.
Encore faut-il garder le sens critique et savoir séparer le blé de l’ivraie. La communauté n’est-elle pas le lieu le plus approprié pour cette opération ? Ce sera alors faire oeuvre de discernement personnel, et de discernement communautaire. Les jeunes pourront y exposer leurs points de vue. La communauté tout entière verra ce qu’il convient d’accueillir et d’intégrer. Occasion exceptionnelle d’écoute réciproque, d’accueil, comme aussi d’enrichissements mutuels ; et, pour les plus jeunes, manière de formation et effort d’intégration.
Je ne me fais aucune illusion sur ce qu’a d’idéaliste une telle perspective. Mais les progrès se nourrissent d’utopies. Ce qui nous manque le plus, quand il s’agit d’un renouvellement de vie commune, comme en toute chose d’ailleurs, c’est ce qu’on peut appeler la » politique du petit doigt » : mettre celui-ci dans l’engrenage et, peu à peu, la main se fait prendre, puis le corps, puis la communauté tout entière : celle-ci en est transformée… » Voyez ! Ou’il est bon… » (Ps 133, 1).
Dialoguer et discuter ne suffisent pas. Chacun doit être prêt à se » mettre en cause « , c’est-à-dire s’examiner soi-même (et pas seulement les autres) sous un nouvel éclairage. Mentalité, culture religieuse ou professionnelle, nouveaux champs d’apostolat, etc. Remuer tout cela en commun approfondit les liens qui font une communauté, la rend plus vivante, plus accueillante. Les jeunes attendent tellement cela ! Et puis, prendre nos frères et nos soeurs à témoin de nos découvertes et de nos décisions sera pour nous une force.
Oui, il y a beaucoup à chercher et beaucoup à découvrir. Il ne s’agit point d’absolutiser la recherche – ce mot qui donne parfois la nausée aujourd’hui, tellement on en abuse -, mais bien de lui donner sa place et son sens. Alors, nous serons tous, et tous ensemble, plus capables d’être, dans l’Eglise et pour le monde, le visage et la bouche de celui qu’on a appelé, avec raison, » le plus contemporain de tous les hommes » , Jésus-Christ.
VI. Des jeunes qui acceptent de compromettre leur vie avec l’institut dans l’espace et dans le temps
Il n’est pas question d’étudier ce point qui à lui seul mériterait un exposé spécial. Jadis, » compromettre sa vie » avec l’Institut était une chose, au fond, assez facile. En ce sens qu’on connaissait, avec assez de précisions, les conditions de vie et le type précis d’apostolat auxquels on s’engageait pour la vie. Il n’en est pas exactement de même aujourd’hui. Le problème me semble se poser dans le contexte suivant
Un Institut a des oeuvres déterminées (paroisses, aumôneries, écoles, hôpitaux, etc.) que le passé a léguées au présent. Les années qui viennent (dix ans, et même davantage, si le nombre des vocations ne remonte pas fortement) verront, par conséquent, une sérieuse diminution des effectifs. Comment tenir ces postes ?
Au même moment, la plupart des diocèses auront à affronter un problème semblable. Beaucoup demanderont des religieux-prêtres une aide dont ils n’avaient pas tellement besoin dans un passé récent. Compte tenu du charisme de chaque Institut, comment répondre à la demande et de quelle manière ?
Durant la même période, des besoins nouveaux se feront certainement sentir (nouveaux champs d’apostolat et méthodes d’évangélisation, importance accrue des moyens de communications sociales, problèmes de » Justice et Paix « , etc.). Qui va s’adonner à ces nouveaux ministères ? Faudra-t-il laisser certains postes tenus par nous aujourd’hui ? Qui les prendra ?
Demain et après-demain, les jeunes devront normalement subvenir à la subsistance de leurs aînés, plus nombreux que jadis du fait d’une plus grande longévité. Cette exigence ne risque-t-elle pas de peser excessivement sur le choix des engagements apostoliques, le point de vue économique l’emportant sur l’aspect apostolique ?
Ces questions, les jeunes se les posent avec de plus en plus d’acuité. Se compromettre avec un Institut, c’est se compromettre avec sa province, avec d’autres provinces, avec la Congrégation ou l’Ordre tout entier, avec l’Eglise universelle, ainsi qu’avec les différentes Eglises locales où l’on est appelé à travailler. C’est dire qu’en acceptant de compromettre leur vie avec l’Institut de leur choix, les postulants ne doivent pas refuser d’avancer dans une obscurité que la plupart de leurs devanciers n’ont pas connue. Leur sens du propos du fondateur et du service de l’Eglise doit être d’autant plus profond, sous peine de mettre en cause, à plus ou moins brève échéance, la spécificité et l’existence même de l’Institut.
Le gouvernement des Prêcheurs (1977)
fr. Vincent de Couesnongle, o.p.
 Les spécialistes du droit constitutionnel ont souvent reconnu une haute qualité, non seulement en formulation juridique mais en valeurs de vie aux constitutions par lesquelles saint Dominique et ses premiers disciples ont exprimé la nouveauté et les structures essentielles du nouvel Ordre. Comme l’a dit heureusement le Père M. D. Chenu, « Dominique et ses premiers frères furent, d’instinct, des maîtres en institution évangélique ».
Les spécialistes du droit constitutionnel ont souvent reconnu une haute qualité, non seulement en formulation juridique mais en valeurs de vie aux constitutions par lesquelles saint Dominique et ses premiers disciples ont exprimé la nouveauté et les structures essentielles du nouvel Ordre. Comme l’a dit heureusement le Père M. D. Chenu, « Dominique et ses premiers frères furent, d’instinct, des maîtres en institution évangélique ».
Communion et mission : ces deux réalités sont indissolublement liées chez nous et définissent notre manière de « suivre le Christ ». A l’encontre d’autres Instituts qui privilégient l’un ou l’autre aspect, l’Ordre veut tenir la balance égale, à l’image de l’Église qui est à égalité communion et mission. Comment s’étonner alors qu’elles configurent notre type de gouvernement ? Si, avec des fortunes diverses, l’Ordre a maintenu au cours de son histoire le propos de saint Dominique et rempli sa fonction de service de l’Évangile, cela vient en grande partie de la force mystérieuse de la présence de saint Dominique à la conscience de ses frères. Comment ne pas citer la célèbre phrase de Bernanos? : « (…) s’il était en notre pouvoir de lever sur les oeuvres de Dieu un regard pur, l’Ordre des Prêcheurs nous apparaîtrait comme la charité même de saint Dominique réalisée dans l’espace et dans le temps, comme sa visible oraison. » Mais il est sûr que, d’un point de vue plus humain, cela s’explique aussi par la nature des institutions qui le gratifient, comme le dit la Constitution fondamentale, d’un « gouvernement communautaire particulièrement apte à promouvoir l’Ordre et à le rénover fréquemment « .
Une dialectique : mission universelle/communion
Dans l’équilibre architectural de l’institution dominicaine, une première constatation s’impose : tout y est orienté vers une députation totale à la prédication évangélique. Ce qui nous saisit alors c’est, à côté d’une forme de « radicalité » commandée par l’urgence de la tâche, un certain « organicisme », car pour répondre à sa propre raison d’être et assurer sa survie, le charisme dominicain s’inscrit et s’explique dans un type déterminé d’institution.
Cette interaction entre communion et mission – qui d’ailleurs rejoint en partie la distinction « vie religieuse » et « apostolat » – se déploie dans « la collaboration organique et équilibrée de toutes les parties dans la visée de la fin de l’Ordre ».
Au niveau le plus élémentaire, nous trouvons la fraternité conventuelle. Celle-ci se construit, non pas selon la juxtaposition des individus, mais selon une structure et une éthique communautaires. Son destin ne se joue pas dans l’addition d’énergies individuelles, mais dans une vie et des engagements collectifs qui veulent permettre de « libérer » la grâce propre à chacun à l’intérieur du charisme du tout.
En second lieu – et d’une façon tout aussi capitale – cette collaboration organique se réalise dans les diverses communions qui développent leurs richesses grâce à l’influence réciproque qu’elles ont les unes sur les autres communion de couvents constituant des provinces et des vicariats (ou embryons de provinces); communion des provinces constituant l’Ordre des frères; enfin, au niveau plus large, communion des frères, moniales, soeurs, fraternités laïques et même sacerdotales, le tout donnant à l’Ordre son profil plénier et réalisant ce qu’on aime appeler aujourd’hui la » famille dominicaine « .
Si cette dernière expression couvre une diversité que saint Dominique n’a pas connue, les réalisations nouvelles qui se sont ajoutées avec les siècles – pensons spécialement aux congrégations de religieuses qui n’existaient pas alors – sont nées de la fécondité du charisme fondateur de saint Dominique. Qu’on ne s’y trompe pas, parler de famille dominicaine, ce n’est pas désigner une quelconque association dont les membres, reconnaissant le même patronage, seraient heureux de se rencontrer. « Famille dominicaine » : ces deux mots veulent affirmer quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus exigeant. C’est la conviction que ce n’est pas seulement à l’intérieur de sa propre branche, et encore moins individuellement, que notre charisme se réalise pleinement. Pour se déployer et donner tous ses fruits, il a besoin de tous. La collaboration effective de tous multiplie les richesses de chaque branche. Parler de la famille dominicaine, c’est faire prendre davantage conscience que la communion qui unit les frères et soeurs de saint Dominique doit dépasser par la prière, l’apostolat et le témoignage de la vie, les limites de nos communautés, chacun apportant à l’ensemble sa richesse propre en vivant pleinement le charisme de la branche dont il fait partie.
Pouvoir et niveaux de gouvernement
Le pouvoir qui régit et coordonne cet ensemble est universel dans sa tête ou son principe : le chapitre général et le Maître de l’Ordre. Sous des noms divers, l’institution des chapitres généraux est commune aux familles religieuses. Dans l’Ordre des Prêcheurs, elle se caractérise par plusieurs originalités qui s’expliquent par la » mentalité dominicaine » et ont de grandes conséquences dans notre gouvernement. II s’agit d’abord de la composition. On distingue entre les chapitres généraux de provinciaux et les chapitres généraux de définiteurs. Les premiers regroupent les responsables de chaque province, ceux qui sont donc affrontés à des problèmes d’organisation, d’animation religieuse et apostolique, d’administration, etc. Les chapitres de définiteurs comprennent, un par province, des frères venant de la base et mandatés par celle-ci. Le fait que les provinciaux ne puissent être membres de ce chapitre manifeste le désir de l’Ordre de donner la parole – et le pouvoir – aux religieux qui, n’étant pas à la tête d’une province, voient les problèmes concrets d’une manière plus dégagée et manifestent plus d’imagination et de volonté de renouvellement.
Ces deux types de chapitre, qui ont exactement les mêmes pouvoirs, alternent, tous les trois ans, dans une proportion que, a priori, on n’attendait pas : deux chapitres de définiteurs pour un chapitre de provinciaux. Cette alternance risquerait d’avoir de graves inconvénients si chaque chapitre avait à lui seul pouvoir de faire des lois, le chapitre suivant s’empressant de voter des lois contraires. Pour éviter une instabilité nuisible et valoriser davantage notre législation, il est stipulé que, pour avoir valeur de loi, un projet doit être adopté par trois chapitres successifs. Si notre législation majore l’ » imagination » en donnant le primat aux chapitres de définiteurs, celle-ci est comme » bridée » par l’obligation de trois chapitres successifs. Certains s’interrogeront sur la valeur d’un tel système. La réponse est brève : il a traversé les siècles puisqu’il remonte à saint Dominique; de plus, en partie pour cette raison, l’Ordre n’a jamais connu de divisions comme tant d’autres et l’Église n’a jamais songé à nous imposer un autre système.
Le chapitre général est au sommet du gouvernement et, comme instance en acte, il a pleins pouvoirs. A chaque chapitre, le Maître général, élu pour neuf ans, rend compte de sa gestion; sa façon de gouverner et sa » politique » peuvent donc être jugées et mises en cause. Si, entre deux chapitres, il jouit d’une certaine liberté dans son gouvernement (liberté accrue du fait que, contrairement à ce qui se passe dans la grande majorité des Instituts, ses assistants ou conseillers ne sont pas nommés par le chapitre général, mais par lui personnellement sur présentation des provinces), la fréquence des chapitres généraux fait qu’il reste proche des instances suprêmes et communautaires de l’Ordre.
Cette concentration du pouvoir, qui différencie nos chapitres généraux des assemblées parlementaires au sens moderne du terme, ne s’exerce pas seulement en termes institutionnels ou juridiques, » comme une machine à faire des lois ou à prendre des « ordinations » « . Tout chapitre a aussi une fonction « prophétique ». Ayant » à discuter et décider de tout ce qui concerne le bien de tout l’Ordre », il doit procéder à une évaluation de l’organisation et de la vie de l’Ordre. Ainsi il éveille la conscience collective des frères sur tous les problèmes et réalités qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, affectent leur vie et leur apostolat, – qu’ils soient d’ordre religieux, culturel, théologique, social ou même politique. De cette analyse et de cette lecture en termes de » signes des temps « , dépend en effet la réalisation de l’authentique mission évangélisatrice de l’Ordre.
Comment ne pas relever ici l’importance donnée progressivement, avec les cinq derniers chapitres généraux, aux « Prologues » mis en tête des divers secteurs abordés vie liturgique et prière, études, ministère de la Parole, Famille dominicaine, etc. C’est ainsi que, à Quezon City en 1977, dans un long et beau texte concernant « notre tâche apostolique dans le monde actuel », le chapitre général a dégagé les points névralgiques de la mission des Prêcheurs à l’heure actuelle, en insistant sur la nécessaire attention aux dynamismes socio-culturels du monde, aux problèmes de la justice et de la promotion humaine, au domaine des mass media.
Ainsi nos chapitres généraux assurent une fonction de gestion institutionnelle et développent une stratégie globale indispensable à la vocation universelle de l’Ordre. Ce faisant, ils stimulent tous ceux qui se reconnaissent en saint Dominique, même les religieuses de vie active, qui cependant ne dépendent juridiquement ni du Maître de l’Ordre, ni des chapitres généraux.
Qu’ils s’agisse de législation, de compte rendu, d’animation, de vie et d’action, saint Dominique a voulu que, d’une manière ou d’une autre, tous les religieux y participent. C’est l’application de l’adage classique du haut moyen âge : Ce qui touche tout le monde, tout le monde doit en traiter. A tous les échelons de la communauté dominicaine, on retrouve ce même principe, mais est toujours prévue une intervention supérieure, au moins transitoire, qui assure l’équilibre des pouvoirs. Le manifeste la manière dont le prieur conventuel, élu pour trois ans, prend possession de sa charge. La communauté élit le prieur, mais pour être nommé prieur, l’élu a besoin de la confirmation du provincial. De même, à l’étage supérieur, le provincial élu doit être confirmé par le Maître général. On comprend mieux alors que, si saint Dominique et ses successeurs ont eu à se soumettre à la régulation de la communauté fraternelle, leur autorité n’en a pas été amoindrie.
Le lien constitutif de la communauté dominicaine est un lien de profession religieuse qui lie chaque frère, chaque moniale et même chaque membre des fraternités laïques au Maître général (mais non les religieuses de vie active qui n’en dépendent pas juridiquement). Conjointement aux chapitres généraux, le Maître de l’Ordre est le garant de la fidélité à l’intuition de saint Dominique, le principe de l’unité de l’Ordre, le » référent » immédiat de chacun de ses membres. C’est dire l’importance des relations directes entre lui et chacun des frères, dans les visites régulières des couvents et des provinces, comme dans les rencontres et lettres individuelles.
Le même type de gouvernement se rencontre au niveau de la province et des couvents
Gouvernement général, gouvernement provincial puis conventuel : on se tromperait en croyant que chacun des étages inférieurs reçoit un pouvoir délégué du degré supérieur. On aurait alors une vue monarchique – et non communautaire – de l’Ordre. A leur niveau propre, ces différentes entités sont dotées d’une réelle autonomie. Ainsi le prieur d’un couvent n’a pas à recevoir du prieur provincial un pouvoir spécial pour donner l’habit ou recevoir une profession. Il l’a du fait même de sa charge. Cela ne veut pas dire pourtant que l’Ordre soit constitué de couvents sans lien juridique avec la province dont ils font partie. Qu’on se souvienne de ce qui a été dit plus haut de l’intervention du provincial dans la nomination d’un prieur élu. Si le religieux est, selon l’expression consacrée, » d’une province, et non du couvent où il vit, le couvent est la cellule de base de l’Ordre. C’est là en effet que les religieux doivent trouver tous les éléments qui leur permettent d’être pleinement frères prêcheurs, car c’est à ce niveau que » communion et mission » trouvent leur terrain nourricier et leur champ d’apostolat.
Selon la formule traditionnelle, le prieur est, par rapport aux frères de son couvent, « primus inter pares » (premier parmi des égaux); formule dominicaine s’il en est! Elle dit assez les liens fraternels qui le caractérisent tout en sauvegardant son autorité. Pour élire le prieur, organiser la vie du couvent, lui donner vitalité interne et rayonnement, les frères d’une communauté se constituent en chapitre conventuel. C’est là que se réalise une confrontation fraternelle au service de la Parole de Dieu et qu’est assurée une co-responsabilité créatrice d’un élan commun. Sans elle, il pourrait y avoir une » entité juridique « , mais il manquerait cette » communion apostolique » – au sens le plus fort de l’un et l’autre terme – caractéristique de l’Ordre.
Tous les quatre ans, chaque chapitre conventuel envoie au chapitre provincial son prieur avec un, deux ou plusieurs délégués selon le nombre de frères. L’ensemble constitue le » chapitre provincial » chargé d’élire le prieur provincial et les « définiteurs » (entre 4 et 8) du chapitre provincial. Il appartient à tous les membres du chapitre d’analyser la situation de la province, de prendre connaissance des desiderata et critiques de tous les religieux, d’étudier les problèmes de la province et de proposer décisions et orientations à prendre. Le prieur provincial et les définiteurs ont la tâche de se prononcer sur celles-ci et de les soumettre à l’approbation du Maître général.
Précision sur le régime » démocratique » de l’Ordre
Cette première précision concerne le régime, disons politique, de l’Ordre. On dit souvent que notre régime est démocratique. C’est vrai dans la mesure où nous intervenons tous dans notre gouvernement. Parler ainsi laisse pourtant échapper la part la plus fondamentale de celui-ci. L’Ordre est une réalité originale, d’ordre évangélique, donc du Royaume de Dieu qui fait de nous des frères. Pour mettre en oeuvre ce type de vie, on a recouru à certaines structures qui, en science politique, sont dites démocratiques, où la souveraineté appartient à l’ensemble des citoyens. Ces mêmes structures ont été utilisées pour donner forme institutionnelle à la fraternité dont parle le Christ : « Pour vous, ne vous faites pas appeler Maîtres, car vous n’avez qu’un Maître et tous vous êtes des frères »(Mt 23,8). Dès lors, qu’on ne s’étonne pas si le gouvernement d’un institut religieux – et singulièrement le nôtre -dépasse de manière importante les types de gouvernement civils, qu’ils soient démocratiques, monarchiques, etc. Cela n’est pas sans conséquences dans le fonctionnement de cette » démocratie religieuse « .
La loi fondamentale de la démocratie, c’est la loi de la majorité. Il n’en est pas ainsi chez nous où pourtant les votes sont nombreux. Notre loi propre est la loi de l’unanimité. Au chapitre conventuel – et il en est de même aux chapitres provinciaux ou généraux – , le prieur, loin de se satisfaire d’un vote précipité, doit permettre une large information, susciter une recherche commune et provoquer un débat de telle façon que l’on tende à un avis aussi unanime que possible. Cette recherche d’unanimité – même si l’on n’y arrivera sans doute pas – garantit la présence du Seigneur et de son Esprit et, par le fait même, oriente plus sûrement vers la découverte de la volonté de Dieu. De même, à Vatican II, Paul VI a fait retarder certains votes pour favoriser une plus grande entente et éviter que des décisions soient prises seulement à la majorité. Il est inutile d’insister sur ce qu’une telle recherche exige de chacun et de la communauté tout entière. Mais c’est le lieu où se vérifie par excellence la justesse de ce que le Frère prêcheur veut vivre et annoncer. Faute de quoi, l’appareil complexe et si riche de virtualités risque de tourner à vide. Et les couvents, au lieu d’être des fraternités d’hommes qui vivent de la foi, l’approfondissent et la prêchent, peuvent donner l’apparence de groupes uniformes à vague coloration religieuse.
Une vraie capacité de renouvellement
Autre précision : ce système législatif, en constant devenir, nous donne une vraie capacité de renouvellement. Et cela d’autant que l’autorégulation qu’il assure n’est pas le fait de quelques individus mais de concertations qui réclament l’intervention de tous ceux qui sont concernés. N’est-ce pas pour cette raison que nos premiers frères ont fait ce choix ? En grande partie grâce à celui-ci, l’Ordre n’a jamais connu de scissions – les réformes qui ont pu voir le jour ont été assumées par l’institution – et, aujourd’hui même, nous admirons l’actualité d’un type de gouvernement vieux de plus de sept cent cinquante ans. Le choix fait par saint Dominique n’a pas été l’effet du hasard. L’Ordre est né d’un affrontement entre l’Église et le monde, où il a trouvé et continue de trouver sa raison d’être et sa mission. D’où la nécessité d’une rénovation permanente qui puisse relever les défis d’un monde en incessante évolution. Cette mise au point continue n’est pas seulement une exigence de conversions individuelles, mais une condition de vie pour l’Ordre à qui cette loi de rénovation est connaturelle. On comprend que le chapitre général de 1977 insiste tellement sur la « formation permanente », condition indispensable de rénovation au fil des années.
Fidélité au charisme de l’Ordre
Dernière précision: comme tout vivant, la vie religieuse croît selon la loi inscrite dans son germe et non en fonction des seuls étais qui la soutiennent. Il n’est pas de progrès ni de renaissance de la vie dominicaine sans nouvelle prise de conscience de l’intuition de saint Dominique en son premier jaillissement. S’il est vrai que cette grâce nous touche au moment de l’appel mystérieux à suivre le Christ avec Dominique, il faut ajouter que l’affermissement et le déploiement de notre personnalité dominicaine supposent une démarche – toujours la même et toujours nouvelle – de fidélité joyeuse et inventive au charisme de l’Ordre. A ce niveau, le voeu d’obéissance est au service d’une Obéis sance plus foncière, celle qui porte sur l’Évangile. C’est dans ma vie dominicaine que je dois vivre l’Évangile. Comme le dit le Père J.M.R. Tillard dans une formule audacieuse : » Par mes Constitutions, j’obéis à l’Évangile « . Il est important de rappeler cette primauté quand certains sont tentés de prendre à des sources variées des éléments de spiritualité qu’ils s’efforceront d’ajouter vaille que vaille au monument architectural que sont nos Constitutions.
Une vie selon l Évangile pour annoncer l Évangile : c’est de la relation vivante entre cette annonce et notre vie de communauté qu’ont jailli les grands traits du gouverne ment de l’Ordre. Et si l’on me demandait: « Dans cet ensemble, comment voyez-vous la fonction du Maître de l’Ordre ? » Je répondrais « C’est une fonction de présence. » Ce mot, on le sait, vient du latin prae-esse qui exprime à la fois proximité, primauté et supériorité avec leurs divers harmoniques accueil, écoute, dialogue, compréhension, aide, encourage ment, action persuasive, affirmation d’autorité, etc. Il y a de tout cela dans le mot présence. II me semble qu’il est en profonde concordance avec l’analyse que nous avons pro posée : un type de gouvernement né de la communion et de la mission universelle de l’Ordre et tout orienté vers leur service.
L'apostolat du Rosaire (1976)
Conférence du Maître de l’Ordre. Mai 1976
fr. Vincent de Couesnongle, o.p.
Bien chers frères et soeurs en Saint-Dominique,
Je ne vous apprendrai mien en vous disant qu’un Colloque international des frères consacrés à l’apostolat du Rosaire s’est tenu à Rome au début de mai. C’e-st un devoir pour moi de souligner le succès de ce rassemblement de près de 90 frères (plus quelques soeurs), venus de tous les coins du monde: l’Europe, certes, mais aussi l’Équateur, les Philippines, le ZaIre… J’ai été frappé par la qualité de cette rencontre, la joie qui y régnait, la ferveur dans la célébration liturgique et dans la prière du Rosaire.
Partant des situations réelles, les frères y ont rendu compte de l’état de l’apostolat du Rosaire dans leur région, avec une objectivité qui ne manqua ni de courage ni parfois d’humour! On a pu y mesurer la diversité des contextes culturels, des situations pastorales, de la sensibilité des frères eux-mêmes : les uns plus soucieux de fidélité à la tradition, les autres plus portés à chercher de nouvelles expressions. Une telle diversité est normale, une telle confrontation est saine et utile, quand elle se fait, comme ce fut le cas, dans la confiance mutuelle.
I. Fondement doctrinal
On reproche, parfois à la dévotion mariale d’être plus fervente qu’éclairée. C’est pourquoi, conscients de prêcher l’Évangile quand ils prêchent le Rosaire, les frères ont voulu confronter leur manière de faire avec la foi de l’Église, spécialement en ce qui concerne la Mère de Jésus: « La vraie dévotion procède de la vraie foi ».
Les frères ont donc consacré toute une journée à étudier l’Exhortation « Marialis Cultus » (mars 1974 qui situe le Rosaire dans le contexte d’une piété mariale renouvelée, à la lumière de Vatican II – Marie y est vue dans le mystère du Christ et de l’Église (Lumen Gentium, VII).
On a souligné, non sans raison, qu’en quelques années, nous sommes passés d’un Rosaire surtout marial à un Rosaire plus nettement christologique, centré sur l’Incarnation et le mystère pascal, où Marie a toute sa place comme servante du Seigneur, modèle des croyants et Mère spirituelle des disciples.
Ne craignons pas d’accentuer cette orientation, qui met en valeur toute la richesse doctrinale du Rosaire. Celui-ci doit être, sous une forme simple mais authentique, une présentation organique de l’ensemble du mystère du Salut. Ne rejoint-il pas le schéma d e la prédication primitive? N’y découvrons-nous pas les chemins d’une prédication doctrinale réellement populaire? Le Rosaire peut servir de cadre â une vraie catéchèse et même, en certains cas, à une première évangélisation comme en témoignent certaines expériences.
D’autre part, on ne peut manquer d’être frappé par l’insistance de Marialis Cultus sur le mystérieux rapport entre l’Esprit-Saint et la Vierge de Nazareth et leur action dans l’Église. Les frères du Rosaire ont été attentifs à cet aspect du mystère chrétien et aux retentissements très actuels d’un renouveau dans l’Esprit. Loin d’apparaître démodé ou périmé, le Rosaire se trouve au contraire bien à l’aise dans ce contexte. Les frères qui le prêchent assidûment en sont de plus en plus convaincus. Les autres n’entretiennent-ils pas sans raison des a priori contre lui?
II. Enracinement biblique
Le renouveau de la piété mariale et de l’apostolat du Rosaire est étroitement lié au renouveau biblique. On a parfois essayé de les opposer. Mais faut-il rappeler, par exemple la piété mariale d’un Père Lagrange? Après Vatican II surtout, nous comprenons mieux la profonde théologie de Luc et de Jean touchant Marie, Mère de Jésus, Fille de Sion, Servante du Seigneur, Demeure de la Gloire de Dieu, la Femme « Mère de tous les vivants ».
Je suis heureux de constater que, dans toutes les parties du monde, le Rosaire est présenté de plus en plus comme une prière authentiquement évangélique, et même comme une initiative des fidèles à une méditation priante et croyante de l’Écriture. N’est-ce pas sa nature même? Il est clair que cela exige des prédicateurs du Rosaire non pas seulement une humble et fervente piété mariale mais aussi une sérieuse culture biblique sans cesse tenue à jour.
III. Dans le monde actuel
Comme toute prédication évangélique, l’apostolat du Rosaire doit s’adresser au monde d’aujourd’hui, un monde qui a beaucoup changé dans sa façon de vivre et de penser. Ainsi l’une des Commissions du Colloque a réfléchi sur « le Rosaire et la vie chrétienne dans le monde d’aujourd’hui », une autre sur « le Rosaire et les perspectives pastorales ».
Nous devons nous interroger loyalement. Le Rosaire, tel que nous le prêchons ne risque-t-il pas parfois de devenir un alibi, un refuge, une « démobilisation »? Ne risque-t-il pas de nous entraîner dans une spiritualité désincarnée, loin de ce qui fait la via réelle, les espoirs, les craintes, les luttes des hommes d’aujourd’hui? Sommes-nous vraiment à l’ écoute des aspirations des hommes à plus de responsabilité de partage fraternel, de liberté spirituelle? Savons-nous assez encourager les chrétiens à travailler à la pleine libération de leurs frères?
Tous ces problèmes et d’autres de ce genre ont été abordés. La lecture du dossier et des conclusions du Colloque montre avec quelle lucidité ils l’ont été.
IV. Une école de vie chrétienne
Enfin, le Rosaire est apte à constituer une la vie de foi, une école de foi, une école de vie chrétienne et de prière.
Dans un temps où l’on redécouvre peu à peu, sous l’amoncellement des constructions savantes, de la religion populaires, le Rosaire apparaît comme un outil précieux. D’une part, à travers la méditation des « mystères »de la vie de Jésus et de Marie, il plonge ses racines au coeur même du mystère de Dieu. D’autre par, grâce à la simplicité de sa méthode, il parle directement au coeur des gens simples et sans complications. Il constitue ainsi vraiment un lien de foi, un rattachement à la source.
Et c’est certes pourquoi des expériences émouvantes ont montré que des populations chrétiennes privées du secours des sacrements ordinaires, isolées de leurs cadres, sans évêques et sans prêtres, ont « tenu » dans leur foi, grâce au Rosaire.
Le caractère simple et direct du Rosaire le rend apte à fournir un cadre, à une catéchèse de la foi, pour de nombreux baptisés qui n’en ont guère reçu, pour des baptisés non-pratiquants. Et le remarquable développement des « Equipes » ou d’autres groupements modernisés du Rosaire, en certain pays, souligne bien la valeur catéchétique.
École de vie ouverte aux âmes les plus simples, le Rosaire, loin de les enfermer dans les rudiments, les entraîne progressivement sur les chemins de la méditation, de l’oraison, du coeur à cœur avec le Seigneur. Il apprend à prier au delà des mots. Il est une école de vie contemplative.
De plus si le Pape Paul VI rappelle, dans « Marialis Cultus », les éléments du Rosaire, tels qu’ils ont été définis par S. Pie V – ce qui demeure la référence indispensable – il encourage aussi une célébration du Rosaire s`inspirant du schéma des célébrations de la Parole de Dieu. L’ effort de recherche et de créativité en ce domaine sont à encourager. Des exemples ont été donnés et des expériences ont été faites, au cours de ces journées.
Une tradition fermement implantée, non seulement dans l’Ordre mais dans toute l’Église, fait de nous les héritiers de la mission confiée par Marie à notre Père Dominique: « Va et prêche mon Rosaire ».
C’est un héritage dont nous avons lieu d’être fiers et dont nous devons être aussi les premiers bénéficiaires dans notre vie, dans notre prière. Combien de dominicains pourraient témoigner de ce que la récitation et la contemplation du Rosaire ont été pour eux, aux premières années de leur vie religieuse, une véritable « école de prière », – l’unique peut-être même? En est-il ainsi aujourd’hui dans l’Ordre? Ne faudrait-il pas que nos jeunes, et ceux qui sont chargés de leur formation, »osent » de nouveau reprendre ce chemin?
Le Rosaire est aussi un héritage dont nous avons à nous montrer dignes. Notre mission de prêcheurs s’exerce selon les formes les plus diverses. De l’enseignement dans les plus brillantes chaires universitaires, de la recherche exégétique, théologique ou philosophique la plus savante, – jusqu’aux missions populaires et aux catéchèses les plus rudimentaires, – en passant par la dispensation quotidienne du pain de la Parole et la méditation soutenue des mystères joyeux, douloureux et glorieux: c’est la même Parole de Dieu que nous proclamons, c’est la même mission prophétique que nous exerçons.
Notre Père Dominique ne pouvait pas voir trois personnes ensemble sans penser aussitôt que c’était là un auditoire suffisant pour sa parole apostolique. Prêcher le Rosaire, expliquer le Rosaire, faire prier le Rosaire, n’est-ce pas un peu la même chose?
La dimension contemplative de notre vie dominicaine (1982)
Conseil interprovincial des États-Unis le 30 juin 1982 à Providence Collège.
fr. Vincent de Couesnongle, o.p.
 Dans son Histoire de France, si caractéristique du XIXe siècle, Jules Michelet a brossé une fresque où il montre comment l’Église en Languedoc au XIIIe siècle a arrêté « l’élan de la liberté de penser » que représentait l’hérésie. Les phrases tombent, nerveuses, haletantes, romantiques… et inexactes. » Ce Dominique » ,écrit-il, » ce terrible fondateur de l’Inquisition, était un noble castillan. Personne n’eut plus que lui le don des larmes qui s’allie si souvent au fanatisme » 1. Et il poursuit au chapitre suivant: » Le Pape n’a vaincu le mysticisme indépendant qu’en ouvrant lui-même de grandes écoles de mysticisme, je parle des Ordres mendiants. C’est combattre le mal par le mal même; c’est entreprendre la chose difficile et contradictoire entre toutes, vouloir régler l’inspiration, déterminer l’illumination, constituer le délire! «
Dans son Histoire de France, si caractéristique du XIXe siècle, Jules Michelet a brossé une fresque où il montre comment l’Église en Languedoc au XIIIe siècle a arrêté « l’élan de la liberté de penser » que représentait l’hérésie. Les phrases tombent, nerveuses, haletantes, romantiques… et inexactes. » Ce Dominique » ,écrit-il, » ce terrible fondateur de l’Inquisition, était un noble castillan. Personne n’eut plus que lui le don des larmes qui s’allie si souvent au fanatisme » 1. Et il poursuit au chapitre suivant: » Le Pape n’a vaincu le mysticisme indépendant qu’en ouvrant lui-même de grandes écoles de mysticisme, je parle des Ordres mendiants. C’est combattre le mal par le mal même; c’est entreprendre la chose difficile et contradictoire entre toutes, vouloir régler l’inspiration, déterminer l’illumination, constituer le délire! «
On connaît également le tableau de Pedro Berruguete (+ 1504), la Scène d’Autodafé, qui se trouve au Musée du Prado à Madrid. Saint Dominique, reconnaissable à son manteau étoilé, siège sur une haute cathèdre, présidant un tribunal, entouré de six assesseurs, presque tous des laïcs. En bas à droite, des hérétiques, mi-nus, sont attachés au bûcher qu’on apprête. Le contraste est saisissant et la composition remarquable. Le tableau est sans nul doute fait à la gloire de saint Dominique: le peintre n’avait-il pas exécuté pour le couvent dominicain d’Avila divers retables à la demande de Thomas de Torquemada (+ 1493), Inquisiteur général pour l’Espagne en 1483 ?
Si nous remontons encore plus le cours du temps, nous trouverons des témoignages dominicains pour montrer comment Dominique participa le premier à l’Inquisition contre Cathares et Vaudois en Languedoc. Une mention de Bernard Gui (1261-1331) dans une Vie de S. Dominique n’hésite pas à revendiquer pour son fondateur le titre de premier Inquisiteur reprenant d’ailleurs des textes » légendaires » du XIIIe siècle 2. L’auteur du célèbre » Manuel des Inquisiteurs » n’a pas hésité d’ailleurs à interpoler de sa propre autorité l’Histoire albigeoise de Pierre des Vaux de Cernai pour mentionner la présence de Dominique à la bataille de Muret au cours de la sanglante croisade albigeoise, le 12 septembre 1213 : le saint aurait tenu en ses mains un crucifix criblé de flèches qu’on montre encore à Saint-Sernin de Toulouse… 3.
A l’inverse, au moment où il plaide devant son » Pays » pour le rétablissement en France de l’Ordre des Frères Prêcheurs, en 1838, c’est-à-dire quelques années après les phrases enflammées de Michelet sur la fondation des Ordres mendiants, Lacordaire affirme hautement, (ch. 6) que » saint Dominique n’a point été l’inventeur de l’Inquisition et n’a jamais fait aucun acte d’inquisiteur. Les dominicains n’ont point été les promoteurs et les principaux instruments de l’Inquisition « . La démonstration historique qui suit ces théorèmes est malheureusement sujette à caution. Elle lui fut – et pas seulement pour des raisons d’exactitude historique – reprochée avec véhémence, en particulier par son ami Dom Prosper Guéranger, le restaurateur des bénédictins à Solesmes, l’accusant de ne pas oser » assumer son héritage » . Qui donc faut-il croire – Dominique fut-il le premier des inquisiteurs ? La réponse est catégorique: aucunement! La simple chronologie suffit à régler le problème: Dominique est mort en 1221 et l’office d’inquisiteur n’a été institué qu’en 1231 en Lombardie et en 1234 en Languedoc.
Les Frères Prêcheurs furent-ils les principaux instruments de l’Inquisition ? Ou y eurent-ils seulement part « comme tout le monde » pour parler comme Lacordaire ? La réponse doit être plus nuancée. Mais il convient sans doute de savoir de quoi on parle quand on prononce ce mot d’Inquisition jugé unanimement si funeste, avant de tenter d’en comprendre la signification.
Il faut d’abord dire qu’il y a deux Inquisitions, ou mieux, deux vagues d’Inquisitions, assez différentes d’origine et de destin. La première, au XIIIe siècle, est l’aboutissement d’un long processus, mis en oeuvre par les Papes: on l’appelle souvent » Inquisition pontificale » . La seconde répond à une initiative des Rois catholiques espagnols qui, en 1478, demandent au Pape de réorganiser l’ancienne institution. Cet instrument de l’absolutisme royal, dirigé contre les minorités religieuses juives et musulmanes mal assimilées, et contre les courants de pensée qui semblent menacer l’ordre social, ne sera supprimée qu’au XIXe siècle. C’est elle qui fait l’objet d’une » légende noire » assez tenace pour qu’encore aujourd’hui le terme d’Inquisition, dans la mentalité générale, évoque immédiatement de façon quasi-affective les idées de fanatisme et d’intolérance. Les rois d’Espagne firent souvent appel à des dominicains comme Thomas de Torquemada, mais, le plus souvent, dès la fin du XVIe siècle, à des jésuites 4.
D’ailleurs quand on parle » d’Inquisition » aujourd’hui on confond souvent deux réalités qu’il y a tout avantage à distinguer: une procédure et un tribunal. L’Inquisition est d’abord une procédure juridique. C’est la procédure d’enquête que, dans les nations modernes, l’autorité publique ouvre d’office dès qu’un crime parvient à sa connaissance, tandis qu’elle attend qu’on ait déposé une plainte, ou accusation, pour poursuivre un préjudice civil. L’introduction de cette procédure très objective et très minutieuse, ce qui est une garantie pour l’accusé, a été un grand progrès par rapport à l’antique procédure accusatoire dont l’usage était jadis général. Tel était le cas au début du XIIIe siècle pour les hérétiques; on ne les poursuivait que s’ils étaient accusés par quelqu’un. Vers 1230 la procédure d’enquête achève de s’installer en Europe dans les affaires de foi. Le problème n’est pas la procédure d’enquête installée de la sorte, mais le fait que les autorités royales et ecclésiastiques considèrent la manifestation du dissentiment dans la foi comme un crime à poursuivre d’office.
L’Inquisition est aussi un tribunal, un tribunal d’exception qu’on destine à connaître du crime d’hérésie, en appliquant entre autres la procédure d’enquête. C’est l’origine de l’office d’inquisition confié à divers personnages. Sans faire disparaître le tribunal de l’évêque qui s’occupait jusqu’ici des causes de foi, ce nouveau tribunal se substitue largement à lui.
Jusqu’à cette époque, l’hérésie relevait, au spirituel, du tribunal de l’évêque, chargé de juger la croyance des baptisés de son diocèse. Le prince, qui usait de la contrainte séculière pour faire comparaître le suspect accusé et punir, en fonction de sa propre loi pénale, l’hérétique condamné, réservait donc à l’évêque le jugement sur la réalité de l’accusation d’hérésie.
Au début du XIIIe siècle, les multiples actions du pape Innocent III contre les hérétiques, par l’envoi de légats en divers secteurs de la chrétienté, ne visent qu’à exciter ou doubler l’action des évêques. Elles s’accompagnent de vastes campagnes de prédication, destinées à conforter la croyance des catholiques et à ramener les hérétiques à la foi. C’est à l’une de ces campagnes de la parole, celle du midi de la France, que saint Dominique s’est adjoint (1206-1209).
L’inefficacité fréquente du tribunal des évêques amène l’empereur d’Allemagne Frédéric II et le pape Grégoire IX à s’orienter vers la création d’un tribunal d’exception. Le juge en serait un clerc, mais le prince en assurerait la base et l’efficacité temporelles: les locaux, l’entretien, l’exécution tant des arrestations et comparutions que des pénalités encourues selon son propre droit pénal. En 1231, une décision commune du Pape et de l’Empereur crée l’office d’Inquisition pour l’appliquer dès lors à l’Allemagne et à l’Italie. Ce tribunal est introduit en France du nord en 1233, et dans celle du midi au début de 1234. II n’a donc pas été spécialement imaginé, comme on le croit souvent, pour cette dernière région. Il n’a rien à voir avec S. Dominique.
On peut le définir comme un tribunal d’exception, permanent, qui intervient dans toutes les affaires intéressant la défense de la foi et qui utilise la procédure inquisitoire beaucoup plus souple et efficace 5. Elle n’est pas une » police de la foi » . Il s’agit de convaincre l’hérétique de la contradiction dans laquelle il s’est mis au regard de la foi chrétienne et de le convertir: l’inquisiteur devra donc être un bon prédicateur. Pour les fautes les moins graves, le tribunal distribue des peines d’ordre religieux: port d’une croix, visites aux églises, pèlerinages – ou plus importantes. Si l’hérétique est opiniâtre, l’Église l’abandonne au bras séculier, qui pourra appliquer à partir du XIIIe siècle la peine de mort, pourtant interdite au III’ concile de Latran. A partir de 1252 l’Inquisition dispose du droit de soumettre à la torture les prévenus d’hérésie, comme il était courant à l’époque en droit commun 6. On comprend la gravité de la fonction d’Inquisition.
Le choix de la personne qui sera juge de la foi est d’autant plus important aux yeux du pape Grégoire IX qu’il redoute le danger d’un juge trop dépendant du prince, au service duquel il risquerait de mettre son office. C’est souvent le cas des évêques, spécialement en Allemagne. Le Pape s’oriente donc vers des religieux, voire des prêtres séculiers. Le premier inquisiteur connu, Conrad de Marbourg, est un Prémontré. Bientôt cependant, le Pape se tourne vers les dominicains en particulier pour la France (1233) et pour le Languedoc (1234). Mais deux ans plus tard, il leur adjoint un franciscain. Dans la suite, les inquisiteurs de Languedoc seront régulièrement des dominicains, ceux de Provence des franciscains. Ces religieux pouvaient se consacrer à instruire les causes de foi de façon continue, plus juste et plus approfondie, à la différence des moines et des clercs séculiers sollicités par d’autres tâches. Mais l’Inquisition ne fut jamais un office de l’Ordre des Prêcheurs en tant que tel.
Ce ne sont pas les inquisiteurs qu’il faut rendre responsables de la création de l’Inquisition. Si certains ont été déséquilibrés par le pouvoir redoutable qui leur était échu, comme le trop célèbre Robert le Bougre, nommé en 1235, qui se déshonora par ses excès dans le nord de la France, la plupart ont rempli avec compétence, indépendance d’esprit et souci principal du salut des âmes la tâche de juge qu’on leur confiait, à la nécessité salutaire de laquelle ils croyaient, comme la grande majorité des chrétiens d’Occident.
Le problème de l’Inquisition s’inscrit dans deux problèmes bien plus anciens: celui de la poursuite de l’hérésie dans la société chrétienne et, plus généralement, celui de la sensibilité de cette société au dissentiment dans la foi. Cette dernière donnée remonte aux origines de l’Église, où les chrétiens s’attachent intensément au » sentiment de l’unanimité » (Philippiens 2, 2) : » Un seul Seigneur, une seule foi, un seul, baptême, un seul Dieu et Père » , dit saint Paul (Ephésiens 4, 5). Certes, la foi est un don total de la personne à Dieu; mais elle comporte, pour être authentique, une croyance, un contenu objectif commun.
C’est la société occidentale, ecclésiastique et politique, qui porte la responsabilité d’avoir créé et perfectionné l’Inquisition, par une longue suite de décisions de toutes sortes. Finalement, c’est le système même de la chrétienté d’Occident qui, soudant étroitement l’Église et la société temporelle, a cru juste et saint de faire de la foi et de la morale chrétiennes la base de la législation comme de l’ordre civils et a mis en retour à son service les forces de coercition temporelle, dont l’Inquisition fut l’un des instruments.
Ce sens de la responsabilité des princes en Europe vis-à-vis de la règle de foi, pour le salut de leurs sujets, et cette volonté d’intervenir pour sa défense avec l’aide de leurs évêques, demeurent très vifs en Occident jusqu’au XVIe et même jusqu’au XVIIe siècle. Se rebeller contre la foi, c’est se rebeller contre le prince. Dans l’inquiétude du salut qui régnait à l’époque, les populations étaient souvent les premières à exiger la poursuite des propagateurs de doctrine ou de remèdes de salut qui, au jugement de l’Église, risquaient de faire se perdre éternellement des chrétiens. L’homme du Moyen Age peut comprendre une tolérance pour les païens qui n’ont pas eu les moyens de connaître la Révélation, à la rigueur pour les juifs: telle sera l’attitude de la Papauté. Il lui est impossible de ne pas regarder la déviation de la foi catholique ou le reniement du baptême comme des péchés graves 7. Le dissentiment dans la foi apparaît ainsi comme la faute la plus grave, de toutes la plus pernicieuse: c’est pourquoi la procédure inquisitoire veut d’abord guérir, comme le fait un médecin. Ne doit-on pas sauver non seulement la société qu’elle menace mais aussi la personne hérétique elle-même? C’est en fait le fameux dilemme posé par Dostoïevsky avec le saisissant tableau du Grand Inquisiteur qu’il trace pour exprimer la révolte d’Ivan Karamazov.
Durant tout le Moyen Age cette collusion du temporel et du spirituel qui culmine dans l’Inquisition est considérée comme normale. Dans aucune des querelles qui opposent successivement à la Papauté des rois,, des empereurs, des clercs révoltés, des théologiens comme Marsile de Padoue, par exemple, si virulent et si violent, on ne trouve de reproche concernant l’Inquisition qui semble être acceptée et même souhaitée par l’opinion générale. Il faudra attendre l’éveil à l’idée de » tolérance » pour qu’on récuse, sinon le fait de l’institution, du moins ses méthodes. Erasme semble avoir été, en ce domaine comme en d’autres, un précurseur 8.
Le Moyen Age était beaucoup plus sensible aux valeurs et aux vérités objectives et sociales qu’à la sincérité des convictions personnelles. L’approfondissement du sens de la personne et de la liberté, pourtant bien souligné par S. Paul quand il considère la vie du chrétien sous la grâce (Galates 5, 19), est une conquête au fond récente. Elle ne permet pas à notre temps de juger les siècles qui pensaient autrement, d’autant que sa pratique n’est, malgré les déclarations d’intention, guère respectueuse des droits de l’homme.
Le zèle de Dominique
Faut-il donc tant s’offusquer quand, après avoir renoncé à cause du démenti de l’histoire, à faire de frère Dominique le premier inquisiteur, on se résout à constater » son zèle précocement inquisitorial » ? 9 Pour un connaisseur du climat psychologique et religieux du XIIIe siècle, l’affirmation n’aurait rien d’étonnant et les successeurs de Dominique auraient sans doute acquiescé à la formule. On insiste à cet égard avec raison sur l’amitié de Dominique et de Simon de Montfort, attestée en particulier par le Libellus (37, 46). Sans doute pour lui comme pour Diègue d’Osma les rigueurs séculières étaient le signe de la colère et de la justice de Dieu contre les sacrilèges (Libellus 33). Notons ici que jamais Jourdain de Saxe ne mentionne l’Inquisition, créée peu de temps avant sa mort. Le zèle que Dominique déploie pendant la Croisade albigeoise, en particulier quand » il demeure dans son rôle de prédicateur diligent de la Parole de Dieu » (Libellus 34) semble en effet d’un autre ordre que celui de la recherche acharnée des hérétiques à la manière des » Manuels d’Inquisiteurs » du XIVe ou du XVe siècle.
Certes il manifeste un grand zèle. Le latin des dépositions du procès de canonisation l’appelle zelator. Mais il est » zélé pour les âmes » (Toulouse 18), » zélé pour le salut du genre humain » (Bologne 12). Il y a plus, qui est le signe de la vraie charité: pour ceux que Dominique ramenait à la foi catholique, il maintenait sa sollicitude jusqu’au retour d’un certain équilibre de vie. Tel est le cas de Sainte-Marie-de-Prouille, dont nous raconterons plus en détail la fondation au chapitre suivant.
Diègue d’Osma avait recueilli en 1207 des jeunes filles qui avaient été confiées par leurs parents à des Parfaites cathares. Avec l’accord de l’évêque Foulques, il fonde pour elles un monastère près de l’église Sainte-Marie-de-Prouille et en confie à Dominique la direction spirituelle. Dominique fait comprendre à l’évêque que » ce serait un acte de piété et de miséricorde » que d’accorder des revenus aux nouvelles converties 10. C’est bien là le dernier mot du » zèle » de Dominique: la miséricorde qui va bien au-delà de la simple réconciliation avec l’Église.
Sa compassion qui » s’étendait jusqu’aux damnés de l’enfer » (Bologne 11) n’aurait-elle pas inclus les hérétiques qu’il côtoyait, auxquels il parlait, avec qui il argumentait ? » Dur à ses ennemis » dit Dante ? » Aucun texte, aucune déposition ne signale d’autres moyens d’action que la parole, les prédications, les controverses, les exhortations et avis, enfin l’exemple, spécialement efficace alors, de la sainteté de sa vie » 11.
Il faut donc renverser la perspective et dire que l’étonnant est précisément que le zèle de Dominique ait été 1a traduction de sa compassion. Dans le contexte de son temps, une tell attitude est en effet, historiquement parlant, une énigme. Mais c’est là où la sainteté transcende, à travers, mais aussi parfois au-delà, les conditionnements et les tempéraments, pour rejoindre avec une sûreté instinctive l’intuition évangélique.
Le zèle de Dominique ressemble à celui dont Paul témoigne dans ses adieux aux Anciens d’Ephèse (Actes 20, 31). La » grâce de la prédication » amène à rendre témoignage à » l’Évangile de la grâce de Dieu » (Ac 20,24). Bien plus, elle fonde l’édifice confié à la » Parole de la grâce de Dieu » (Ac 20, 32). Pour servir cette construction dans le Christ, prêchant pour une Église pleinement catholique, c’est-à-dire, enseignant contre toute falsification mythique, la doctrine de la grâce, Dominique n’a voulu qu’annoncer la vérité. Il n’a pas cherché pour ses frères d’autre mission que celle de » serviteurs de la Parole « . (Source : Bedouelle, Guy. Dominique ou la grâce de la parole. Fayard-Mame, 1982.) ![]()
1. Tome II, I. IV, ch. 7, Oeuvres complètes, t. IV, éd. critique P. Viallaneix, Paris, 1974. Dans la première édition, Michelet avait écrit: » C’était un noble castillan, singulièrement charitable et pur. Personne n’eut plus que lui le don des larmes et l’éloquence qui les fait couler ». Ces derniers mots ont été supprimés en 1852 et remplacés par la phrase vengeresse en 1861. » Examen des remaniements du texte de 1833 » , op. cit., p. 657.
2. Pour un état de la question, Vicaire, Dominique, pp. 36-57 ( » Dominique et les Inquisiteurs « ) à compléter par les pp. 143-149.
3. Fanjeaux, 16, pp. 243-250 (M. Prin et M. H. Vicaire).
4. Guy et Jean Testas, L’Inquisition, Paris, 1974.
5. Cf. Fanjeaux 6, » Le Credo, la morale et l’Inquisition » (1971) en particulier les contributions d’Yves Dossat. Du même auteur, Les crises de l’Inquisition toulousaine (1233-1273), Bordeaux, 1959. Voir aussi Henri Maisonneuve, Etudes sur les origines de l’Inquisition, Paris, 1960 : sur Dominique et les premiers frères: pp. 248-249.
6. Francesco Compagnoni, La peine de mort dans la tradition de l’Eglise catholique romaine, » Concilium « , n° 140, 1978, pp. 53-67.
7. Pour un exposé de l’attitude médiévale, voir dans la Somme de théologie de S. Thomas, II IIa, la question 10. C’est là qu’on trouve la célèbre formule » recevoir la foi appartient à la volonté, mais il est nécessaire de la garder quand on l’a acceptée » (question 10, art. 8, ad 3).
8. Joseph Lecler, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, I, Paris, 1955, p. 140.
9. Christine Thouzellier, Catharisme et Valdéisme en Languedoc à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, Louvain-Paris, 19692, p. 251.
10. Vicaire, Histoire, I, p. 255, avec la note 117.
11. Vicaire, Dominique, p. 148